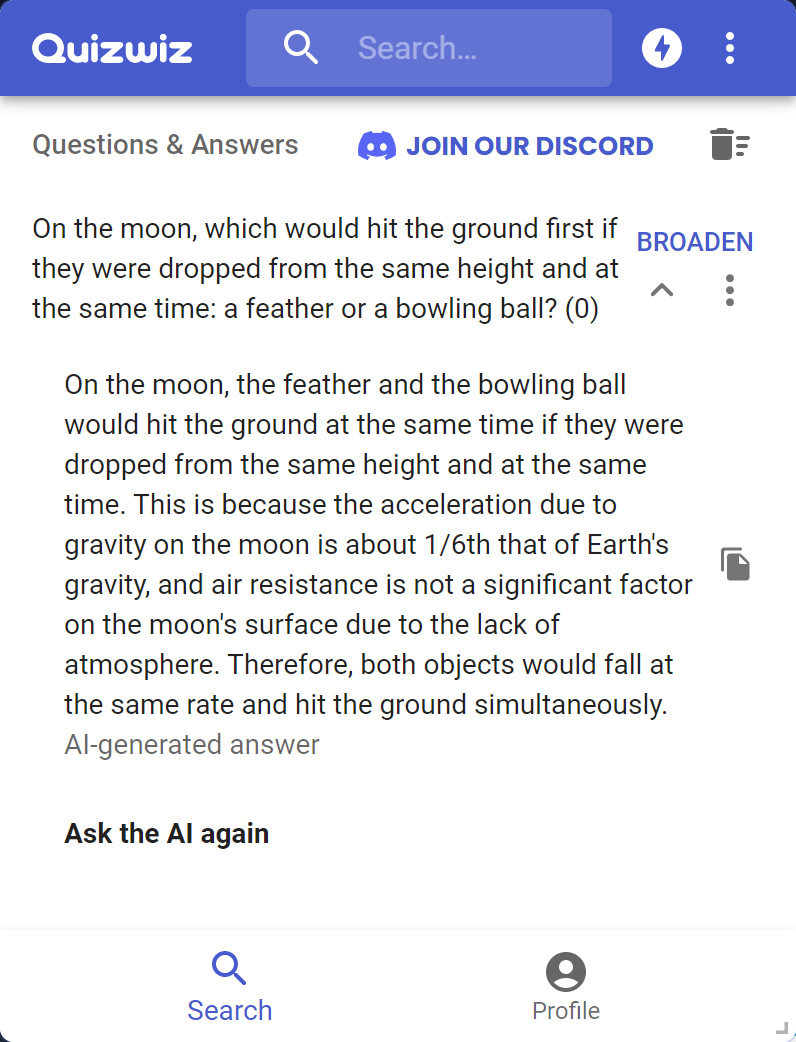THÉÂTRE ANGLAIS
O'TOOLE PETER
Acteur de théâtre et de cinéma, Peter Seamus O'Toole est né le 2 août 1932 à Connemara (Comté de Galway, Irlande). Il grandit à Leeds en Angleterre et suit les cours de la Royal Academy of Dramatic Arts à Londres. Adolescent, il est journaliste au quotidien Evening Post de Yorkshire et débute dans le théâtre amateur au Civic Theatre de Leeds. Après deux années de service militaire dans la Royal Navy, il se produit avec la compagnie Old Vic de Bristol de 1955 à 1958, et fait ses débuts à Londres en interprétant Peter Shirley dans la pièce Major Barbara (1956) de George Bernard Shaw. En 1960, il est encensé par la critique pour son rôle de Shylock dans Le Marchand de Venise et pour celui de Petruchio dans La Mégère apprivoisée, deux pièces montées par la compagnie du Shakespeare Memorial Theatre à Stratford-upon-Avon en Angleterre. En 1963, il est Hamlet dans la toute première mise en scène de la troupe du National Theatre à Londres. À cette époque, il est déjà une star de cinéma de premier plan, mais il n'en continue pas moins à se produire sur les planches dans le monde entier, où il est salué tant par la critique que par le public. Il est nommé directeur adjoint du Old Vic en 1980. La même année, il y interprète le rôle titre de Macbeth. Peter O'Toole débute à l'écran en 1960 dans Kidnapped. Deux ans plus tard, il accède au rang de star internationale en interprétant le rôle de T. E. Lawrence dans le film à grand spectacle Lawrence of Arabia (Lawrence d'Arabie, 1962) de David Lean. En 1964, au côté de John Gielgud et Richard Burton, il joue Henry II dans Becket de Peter Glenville, d'après Jean Anouilh, et, l'année suivante, interprète le rôle principal de Lord Jim, de Richard Brooks, d'après Joseph Conrad. Il reprend le rôle d'Henry II pour The Lion in Winter (Le Lion en hiver, 1968), œuvre remarquable pour ses joutes verbales
GARRICK DAVID
Comédien que la postérité a retenu comme le plus grand du théâtre anglais de son époque, Garrick a dirigé le théâtre de Drury Lane de 1747 à 1776. Chef d'école, il enthousiasme son public par la vérité, le naturel de son jeu. Avec son puissant tempérament d'acteur, il impose Shakespeare, mais avec des accommodements très personnels : il ampute Hamlet de la scène du fossoyeur, il dote Roméo et Juliette d'une scène finale inédite, et Le Roi Lear d'un dénouement heureux. Mais la popularité de Shakespeare n'en est que plus éclatante. Auteur lui-même d'un certain nombre de farces et de comédies sérieuses, jouant tour à tour la tragédie et la comédie, Garrick est avant tout un animateur exceptionnel. Ne reculant pas devant le grand spectacle, il a permis le maintien d'une généreuse tradition théâtrale dans une période d'affadissement.
LILLO GEORGE
Dramaturge londonien, George Lillo est aussi un pionnier. Après avoir fait jouer en 1730 un opéra comique, Silvia, or the Country Burial, il fait représenter l'année suivante, par le Drury Lane Theater de Londres, sa pièce Le Marchand de Londres (The London Merchant, or the History of George Barnwel). Inspirée du mélodrame élisabéthain, cette pièce peut être considérée comme la première tragédie bourgeoise en prose. L'aventure de ce jeune homme qui, séduit par une courtisane, vole et va jusqu'à tuer son bienfaiteur, n'est pas nouvelle, mais les traditionnels héros nobles sont ici remplacés par des bourgeois : le personnage principal est un apprenti. De plus, le fait que le nœud du drame soit le remords et le repentir du coupable témoigne d'une confiance sentimentale dans l'efficacité morale et civilisatrice des bons sentiments. Le Marchand de Londres a influencé le développement du théâtre bourgeois tant en Grande-Bretagne qu'en Allemagne (Lessing) et en France (Diderot). On peut encore citer de Lillo : The Christian Hero (1735), Fatal Curiosity(1736), Marina (1738), et l'adaptation inachevée d'une tragédie élisabéthaine anonyme, Arden of Feversham.
CORIOLAN (mise en scène C. Schiaretti)
Il y un côté « hussard noir » du théâtre chez Christian Schiaretti. Successeur depuis 2002 de Roger Planchon à la tête du T.N.P. à Villeurbanne, après avoir été dix ans directeur du Centre dramatique national de Reims, il ne cesse d'y défendre un théâtre ancré dans le politique et dans l'Histoire, frappé du double sceau de la décentralisation et de l'éducation populaire. Un théâtre citoyen et de service public qui, pour relever de l'émotion directe, n'en prétend pas moins éclairer le spectateur du présent à la lumière des poètes du passé. C'est dans cette droite ligne que s'inscrit la mise en scène du Coriolan de William Shakespeare, qu'il a créée à Villeurbanne à la fin de l'année 2006. Quel en est le sujet ? La « chose publique ». Datée de 1607 - soit quatre ans après la mort d'Élisabeth Ire, trente-deux ans avant la dictature de Cromwell -, cette tragédie est la dernière de Shakespeare. La plus ouvertement politique, la plus complexe aussi - ce qui explique, sans doute, qu'elle soit rarement jouée, notamment en France. L'histoire, inspirée d'un chapitre des Vies des hommes illustresde Plutarque, retrace les débuts balbutiants de la République romaine, au Ve siècle av. J.-C. Les rois étrusques en ont été chassés vingt ans auparavant. À l'intérieur, le spectre de la famine pousse à la guerre civile entre patriciens et plébéiens. À l'extérieur, les Volsques menacent. Caïus Marcus, général des troupes romaines, les défait à Corioles - d'où son surnom de « Coriolan ». Célébré en héros, ce guerrier fier et incorruptible est poussé par le Sénat et par sa mère, Volumnia, à briguer le consulat. Réticent d'abord, il accepte. Mais s'il revêt la « toge d'humilité » et se prête à la comédiede la séduction pour recueillir les suffrages, son discours méprisant et son attitude hautaine effraient les tribuns et la plèbe qui réclament son bannissement.
OLIVIER LAURENCE
Interprète de théâtre comme de cinéma, metteur en scène et réalisateur de films, Laurence Olivier est considéré comme le plus illustre des acteurs d'expression anglaise de son temps. Il est le premier membre de cette corporation à être élevé à la dignité de pair à vie. Artiste professionnel dès 1926, il rejoint en 1937 la compagnie de l'Old Vic Theatre de Londres où il assure avec brio divers rôles shakespeariens, notamment celui d'Hamlet (avec, dans le rôle d'Ophélie, Vivien Leigh qui devait devenir sa femme) dans le cadre du château d'Elseneur, après une série de films qu'il interprète à Hollywood : Les Hauts de Hurlevent (1939), Rebecca (1940) et Orgueil et préjugé (1940). C'est encore Shakespeare qu'il sert pour le septième art en transposant à l'écran Henri V (1944), Hamlet (1948), Richard III (1956) et Othello (1965), dans lesquels il incarne lui-même le héros. Sa carrière de cinéaste se poursuit de pair avec celle d'homme de théâtre. Codirecteur de l'Old Vic avec sir Ralph Richardson, il contribue avec lui à la renaissance de cette illustre formation de 1944 à 1950. À partir de 1950, il dirige et joue dans ses propres mises en scène. Directeur de la National Company en 1962, il met en scène tout un éventail de pièces allant des farces de Feydeau aux tragédies de Strindberg. En 1970, il mène cette compagnie aux États-Unis, comme il l'avait fait en 1946 pour l'Old Vic, et ce fut chaque fois une tournée triomphale. Le cinéaste a une réputation surfaite : son Hamlet trahit le texte par d'inexcusables suppressions, son Henri V n'est qu'une enluminure, et partout « sir Laurence » étale son vedettariat. Ce défaut se change en qualité, l'âge venant : Laurence Olivier campe une série d'agréables ou d'odieux coquins dans les films d'autrui, et là, son cabotinage fait merveille. Il n'aura eu que le tort d'avoir appliqué son intelligence et son talent à une lecture « passéiste » qui ne donne qu'une image étriquée du génie de Shakespeare.
THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Jusqu'aux alentours de 1956, et depuis fort longtemps, le répertoire moderne de « qualité » dans le théâtre anglais se bornait, peu ou prou, à trois auteurs : Oscar Wilde, George Bernard Shaw et Noel Coward, dont on jouait les œuvres, en province comme à Londres, jusqu'à satiété. Ce répertoire visait un public bourgeois, et, sauf de très rares exceptions, prenait pour cadre la « bonne société ». Le brillant des reparties et la subtilité de la dialectique - tous produits de la meilleure éducation - étaient les qualités maîtresses de ces œuvres, à quoi s'ajoutait l'habileté de l'agencement : l'idéal était la « pièce bien faite » (well-made play). À partir de 1956 apparaît une jeune génération d'auteurs, souvent d'origine populaire, qui révolutionnent le ton, le langage, le cadre social et la « psychologie » des personnages. Avec eux, « la classe ouvrière en tant que telle entre pour la première fois dans le théâtre en Angleterre » (J. R. Taylor), sur scène sinon dans la salle. C'est sans doute là le principal apport de ceux que l'on nommait les « jeunes hommes en colère » (angry young men). Par la suite, la recherche d'une audience élargie - populaire - provoque la diversification des lieux et des formes à laquelle on assiste surtout dans les années 1970. L'abolition, en 1969, de la censure officielle, qui mutilait auparavant nombre de pièces d'avant-garde, marque un nouveau tournant : sujets interdits (surtout l'homosexualité) et mots tabous (les célèbres « mots de quatre lettres ») envahissent la scène et, avec eux, l'argot et les jargons spécialisés - dont la violence ou l'hermétisme auraient été inimaginables au théâtre quelques années plus tôt.
EDWARD GORDON CRAIG
L'Anglais Edward Gordon Craig fut acteur, metteur en scène et décorateur de théâtre, graveur et illustrateur, essayiste et éditeur de revues. Son œuvre écrite et dessinée n'a cessé de constituer l'une des sources principales de la réforme artistique du théâtre qu'il s'agisse de décors et de costumes, de mise en scène, d'architecture, des rapports du metteur en scène avec l'auteur dramatique et les interprètes, ou de l'enseignement du théâtre. Praticien et théoricien Fils de la célèbre actrice anglaise Ellen Terry (1848-1928) et d'Edward William Godwin (1833-1886), architecte épris de théâtre, Craig, né à Stavenage (Hertfordshire), commence sa carrière d'acteur à l'âge de treize ans, au cours d'une tournée effectuée aux États-Unis avec sa mère et Henry Irving, qu'il considérera toute sa vie comme son maître. Engagé par Irving au Lyceum Theatre à dix-sept ans, il interprète des rôles souvent importants du répertoire shakespearien. Il jouera le même répertoire, pour d'autres compagnies, et s'illustrera dans le rôle de Hamlet. Sa carrière de metteur en scène et de décorateur commence en 1893 avec On ne badine pas avec l'amour, et se poursuit avec Hamlet puis Roméo et Juliette (1896). En 1897, il s'installe, avec une compagnie qu'il a constituée, au Royal Theatre de Croydon. S'associant avec le compositeur Martin Shaw, il monte Didon et Enée (1900), The Masque of Love (1901), et Acis et Galatée (1902), pour lesquels il compose décors, mises en scène et costumes. Il met en scène Bethleem, miracle de Laurence Housman (1902), puis Les Vikings d'Ibsen et Beaucoup de bruit pour rien. À Florence, il décore et met en scène Rosmersholm d'Ibsen qu'interprète Eleonora Duse (1906). Divers projets de décors interfèrent avec des expositions de ces maquettes, dessins et gravures organisées en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Hollande, en Italie et en Suisse, et avec l'édition de publications et d'écrits théoriques : The Art of the Theatre (1905) ; On the Art of the Theatre (1911) ; A Living Theatre (1913) ; Books and Theatres (1925), ou des reproductions de maquettes de décors : A Portfolio of Etchings (1908) ; A Second Portfolio of Etchings (1910) ; Toward a New Theatre (1913) ; A Production (1926) ; des maquettes et esquisses pour Les Prétendants à la Couronne d'Ibsen (1930). Enfin il publie des revues : The Page (1898-1901) ; The Mask (1908-1915, 1918, 1923-1929) ; The Marionette (1918).
COWARD NOEL
Né en 1899 dans la banlieue londonienne, Noel Coward est précocement attiré par le théâtre. Après de difficiles débuts, il sait s'imposer à l'attention du public anglais de l'entre-deux-guerres, et son succès lui assure dès lors une audience internationale. Comédien, romancier, auteur dramatique, il va être l'une des figures les plus populaires du théâtre anglais. Bon nombre de ses pièces, dont la plus célèbre, Brève Rencontre (1945, D. Lean), furent portées à l'écran. Joué aux quatre coins du monde, promu à la dignité de chevalier par la reine Élisabeth en 1970, il s'éteint à la Jamaïque le 26 mars 1973, victime d'une crise cardiaque. Spirituel humoriste, d'une audace frisant parfois l'impertinence, Noel Coward a gardé de son enfance le goût de la farce et de la mystification. Il peut être considéré comme le Sacha Guitry de l'Angleterre. Monté pour la première fois sur une scène à l'âge de dix ans, il avait écrit sa première pièce à douze. Pourtant, cet homme brillant et distingué, qui posséda la réputation d'être le plus parisien des auteurs dramatiques anglais, dut affronter la misère avant de séduire la fortune. Après le succès triomphal de The Vortex (1924), histoire d'un jeune intoxiqué dont la mère est immorale, il s'essaie un temps à la revue, puis crée d'élégantes comédies. Si certaines furent boudées par le public, comme Sentiment, Peace in Your Time, d'autres firent le tour du monde, comme Private Lives (1930), Gai Fantôme (1941) et surtout Brève Rencontre, qui fut jouée seize mois de suite à New York et dont l'adaptation cinématographique obtint en 1946 le grand prix de la critique internationale au festival de Cannes. Le cinéma attira également Noel Coward, qui connut le succès dans Heureux mortels (D. Lean, 1944), d'après sa pièce Cavalcade, puis dans Égarement (1951), dont il était à la fois l'auteur, le dialoguiste, l'acteur principal et le compositeur. Créateur polyvalent (il s'adonnait aussi à la peinture), il écrivit deux livres autobiographiques : Present Indicative (1937) et Future Indicative (1954).
FRY CHRISTOPHER
On a assisté dans les années qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale à une renaissance du théâtre britannique. John Osborne, Arnold Wesker, Harold Pinter et bien d'autres ont largement contribué à ce renouveau. Parmi eux, Christopher Fry tient une place à part, aussi bien par les genres qu'il a abordés (souvent des sujets religieux) que par la forme : il est le premier dramaturge anglais depuis des années qui ait écrit en vers. Christopher Fry est né à Bristol dans une austère famille de Quakers. Son père, un pasteur, le destine à l'enseignement. Mais Christopher Fry, de son vrai nom Christopher Harris, abandonne bientôt cette carrière et, ayant choisi pour pseudonyme le nom de jeune fille de sa mère, il acquiert une large expérience dans les divers métiers de la scène ; travaillant aussi bien dans les cabarets que dans les théâtres de répertoire, il est successivement acteur puis metteur en scène. Mais ce qui l'attire surtout, c'est d'écrire lui-même des pièces de théâtre. Ses premières pièces, il les compose pour des festivals locaux et les monte lui-même. Inspirées surtout par des sujets religieux, ces œuvres n'ont pas grand mérite, et seule Le Garçon au chariot (The Boy with a Cart, 1939) est publiée. Lorsque la Seconde Guerre mondiale survient, il est directeur du Playhouse, à Oxford. Il est mobilisé dans le Pioneer Corps et passe la guerre à déblayer les ruines des bombardements allemands. Sa grande période fut celle de l'immédiat après-guerre. Il se remit à écrire et publia et fit jouer successivement : Un phénix trop fréquent (A Phœnix too Frequent, 1946), une comédie légère sur le thème de la matrone d'Éphèse ; Cette dame n'est pas à brûler (The Lady's not for Burning, 1949), qui connut un triomphe ; Vénus au zénith (Venus Observed, 1950) ; Le Sommeil des prisonniers (A Sleep of Prisoners, 1951), sa pièce la plus ambitieuse ; puis La Lumière dans les ténèbres
PIÈCES DE GUERRE, EDWARD BOND
On ne saurait séparer les Pièces de guerre (The War Plays, 1985) d'Edward Bond (né en 1934), du contexte contemporain de leur écriture : la guerre froide du début des années 1980, et la menace nucléaire qui occupait alors les esprits. À tel point que Bond lui-même a pu justifier le choix de son sujet en proclamant que la destruction nucléaire était alors le seul sujet possible pour l'art. Chez Bond, le propos politique, prenant comme détour la fiction apocalyptique pour mieux pointer les failles du monde actuel, s'accompagne d'une exploration des formes théâtrales du passé, assortie de perpétuelles innovations esthétiques. Les Pièces de guerre jouent d'une tension entre un régime dramatique, fondé sur le dialogue et la relation interpersonnelle, et des techniques épiques telles que l'adresse frontale au public ou le récit choral. Mais elles proposent également un agencement variable des parties qui la composent. De même qu'elle entreprend de relire le devenir de l'humanité à travers le prisme de sa destruction, l'œuvre offre une traversée des formes dramaturgiques, de la tragédie antique au théâtre épique. Bien plus pourtant qu'un catalogue formel, la démarche de Bond se veut une expérimentation théâtrale du politique. Un théâtre de cataclysme La première des trois pièces, Rouge noir et ignorant (Red Black and Ignorant), est placée sous le signe du théâtre d'agit-prop, théâtre d'agitation et de propagande, apparu en U.R.S.S. et en Allemagne après 1917. Faisant office de prologue, elle se compose d'une série de tableaux qui sont autant d'épisodes de l'existence virtuelle et tronquée d'un Monstre brûlé par le feu des bombes : « Mon sang pue : flaques sur sols d'usine : acide/ Mes bandages sont brûlés par l'acide/ Les mots arrachent mes dents : les souches de vieux arbres/ Elles s'entrechoquent dans ma bouche : jeu de dés/ Je les crache et compte : la fin du monde ! » La Furie des nantis (The Tin Can People) se déroule dans un désert postnucléaire, au sein d'une communauté de survivants persuadés, parce qu'il leur reste de quoi subvenir à leurs besoins pour des siècles et qu'ils n'ont donc pas à travailler, de jouir d'un état paradisiaque, avant que l'arrivée d'un étranger ne coïncide avec le déclenchement d'une épidémie qui les décime. La troisième pièce, Grande Paix (Great Peace), relate le calvaire d'une femme traînant dans le même désert un baluchon qu'elle chérit comme son enfant. Son errance fait suite au crime fratricide accompli par son fils, à qui l'armée, pour cause de pénurie, avait intimé l'ordre de supprimer un nouveau-né de son voisinage. Une série d'éléments (le désert postatomique, la présence de certains personnages) contribue à assurer une continuité entre la deuxième et la troisième partie de la trilogie, même si le début de l'action de Grande Paix se situe dans un temps antérieur à celui de La Furie des nantis. Le développement des deux pièces s'articule autour du moment non représenté de l'explosion atomique, événement destructeur, sur le plan thématique, de tout édifice social, politique ou institutionnel, mais dramaturgiquement fondateur. Le cataclysme devient le point d'appui de la fiction bondienne, légèrement anticipatrice, et lui permet de montrer sur la scène la constitution ex nihilo d'une société humaine. Le « postmodernisme » de Bond Le moment sans durée de l'explosion dévastatrice est donc oblitéré, absent du présent de l'action dramatique, mais resurgit éclaté en une infinité de récits subjectifs et traumatiques. Le « postmodernisme » dont se réclame le dramaturge désigne ici l'impossibilité de se référer désormais à un grand récit commun, garant du progrès humain et du sens de l'Histoire. Le recours aux dispositifs tragique et épique fonctionne dès lors de façon incomplète. Les meurtres ponctuant la trilogie (le fils tuant son père à la fin de Rouge noir et ignorant, le soldat supprimant son frère au début de Grande Paix) apparaissent comme des situations constitutives de la tragédie, mais sans que leur développement soit mené à son terme. La monstruosité de la situation inaugurale se trouve non pas résolue mais perpétuellement reconduite par un geste paradoxal : la mère en deuil de Grande Paix abandonne à son tour l'enfant qu'une autre femme lui a confié dans le désert ; le Monstre de Rouge noir et ignorant évoque la vie qui aurait pu être la sienne sans la guerre, mais celle-ci se situe de nouveau sous le signe de la violence et de l'impossible sociabilité. La tentation d'une interprétation spirituelle ou hagiographique bute finalement sur la vision qui clôt les Pièces de guerre (le squelette de la Femme sur le sable du désert). Au théâtre épique brechtien, Bond emprunte la dialectique et les techniques d'inversion, soutenues par le geste de l'affirmation. Mais il recourt ponctuellement à une stratégie d'agression du public, qu'il nomme « aggro-effect » ou « événement théâtral », induisant à l'opposé l'abolition momentanée d'une distance critique. On ne saurait donc nier la dimension didactique des Pièces de guerre, mais à condition de préciser que leur vertu d'apprentissage prend pour objet l'apprentissage lui-même, et que les effets de distanciation qu'elles mobilisent se trouvent eux mêmes distanciés. La création de la trilogie par la Royal Shakespeare Company, à Londres en 1985, a contribué à éloigner encore Bond des institutions théâtrales de son pays
BECKETT SAMUEL
Pour Samuel Beckett plus que pour tout autre écrivain moderne - sauf peut-être Kafka -, la création littéraire aura signifié exil, isolement, résistance. Né en 1906 dans une famille protestante de la banlieue de Dublin, l'écrivain multipliera, toute son existence, fugues, évasions et autres évitements. D'abord, au Trinity College de Dublin, en étudiant les langues romanes, italien et français ; puis en voyageant longuement dans les pays d'où proviennent ces langues (en 1928, il est lecteur d'anglais à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm), en choisissant de vivre en France l'essentiel de sa vie d'adulte et d'écrire en français une grande part de ses œuvres ; enfin en fuyant autant qu'il lui fut possible, jusqu'à sa mort en 1989, la gloire qui avait fondu sur lui à la suite de ses succès internationaux au théâtre et du prix Nobel de littératureobtenu en 1969. Beckett n'a jamais consenti à commenter son propre travail d'écrivain, mais la critique, elle, a été très prolixe à son sujet et, aussi, très contradictoire. Au point de consacrer, successivement ou simultanément, plusieurs Beckett, des Beckett « existentialiste », « métaphysique » ou « absurdisant » des années cinquante au Beckett « populaire » salué par Bernard Dort au début des années quatre-vingt, sans oublier le Beckett « littéral » de Robbe-Grillet et du nouveau roman. La vérité est que l'auteur de Molloy et de En attendant Godot n'en finira jamais de décourager toute approche systématique. Doué d'un talent protéiforme, qui lui permet de s'illustrer tant dans la poésie que dans le roman, aussi bien au théâtre qu'à la radio, à la télévision, au cinéma, voire dans l'essai critique, Beckett s'emploie en fait à convertir cette profusion des dons en rareté de la production, à effacer les frontières entre les genres et entre les arts, à abolir la notion même d'œuvre et à lui substituer celle, volontairement déceptive, de fragment. L'emploi du temps Parmi les influences qui ont pu s'exercer sur Beckett, celle de Proust - auquel il consacre un essai en anglais dès 1931 - n'est sans doute pas la moins forte. Certes, Joyce pourra un temps subjuguer son cadet, qui fut son ami et son secrétaire, et continuer à long terme de hanter son esprit (notamment lorsqu'il s'agit pour Beckett de mettre en scène la relation de l'homme au langage). Mais, avec Proust, la relation paraît plus nette et plus fondamentale. Dès Murphy (1938), Beckett reprend le travail du roman là où Proust l'a laissé. Ou, plutôt, il le prend à contresens, comme un véhicule fou remonte une autoroute au-devant de la catastrophe. À la recherche du temps perdu se présentait comme une quête où la mémoire tenait du talisman, de l'auxiliaire magique, et au bout de laquelle il s'agissait de parvenir à une réconciliation avec soi-même et avec le monde, dans l'apaisement du « temps retrouvé » de l'œuvre d'art. Quand l'auteur du cycle romanesque qui se poursuit avec Molloy, Malone meurt(1951), L'Innommable (1953), trois textes écrits en français, et qui comprend également Watt (1953, composé en anglais dix ans auparavant) déboule dans son passé, c'est pour n'y retrouver qu'une terre aride, désertique, dévastée, inhospitalière à jamais. L'éternel va-et-vient Tous les personnages des romans et des premières pièces de Beckett sont des errants. Quand ils ne vont pas par les chemins, c'est dans leur tête qu'ils vagabondent, tels Malone ou Hamm de Fin de partie (1957). Cette errance, dont les protagonistes, très courbés, voire effondrés et réduits à la reptation, semblent, selon une expression de l'auteur, « mourir de l'avant », nous fait penser à quelque odyssée parodique dont le héros serait un Ulysse moderne à la façon de Joyce ou de Pound : l'« homme moyen sensuel ». « Nées retraitées », à l'instar de Murphy, les créatures beckettiennes s'échinent en apparence à amorcer leur retour vers le monde. En fait, ce retour n'est qu'un trompe-l'œil qu'elles effectuent en marche arrière ou en faisant du surplace. Ainsi elles se retrouvent toujours plus en retrait du monde, laissées pour compte dans les marges ou les no man's land, échouées. Là, sur le sable d'une existence végétativo-méditative, elles peuvent se livrer à leur non-activité de prédilection : cette « supination » qui, les ravalant à l'état de « vieux fœtus », donne libre cours à leur lente et méthodique agonie. La pure sensualité - entendons ce qu'il reste de très vieilles pulsions pratiquement exténuées, ces « histoires de gamelle et de vase » - l'emporte invariablement sur tout projet, serait-ce même, chez Malone et Hamm, le projet de se raconter et d'écrire. Aspiration - littérale bien souvent (Oh les beaux jours, 1963) - à ou par le nirvana d'un individu qui retourne au ventre liquide de la mère ou au magma originel. Jusque dans cet état inerte de la matière dont il aurait voulu ne sortir jamais. Et si, comme au stéthoscope ou grâce à une sonde, nous captons ce qu'il subsiste de vie autonome dans l'être beckettien blotti en son terrier, le bruit et le mouvement quasi animaux, la pulsation que nous percevons alors sont ceux d'un permanent va-et-vient. La « Comédie » Et l'écrivain irlando-français boucle son esthétique du va-et-vient en passant lui-même sans cesse d'une langue à l'autre, traduisant ses textes français en anglais, et ses textes anglais en français. Ou bien en alternant prose et théâtre. Car, pour Beckett comme pour Genet, le théâtre n'est pas une dérivation de la création littéraire. Il s'impose au contraire, à un moment donné (à vrai dire assez tôt, Éleuthéria, première pièce toujours inédite, datant de 1947), comme une nécessité intrinsèque à la poursuite de l'œuvre. Comme le détour qui permet à Beckett, nourri dès l'adolescence par la lecture de Dante, de donner forme à sa propre Comédie. L'art étant, selon le credo beckettien, « contraction », l'espace théâtral, par ses strictes limites physiques et l'espèce de compression qu'il exerce sur les corps et les paysages humains, ne peut que séduire un auteur qui, par ailleurs, dépouille de plus en plus ses textes de toute tendance anecdotique ou descriptive, narrative même, au profit du seul soliloque. Or quel instrument mieux que la cage de scène pourrait donner toute sa résonance à ce dialogue à l'intérieur d'une seule tête ? Enfin, il a l'ambition beckettienne de donner à voir l'invisible. Ce désir de « forcer l'invisibilité foncière des choses extérieures jusqu'à ce que cette invisibilité elle-même devienne chose, non pas simple conscience de limite, mais une chose qu'on peut voir et faire voir » (à propos de la peinture des Van Velde dans Le Monde et le Pantalon, 1989) trouve au théâtre son accomplissement : le lieu où rendre palpables, concrètes, où donner corps aux forces invisibles qui trament et orientent nos existences. Dès En attendant Godot, porté à la scène en 1953 par Roger Blin, et de plus en plus radicalement avec chaque pièce nouvelle (Fin de partie, 1957 ; La Dernière Bande, 1959 ; Oh les beaux jours, 1963), Beckett jouera à plein de ce pouvoir du théâtre de rendre sensible et visible l'invisible. Le geste testamentaire De même que Genet n'a cessé de transposer au théâtre, ainsi qu'il le déclarait lui-même dans sa « Lettre à Pauvert », le geste liturgique de l'élévation, Beckett, lui, ne semble jamais mettre en scène, dans ses pièces et dans toute son œuvre, que le moment de l'agonie, travail symétrique à celui de la naissance, dernier et vain combat pour tenter de donner un sens à la vie. « Je consulterai ma conscience périmée, je gâcherai mon agonie pour mieux la vivre » (Malone meurt). Du cours de l'existence, le dernier théâtre et les ultimes récits de Beckett, c'est-à-dire aussi bien Solo et Berceuse (1982) que Soubresauts (1989), ne nous donnent à voir et, surtout, à entendre (le visuel étant de plus en plus l'objet d'un deuil) que le temps à la fois très court et très long, le temps dichotomique de ce trépas à la faveur duquel toute une vie repasse par la tête d'un personnage « récitant », « souvenant », bref, agonisant. Gisant debout sur son vertical reposoir (le Souvenant de Cette Fois : « Vieux visage blême légèrement incliné en arrière, longs cheveux blancs dressés »), la créature fait interminablement ses adieux au monde au cours d'une cérémonie secrète et sans faste. « Muette toute sa vie [...] pratiquement muette [...] même à elle-même », Bouche de Pas moi est soudain saisie par « une voix que d'abord [...] elle ne reconnaît pas [...] depuis le temps [...] puis finalement doit avouer [...] la sienne [...] nulle autre que la sienne [...] ». Or que dit cette voix de la dernière heure qui, pour être celle de Bouche ne sort pas moins des ténèbres extérieures ? « Comment ç'avait été [..]. Comment elle avait vécu. » Déjà en faveur dans le théâtre de Strindberg et chez les dramaturges expressionnistes, l'écriture de l'agonie est sans doute la forme littéraire et théâtrale qui correspond le plus étroitement à la recherche beckettienne d'un art condensé, contracté. « À peine venu parti », telle est la formule lapidaire du Souvenant de Cette Fois. Oh les beaux jours est une pièce d'abord écrite en anglais et créée à New York le 17 septembre 1961. Beckett en fait lui-même une version française en 1963, créée au cours de l'été à la Biennale de Venise. Les premières représentations ont lieu en octobre au Théâtre de l'Odéon dans une mise en scène de Roger Blin, avec Jean-Louis Barrault dans le rôle de Willie, et Madeleine Renaud dans celui de Winnie, rôle qui deviendra l'un des plus marquants de sa carrière et qu'elle jouera jusqu'en 1986, à l'âge de 86 ans. Cette pièce de théâtre, mêlant tragique et comique, présente une situation très absurde. C'est en réalité une pièce sur rien car personne n'écoute Winnie, personne ne lui répond et elle se trouve dans un endroit désert, enterrée jusqu'au cou et s'enfonce peu à peu.
GREENE ROBERT
Robert Greene fut un prosateur anglais de la fin du XVIe siècle et l'un des plus brillants prédécesseurs de Shakespeare dans le genre de la comédie romanesque en vers « blancs ». Il fut aussi un des premiers écrivains professionnels en Angleterre, et l'un des premiers auteurs anglais à rédiger son autobiographie. Robert Greene naît en juillet 1558 ( ?) à Norwich (Angleterre). Diplômé de Cambridge et d'Oxford, il s'installe à Londres, où il mène une vie dévoyée. Entre 1580 et 1592, il écrit plus de trente-cinq ouvrages. Afin de plaire au lecteur, il suit dans un premier temps aveuglément la mode littéraire, prenant pour modèle Euphues, roman en prose de John Lyly. À la fin des années 1580, il écrit des pastorales en prose à la manière de l'Arcadia de Philip Sidney, émaillant ses textes de paroles de chanson charmantes qui lui donnent une réputation de poète. Son plus bel essai dans ce domaine, Pandosto(1588), inspirera directement Le Conte d'hiver de Shakespeare. Vers 1590, Robert Greene commence à rédiger des ouvrages didactiques sérieux. Avec Greenes never too late (1590) tout d'abord, il rapporte des histoires d'enfant prodigue. Il s'inspire de toute évidence de son expérience personnelle, comme en témoigne le pamphlet Greenes groats-worth of witte, bought with a million of repentance, imprimé à titre posthume en 1592 et dans lequel Greene avoue que les aventures de Roberto reflètent en grande partie les siennes. Dans ce même ouvrage apparaît la première référence imprimée à Shakespeare. Greene le décrit ainsi : « un parvenu, corbeau paré de nos plumes, qui, avec son cœur de tigre recouvert d'une peau d'acteur, se croit aussi habile à enfler [...] un vers blanc que le meilleur d'entre vous, et devenu absolument un Johannes factotum, est, dans sa propre opinion, le seul shake-scene du pays »
THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN
production dramatique qui fit la gloire littéraire du règne d'Élisabeth Ire(1558-1603) et se prolongea jusqu'à la fermeture des théâtres, en septembre 1642, après la victoire des puritains. Toutefois, la critique anglaise utilise le terme « jacobéen » ou « Stuart » quand il s'agit de pièces écrites après l'avènement de Jacques Ier (1603) et jusqu'à sa mort (1623), date après laquelle la plupart des grands dramaturges ont disparu ou cessé d'écrire. La période florissante de ce théâtre, qu'illustre brillamment l'œuvre de Shakespeare, s'étend de 1580 à 1630 environ. Origines Les mystères L'amour du spectacle - action, costumes, personnages - est déjà profondément enraciné dans l'âme du peuple anglais au cœur du Moyen Âge, et le rituel des cérémonies chrétiennes - dont la messe et les épisodes de la Passion - préfigure, dès les premiers siècles du christianisme, les jeux dramatiques, qui passent de l'église dans la rue et se concrétisent dans les somptueux défilés de chars (pageants) des miracle plays montés par les guildes ou les corporations. Ces pièces racontent naïvement les épisodes de l'histoire sainte, et sont comme un acte de piété auquel le peuple entier d'une ville ou d'une province prend part avec ferveur. Les moralités Les moralités apparaissent vers la fin du XIVe siècle, sans d'ailleurs supplanter les miracle plays. Ce sont de véritables pièces de théâtre, avec conflit et dénouement, qui dramatisent les difficultés du salut de l'homme, champ de bataille où les forces du mal. Les théâtres À l'origine, les lieux scéniques étaient les églises pour les textes sacrés et le rituel, puis la rue pour les mystères, la place publique et les cours d'auberge pour les autres productions : moralités, interludes, comédies. Voilà pour les représentations publiques. L'auberge du Bull dans Bishopgate Street et du Bel Savage de Ludgate Hill étaient parmi les plus notoires pour les pièces qu'on y jouait. Les spectateurs s'installaient dans la cour rectangulaire et sur la galerie qui courait le long du premier étage. Cette disposition se retrouvera lorsqu'on construira des théâtres. Il y avait aussi des enceintes qui servaient à des spectacles populaires autres que du théâtre. Ainsi on donnait des duels au sabre ou à l'épée, des combats de taureaux et d'ours contre des chiens. L'ours était attaché à un poteau : d'où la métaphore de Macbeth acculé à la mort : « Ils m'ont attaché au poteau » (acte V, sc. VII). Par ailleurs, les universités, les quatre écoles de droit de Londres (inns of court), la cour, les châteaux et les résidences des grands seigneurs offraient aussi des lieux scéniques dans leurs chapelles, leurs halls ou leurs réfectoires. C'étaient là des représentations privées ; des comédiens, amateurs d'abord, puis, à mesure que se formèrent des troupes, professionnels, furent invités à y présenter des spectacles. Le premier théâtre public, appelé précisément The Theatre, fut construit en 1576, dans Shoreditch, au nord de Londres. L'année suivante fut construit The Curtain (La Courtine, et non pas Le Rideau, parce qu'il s'élevait près de la courtine, fortification de la Cité). Les « university wits » On désigne sous ce terme un groupe d'écrivains, dramaturges, conteurs et pamphlétaires, issus des universités, qui mirent leur culture au service de l'art populaire du théâtre au lieu de se faire prêtres ou professeurs. Ces intellectuels, ardemment désireux d'accroître le prestige de la poésie et de propager leurs idées, furent les protagonistes d'un théâtre d'avant-garde et donnèrent en quelque sorte au théâtre populaire ses lettres de noblesse. Leur période de production (1580 env.-1595 env.) est une féconde période de germination qui annonce les grandes œuvres à venir. De Lodge (auteur d'un conte romanesque, Rosalynde, 1590, dans le style de Lyly, d'où Shakespeare tirera Comme il vous plaira, 1559), on ne connaît qu'une tragédie historique, The Wounds of Civil War (1594 env.), première pièce sur l'histoire romaine traitant de la guerre civile entre Marius et Sylla. La comédie des humeurs Alors que la comédie romanesque va briller de tout son éclat avec Shakespeare, un autre genre comique, nourri de réalités plus terre à terre, d'observation impitoyable et plus soucieuse de fustiger que d'amuser, s'installe solidement sur la scène grâce à la plume précise et mordante de Ben Jonson. Ce fils de maçon est le grand rival de Shakespeare par l'ampleur et la diversité de son œuvre, la foi en son génie et en sa mission. La comédie, il la veut « le miroir des mœurs, l'image de la vérité ». Son observation se fonde sur la vieille psychologie qui assigne aux quatre humeurs fondamentales (sang, phlegme, bile jaune et bile noire) un rôle capital dans le tempérament. Ainsi l'excès d'une humeur provoque les anomalies de caractère qui rendent si difficile le commerce des humains entre eux. Les personnages de Ben Jonson sont tous des pervers, des coquins ou des fous, véritables caricatures de l'humanité. L'objet de la comédie est la purgation de ces vices par leur exposition sans pitié. Volpone (1607) est un modèle du genre : la rapacité, la fourberie, la luxure sont les répugnants ressorts d'une action brillante et bien menée. Ben Jonson, d'ailleurs, est maître de l'intrigue, comme en témoigne l'extraordinaire structure en spirale de L'Alchimiste (1610), véritable course à relais d'escrocs et de dupes. Maître de la truculence satirique dans Bartholomew Fair (La Foire de la Saint-Barthélemy, 1614) et du sarcasme antibourgeois dans The Silent Woman (La Femme silencieuse, 1609), Ben Jonson démasque le vice avec férocité ; il tend vers la comédie de mœurs d'un âge truculent et baroque, qui aime les sensations fortes, a le courage de ses ambitions et de ses vices et ne craint pas de les voir mettre au pilori.
JONSON BENJAMIN
À côté de Shakespeare, son émule et son rival, Ben Jonson est le plus important dramaturge de la Renaissance anglaise. Il naquit à Westminster School, sous la férule de l'humaniste Camden (1551-1623). Sa mère s'étant remariée à un maçon, il exerça ce métier quelque temps, puis partit guerroyer dans les Flandres (1591-1592 ?). À son retour à Londres, il se mêle au monde des théâtres, et travaille pour Philip Henslowe (1550 env.-1616), directeur du théâtre de la Rose, qui avait sa compagnie et ses auteurs. Sa vie fut fertile en tribulations : il connut la prison, pour avoir tué un confrère acteur en duel, et pour avoir raillé les Écossais dans Eastward Hoe, pièce écrite en collaboration avec George Chapman (1560-1634) et John Marston (1576-1634) ; il faillit être arrêté lors de la conspiration des Poudres (1605) et, après des années de succès, et même de gloire (il fit publier en un volume in-folio ses œuvres complètes l'année où il reçut le titre de poète lauréat, en 1616), il mourut dans la pauvreté. L'œuvre de Ben Jonson est considérable. Il écrivit de nombreux poèmes, fit jouer près de cinquante pièces de tous les genres, comédies satiriques, tragédies classiques et pièces lyriques, appelées « masques », qui sont des divertissements de cour à grand spectacle, sur des thèmes mythologiques, accompagnés de chansons et de danses, auxquels les grands seigneurs prennent part en présence des souverains, vers qui converge l'action. À la fin de sa carrière, Ben Jonson n'écrivit plus que des « masques », nostalgiques élans vers une splendeur poétique qui allait être bientôt dépassée. Les tragédies de Ben Jonson : La Chute de Séjan (Sejanus, his Fall, 1605) ; La Conspiration de Catilina (Catiline, his Conspiracy, 1611), pièces romaines, ne mettent pas, comme c'est le cas chez Shakespeare, le héros au centre de l'intérêt. Elles sont de structure rigoureuse (Ben Jonson était classique en la matière)
HAMLET
"Hamlet n'est peut-être qu'une gigantesque et géniale parabole sur le théâtre et l'acteur. Shakespeare nous livre sa pensée, sa foi dans cet art, au point d'en faire une arme absolue pour débusquer le mensonge." P. TORRETON
STOPPARD TOM
Après s'être essayé au genre romanesque dans Lord Malquist and Mr. Moon (1966), Tom Stoppard se tourne vers le théâtre. Son œuvre se structure autour d'une donnée commune : l'esprit, ou wit. Si ce dramaturge britannique - né le 3 juillet 1937 à Zlin, en Tchécoslovaquie, sous le nom de Thomas Straussler - est l'héritier d'Oscar Wilde et de la wittycomedy (« comédie du bel esprit »), il n'en est pas moins également un philosophe du langage théâtral. Sa lecture de Beckett, mais aussi de Wittgenstein, l'inscrit dans le sillage d'un théâtre privilégiant la polysémie et l'auto-référence : Stoppard fait jaillir un sens nouveau des textes de Shakespeare (Rosencrantz and Guildenstern Are Dead), de Beckett ou de Wilde (Travesties), comme des tableaux de Magritte ou de Marcel Duchamp (« L'Assassin menacé » dans AfterMagritte et « Nu descendant l'escalier » dans Artist Descending a Staircase). Abondante, l'œuvre de Stoppard offre à la fois des comédies métaphysiques, des comédies politiques et historiques et des farces bâties sur le nonsense. Tout se donne en spectacle : le geste, mais aussi le mot dans une célébration jubilatoire de la théâtralité, où le thème de la pièce dans la pièce vient effacer la frontière entre réalité et fiction (The Real Inspector Hound, 1968 ; The Real Thing, 1982). C'est Rosencrantz and Guildenstern Are Dead (1967) qui donne le ton. Largement inspirée par Beckett et le Pirandello de Six Personnages en quête d'auteur, la pièce, portée à l'écran par l'auteur en 1990 (lion d'or à la Mostra de Venise), est une réécriture du Hamlet de Shakespeare. Comme souvent chez Stoppard, ce sont les marges qui viennent au centre : personnages mineurs de la pièce de Shakespeare, Rosencrantz et Guildenstern tiennent ici le devant de la scène. À la manière de Vladimir et Estragon dans En attendant Godot ou des personnages de Pirandello, ils tentent d'improviser leur vie en s'insurgeant contre leur destin de personnages de théâtre. Le comique naît alors de cette incertitude existentielle.
THÉÂTRE DU GLOBE
Au début de 1599, William Shakespeare, qui, depuis 1594, faisait partie comme acteur des Lord Chamberlain's Men, alloua à ces derniers une somme équivalant à 12,5 p. 100 du coût de construction du Globe. Il agissait ainsi en tant qu'actionnaire principal de la compagnie : cette opération commerciale, tout à fait originale pour des acteurs de l'époque, devait rencontrer un éclatant succès. Shakespeare et ses principaux camarades obtenaient ainsi non seulement une part dans les bénéfices de leur compagnie, mais aussi une part dans leur théâtre. Cela faisait cinq ans qu'existaient à Londres des salles et des troupes officiellement reconnues. Les Lord Chamberlain's Men étaient l'une des deux troupes autorisées à jouer dans la capitale. L'autre se produisait au théâtre de la Rose, propriété d'un imprésario et de son beau-fils, un ancien acteur. La troupe de Shakespeare construisit le Globe parce qu'il lui fut impossible de disposer du théâtre des Blackfriars, un théâtre couvert qu'avait fait édifier pour elle, à l'intérieur de la ville, James Burbage (le père de leur acteur vedette Richard Burbage). James Burbage n'en était pas à son coup d'essai : il avait à son actif le premier amphithéâtre à avoir connu le succès, le Théâtre, qu'il avait fait bâtir en 1576 dans un faubourg de Londres. Vingt ans plus tard, peu avant l'expiration du bail qu'il avait souscrit pour le terrain de cet édifice, il crut trouver une solution de remplacement en faisant construire une nouvelle salle aux Blackfriars. Mais les riches occupants du voisinage persuadèrent le gouvernement d'y interdire la représentation de pièces, si bien que le capital de Burbage se trouva bloqué. Il mourut au début de 1597, sans avoir pu se remettre de ce cuisant échec. Les Lord Chamberlain's Men se virent alors contraints de louer un théâtre. À la fin de 1598, ils décidèrent d'en construire un pour eux. Le succès du Globe Édifié en 1599, le Globe, en dépit de la hâte qui avait présidé à sa construction, devait connaître un véritable triomphe. Après dix ans d'exercice, il n'était pas seulement devenu la coqueluche des amateurs de théâtre, mais aussi celle de la troupe elle-même, qui dépensa des sommes considérables pour pouvoir s'y maintenir. Deux faits au moins en apportent la preuve. En 1608, quand la compagnie put enfin faire aboutir le projet de James Burbage, ses membres choisirent, contre toute raison, de se produire dans les deux salles à la fois, dans celle à ciel ouvert du Globe en été, et dans celle des Blackfriars, qui était protégée par un toit, en hiver. S'ils en avaient décidé autrement, ils auraient pu facilement louer l'un des deux bâtiments à une autre compagnie, si grande était à cette époque la pénurie de théâtres dans Londres. Une seconde chance leur fut offerte en 1613 d'occuper à plein temps les Blackfriars, lorsque le Globe fut entièrement détruit par un incendie, un canon ayant accidentellement mis le feu à la toiture en chaume lors d'une représentation de Henry VIII. À cette date, les Blackfriars commençaient déjà à se révéler plus rentables que le Globe : même si l'espace y était moindre, on y pratiquait en effet des prix plus élevés. Mais, par attachement sentimental et dans un esprit de loyauté, les membres de la troupe se saignèrent aux quatre veines pour faire renaître le Globe de ses cendres et lui donner plus belle allure encore. Techniquement, le Globe de 1599 et sa nouvelle version de 1614 ouvrent une ère nouvelle dans la conception de l'architecture théâtrale. Le premier Globe, qui avait emprunté sa forme au Théâtre de 1576, était exceptionnel à un double titre : parce qu'il était l'exemple le plus célèbre d'un type de salle très particulier et qui devait rapidement disparaître, mais aussi parce qu'il fut le premier à avoir été construit spécialement pour une compagnie en exercice, une compagnie qui l'avait elle-même financé sur ses propres deniers. C'est pour être joués dans cette salle que Shakespeare conçut Comme il vous plaira. La conception du Globe La conception du premier Globe se faisait l'écho de plusieurs traditions. Son nom, qui avait été utilisé jusqu'alors pour des atlas, comme celui de Mercator, plutôt que pour des salles de représentation, évoquait les théâtres de la Rome ancienne. Sa forme circulaire, pourtant, s'éloignait de celle en usage dans l'Antiquité et faisait davantage penser à la façon dont les curieux se regroupent autour des acteurs sur une place de village, là où les acteurs de 1576 avaient précisément fait leur apprentissage. L'idée de construire une sorte d'échafaudage avec trois niveaux de galeries entourant une cour circulaire renvoyait aux sortes d'arènes alors en usage pour les combats d'ours et de chiens, ou bien encore de taureaux. La scène, une estrade au centre du théâtre, s'inspirait des tréteaux que montaient alors les compagnies itinérantes dans les cours d'auberge. Le premier théâtre disposait d'une structure extérieure à vingt côtés, c'est-à-dire aussi proche d'un cercle que la charpenterie de l'époque le permettait. Cette structure faisait trente pieds de hauteur (9 mètres), avec des places assises réparties sur trois niveaux. L'accès du public avait lieu de deux façons : soit par deux étroits couloirs ménagés sous les galeries et qui permettaient d'accéder au parterre entourant la scène, soit par des escaliers installés dans deux tours extérieures et qui conduisaient dans les étages. Cinq des vingt baies qui entouraient les galeries étaient masquées par le frons scenae, un mur de séparation derrière lequel la troupe entreposait accessoires, costumes et livrets et pouvait se préparer avant d'entrer en scène. La scène consistait en une estrade de 1,50 mètre de hauteur qui s'avançait depuis le mur de séparation jusqu'au milieu du parterre. Deux poteaux soutenaient une sorte de toit destiné à protéger de la pluie les acteurs et leurs riches costumes. Les spectateurs du parterre étaient à découvert ; en cas d'intempéries, ils pouvaient, moyennant un supplément, se mettre à l'abri dans les galeries du bas.
ANGRY YOUNG MEN
Bien que leur humeur ait plutôt été une amertume sarcastique ou boudeuse et leur rébellion un repli, un refus de souscrire plus longtemps à une vulgate officielle qui leur donnait des haut-le-cœur, on les a appelés, globalement, les « jeunes gens en colère », et le label est resté. Il désigne une poignée d'écrivains, romanciers dramaturges ou essayistes, qui, vers le milieu des années 1950, en Angleterre, se sont mis à donner de la voix (pas en chœur, d'ailleurs) et à faire souffler sur le pays un petit vent de fronde qu'on n'attendait pas. Le cri de guerre de Jimmy Porter L'événement qui catalysa le phénomène fut la représentation, le 8 mai 1956, au Royal Court Theatre de Chelsea, à Londres, de la pièce de John Osborne, Look back in Anger (La Paix du dimanche). Depuis quelque temps déjà, il y avait une certaine effervescence dans le monde du jeune théâtre anglais : en août 1955, Peter Hall avait monté En attendant Godot de Beckett. En 1956, on avait pu voir à Londres La Cantatrice chauve de Ionesco et le Berliner Ensemble de Brecht venu en tournée. En avril 1956, l'English Stage Company s'installait au Royal Court avec comme objectif de promouvoir un jeune théâtre, plus incisif, plus « engagé » : après The Mulberry Bush d'Angus Wilson et Les Sorcières de Salemd'Arthur Miller, elle donna la pièce d'Osborne et, à l'écho que la première trouva, au scandale qu'elle suscita, on comprit qu'un point sensible avait été, plus que touché, dynamité. Jimmy Porter devint l'archétype du jeune rebelle ayant perdu ses illusions sur l'Angleterre contemporaine et John Osborne (1929-1994), son créateur, l'un des « trois mousquetaires » (avec Kingsley Amis et Colin Wilson) de la guérilla culturelle. On était au jeu de massacre. Né dans la classe ouvrière, Jimmy Porter a pu s'en sortir grâce à la politique du gouvernement travailliste venu au pouvoir en 1945. Il fait partie de cette élite plébéienne qui pour la première fois a eu accès à l'université. Il a épousé, de haute lutte, la fille du colonel Redfern, un ancien de l'armée des Indes, de l'Angleterre édouardienne et de ses splendeurs. Mais loin de prendre plaisir à son ascension sociale, il a le sentiment que lui et ses semblables ont été victimes d'un marché de dupes. On leur a donné accès aux études, mais les études ne donnent plus accès à rien. Ils se retrouvent entre deux chaises, sans foi ni classe, déracinés et à la dérive. Un mouvement plus social qu'artistique Parut le roman de Kingsley Amis (1922-1995), Lucky Jim (1954). En racontant les facéties de Jim Dixon, assistant en littérature médiévale anglaise dans une université de province qui, tout en faisant des ronds de jambe à son patron, se moque son dos de la culture en peau de lapin dont celui-ci est le porte-flambeau, Amis, au départ, n'avait voulu qu'écrire un roman comique. Rétrospectivement, à partir de 1956, « Jim la Chance » fut vu comme un autre de ces déclassés en transit qui utilisent ce qu'il leur reste de truculence populaire pour dynamiter le mirage de « culture » auquel ils ont eu la naïveté de se laisser prendre. S'il restait ici ou là des mèches qui traînaient, Colin Wilson (né en 1931) les alluma toutes dans son essai The Outsider (printemps 1956), un pot-pourri de citations où le « nouveau philosophe » de sa génération faisait donner en vrac Nietzsche, Gurdjieff, saint Jean de la Croix et cent autres pour théoriser la figure du « rebelle » existentialiste. Le livre eut une grande publicité et acheva de transformer le mouvement des « jeunes gens en colère » en un phénomène qui fit partout la une des journaux.
MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
Cette comédie de William Shakespeare (1564-1616), représentée pour la première fois vers 1595-1596 (première édition en 1600), fut probablement écrite à l'occasion d'un mariage aristocratique, d'où son aspect d'épithalame (pièce lyrique composée à l'occasion d'un mariage). En effet, Le Songe d'une nuit d'été se déroule entièrement dans l'intervalle qui sépare l'annonce du mariage de Thésée, duc d'Athènes, et d'Hippolyta, reine des Amazones, et le début effectif des festivités, avec, en particulier, la représentation d'une pièce de théâtre par des artisans, en l'honneur de leur duc (acte V). C'est une comédie à la fantaisie débridée, qui mêle habilement plusieurs intrigues présentées en alternance, où se rencontrent constamment le merveilleux et le comique. Le Songe d'une nuit d'été n'a pas fini de fasciner pour l'extraordinaire liberté d'imagination dont y fait preuve Shakespeare. Une comédie pleine de fantaisie À la cour d'Athènes qui s'apprête à célébrer le mariage princier, deux jeunes gens, Hermia et Lysandre, en appellent à la clémence du duc : Égée, père d'Hermia, veut lui imposer Démétrius, lui-même aimé d'Héléna. Mais Thésée ordonne l'obéissance à la loi du père et à celle d'Athènes ; Hermia et Lysandre n'ont d'autre recours que de s'enfuir dans la forêt, dès la nuit venue, bientôt poursuivis par Démétrius, Héléna sur ses talons (acte II). Or la forêt, lieu symbolique de la licence et du chaos, est en fait la résidence de tout un peuple de fées et de génies, qui redouble la structure sociale de la cour. C'est aussi le lieu retiré qu'a choisi une troupe d'artisans pour répéter une pièce de théâtre (« Pyrame et Thisbé ») qu'ils devront jouer devant le duc. Au début de l'acte II, Obéron et Titania, le roi et la reine des fées, se querellent pour la possession d'un petit page. Obéron décide de se venger de Titania en lui jouant un tour : il ordonne à son génie, Puck, de verser un philtre d'amour sur les yeux de la reine pour qu'elle tombe amoureuse de la première créature qu'elle apercevra au réveil : ce sera Bottom, le tisserand, l'un des comédiens amateurs, affublé par Puck d'une tête d'âne. Obéron décide aussi d'intervenir en faveur des jeunes Athéniens, qu'il a observés : il charge Puck de verser le philtre d'amour sur les yeux de Démétrius pour qu'il aime à son tour Héléna. À la suite d'une confusion de Puck, qui prend Lysandre pour Démétrius, puis croit réparer son erreur, Héléna se voit courtisée à la fois par les deux jeunes Athéniens, au grand dam d'Hermia. À la fin de l'acte III, la confusion est à son comble : la Reine des fées aime un monstre et les amants sont prêts à s'entre-tuer. Mais Obéron veille ; il ordonne que tous soient endormis, plaçant les Athéniens de telle sorte qu'en se réveillant, la première personne qu'ils aperçoivent soit la bonne. Il réveille alors Titania (acte IV, scène 1) pour rire, avec elle, de ses errements sous l'effet de la magie. Une réflexion sur le théâtre Le Songe d'une nuit d'été est une pièce inclassable, où le merveilleux le dispute au comique. C'est une méditation sur les pouvoirs du rêve et de l'imagination face à l'arbitraire de la loi, qui donne une forme dramatique à l'intuition de l'inconscient. Ainsi, la forêt permet aux jeunes gens d'échapper aux rigueurs de la loi familiale et civile et, lieu de tous les aveuglements, de donner libre cours aux passions les plus débridées. Ces expériences-limites, bornées finalement par le retour à la vie réelle au réveil, semblent permettre la libération de leurs pulsions. Rendus à la cour d'Athènes, les jeunes amants paraissent avoir effectué les ajustements nécessaires à la vie sociale, ne gardant de leurs excès nocturnes qu'un souvenir lointain. Mais il s'agit surtout d'une réflexion sur le théâtre : par la pièce des sympathiques artisans, scène de « théâtre-dans-le-théâtre » qui reprend sur le mode burlesque le thème de l'amour contrarié, Shakespeare se moque d'une conception naïve de l'art théâtral, excessivement réaliste. Ainsi les artisans s'acharnent, par exemple, à détruire toute illusion dramatique pour éviter que leur public ne soit terrorisé par leur faux lion - un artisan revêtu d'une peau de bête. Ce théâtre burlesque, parmi les scènes les plus drôles de toute l'œuvre de Shakespeare, renforce par contraste l'illusion de réalité qui permet au reste de la pièce d'emporter l'adhésion. Shakespeare s'y montre au sommet de son art : tout est représentable, semble-t-il nous dire, y compris le magique et le surnaturel, par le simple jeu sur l'imaginaire du spectateur. Car ainsi que le déclare Thésée dans sa fameuse tirade (acte V, scène 1) qui célèbre les pouvoirs de l'imagination, le poète, comme l'amant ou le fou, a des pouvoirs visionnaires qui lui permettent de courir « du ciel à la terre et de la terre au ciel », et par la force d'évocation de faire exister une chose absente
LA NUIT DES ROIS
Cette comédie majeure de William Shakespeare (1564-1616), publiée pour la première fois en 1623, fut sans doute écrite pour être jouée à l'Épiphanie de 1601. Moment où le temps païen reprend le pas sur le temps chrétien, la « Douzième Nuit », pour reprendre le titre original de la pièce (Twelfth Night or What you Will) était, dans le calendrier élisabéthain, la dernière nuit des fêtes de Noël, traditionnellement allouée aux travestissements et aux jeux puis au théâtre. La Nuit des rois appartient, avec La Comédie des erreurs et Comme il vous plaira, à la catégorie des comédies dites « romantiques » de Shakespeare. La pièce se caractérise par l'élagage spectaculaire de l'environnement sociopolitique, au profit d'une intrigue amoureuse. Il s'agit d'une œuvre joyeuse, où la musique joue un grand rôle, mais dont la tonalité s'avère cependant ambivalente lorsque, à l'orée de l'acte V, l'atmosphère festive cède la place à une note plus sombre : le jeu des désirs amoureux et les excès de la farce menacent en effet de provoquer un déchaînement de violence. Il faudra que l'excès soit purgé pour que l'harmonie sociale puisse être rétablie. Une comédie des erreurs Shakespeare reprend à son compte plusieurs sources italiennes et anglaises, mais, à son habitude, pour les transformer de manière radicale. Ainsi ses sources du XVIe siècle (Bandello notamment) comprennent toutes les éléments stéréotypés d'une intrigue comique marquée par l'influence de Plaute : un amant malheureux, une héroïne déguisée en page qui tombe amoureuse du premier, son frère jumeau, une seconde héroïne, amoureuse du jeune page - qui est amené à jouer les intermédiaires entre son maître et la belle -, un naufrage, des confusions d'identités... Mais si Shakespeare semble accepter ces conventions, c'est pour mieux les transformer, en insufflant à ses personnages une vérité psychologique absente des modèles. Viola, notamment, véritable pivot de la pièce, devient l'un de ces personnages féminins inoubliables dont Shakespeare a le secret. Image du deuil inconsolable lorsqu'elle croit perdre son frère jumeau Sébastien dans un naufrage au début de la pièce, elle incarne ensuite l'amour véritable et adulte face aux errements des autres personnages, et en particulier ceux de l'homme qu'elle aime, le duc Orsino, dont la mélancolie pétrarquisante donne à la pièce une tonalité lyrique - mais aussi quelque peu comique - dès la première scène : « Si la musique est nourriture d'amour, joue encore,/ Donne-m'en à l'excès afin que, rassasié,/ Mon appétit languisse et meure./ Encore cette mélodie, elle avait une cadence mourante... » Tous les amants - Orsino, la comtesse Olivia amoureuse d'une illusion (Viola qui s'est travestie en page et a pris le nom de Cesario pour entrer au service d'Orsino), Sir Andrew Aguecheek le fat coureur de dot, ou Malvolio, l'intendant puritain amoureux de sa maîtresse - sont en effet caractérisés par une forme de folie amoureuse qui relève de l'aveuglement sur soi et sur le monde. Malvolio et le principe du carnaval L'une des grandes réussites de la pièce tient dans l'entrelacs savant entre l'intrigue principale, centrée sur les amourscontrariées des protagonistes, et une intrigue secondaire de pure comédie. Celle-ci concerne les aventures amoureuses parodiques de sir Toby Belch et de sa bande de bons vivants, qui vivent en parasites dans la maison de sa nièce, la belle Olivia, celle-là même qu'Orsino aime en vain. Il faut tout l'art de Shakespeare pour assurer l'unité structurelle et thématique de ces deux niveaux : certes, quelques personnages évoluent également dans les deux sphères, tels le page Viola-Cesario et le personnage mémorable du bouffon d'Olivia, Feste, qui par ses commentaires obliques éclaire l'action. Mais l'unité est surtout d'ordre thématique et symbolique : d'Orsino à Olivia en passant par sir Toby Belch, Malvolio et son acolyte et dupe sir Andrew Aguecheek, tous les personnages incarnent par leurs excès la nécessité de la mesure et du retour à l'ordre. Nul n'incarne mieux ce dérèglement passionnel que sir Toby Belch, perpétuellement prêt à faire la fête, lorsqu'il s'oppose à son ennemi intime, l'intendant puritain Malvolio, en lui faisant croire à l'amour que lui porterait sa maîtresse Olivia. Leur affrontement n'est pas sans évoquer l'opposition entre carnaval et carême. C'est l'occasion d'une scène comique d'anthologie au cours de laquelle Malvolio est amené à se travestir et à employer un langage codé pour, croit-il, plaire à Olivia - qui conclut à un accès de folie. Mais cette intrigue se solde par un épisode semi-tragique lorsque Malvolio est enfermé et torturé moralement par Feste, déguisé en faux prêtre exorciste : la farce tourne à l'aigre. Dans la très longue dernière scène, qui occupe tout l'acte V, toutes les complications de l'intrigue, après un moment de tension maximale, sont résolues de façon quasi rituelle : la comédie menace en effet de se changer en drame, lorsque Orsino, qui croit que Viola-Cesario a épousé secrètement Olivia
EDWARD BOND
Dramaturge prolifique, dont les premières pièces datent des années 1960 (The Pope's Wedding, 1962 ; Saved, 1965 ; Narrow Road to the Deep North et Early Morning, 1968), le Britannique Edward Bond n'a cessé d'embrasser, jusque dans ses pièces les plus récentes, le marasme contemporain. Accommodant le théâtre épique à son propre système, il a fait du paradoxe la figure privilégiée de son travail théâtral. Le destin de Bond, qui répugne depuis de nombreuses années à confier ses pièces aux institutions théâtrales anglaises, passe depuis plus d'une décennie par la France. Le metteur en scène Alain Françon est devenu son interlocuteur privilégié, après avoir monté La Compagnie des hommes (In the Company of Men) en 1992, puis les Pièces de guerre(The War Plays) trois ans plus tard. Le Théâtre national de la Colline a ainsi trouvé en Edward Bond le « phare » de sa mission de service public. Un théâtre du cataclysme Edward Bond est né en 1934 à Holloway. Lié dans un premier temps au Royal Court Theatre de Londres, connu comme un laboratoire d'avant-garde, Bond fut associé au Royal Court Writer's Group. Il y acquit, au contact de metteurs en scène comme William Gaskill ou George Devine, une expérience concrète de la scène et du jeu théâtral, dimension qu'il développera par la suite au cours de nombreux ateliers d'acteurs, mettant au point une véritable théorie de l'interprétation. En 1965, Saved, description du sous-prolétariat anglais culminant dans une scène de lapidation d'un bébé dans son landau, provoque une polémique enflammée. Trois ans plus tard, le scandale est reconduit par Early morning, allégorie antivictorienne baignée d'une atmosphère cauchemardesque. Saved, montée par Claude Régy (Sauvés, 1972) va contribuer à faire découvrir Bond en France, avant que Patrice Chéreau ne le consacre grâce à sa mise en scène de Learen 1975. Profondément marqué par l'héritage shakespearien (Bingo, écrit en 1973, montre un Shakespeare aux prises avec la dimension matérielle du réel social), et plus encore par l'esprit et la violence des représentations de l'âge élisabéthain, Bond se réfère aussi volontiers à l'institution de la tragédie athénienne, dont il conceptualise à plusieurs reprises l'apport dans L'Énergie du sens (1998), sa principale somme esthétique et théorique, ou dans son Commentaire sur les « Pièces de guerre », écrit quelques années plus tôt. Cette analyse se veut un corollaire de son œuvre la plus ambitieuse, la trilogie des Pièces de guerre (The War Plays, 1985), sans doute aussi la plus universelle, en ce qu'elle entreprend de se charger du sort du genre humain tout entier, dépeint à travers les survivants d'un cataclysme nucléaire en forme d'apocalypse. => La fiction, légèrement anticipatrice, vise ici comme souvent chez Bond à mettre en évidence le mal d'une structure sociale. Edward Bond prolonge ce type de structure avec Café, montée par Alain Françon en 2000, au Théâtre national de la Colline, à Paris, qui prend comme point de départ le massacre de Babi Yar lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces pièces à valeur de démonstration entreprennent de sonder les fondements de l'histoire du XXe siècle. Elles font montre d'une architecture complexe, pourvoyeuse d'un large effet d'abstraction, et franchissent sans relâche les frontières entre présent, passé et futur, réel et imaginaire. Jackets or The Secret Hand (Jackets, ou la Main secrète, 1990) repose sur une organisation binaire, une fable japonaise située au XVIIIe siècle occupant la première partie, tandis que dans la seconde prend place de nos jours un drame en milieu urbain. Tuesday (monté par la troupe de Christian Benedetti en 1999 à Alfortville, autre pôle de dialogue entre Bond et les praticiens français) met à profit la tension entre le cloisonnement d'une chambre d'adolescent et le déchaînement du monde extérieur, qui l'envahit brutalement. Plus encore, peut-être, que dans l'art de la composition dramatique, la maîtrise de Bond éclate dans l'invention d'images poétiques sans précédent, concentrées à l'extrême et rayonnant d'une étrange puissance, tant allégorique que littérale. Après Café, les principales mises en scène d'Edward Bond en France sont encore le fait d'Alain Françon au Théâtre de la Colline. L'écriture de Bond adopte alors une inflexion plus morale que directement politique. Il sonde les universaux, s'interroge sur la notion d'« humanité »
PINTER HAROLD
Harold Pinter se situe, parmi les auteurs dramatiques de l'après-guerre, au premier rang de la « nouvelle vague » anglaise, grâce à une production variée qui commence en 1957. Acteur pendant une dizaine d'années et plus tard metteur en scène, poète et auteur de nouvelles, puis de saynètes et de pièces pour le théâtre, la radio et la télévision, il est devenu, par ses adaptations cinématographiques de romans contemporains, un scénariste recherché. C'est sur ses œuvres théâtrales qu'est fondée sa notoriété : dans ce domaine, c'est l'écrivain le plus novateur et le plus fécond de sa génération. Le prix Nobel de littérature lui a été décerné en 2005. Né en 1930 dans une famille israélite, Pinter a grandi dans un quartier juif de l'East End de Londres. Il en sort objecteur de conscience, et obsédé par les situations de conflit où la seule issue est l'assujettissement, sinon l'anéantissement de l'Autre : c'est cette situation type que, en la dépouillant de toute spécificité historique, il reproduit sans cesse dans son œuvre. La parole y fonctionne essentiellement sur le mode du déni, comme écran de fumée (smoke screen) ou brouillage de piste : « On peut considérer le langage comme un stratagème systématique pour cacher sa propre nudité. » C'est ce qu'illustre cette anecdote exemplaire : face à un groupe de fascistes qui s'apprêtent à le rouer de coups, Pinter, encore lycéen, entame le dialogue suivant : « Ça va ? - Moi, ça va. - Alors ça va », et il s'éloigne, indemne. Il vit pendant près de dix ans tantôt de ses talents d'acteur (sous le nom de David Baron, il fait des tournées en province et en Irlande), tantôt de petits métiers - camelot à Oxford Street, contrôleur de billets dans un bal public, vendeur de tout et de rien. C'est ainsi qu'il entre en contact avec des êtres marginaux, tout un monde crépusculaire d'habitants de garnis, de logeuses de province, de clochards, de blousons noirs et de maquereaux, qui peuplent certaines de ses pièces. Une dramaturgie de l'Innommable Née du prodigieux renouveau de l'écriture dramatique au milieu des années 1950 qui a, pour la première fois, ouvert les théâtres prestigieux du West End à de jeunes auteurs, souvent d'origine populaire, l'œuvre de Pinter se situe au carrefour de deux genres : le théâtre dit de l'Absurde et un genre spécifiquement britannique, le néo-naturalisme de l'école de la Cuisine. Pour des auteurs comme Wesker, la peinture réaliste d'un cadre de vie et d'un langage est le véhicule d'une réflexion sociale ou politique : le langage est conçu comme le reflet direct du cadre qui le produit. (In the later 1950s, a term applied (often disparagingly) to the new wave of plays that dealt realistically with the domestic lives of working or lower middle class characters. The use of humdrum or seedy settings in such plays as Osborne's Look Back in Anger (1956), Shelagh Delaney's A Taste of Honey (1958), and Wesker's Roots (1959), represented a decisive break with the elegant drawing-room comedies of (for instance) Noël Coward or Terence Rattigan. Roots actually begins with a character standing at a kitchen sink. The term had previously been applied to the kitchen-sink school, a group of British artists, who held several joint exhibitions in the 1950s. They were known for painting scenes of working-class domesticity in a drably realistic style). C'est tout le contraire de ce qui se passe chez Pinter, dont l'œuvre comme la personnalité se placent sous le signe d'un scepticisme extrême qui se rattache à la grande tradition de la philosophie anglaise. C'est dans cette coupure radicale entre le dire et l'être que réside la spécificité de ce que l'on dénomme le « dialogue pintérien » : expression qui est entrée dans la langue anglaise pour désigner tout échange de propos apparemment anodins, voire vides de sens, mais où couvent tantôt de sourdes tensions, sinon de véritables luttes à mort, tantôt des désirs larvés. Ce double registre, cet écart maximal entre le dit et le non-dit, voilà ce qui constitue « un territoire qu'il vaut la peine d'explorer et même qu'il faut explorer ». C'est ce no man's land - le domaine du tabou - qui se trouve au centre des recherches de cet auteur.
PETER BROOK
L'apport de Peter Brook tient d'abord au profond renouvellement de la mise en scène qu'il fait subir au théâtre de Shakespeare, en Angleterre, grâce à des spectacles mondialement connus. Il se manifeste aussi dans son travail d'exploration des écritures contemporaines. Au début des années 1970, il opère une rupture en s'installant à Paris, où il crée, avec Micheline Rozan, le Centre international de recherches théâtrales (C.I.R.T.) et se consacre aussi bien à une recherche de groupe sur le langage théâtral qu'à l'exploration de grands textes épiques fondateurs et de textes scientifiques, sans pour autant abandonner Shakespeare. Chercher partout : de Shakespeare au boulevard Après quelques spectacles remarqués, le directeur du nouveau Festival Shakespeare le convie à Stratford où il monte Peines d'amour perdues (1945-1946), en affichant déjà son intérêt pour les œuvres dites « secondaires » de Shakespeare, rarement jouées à l'époque. => Il se libère de l'autorité du plan de mise en scène préalablement établi pour se fier aux rapports directs avec les comédiens et renouveler le processus d'élaboration du spectacle. Passionné et actif, Peter Brook s'attache aussi à la mise en scène d'opéra et réalise un retentissant Boris Godounov, donné à Covent Garden en 1948. Adoptant un parti pris d'éclectisme, il présente successivement des auteurs aussi divers que Sartre, André Roussin, Dostoïevski ou Anouilh... Après un Hamlet (1955, pièce à laquelle il reviendra en 2000 avec La Tragédie d'Hamlet), qui est l'occasion d'une tournée triomphale à Moscou, Brook s'impose la même année, avec un spectacle qui est considéré comme son premier chef-d'œuvre, Titus Andronicus de Shakespeare, dont la cruauté extrême apparaît telle une sorte de reflet du monde moderne. Brook met en évidence la violence de l'œuvre en utilisant la « musique concrète », à peine affirmée à l'époque. Puis il alterne les registres et passe d'une comédie musicale, Irma la douce (1959) d'Alexandre Breffort sur une musique de Marguerite Monnod, au Balcon (1960) de Jean Genet, où il réunit pour la première fois une distribution hétéroclite qui rassemble des acteurs amateurs et des professionnels, des comédiens noirs et blancs, véritable imago mundi. La « voie double » À la même époque, à l'invitation de son directeur Peter Hall, Brook accepte de rejoindre la Royal Shakespeare Company, à condition de pouvoir se livrer à un travail de recherche sans impératif de présentation publique. Il imagine une structure autonome, intitulée Lamda theatre, au sein de laquelle s'amorce une importante investigation sur le langage de l'acteur. Aventure de laboratoire qui débouchera sur une présentation célèbre de textes non théâtraux ou de fragments réunis sous l'intitulé « artaudien », Le Théâtre de la cruauté. Dans cet esprit, Brook met en scène, en 1964, Marat-Sade de Peter Weiss, où il s'attaque à la question des rapports entre la politique et la folie. Peter Brook, dans ces années d'effervescence, montre un vif intérêt pour le « théâtre documentaire » ; il met en scène, à Paris, Le Vicaire (1963) de Rolf Hochhuth, qui provoque un énorme scandale en dénonçant le silence du Vatican durant la Seconde Guerre mondiale, et organise une lecture de l'Instruction (1965) de Peter Weiss, une évocation des camps de concentration. Dans la même voie, le spectacle US (1966), qui condamne la guerre du Vietnam, est réalisé à base d'entretiens avec les gens de la rue. Cependant, alors qu'il semble attacher sa réflexion au monde contemporain, à la surprise générale, il met en scène une pièce ancienne, oubliée, jamais jouée, Œdipus rex (1968) de Sénèque, qu'il traite avec une sobriété tragique, austère et rituelle. Brook réalise deux films à partir de ses spectacles : Marat-Sade (1967) et Le Roi Lear (1971). Puis il publie L'Espace vide(1968), livre organisé en quatre parties (le « Théâtre mortel », le « Théâtre sacré », le « Théâtre brut » et le « Théâtre immédiat ») Un nouveau départ : le Centre international des recherches théâtrales et les Bouffes du Nord Installé à Paris, Peter Brook, libéré des exigences de la production théâtrale habituelle, se lance d'abord dans une recherche radicale qui porte sur la voix et les sons « premiers ». Il fait travailler les membres de son équipe sur des langues anciennes dans les espaces mythiques de Persépolis. Les recherches aboutiront à une version du mythe de Prométhée placée sous le signe de la quête des origines : Orghast (1971), proche du « théâtre sacré ». Il entraîne ensuite son équipe dans une expédition de trois mois en Afrique, afin d'expérimenter les ressources du « théâtre brut ». Ici les comédiens, privés de leurs appuis habituels, le prestige de leur statut ou celui du texte, jouent dans des villages et découvrent les ressources de l'improvisation aussi bien que l'obligation de fonder l'échange avec le public sur la base d'un élément concret, matériel, compréhensible : une botte, un pain, un chapeau. L'année suivante, l'équipe part aux États-Unis où elle intervient dans des réserves d'Indiens. La même quête de communication se poursuit. Après ces années de voyage, Brook décide de revenir à une activité publique. Pour abriter le Centre international des recherches théâtrales, la salle des Bouffes du Nord est mise à sa disposition à partir de 1974. Restauré, le lieu répond à ses attentes, synthétise son esthétique et constitue un véritable sceau identitaire. Par ailleurs, en shakespearien jamais démenti, il distribue les volumes du théâtre selon les principes du modèle élisabéthain.
MARLOWE, CHRISTOPHER - DOCTOR FAUSTUS
L'auteur de The Tragical History of Doctor Faustus (créée entre 1588 et 1592, première publication en 1604) est un personnage presque aussi mythique que son héros : poète et dramaturge talentueux, espion, grand amateur de vin et de garçons, intellectuel proche des milieux de libres-penseurs, Christopher Marlowe (1564-1593) fut assassiné lors d'une mystérieuse rixe dans une taverne. Cet enfant terrible de la période élisabéthaine affiche une prédilection pour les héros ambitieux qui n'hésitent pas à défier l'ordre divin pour affirmer leur volonté de pouvoir ou de savoir : Tamerlan (Tamburlaine the Great, 1590), destructeur d'empires que son ambition démesurée mène à sa perte, mais surtout Faustqui vend son âme au diable pour transcender la finitude et pénétrer les secrets de l'univers. Un pacte avec le diable Marlowe hérite son personnage du Faustbook (1587), biographie allemande romancée d'un personnage réel, qui se présente comme une mise en garde destinée aux penseurs fascinés par les sciences occultes. Marlowe en fait un personnage tragique, qui découvre le dérisoire de la connaissance devant l'insurmontable finitude de l'homme. La pièce, publiée pour la première fois en 1604, puis dans une version différente, plus longue, en 1616, retrace sous forme de tableaux quelques événements qui séparent le moment où Faust décide d'abjurer la science et de choisir la magie et celui, vingt-quatre ans plus tard, où Lucifer vient réclamer son âme. Guidé par Méphistophélès, Faust explore les secrets de la terre et du cosmos ; il s'attarde à Rome où, invisible, il contrecarre la politique papale et, au passage, joue quelques tours au pape lui-même. Puis, l'acte IV (dans l'édition de 1616, puisque celle de 1604 est seulement divisée en une série de scènes) nous le montre devenu l'hôte des grands de ce monde, à qui il offre de splendides divertissements. À l'acte V, l'action se resserre sur le débat intérieur de Faust : guidé par un vieil homme, figure du Bien, il est à deux doigts du repentir. Mais Méphistophélès veille : il le rappelle à son pacte et lui octroie la consolation d'une nuit d'amour avec Hélène de Troie, figure emblématique de la beauté humaine. Après un dernier monologue, déchirant, dans lequel Faust se montre prêt à renoncer à la dignité humaine pour éviter la mort, il est attiré dans la gueule d'Enfer : « Ô mon Dieu !/ Même si tu n'as pas pitié de mon âme,/ Pour l'amour du Christ dont le sang est mon rachat,/ Ordonne une fin à l'incessante souffrance !/ Que Faust en enfer reste mille ans, cent mille,/ Mais qu'à la fin des fins il soit sauvé ! » Un enchantement baroque Cette pièce doit encore beaucoup à la moralité médiévale, drame religieux obéissant à une structure stéréotypée où on voyait un personnage souvent baptisé Everyman, allégorie de l'homme en général, découvrir peu à peu la voie du salut. La pièce partage avec ce genre dramatique la structure en tableaux, assez lâchement reliés les uns aux autres, un certain hiératisme des personnages - seul Faust connaît un véritable développement psychologique, les autres protagonistes étant souvent réduits à n'être que des fonctions -, ainsi que l'alternance entre scènes sérieuses et scènes de farce. La dimension allégorique est, elle aussi, présente : Faust est tiraillé entre des figures du Bien dont la rencontre est toujours prélude à une phase de repentir (le bon Ange, le vieil homme) et ces figures du Mal que sont Méphistophélès et son maître Lucifer. Mais, le schéma de la moralité est quelque peu subverti : nul salut n'est ici possible. Le pacte initial rend irréversible la faute originelle, qui relève d'un choix purement intellectuel. L'homme qui voulait transcender sa finitude et rencontrer Dieu doit expier son orgueil démesuré. Faust, cet homme de la Renaissance conscient des limites du savoir scolastique, est bien un héros tragique moderne, celui de la volonté de savoir, couplée à la volonté de pouvoir. Mais le marché avec Lucifer est un marché de dupes : ce pouvoir, finalement, n'est guère qu'illusion. Et de fait, le magicien qu'est devenu Faust est tantôt spectateur des scènes ou des divertissements qu'invente Méphistophélès à son intention, tantôt lui-même le maître d'illusion, le metteur en scène de tableaux historiques ou mythologiques à l'intention de ses hôtes. Marlowe fait ainsi de sa pièce un véritable enchantement baroque où c'est la magie du théâtre lui-même qui est mise en abyme.
WILDE OSCAR
La célébrité d'Oscar Wilde tient à son destin. Prodigieusement doué, d'un esprit étincelant qui subjugua la société londonienne, fin lettré, nourri de Swinburne, de Ruskin, de Walter Pater, il a surtout été considéré comme un esthète décadent et révolté : son procès pour mœurs acheva de faire de lui une figure publique entourée d'éclat, de honte et de scandale. Lui-même savait combien la vie empiétait dangereusement sur son art et sur sa personne quand il confiait à Gide « avoir mis tout son génie dans sa vie et son talent seulement dans son œuvre ». Son personnage fut, et par sa propre faute, entouré par une légende de causeur génial et d'écrivain mineur, mais ses poèmes, son roman Le Portrait de Dorian Gray, sa correspondance, dont la lettre si importante dite De profundis écrite à lord Alfred Douglas en 1897, révèlent une personnalité divisée et tragique, un profond narcissisme, une attirance de l'échec qui l'apparentent aux romantiques et sur lesquels il faut de nouveau s'interroger. Une hérédité complexe L'hérédité et l'éducation jouent un rôle particulièrement important dans la vie d'Oscar Wilde : sa mère, Jane Francisca Elgee, ardente poétesse qui avait choisi comme pseudonyme Speranza, collaborait au journal nationaliste irlandais The Nation quand un procès retentissant mit fin à ses activités littéraires. Comme d'autres furent accusés d'avoir composé les appels aux armes dont elle était l'auteur, elle revendiqua la paternité de ses écrits. Cette Junon théâtrale, courageuse, capable de grandeur comme de grotesque, finit par épouser William Wilde, oculiste célèbre et chirurgien, don Juan obstiné, d'une infatigable activité. La carrière brillante de ce médecin fut à son tour interrompue par les accusations venimeuses d'une maîtresse abandonnée, d'où un procès entouré de ridicule qui signa la déchéance d'un des hommes les plus remarquables d'Irlande. Oscar Wilde et son frère, Willie, assistèrent à cette lente dégradation qui se termina par la mort de leur père avant la cinquantaine. À la naissance d'Oscar à Dublin, lady Wilde désirait à tout prix une fille ; elle déguisa sa déception en travestissant son fils qui fut élevé comme la fille qu'elle n'avait pas eue. La naissance d'une petite Isola n'y changea rien et la mort à l'âge de neuf ans de cette sœur fut un grand drame dans l'enfance de Wilde : « Toute ma vie est enterrée là, jetez de la terre dessus », écrira-t-il dans un poème. Drame d'autant plus marquant que la mère demeurait, plus que jamais, l'unique figure féminine qui sût le retenir. Ainsi ce fils d'un couple fantasque, original, ce produit d'une « famille sale, désordonnée, hardie, imaginative et cultivée », selon les termes de Yeats, sera-t-il la victime d'une enfance étrange et d'une hérédité « aux mains chargées de présents ». « Ce n'est pas notre propre vie que nous vivons, mais la vie des morts », écrira-t-il dans Intentions (1891). Le drame de l'ambiguïté Oscar Wilde connut les esprits les plus remarquables de l'Angleterre de son temps : Dante Gabriel Rossetti, Robert Browning, Meredith, Swinburne et Whistler. On n'a que trop insisté sur sa conversation éblouissante, son goût du paradoxe, ses aphorismes insolents, sur son cynisme et son humour que l'on retrouve dans les excellentes reparties de ses pièces. Entre 1887 et 1895, l'écrivain connut une période de grande créativité et de succès immédiat avec ses contes, comme Le Crime de lord Arthur Savile (Lord Arthur Savile's Crime, 1891), son Portrait de Dorian Gray, roman « prémonitoire » étrangement torturé et puritain, ses pièces : L'Éventail de lady Windermere (Lady Windermere's Fan, 1892), Une femme sans importance (A Woman of No Importance, 1893), Un mari idéal (An Ideal Husband, 1895), L'Importance d'être constant (The Importance of Being Earnest, 1895). Mais l'intérêt de la personnalité de Wilde réside en son ambiguïté. Derrière l'insolence du dandy en apparence révolutionnaire se cache un autre Wilde, secrètement attiré par les forces de mort. Gide avait bien compris combien le théâtre de Wilde comportait sa propre « image dans le tapis » et que « son esthétisme d'emprunt n'était pour lui qu'un revêtement ingénieux pour cacher en révélant à demi ce qu'il ne pouvait laisser voir au grand jour ». Un autre écrivain aura l'intuition du fond tragique de l'œuvre wildienne : Hugo von Hofmannsthal. Dans son étude Sébastien Melmoth, il écrit : « Le destin de cet homme aura été de porter successivement trois masques : Oscar Wilde, C. 3.3., Sébastien Melmoth », et de descendre « vers la catastrophe du même pas qu'Œdipe aveugle et clairvoyant ». Certaines hantises reviennent dans les contes, les essais et le théâtre, celles du masque, de la mort et de la femme liée à la destruction.
SHAW GEORGE BERNARD
La personnalité de Shaw, son extraordinaire vitalité, ses écrits politiques, sociaux et philosophiques, surtout son éblouissant théâtre d'idées dominent la scène littéraire anglaise de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Tour à tour romancier, critique littéraire, musical, dramatique, vulgarisateur des idées socialistes, brillant causeur, pamphlétaire paradoxal, réformateur impénitent et surtout auteur dramatique de tout premier plan, il s'imposera à la société anglaise de son temps, à la fois divertie par son humour et son génie comique et irritée par ses prises de position politiques, son didactisme de prophète ou ses extravagances. Le masque parfois excentrique ou sarcastique de G. B. S. Le réformateur social et le critique George Bernard Shaw naît à Dublin, d'une bonne famille d'origine anglo-écossaise et protestante. Une conférence de l'économiste H. George en 1882 et la lecture de Marx l'ont converti au socialisme qui lui apparaît comme la seule solution possible aux problèmes sociaux. La satire sociale et la lutte pour l'amélioration de la société occuperont une grande partie de sa vie. Pendant une quinzaine d'années (1883-1898), il déploie une intense activité dans deux directions : celle du socialisme et celle de la critique d'art. Son intérêt pour les questions sociales, économiques et politiques ne fléchira pas puisqu'il publiera, en 1928, le Guide de la femme intelligente en présence du socialisme et du capitalisme (The Intelligent Woman's Guide to Capitalism and Socialism). L'auteur dramatique Depuis 1892, Shaw est attiré par un nouveau mode d'expression où il va exceller : le théâtre. De 1892 à 1950, il écrit plus de cinquante pièces, dont une trentaine d'au moins trois actes. Les sept premières sont publiées en 1898 sous le titre Pièces plaisantes et déplaisantes (Plays, Pleasant and Unpleasant). L'Argent n'a pas d'odeur (Widower's Houses, 1892), L'Homme aimé des femmes (The Philanderer, 1893) et La Profession de Mrs. Warren (Mrs. Warren's Profession, 1893) sont des pièces de combat, s'attaquant de front aux abus sociaux : les propriétaires de taudis, la prostitution, hypocrisie générale qui masque les réalités sordides. Le pamphlet et la satire dominent, la technique dramatique est encore peu sûre. Shaw s'oriente rapidement vers des pièces plus jouables dans lesquelles la satire est portée par une verve comique et humoristique qui va se développer : Le Héros et le soldat(Arms and the Man, 1894) attaque l'idéal romantique ou romanesque, la gloire militaire, la guerre ; Candida (1894) oppose le bonheur domestique, l'amour et la solitude de l'homme de génie ; L'Homme du destin (The Man of Destiny, 1895), pochade sur Bonaparte, et On ne sait jamais (You Never Can Tell, 1895) complètent le groupe des « pièces plaisantes ». Les Trois Pièces pour puritains (Three Plays for Puritans, 1901) contiennent entre autres Le Disciple du diable (The Devil's Disciple, 1896), où est abordé le problème religieux et surtout César et Cléopâtre (Caesar and Cleopatra, 1898), pièce dans laquelle éclatent le comique verbal de Shaw et son traitement irrévérencieux de l'histoire. L'art et l'humour au service de la pensée Les grands thèmes du théâtre de Shaw : l'art conçu comme didactique et réformateur, le socialisme iconoclaste destiné à détruire les structures présentes et à instaurer une juste démocratie dont les citoyens seront des surhommes. On peut citer Mieux que Shakespeare ?, Sur les médecins, Épître dédicatoire à A. B. Walkley, Le Demi-Siècle incroyant, L'Avenir du christianisme. Du point de vue de la technique dramatique, l'apport de Shaw n'est pas moins important. Pour redonner vie au théâtre anglais, il substitue au conflit des passions, devenu banal et conventionnel, un conflit d'idées, tout aussi dramatique, car pour Shaw les pensées sont aussi des passions, passions intellectuelles, certes, mais aussi fortes que les autres. Ces discussions sont portées par un dialogue où l'humour, l'esprit, le paradoxe et la fantaisie sont toujours présents dans une sorte de gaieté intellectuelle. Il faut aussi noter le soin apporté par Shaw à préciser le décor, l'attitude des personnages et leurs réactions dans des indications scéniques très développées.
SHERIDAN RICHARD BRINSLEY
La vie et l'œuvre de Sheridan se partagent entre le théâtre et la politique. Jouet d'une oligarchie puissante, qui se servait de son éloquence, il n'a pas réussi vraiment sa carrière politique bien qu'ayant écrit quelques-uns des meilleurs discours de l'histoire parlementaire britannique. Son œuvre théâtrale demeure pétillante d'esprit, trépidante de vie et de gaieté. Ses comédies narquoises reflètent surtout l'attitude profonde de Sheridan, humoriste qui ne semblait pas prendre la vie au sérieux, peut-être parce qu'il mettait très haut les valeurs fondamentales. Un personnage énigmatique Né à Dublin, fils de Thomas Sheridan, homme de théâtre irlandais, et de Frances Sheridan, romancière réputée, Richard Brinsley Sheridan reçoit une bonne éducation à Harrow. Un mariage romanesque, avec enlèvement et duel, l'oblige à se tourner vers le théâtre pour gagner sa vie et lui inspire sa première comédie, The Rivals (1775). Profondément remaniée après un semi-échec, elle finit par s'imposer. Sheridan est lancé et donne la même année une farce, St. Patrick's Day, et un opéra-comique, La Duègne (The Duenna), également très réussis. Grâce à d'habiles arrangements financiers, Sheridan rachète à Garrick sa part de Drury Lane, qui va devenir son théâtre et son gagne-pain. En 1777, il fera représenter un des chefs-d'œuvre de la comédie anglaise, L'École de la médisance (The School for Scandal), avec une distribution étincelante, puis en 1779 une farce, The Critic, qui reste une des meilleures satires de l'illusion théâtrale. Dès 1780, Sheridan se désintéresse du théâtre, dans lequel il ne voit plus qu'un moyen de financer sa vie politique, qui désormais l'accapare. Il reconstruit Drury Lane en 1794, y donnera Pizarro, tragédie à la mode du Sturm und Drang. Ruiné par un incendie en 1809 et pressé de dettes, il cède ses parts. Sa carrière politique se poursuit avec des succès et des revers, car il s'est lié au parti whig et s'est fait le fidèle partisan du prince de Galles. Sa fin aurait pu être lamentable : ivrogne accablé de dettes, ayant perdu son théâtre, remarié avec une femme qui ne l'aime guère, éloigné de la vie politique, il meurt à Londres presque isolé. Pourtant il n'a pas été oublié ; discrètement, le prince et ses amis whigs lui sont venus en aide. Ils assistent à son enterrement qui fut grandiose, et qui eut lieu à Westminster. La personnalité de Sheridan est quelque peu énigmatique. Personnage léger et fantasque, il ne se laisse pas saisir ni enfermer en quelques formules. Il y a une tragédie dans la vie de cet homme de salon recherché pour son esprit et de ce grand auteur whig.L'ambiguïté d'une œuvre Bien qu'étant l'auteur de la meilleure comédie, du meilleur opéra et de la meilleure farce du XVIIIe siècle anglais, Sheridan n'a pas vraiment réussi sa carrière d'homme de théâtre. Pourtant il aimait son métier qu'il possédait parfaitement. Ses pièces étaient écrites pour sa troupe, ce qui explique la perfection de L'École de la médisance. Quoique par ailleurs fort négligent en tant que directeur, il met en scène lui-même avec minutie. Des Rivaux au Critique sa sûreté s'affirme. Les comédies de Sheridan sont dans la tradition de la comédie de mœurs, comedy of manners, héritée de la Restauration. En 1775, diverses influences, et surtout le sentimentalisme, avaient transformé l'atmosphère désinvolte et libertine de 1660 ; le théâtre produisait surtout des pièces édifiantes et larmoyantes (sentimental comedies). Sheridan renoue avec la comédie gaie sans oublier complètement les leçons du sentimentalisme. Ses comédies sont enlevées, leur rythme rapide est bien celui de la vie de ces jeunes écervelés, un peu étourdis, mais garçons de cœur, qu'il aime mettre à la scène. Ces grands rôles mènent le jeu à une allure endiablée qui entraîne l'adhésion du public. Si l'on y regarde de près, l'attitude de Sheridan demeure ambiguë. Du point de vue moral, s'il a le goût de l'insouciance et d'une certaine légèreté, Sheridan ne repousse pas les vertus du cœur : il dénonce l'hypocrisie et s'attendrit volontiers sur la générosité et la bonté. Du point de vue littéraire, cet auteur qui dans Le Critique s'est abondamment moqué de l'artifice théâtral, de l'emphase et de la fausse éloquence, surtout dans la tragédie, a introduit en Angleterre, en tant que directeur, les tragédies romantiques allemandes de Lessing et Kotzebue ; ce défenseur de la vraie comédie a cédé à la vogue des arlequinades et de la farce, pour le plus grand plaisir de son public, a permis la résurrection de la comédie et, pour flatter ce même public, a peut-être favorisé une certaine décadence du théâtre anglais.
MARTIN CRIMP
Né dans le Kent, élevé à Londres et dans le Yorkshire, Martin Crimp poursuit des études littéraires à Cambridge. L'Orange Tree Theatre donne ses premières pièces - Living Remains (1982), A Variety of Death Defying Acts (1985) -, tandis que, parallèlement, il écrit pour la radio - Three Attempted Acts (Giles Cooper Award, 1985), Definitely the Bahamas (prix Radio Times Drama 1986). Orfèvre de la langue, Martin Crimp est l'auteur de nombreuses adaptations et de traductions - Le Misanthrope de Molière (1996), Les Chaises de Ionesco (1997), Roberto Zucco de B. M. Koltès (1997), Les Bonnes de Genet (1999) - et d'un roman, Stage Kiss (1991). On lui doit également le livret de Into the little Hill (2006) et Written on the skin (2012), deux opéras de George Benjamin. Dès le début, on sent dans l'œuvre de Martin Crimp une volonté de retour au théâtre du verbe : les mots, leur musicalité, leur rythme surtout sont les principaux ressorts de sa dramaturgie. Ses pièces se tissent en recourant à d'incessants effets de répétition. Circulaire, jouant des différentes formes d'un même vocable, le texte se développe par une suite d'insensibles progrès, à l'échelle d'une scène comme de l'œuvre tout entière : les thèmes effleurés ici sont repris là, faisant du texte en son entier une métaphore de l'errance existentielle des personnages. Le langage est le lieu où ceux-ci se disent, s'inventent et se rendent réels. Partant, c'est également le lieu du pouvoir et de la menace, ce qui n'est pas sans rappeler l'univers de Harold Pinter. The Country (2000), qui met en scène un couple de Londoniens retirés à la campagne pour échapper au passé et à la corruption de la ville mais qui sont rattrapés par eux, lorsqu'ils revêtent les traits d'une jeune et jolie fille, est sans doute la plus « pintérienne » des pièces de Crimp. Le langage est enfin le lieu de la dissimulation, un terrier où se replier,