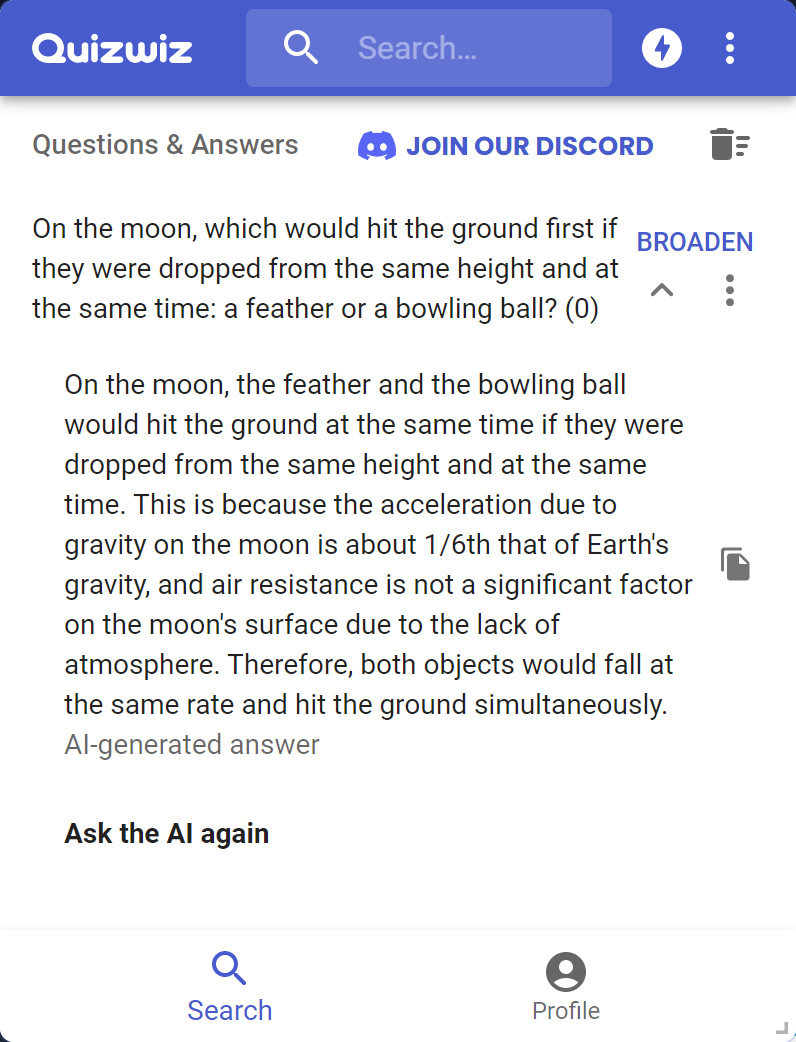🏢 Arrêts droits réels
(63QUINTER) Cass., du 04 mai 2005
(vu ex cathedra) arrêt de confirmation réitérée des principes allant dans le sens de la jurisprudence classique.
(7BIS) Cass., du 12 juillet 1917 - arrêt de l'enseigne nuisible
(vu ex cathedra) enseigne nuisible = abus de droit
(99BIS) Cass., du 13 octobre 2001
2) Deuxième règle implicite, également appliquée au demandeur au pétitoire. Il résulte de la première règle expresse une deuxième règle implicite qui peut être formulée comme suit : si le demandeur au pétitoire échoue dans son action pétitoire, il ne sera plus recevable à agir au possessoire. En effet, il ne se concevrait pas que le juge du possessoire reconnaisse qu'un sujet de droit est possesseur d'un droit réel, alors que ce sujet viendrait d'échouer dans une action concernant ce droit, et en aurait vu la titularité déniée dans son chef. En termes d'opportunité, on relèvera également que lorsqu'une personne est dépossédée d'un immeuble ou d'un droit immobilier, elle a toujours intérêt à agir d'abord au possessoire, dans le respect des conditions de ce type d'action, plutôt qu'au pétitoire, parce que la preuve de sa possession sera plus facile à rapporter (c'est un état de fait) que le droit lui-même (premier intérêt). En outre, si elle échoue au possessoire, elle pourra encore, en principe, se rabattre sur l'instance pétitoire (deuxième intérêt). 3) Troisième règle implicite, appliquée au défendeur au pétitoire : en revanche, il n'existe aucun inconvénient à admettre que le défendeur au pétitoire puisse agir au possessoire ; il peut en effet toujours faire protéger sa possession, tant qu'il n'est pas décidé qu'il est sans droit quant au fond. 4) Quatrième règle implicite, appliquée au demandeur au possessoire : ce dernier ne peut agir au pétitoire qu'après la fin de l'instance au possessoire. Cette règle implicite découle de l'économie générale des actions possessoires et pétitoires : il faut d'abord vider l'instance au possessoire avant d'aborder le fond (pétitoire). Cette règle s'applique également au défendeur au possessoire. 5) Cinquième règle expresse, appliquée au défendeur au possessoire : de même, le défendeur au possessoire ne peut agir au pétitoire qu'une fois l'instance au possessoire terminée : cette règle est posée en les termes suivants par l'article 1371, alinéa 3, initio : "le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée ; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir". Tel est le prix que le défendeur au possessoire doit payer pour avoir tenté de se faire justice à lui-même (par hypothèse, en portant atteinte à la possession d'autrui). Il s'agit en principe d'une fin de non-procéder quant à l'action au pétitoire (le juge doit dès lors surseoir à statuer dans l'attente de la fin de l'instance possessoire), et non d'une fin de non-recevoir : "le juge pétitoire doit attendre qu'il soit satisfait aux exigences légales fixées pour que, sans qu'une nouvelle assignation soit nécessaire, il puisse juger de la demande". 6) Par ailleurs, la suite de l'article 1371, alinéa 3, ajoute les règles plus spéciales suivantes qui s'appliquent encore, en particulier, au défendeur au possessoire" : - "si le défendeur au possessoire a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui" ; - exception partielle à la règle précédente : "néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise" : imaginons en effet que le demandeur au possessoire ait triomphé dans son action contre le défendeur, mais tarde à faire liquider, à faire exécuter donc, les condamnations au possessoire, dans le but sans doute de bloquer l'éventuelle action au pétitoire du défendeur originaire. Ce dernier pourrait alors demander au juge du pétitoire qu'il fixe un délai pour l'exécution par le demandeur de la condamnation qu'il a obtenue au possessoire, délai au terme duquel l'action pétitoire du défendeur au possessoire serait admise et pourrait suivre son cours ; - autre exception partielle à la règle sub. 1) : en outre, "le juge du pétitoire pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action pétitoire à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir". Notons en finale qu'il existe un article 1371bis dans le Code judiciaire, mais portant sur une matière tout à fait différente de celle des actions possessoires, à savoir les règles de droit judiciaire applicables à l'action an attribution, suppression ou déplacement d'une servitude de passage.
(51) Cass., du 05 novembre 1885 - affaire de la veuve Douxchamps
Après avoir construit sur la limite de son fonds, à Namur, un mur de séparation entre jardins, sans l'accord préalable de sa voisine, la veuve Douxchamps, le sieur Legros exigea d'elle le remboursement de la moitié des frais de construction du mur et l'application a posteriori de l'article 663 du Code civil. Il fut fait droit à son action par le tribunal de première instance de Namur qui décida que celui qui avait construit de sa propre autorité un mur, peut malgré tout, après la construction, forcer son voisin à en acquérir la mitoyenneté. Pourvoi en cassation de la veuve Douxchamps, plaidant la violation de l'article 663 du Code civil. Les conclusions du ministère public sont d'un grand intérêt et mettent en évidence l'économie générale de l'article 663 du Code civil, à la lumière de la ratio legis et des origines de la disposition dans l'histoire du droit. L'évolution a été la suivante : 1) l'article 663 du Code civil remonte à la Coutume de Paris et Claude de la Ferrières, à l'époque où la Coutume était en vigueur, concluait déjà à l'absence d'application a posteriori du système à l'origine de l'article 663 du Code civil ; 2) Pothier, au 18ème siècle, concluait de même, à la lumière de l'esprit gouvernant la coutume d'Orléans ; 3) et Berlier, dans les travaux préparatoires du Code civil, avait indiqué que les nombreuses dispositions des coutumes, dont essentiellement la Coutume de Paris, avaient offert au législateur de 1804 un "guide plus sûr et plus adapté". Dès lors, le ministère public a eu raison de mettre en évidence la ratio legis de l'article 663, qui tendait à maintenir des relations de bon voisinage et reposait "sur les règles les plus élémentaires de bienséance sociale", de sorte qu'il s'imposait aux voisins de "s'aboucher au préalable", avant la construction du mur. Ce constat s'oppose donc à toute application a posteriori de l'article 663 du Code civil. Au demeurant, "les servitudes sont déjà par elles-mêmes une charge trop réelle de la propriété, pour n'en pas restreindre l'exercice à ce qui est la rigoureuse nécessité, d'après la nature des choses, et toutes les fois que le but de la loi peut être atteint par des voies concurrentes, c'est la moins onéreuse qui doit être suivie". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a suivi, avec raison, le ministère public et a décidé que : "1) si l'article 663 permet à celui qui veut clôturer sa propriété de contraindre son voisin à contribuer à la dépense, il résulte du texte même de cet article que ce droit doit être exercé avant la construction du mur séparatif ; 2) les dispositions du code civil sur la mitoyenneté des murs ont été puisées dans les coutumes et notamment dans celle de Paris ; le rapport de Berlier le dit expressément ; que l'on décidait, sous l'ancien droit, dans les pays qui admettaient la clôture forcée, que celui qui avait bâti sur son terrain et à ses frais ne pouvait rien exiger de son voisin tant que celui-ci ne faisait pas usage du mur ; 3) l'article 663 constitue une exception au principe de la liberté des propriétés territoriales ; il doit donc être restrictivement interprété, comme toute dérogation au droit commun". La cassation de la décision entreprise a dès lors été prononcée sur ces bases.
(122) Cass., du 09 mars 1961 et du 16 janvier 1964 - affaire du Comte de Béthune
Après le décès d'un contribuable, le Comte de Béthune, se retrouvent dans l'actif de la succession différentes actions. Un litige naît entre l'Etat belge, administration des finances, et la famille du Comte de Béthune et porte sur la question de savoir si des dividendes d'actions se trouvant dans la succession, dont le contribuable était usufruitier, tombaient également dans l'actif et à partir de quel moment. Deux thèses s'opposaient à cet égard : 1) la thèse de l'administration, soutenant que les dividendes devaient être considérés comme des fruits civils, de sorte qu'ils avaient été acquis à l'usufruitier au jour le jour, donc du début jusqu'à la fin de l'usufruit à la suite du décès de l'usufruitier ; 2) et la thèse des contribuables, arguant que les dividendes d'actions ne pouvaient pas être qualifiés de fruits civils, parce que, notamment, les dividendes en rapport avec l'exercice social qui précédait le décès de l'usufruitier, étaient issus d'une décision d'assemblée générale postérieure à ce décès ; ils ne pouvaient donc être considérés comme ayant été acquis à l'usufruitier en raison de la survenance de cette circonstance postérieure à la fin de l'usufruit ; dès lors les dividendes ne pouvaient être considérés que comme des fruits naturels ou industriels (raisonnement par analogie), dont le sort était lié à une sorte de perception effective, ou du moins d'attribution conditionnant la perception, réalisée du vivant de l'usufruitier, ce qui impliquait qu'une décision d'assemblée générale ait attribué les dividendes en question avant la fin de l'usufruit pour qu'ils lui soient acquis (or tel n'était pas le cas). L'enjeu financier du litige était en réalité très limité (+ ou - 1.800 francs de l'époque), et portait sur la période de fin d'usufruit et non, semble-t-il, celle de début. L'Etat belge (administration des finances) se servit toutefois de cette affaire pour foire trancher la question de principe de la qualification des dividendes d'actions. Le juge de renvoi, à savoir le juge de paix du 2ème canton de Bruxelles, statua dans le même sens que le juge de paix précédent et assimila les dividendes litigieux à des fruits naturels. L'Etat belge se pourvut donc en cassation de la même façon que précédemment et la Cour de cassation dut se prononcer en chambres réunies, de façon définitive et sans renvoi, puisque le premier juge de renvoi avait refusé de s'incliner. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : L'arrêt de la Cour de cassation est plus solide que le précédent. Il s'articule comme suit : 1) prémisses du raisonnement : - l'énumération des fruits civils se trouvant dans l'article 584 n'est pas limitative ; - définition extensive des fruits civils : "les fruits civils, au sens des articles 582 et 584 du Code civil, sont les revenus en argent périodiques d'un bien" ; 2) poursuite du raisonnement : analyse des droits de l'actionnaire portant sur les dividendes, et réaffirmation de la qualification de fruits civils ; cette analyse se fait en deux temps : - "si l'actionnaire n'a, en vertu du contrat de société, que le droit de participer aux répartitions qui seront décidées, conformément aux statuts sociaux, par l'assemblée générale des associés, cette circonstance n'exclut pas que les dividendes des actions puissent être une contrepartie de la jouissance, par la société, des apports mis en commun par les associés et représentés par ces actions ; que les dividendes, dont l'assemblée générale décide la distribution, dans la mesure où ils sont, conformément aux statuts, périodiquement répartis entre les associés sont des fruits civils" ; - "d'autre part, si la créance du dividende, relatif à un exercice social, de l'associé contre la société ne naît que le jour où l'assemblée générale a décidé la distribution de ce dividende et si cette décision a pour conséquence que les bénéfices ainsi distribués sont des fruits des actions, il n'en résulte pas que ceux-ci ont été produits non point pendant l'exercice social, mais seulement le jour de la décision de l'assemblée générale : que les dividendes sont fixés et attribués par l'assemblée générale pour une période déterminée, l'exercice social : qu'envisageant le cas où des fruits civils ont été produits pendant une période au cours de laquelle un usufruit sur le bien qui les produit a été constitué ou s'est éteint l'article 586 du Code civil établit la règle suivant laquelle sont déterminés les droits respectifs du propriétaire et de l'usufruitier sur ces fruits : qu'aucun obstacle de droit ou de fait n'empêche l'application de cette règle aux dividendes qui sont des fruits civils des actions d'une société commerciale et qui se rapportent à un exercice social au cours duquel un usufruit sur ces actions a été constitué ou s'est éteint". Sur ces bases, la Cour de cassation a cassé à nouveau la décision de fond qui avait rejeté la qualification de fruits civils. Cet arrêt est plus solide et plus convaincant que le précédent. Il insiste sur le critère de la périodicité des dividendes, en donnant une définition extensive des fruits civils, et sur l'existence d'un droit de créance dans le chef des actionnaires portant sur les dividendes, naissant le jour où l'assemblée générale en décide la distribution, mais ne prend pas en considération le caractère conditionnel et éventuel de ce droit avant l'assemblée, ce qui était le noeud du problème de la qualification des dividendes en tant que fruits civils. En réalité, la Cour de cassation était confrontée à un dilemme difficile, pour combler une lacune du Code civil : soit privilégier la qualification de fruits naturels, mais il est vrai que les dividendes ne rentrent pas dans la définition de ceux-ci et le processus de la "perception" ne correspond pas réellement au processus d'attribution des dividendes ; soit retenir celle de fruits civils, mais le processus de décision et d'attribution des dividendes, s'écartait aussi de l'automaticité et de la réelle périodicité des fruits civils. Peut-être la Cour de cassation a-t-elle retenu en définitive la moins mauvaise des solutions, en tout cas la plus simple et la plus pratique eu égard à l'alignement de régime des dividendes sur les intérêts des obligations et à la facilité du calcul prorata temporis qui en découle.
(13) Cass., du 06 avril 1960 - affaires Jamblinne de Meux & de la Meunerie De Voghel
C'est en audience plénière que la Cour de cassation s'est prononcée pour rendre ces arrêts dans les deux affaires concernées, afin de trancher la question du statut de la théorie des troubles de voisinage et de faire évoluer celle-ci de façon décisive. Dans la première espèce, il s'agissait de particuliers, les consorts Jamblinne de Meux, qui avaient introduit une action en réparation du trouble excessif subi par leur immeuble, une cheminée aboutissant au faîte de ce dernier, ayant été privée de tirage suite à la construction d'un immeuble à appartements voisin, nettement plus élevé. Leur action tendait donc à obtenir l'exhaussement de la cheminée (réparation en nature) à la charge des propriétaires voisins. Dans la seconde espèce, la société Meunerie De Voghel, installée au bord du canal de Charleroi à Bruxelles, avaient subi des dégradations dans ses immeubles et des troubles dans son exploitation, suite aux travaux de mise à grande section du canal, menés à bien à l'initiative de l'Etat Belge. L'action de la partie demanderesse, fondée sur les troubles de voisinage également, tendait cette fois à obtenir une réparation par équivalent des troubles dommageables subis, sous la forme de l'octroi de dommages-intérêts. Les juges du fond ont fait droit aux demandes dans les deux affaires, et condamné à l'exhaussement de la cheminée dans la première espèce et au paiement de dommages-intérêts, du chef des travaux publics concernés, dans la seconde (au sujet de la motivation précise de chacune des décisions, cfr. notamment "en ce que" des moyens). Il s'en est suivi un double pourvoi des parties condamnées, dont l'argumentation centrale consistait à soutenir que les juges du fond n'avaient pas légalement justifié leur décision de condamnation sur pied de la théorie des troubles du voisinage, à défaut d'avoir établi le lien entre l'article 544 et l'article 1382 du Code civil et, surtout, à défaut d'avoir relevé une faute à charge des propriétaires déclarés responsables, dont l'Etat belge (cfr. notamment moyen dans la 2ème espèce et mise en évidence de ce que le juge du fond n'aurait pas relevé en la cause "l'existence d'aucun fait ni d'aucune circonstance constitutive d'une faute d'où résulterait la responsabilité" de l'Etat). La Cour de cassation a cependant rejeté les deux moyens et développé, dans chaque espèce, un raisonnement pertinent basé sur les mêmes principes. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Voyons, comme dans l'arrêt précédent, l'articulation du raisonnement suivi par la Cour et les conséquences déduites dans les deux causes. 1) premier temps : point de départ identique du raisonnement par la référence à l'article 544 du Code civil: "attendu que l'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose". Le point de départ est le même que dans l'arrêt de 1949 et l'un des fondements de la théorie demeure, à juste titre, l'article 544 du Code civil. 2) deuxième temps : construction du contenu nouveau de la théorie, sans plus de référence à la faute, mais basé sur la relation d'égalité et d'équilibre entre les propriétés et les droits : "que les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur propriété, il en résulte qu'une fois fixés les rapports entre leurs propriétés compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l'équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires" ; cet attendu balance entre la référence à "l'égalité" et la référence à "l'équilibre" entre les droits. 3) troisième temps : mise en évidence du mécanisme de la théorie et du droit à réparation qui en découle, ainsi que de ses conditions de base : "attendu que le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet équilibre, en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'égalité rompue". Cet attendu est essentiel, aussi bien dans la qualification de "fait non fautif" retenue à l'égard du fait juridique qui déclenche l'application éventuelle de la théorie, que dans la référence à l'une de ses conditions de base de la théorie, qui implique l'existence d'un trouble excessif par rapport aux inconvénients du voisinage devant être à l'origine de la situation dommageable. Est également déterminante la mise en évidence du mécanisme de réparation résultant de la théorie, qui consiste en principe dans le paiement d'une ''juste et adéquate compensation", à concurrence de l'excès de dommage subi par la victime. 4) quatrième temps : mise en évidence des fondements complémentaires du droit à réparation qu'implique la théorie : "qu'en effet, portant par-là atteinte au droit de propriété du voisin, il doit l'indemniser, conformément à la tradition et au principe général consacré notamment par l'article 11 de la Constitution". Le terme "indemniser" doit ici être entendu au sens large, sans renvoyer au droit commun de la responsabilité pour faute. Sans doute le terme "compensation", utilisé dans l'attendu précédent, est-il plus exact. Ce terme reviendra d'ailleurs davantage dans la jurisprudence ultérieure de la Cour. Notons enfin la référence à la tradition et au principe général consacré par l'article 11 de la Constitution. 5) cinquième temps : enfin, la Cour tire les conséquences de ces principes à l'égard des deux causes dont elle avait à connaître, en décidant que les juges du fond n'avaient pas eu tort d'y retenir une responsabilité tout en ayant relevé que les parties défenderesses initiales n'avaient pas commis de faute. La théorie des troubles de voisinage est donc clairement devenue une théorie qui est à l'origine d'une responsabilité objective sans faute.
(149) Cass., du 13 décembre 1957 - affaire du jeu de quilles
Ce cas porte sur une servitude conventionnelle. Il s'agit de l'affaire dite du ''jeu de quilles". Une servitude de passage était stipulée comme suit par un acte du 16 août 1913 : ''M. Dominique Kraus, acquéreur, a également droit à un passage à pied sur la propriété de M. Jean Hardy. Ce passage doit s'exercer sur le long du terrain présentement cédé pour donner accès à l'acquéreur". Mme Tockert, acquéreuse du fonds dominant, exerça la servitude au profit de son fonds sur lequel elle avait installé une activité de jeu de quilles, et ce donc au profit d'elle-même, de sa famille mais aussi des clients du jeu de quille, ainsi que de toute personne devant accéder au fonds pour l'exploitation de ce dernier. Mr. Adam, nouveau propriétaire du fonds servant, considéra qu'il y avait aggravation de la condition du fonds servant (cfr. art. 702 du Code civil), ce que le juge du fonds écarta en décidant que Mme Tockert avait prescrit les modalités d'exercice étendues de la servitude dont elle faisait usage, par usage plus que trentenaire. Mr. Adam s'est pourvu en cassation et invoqua la violation des articles 691 du Code civil, la servitude de passage étant discontinue, et 702 quant à l'aggravation de la servitude, outre les dispositions permettant de justifier selon lui une violation de la loi due à la convention initiale (art. 1319 et 1320) et de la convention-loi (art. 1134. al. 1er du Code civil). La Cour de cassation a fait droit au pourvoi, revenant ainsi à l'orthodoxie des principes en matière de non-prescription der assiette ou des modalités d'exercice des servitudes de passage conventionnelles. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour s'est d'abord référée au contenu de la décision de fond, en relevant qu'elle n'avait pas été attaquée sur le terrain de la détermination qu'elle avait donnée au contenu de la servitude, puis a abordé la question de la violation des articles 691 et 702 du Code civil, en décidant que cette violation était établie : 1) rappel du contenu du jugement a quo à cet égard ; que le juge décide, en outre, que la défenderesse a acquis, par la prescription trentenaire, le droit de faire passer sur l'assiette de la servitude les clients du jeu de quilles qu'elle a organisé derrière le bâtiment d'habitation et ce bien que le passage par ces clients de la défenderesse constitue, suivant l'énonciation expresse du jugement attaqué, une aggravation de la servitude" ; 2) rappel du contenu des articles 691 et 702 du Code civil ; 3) conséquence : rejet de la théorie de la prescription de l'assiette, plus précisément des modalités d'exercice nouvelles de la servitude : "attendu qu'il résulte de ces articles que le titulaire d'une servitude de passage, servitude discontinue établie par le fait de l'homme, ne peut, par la prescription acquisitive, obtenir un droit de passage plus étendu que celui qui lui a été concédé par le titre constitutif, pareille extension formant soit une servitude nouvelle, soit un supplément de servitude", d'où la cassation. Cet arrêt est tout à fait pertinent. Le rejet de la théorie de la prescription de l'assiette ou des modalités d'exercice de la servitude, s'imposait manifestement en matière de servitude conventionnelle car la théorie s'opposait frontalement à la convention et à la force obligatoire du contrat, ainsi qu'à l'article 702, outre bien entendu l'article 691. Il est assez incompréhensible que la Cour de cassation ait encore admis la théorie par l'arrêt n° 148 de 1969, en matière de servitude légale de passage il est vrai, pour laquelle l'opposition à la convention des parties n'existait pas, par définition. Sans doute ce dernier élément explique-t-il la persistance de la théorie en matière de servitude légale, comme il découle aussi de la note du Procureur général R. Hayoit de Termicourt (note signée "R.H.''), sous l'arrêt du "Jeu de quilles", qui relève, sans la critiquer et en la prenant comme un fait acquis, la jurisprudence de la Cour en matière de servitude légale, admettant la théorie de la prescription de l'assiette ou des modalités d'exercice. Le législateur de 1978 a remis l'église au milieu du village en matière de servitude légale en énonçant l'article 684, alinéa 2, mais la théorie de la prescription de l'assiette existe en droit français sur une base légale directe toutefois. Notons enfin que le Procureur général R. Hayoit de Termicourt observe avec raison sous l'arrêt, que la possession, si elle ne peut opérer pour fonder la prescription acquisitive,"peut toutefois être prise en considération, non comme mode d'acquisition d'un supplément de servitude, mais pour déterminer, en cas de silence ou d'ambiguïté du titre sur ce point, l'assiette ou le mode d'exercice de la servitude établie par le titre".
(57) Cass., du 26 avril 1957 - affaire du 4ème mur
Ce litige opposait deux sociétés. La société anonyme Metallurgique de Haren (société X) avait construit un espace clos en profitant du mur jointif se trouvant sur le fonds de sa voisine (le 4ème mur, placé sur le fonds d'autrui), la société coopérative Tubes de Haren (société Y), sans ancrer ses murs latéraux dans le mur de cette dernière et sans demander à cette dernière qu'elle lui cède la mitoyenneté sur la base de la règle de la vente forcée déduite de l'article 661 du Code civil. La société Y, trouvant la situation anormale dès lors que la société X bénéficiait et jouissait indirectement de son mur jointif, assigna la société X pour qu'elle soit reconnue cessionnaire de la mitoyenneté et lui en paie le prix. Le juge du fond décida de faire droit à l'action, au motif que, notamment, "les travaux exécutés par la (société X) ont essentiellement transformé l'utilité et la destination de son bien, que ce qui n'était jadis qu'un couloir sans protection est devenu un espace clos, que la nouvelle disposition des lieux fait nettement apparaître sa volonté d'utiliser désormais sa propriété comme une double cour fermée, et que, pour réaliser cette fin, elle s'est appropriée le mur dont litige pour parfaire la clôture de son bien". La société X se pourvut en cassation et invoqua, entre autres, la violation de l'article 661 du Code civil, au motif : "qu'il ne peut y avoir appropriation d'un mur voisin obligeant à en payer le prix, sans usurpation ou emprise du propriétaire", non constatée en fait par le juge du fond. Ce moyen tenait d'un certain bon sens et exprimait un point de vue rigoureux, permettant de constater de façon précise l'accord de volontés sur pied de l'article 661 du Code civil, ce que n'avait pas fait le juge du fond. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation décida pourtant de rejeter le pourvoi. Son raisonnement est structuré en trois temps : 1) considération de départ touchant à nouveau à la technique de cassation : "le moyen ne critique pas la règle à laquelle le jugement attaqué, interprétant l'article 661 du Code civil, s'est rallié et suivant laquelle le voisin qui accomplit des actes d'appropriation sur un mur séparatif jouxtant son fonds doit être tenu au payement du prix de la mitoyenneté du mur" ; cette motivation constitue une référence expresse à l'article 661 du Code civil ; 2) suit un rappel des énonciations de la décision attaquée ; 3) puis nous trouvons cette conclusion dans l'attendu final suivant : "que le juge du fond a ainsi pu déduire des circonstances de fait qu'il y avait prise de possession ayant donné au propriétaire du mur séparatif le droit d'exiger le payement de la valeur du mur dont le voisin avait manifesté la volonté d'acquérir la mitoyenneté", d'où le rejet du pourvoi. La note publiée sous l'arrêt, signée F. D. (M. Frédéric Dumon, membre éminent du ministère public près la Cour de cassation et futur procureur général), éclaire à bon escient l'arrêt et le raisonnement juridique suivi. Retenons la conclusion de ce raisonnement, qui est tout à fait judicieuse : "en présence de la demande et de la mise en demeure du propriétaire dont le mur a été usurpé, soit de faire cesser la prise de possession, soit de reprendre la mitoyenneté et d'en payer le prix, ou bien le voisin fera cesser les faits de prise de possession, et tout rentrera dans l'ordre, ou bien il les laissera subsister. De cette dernière attitude, doit se déduire qu'il manifesté la volonté de rendre le mur mitoyen. Dès lors, le propriétaire est en droit d'obtenir le remboursement de la moitié de la valeur du mur. Comme le précisait déjà l'arrêt du 26 avril 1934, "un concours de volontés" est ainsi né entre parties". Critiques : 1) il est positif que la référence à l'article 661 du Code civil soit maintenant établie ; 2) de même, constitue un autre progrès le fait que la Cour fasse référence au critère de la prise de possession, et au droit d'exiger le paiement de la valeur du mur (obligation de payer le prix de la mitoyenneté, et non pas obligation d'acquérir la mitoyenneté, ou acquisition forcée de cette dernière) ; 3) la Cour n'a cependant pas été aussi précise que le Ministère public : ce n'est pas en effet la simple prise de possession qui justifie l'obligation de payer le prix de la mitoyenneté, mais le fait de refuser d'y mettre fin, d'où l'émission alors d'une volonté certaine d'acquérir la mitoyenneté et l'obligation d'en payer le prix au titre du contrat de vente qui s'est formé ; 4) enfin, le critère de la prise de possession est encore insuffisant sur le plan de la sécurité juridique, et la Cour de cassation ajoutera, à juste titre, dans l'arrêt suivant, l'usurpation ou la voie de fait en tant qu'éléments constitutifs essentiels de cette prise de possession, à constater concrètement par le juge du fond.
(19) Cass., du 28 janvier 1965 - affaire Imavda
Cet arrêt est le premier arrêt de principe qui tranche la question du sort à réserver à l'entrepreneur, en excluant celui-ci du cadre de la théorie. Dans les faits, un maître de l'ouvrage, le sieur Borenstein, avait conclu un contrat d'entreprise avec un entrepreneur dénommé Vandist. Les travaux avaient causé des troubles dommageables à la société Imavda, laquelle avait assigné le propriétaire voisin sur pied de la théorie des troubles de voisinage. Le propriétaire Borenstein avait lui-même appelé l'entrepreneur en intervention, pour le garantir de toute condamnation dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage. C'est en rapport avec cette action en garantie que s'est posée, pour la première fois, à la Cour de cassation, la question du sort à donner à la situation de l'entrepreneur. L'arrêt de fond rendu par la cour d'appel de Bruxelles, a résolu cette question en suivant l'enseignement du Professeur R.O. Dalcq notamment et, a décidé que : "c'est à tort que Vandist soutient qu'il ne peut, en sa qualité d'entrepreneur, être tenu de payer la compensation due à la société Imavda ; que le fondement de son obligation se trouve dans l'article 544 du Code civil comme Borenstein le maître de l'ouvrage ; que cet article confère à tout propriétaire le droit de jouir paisiblement de sa chose, avec l'obligation pour tous les tiers (et pas seulement pour les propriétaires voisins) de respecter ce droit ; que l'activité de Vandist a contribué à rompre l'équilibre préexistant dans les rapports entre les propriétés voisines". La décision en degré d'appel a donc fait droit à l'action en garantie dirigée contre l'entrepreneur Vandist. Le deuxième moyen du pourvoi diligenté par ce dernier a soutenu que cette décision était illégale pour violation des articles 6 et 11 de la Constitution ainsi que 544 du Code civil, l'indemnité découlant de la théorie des troubles de voisinage ne pouvant être mise à charge d'un entrepreneur, "puisqu'elle est due à titre de compensation pour la rupture d'équilibre, dont l'entrepreneur n'est pas bénéficiaire, entre les droits de propriété respectifs du voisin et du maître de l'ouvrage". Le quatrième moyen est également intéressant en tant qu'il porte sur une clause du contrat d'entreprise sur laquelle l'arrêt entrepris s'était également fondé pour faire droit à l'action contre l'entrepreneur, or, l'arrêt n'avait pas répondu, semble-t-il, aux conclusions de celui-ci, qui avaient soutenu que telle ne pouvait pas être la portée de la clause, au vu de son contenu. Selon le moyen, la décision d'appel n'était dès lors pas non plus régulièrement motivée (violation de l'ancien article 97 de la Constitution). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Par cet important arrêt de principe, la Cour de cassation a décidé de casser l'arrêt attaqué et de faire droit aux deux moyens ci-dessus résumés. Quant à la réponse au deuxième moyen, la Cour a repris les deux attendus de base des arrêts d'avril 1960 pour en dégager ensuite l'enseignement applicable à la situation de l'entrepreneur, en ces termes : "que cet équilibre supposant nécessairement l'existence de biens voisins et l'entrepreneur qui effectue des travaux pour compte d'autrui étant étranger aux liens de droit qui naissent du voisinage, l'entrepreneur, dont les travaux ont créé un trouble (excessif) n'est pas tenu de rétablir l'égalité rompue ; que le propriétaire lésé n'est donc pas fondé à lui réclamer une indemnité sur base de l'article 544 du Code civil". Sur la base du quatrième moyen, la décision de fond est également cassée, car notamment, elle n'a pas "examiné si la clause (du contrat d'entreprise) est applicable lorsque le maître de l'ouvrage n'est tenu d'indemniser le propriétaire voisin qu'en vertu de l'article 544 du Code civil" (cfr. aussi suite de la motivation à cet égard). Cet arrêt est important (et il convient d'en approuver le contenu) dans le principe qu'il énonce très clairement en ce qui concerne la situation de l'entrepreneur. Présente également de l'intérêt la problématique que l'arrêt aborde en la cause, de la validité des clauses de garantie contenues dans les contrats d'entreprise et cahiers généraux ou spéciaux des charges, qui peuvent mettre à charge d'un entrepreneur, non seulement une responsabilité pour faute sur pied de l'article 1382 du Code civil, mais aussi une responsabilité sans faute découlant de la théorie des troubles de voisinage, à condition toutefois, conformément au droit commun des obligations applicable aux clauses exonératoires de responsabilité et de garantie, que le contenu de la clause ne laisse aucun doute et soit certain à cet égard, ce dont le juge du fond doit faire la constatation in specie.
(99TER) Cass., du 19 juin 2009 - affaire du Breughel de Velours
Cette belle affaire portait sur la propriété d'un meuble individualisé constituant une œuvre d'art : un tableau de Jan Breughel l'Ancien, dit de Velours, qui avait été dérobé (dessaisissement involontaire) pendant la seconde guerre mondiale par l'Armée rouge au musée de Dresde (Statliche Kunstsammlungen Dresden). Le tableau avait été ensuite acquis, dans les années 1960, par un professeur d'université ukrainien, et se retrouva finalement dans les mains d'une personne qui le mit en vente dans des conditions douteuses, par l'intermédiaire d'un bijoutier et d'un exploitant de "car wash", en Belgique, ce dont le musée de Dresde eut vent de sorte qu'il revendiqua le tableau. La cour d'appel de Gand accepta cette revendication sur pied de l'article 2279, règle de fond, plus de trente ans après la dépossession du tableau, au motif que la possession n'était pas utile dans le chef de la personne qui prétendait vendre l'œuvre d'art. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de cette dernière, et confirma la décision de fond, par cet arrêt du 19 juin 2009 décidant que : "2) conformément aux articles 2229 et 2279 du Code civil, la possession de bonne foi de biens meubles ne fait naître le droit de propriété que si la possession est utile, c'est-à-dire qu'elle continue, non interrompue, paisible, public et non équivoque et à titre de propriétaire ; 3) pour qu'il soit question d'une possession publique au sens des dispositions légales précitées, il est requis que, toute personne y ayant un intérêt, puisse voir et constater la possession et les actes de possession et, le cas échéant, puisse prendre les mesures nécessaires pour s'opposer à la prescription. Le fait que la possession soit publique pour certains, n'exclut toutefois pas qu'à l'égard d'autres personnes qui ont un intérêt à voir ou à constater les actes de possession, elle ait un caractère secret. Il appartient au juge du fond de constater en fait si c'est le cas. 4) les juges d'appel ont considéré que la mise en vente dudit tableau par l'intermédiaire d'une bijouterie et de l'exploitant d'un car wash et non par une salle de vente spécialisée ou par une galerie d'art, pour un prix notoirement inférieur à la valeur attribuée par le demandeur lui-même au tableau, ne laisse aucun doute quant au caractère secret de la possession du demandeur. 5) en décidant que la possession du tableau en question était secrète dans le chef du demandeur et que celui-ci ne peut invoquer l'article 2279 du Code civil à titre de défense contre l'action en revendication de la défenderesse, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche. 6) la constatation que la possession dans le chef du demandeur du tableau litigieux a finalement été connue à la suite de la mise en vente par l'intermédiaire d'un bijoutier, n'exclut pas que la possession du tableau est restée secrète à l'égard de la défenderesse." Un élément de fait nous interpelle : la Staatlische Kunstsammlungen Dresden avait reconnu dans sa citation introductive d'instance, qu'elle avait eu connaissance du fait que la toile avait été mise en vente en 1979, par une galerie d'art de Berlin-Ouest, et qu'elle était réapparue en 1989 aux États-Unis. Le fait que la possession avait été, un moment donné, publique dans le chef d'un précédent possesseur, empêchait-il le revendiquant de se prévaloir de la clandestinité de la possession d'un possesseur ultérieur ? Il faut répondre résolument de façon négative à cette question : la possession du possesseur actuel était entachée d'un certain caractère secret, qui avait pour but de faire obstacle à la revendication du verus dominus, dont l'action avait pu finalement aboutir en raison de cette clandestinité. Le vice de la possession devait s'apprécier dans le chef du possesseur actuel même si la situation avait pu être différente dans le chef d'un éventuel possesseur antérieur dont la possession avait été publique. Ce vice était relatif au possesseur actuel, sur la base notamment de son corpus et animus. Ce principe est concordant avec le caractère nécessairement personnel et conscient, de tout acte de fraude, de dol ou d'abus intentionnel (cfr. "Fraus omnia corrumpit"). Les enseignements à déduire de cet arrêt convaincant peuvent être étendus à la sphère immobilière et sont les suivants : - l'usurpateur de mauvaise foi peut dans certains cas résister aux attaques du verus dominus, tendant à démontrer (et ce dernier en supportant la charge de la preuve) que sa possession n'est pas utile, parce qu'elle est déduite d'un acte de violence, ou qu'elle est équivoque, ou bien encore qu'elle est cachée et clandestine, comme cela pourrait être le cas d'un voleur ou d'un receleur ; - mais, si le vice dans le chef du possesseur actuel est démontré, sa possession ne pourra plus opérer sur le plan de la prescription, que l'on se trouve en matière mobilière ou immobilière d'ailleurs ; le principe général du droit "Fraus omnia corrupit" retrouve alors à s'appliquer en vertu de la loi, dans le cadre des articles 2228, 2229, 2262 ou 2279 du Code civil, et c'est bien sûr une bonne chose ; - cela signifie qu'en cas d'action en revendication du verus dominus, dans une situation de dépossession involontaire en particulier (perte ou vol), contre un possesseur n'ayant pas une possession utile, cette action restera possible tant qu'un possesseur n'aura pas commencé à prescrire, or le "possesseur" dont la possession sera entachée de vice, ne pourra pas se prévaloir d'une possession utile ; - mais le droit est nuancé et il ne faudra pas oublier l'article 2233, alinéa 2, qui prévoit que : "la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé", en impliquant donc une limitation dans le temps des effets de la violence et de la mauvaise foi, ce qui limite dans le temps les effets de notre principe "Fraus omnia corrumpit" ; - et sans qu'il soit exclu, s'il y a de nouveaux actes de violence notamment, que la possession redevienne vicieuse ; - enfin, élément important du raisonnement, il se confirme que les vices de la possession sont relatifs "ratione personae" , ce qui signifie qu'ils s'appliquent précisément : à la situation et à la personne du possesseur, quant à son corpus et surtout son animus, et cette relativité rejaillit favorablement sur le verus dominus, lequel, s'il n'a pu revendiquer auprès d'un possesseur antérieur dont la possession n'était pas vicieuse, peut le faire contre le possesseur actuel qui agit avec violence, équivoque, ou dans la clandestinité (cet élément nous semble confirme l'intérêt de l'approche subjectiviste de la possession que nous avons soutenue supra) ; mais la relativité doit donc exister aussi à l'égard du revendiquant ; il faut voir si à son égard, le vice existait (par exemple un vice de clandestinité), sauf si l'on peut dire que le vice n'existant pas à l'égard du possesseur antérieur, son ayant-cause ne peut plus le faire valoir. Il va de soi que les mêmes principes que ceux vus ci-dessus quant à la bonne et la mauvaise foi, s'appliquent ici aussi. On voit par ailleurs, à la lecture de l'alinéa 2, in fine, de l'article 2279, que le possesseur de bonne foi qui devra restituer le bien au propriétaire dès lors que ce dernier aura agi endéans le délai de 3 ans, disposera en principe d'une action en réparation du préjudice subi, contre le tiers intermédiaire auprès duquel il aura acquis le bien.
(1BIS) Cass., du 14 février 2008
Comme souvent dans cette matière, le litige dans cette affaire, d'ordre fiscal, posait une question de droit civil, à défaut de précision de la loi fiscale. La question était simple : des grues roulantes, placées sur des rails, permettant sur un quai, le chargement et le déchargement de navires à Zeebruges, devaient-elle être considérées comme des biens immeubles par nature et par conséquent être soumises à un revenu cadastral donnant lieu à perception d'un précompte immobilier dans le chef de la société qui en était propriétaire, en vertu de l'article 360, §1er du Code des impôts sur les revenus ? Deux thèse s'opposaient : la thèse du contribuable, qui mettait en avant le fait que les grues étaient mobiles, déplaçables, et qu'elles pouvaient être séparées du sol, plus précisément des rails qui les supportaient, sans dommages pour elle et pour leur support immobilier ; il ne pouvait donc s'agir que de biens meubles par nature (cfr. art. 528 du Code civil), échappant à la taxation ; et la thèse de l'administration fiscale, plaidant la nature immobilière par nature des grues (cfr. art. 518 du Code civil) : celles-ci avaient été incorporées durablement au sol en dépit de leur capacité de mouvement, au surplus limitée, et de la possibilité de les séparer du sol sans dommage. Quelle thèse consacrer : celle restrictive d'une incorporation durable ne pouvant opérer qu'à condition d'une impossibilité ultérieure de séparation du bien incorporé au sol, ou celle, plus extensive, privilégiant une conception plus souple de l'incorporation durable ? Fallait-il interpréter le Code dans un sens restrictif ou raisonnablement extensif ? Au fond, la cour d'appel de Gand statua, par un arrêt du 14 décembre 2004, dans le sens de le thèse extensive et donna raison à l'Etat. Elle prit en considération l'arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 1988. Après avoir ainsi relevé que : "les immeubles par leur nature sont les fonds de terre, et les bâtiments auxquels doivent être assimilés les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle (article 518 du Code civil)", la Cour a décidé : "qu'il s'agit de grues roulantes utilisées pour le déchargement et le chargement de navires ; que ces grues roulantes sont très grandes ; que la demanderesse explique, d'une part, que ces grues roulantes se déplacent sur des rails au moyen d'une locomotive, d'autre part, qu'elles se déplacent par leur propres moyens par propulsion électrique. Que les grues roulantes sont unies au sol du fait qu'elles reposent pesamment (vu leur grande taille) sur des rails qui sont eux-mêmes incorporés dans le sol ; que pour leur déplacements latéraux nécessités par leur fonction de chargement et de déchargement de bateaux, ces grues restent nécessairement sur ces rails situés sur le quai. Que cela implique que, par leur nature, de telles grues roulantes sont destinées à demeurer sur le quai et à se déplacer latéralement de manière limitée à cet endroit pour les besoins de leur fonctionnement ; qu'il est ainsi établi que les grues roulantes sont des objets qui sont unis d'une manière durable et habituelle avec le sol et qui doivent être considérés comme immeubles par leur nature". La société à qui furent réclamés les précomptes, attaqua cette décision en invoquant la violation des dispositions fiscales ainsi que des articles 518 et 528 du Code civil. Elle se référa à nouveau à la thèse restrictive de l'immobilisation d'ouvrages ou d'objets par incorporation, en faisant valoir que les grues ne pouvaient être qualifiées que de biens meubles, au motif essentiellement qu'elles pouvaient être déplacées. En d'autres termes, un immeuble devait nécessairement demeurer immobile, ce qui n'était pas le cas des grues, à caractère mobile, qui étaient dès lors des meubles au sens de l'article 528 du Code civil. Cette thèse rejoignait une conception des notions d'immeubles et de meubles basée sur l'étymologie latine de ces notions : un immeuble serait toujours immobile ("immobilis") tandis qu'un meuble serait par nature mobile ("mobilis"). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : A juste titre la Cour de cassation a écarté cette vision trop restrictive des choses, éloignée du Code civil et des nécessités de la pratique. Elle a rejeté le pourvoi en cassation, pour les motifs suivants : 1) rappel de droit fiscal renvoyant au droit commun : "conformément à l'article 360, §1, du Code des impôts sur les revenus 1964 et à l'article 461, §1, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est établi un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant un caractère d'immeuble par nature ou d'immeuble par destination. Dès lors que la loi ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par matériel et outillage présentant le caractère d'immeubles par nature, le terme "par nature" doit être compris dans le sens du droit commun". 2) référence à l'article 518 du Code civil et mise en évidence du critère de l'incorporation durable et habituelle, outre celui de l'unification : "en vertu de l'article 518 du Code civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. Il faut y assimiler les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle. Les mouvements fonctionnels limités d'un objet qui demeure de manière durable à un endroit déterminé, en l'espèce un quai, et qui s'y incorpore au sol, ne prive pas cet objet de sa nature de bien immobilier". 3) conclusion : application des principes au cas d'espèce et rejet du pourvoi : "l'arrêt constate que : - il s 'agit de grues roulantes places sur des rails situés sur le quai et elles sont de grande dimension ; - les grues roulantes se déplacent sur les rails au moyen d'une locomotive ou par leur propres moyens par propulsion électrique ; - les grues roulantes sont unies au sol du fait qu'elles reposent pesamment sur des rails qui sont eux-mêmes incorporés dans le sol ; - pour leurs déplacements latéraux nécessités par leur fonction de chargement et de déchargement de navires, ces grues restent nécessairement sur les rails situés sur le quai. L'arrêt considère ainsi que par leur nature de telles grues roulantes sont destinées à rester sur place et à ne se déplacer latéralement qu'à cet endroit pour les besoins de leur fonctionnement. En décidant ensuite que les grues roulantes sont des objets qui sont unis de manière durable et habituelle au sol et qu'elles doivent être considérées comme immeuble par leur nature, les juges d'appel ont justifié légalement leur décision et n'ont pas violé les dispositions légales citées par le moyen. 4) le moyen ne peut être accueilli". Cet important arrêt confirme l'arrêt antérieur de 1988. Il consacre à nouveau le critère de l'incorporation durable et habituelle. Celui-ci s'ajoute à une autre situation : la situation de biens meubles unis irréversiblement à un bien immeuble, et devenant par conséquent immeubles par nature. L'incorporation réversible s'ajoute donc à l'union irréversible comme critère d'immobilisation par nature et elle n'est pas le seul critère. Relevons également que cette jurisprudence est concordante avec la jurisprudence de la Cour de justice européenne sur la notion d'immeuble au sens de la 6ème Directive européenne en matière de T.V.A., laquelle exempte les locations de biens s'ils sont immeubles précisément. Selon la Cour de justice, dans un arrêt du 16 janvier 2003, pour que le bien soit immeuble, il faut qu'il ne soit "pas aisément démontable et déplaçable, mais, contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, en l'espèce, il n'est pas nécessaire que les constructions soient indissociablement au sol. La durée du contrat de location n'est pas non plus décisive aux fins de déterminer si les bâtiments en cause sont des biens meubles ou des immeubles".
(67) Cass., du 03 février 1944 - affaire De Neef
Dans cette affaire, deux fonds étaient contigus, l'un appartenant à Mme De Neef, veuve Mahillon, l'autre appartenant à la Ville de Bruxelles. Le fonds de la Ville de Bruxelles avait fait antérieurement l'objet d'une expropriation au profit de la Ville et les bâtiments qui s'y trouvaient avaient été démolis, avec pour conséquence que le mur séparatif entre le fonds et celui de la dame De Neef, était devenu à nu du côté du fonds de la Ville de Bruxelles. A la suite de l'expropriation, le mur était en outre devenu mitoyen entre la dame De Neef et la Ville de Bruxelles. La Ville décida de valoriser le mur, de son côté. Il s'ensuivit la conclusion d'un ensemble de conventions : 1) la Ville de Bruxelles conclut avec un certain Van Schelle un contrat de concession portant sur la jouissance du mur pignon ; ce dernier allait en effet être utilisé pour recevoir des panneaux de publicité ; 2) Van Schelle fit appel à Eugène Jean pour faire effectuer des travaux de peinture après pose d'échafaudages sur le mur ; 3) la société "Havas Brussels Publicity Office" ("HB.P.") éleva les échafaudages à la demande de Eugène Jean, ces échafaudages devant permettre semble-t-il l'installation de panneaux publicitaires sur le mur. Mme De Neef s'opposa à cette utilisation du mur mitoyen. Il en résulta les actions suivantes : 1) action principale de Mme De Neef contre la société H.B.P., lui reprochant d'avoir élevé des échafaudages contre le mur pignon dont elle était copropriétaire mitoyenne ; 2) la société H.B.P. appela en garantie Eugène Jean ainsi que Van Schelle ; 3) Eugène Jean appela en sous-garantie Van Schelle et la Ville de Bruxelles. En première instance, le tribunal de commerce de Bruxelles, par un jugement du 22 juillet 1936, fit droit à l'action de Mme De Neef et condamna la société H.B.P. à enlever, dans les trois jours de la signification, les échafaudages érigés par elle et à rétablir le mur pignon dans son pristin état (cfr. première Décision). L'argumentation du tribunal découla de l'analyse restrictive qu'il fit de la mitoyenneté, de la façon suivante : prise en compte de la spécificité de la mitoyenneté par rapport à la copropriété de droit commun, eu égard à la destination du mur mitoyen. Relevons plus précisément les éléments suivants : 1) selon Pothier, "quels sont les usages naturels d'un mur mitoyen et pourquoi le fait-on ? C'est pour s'enclore et pour appuyer contre les choses qu'on juge à propos d'y appuyer et notamment les bâtiments et édifices ; dès lors chaque voisin ne peut sans le consentement de l'autre voisins s'en servir pour d'autres usages" ; 2) les droits spéciaux résultant des articles 657 à 659 du Code civil s'expliquent donc en fonction de l'utilité normale du mur mitoyen, qui est de servir d'appui et d'aider à la construction, le droit d'affichage sur le mur n'étant pas prévu ; 3) au surplus, le statut réel du mur mitoyen est traité au titre des servitudes et il en résulte que les dérogations apportées au droit commun de la copropriété (par conséquent les droits spéciaux prévus en matière de mitoyenneté) doivent être interprétées restrictivement ; 4) enfin, "la concession du droit d'afficher sur la face du mur non utilisée pour des constructions est susceptible de nuire au voisin propriétaire, les réclames apposées pouvant réduire la valeur du mur" ; 5) il a donc été fait droit à l'action de la demanderesse même si cette dernière n'a pas établi qu'elle avait subi un dommage autre que la privation partielle de son droit de copropriétaire. La société H.B.P. interjeta appel contre cette décision mais la cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 19 février 1941, rejeta cet appel et les appels incidents (cfr. deuxième Décision), en reprenant l'argumentation du juge du fond sous réserves de quelques nuances. Retenons les points suivants : 1) rappel cette fois de ce que la propriété mitoyenne est une forme de copropriété indivise ; 2) dès lors, en principe, aucun des indivisaires ne peut disposer du mur mitoyen sans le consentement de l'autre ; 3) surtout, la prétention à utiliser le mur mitoyen à des fins d'affichage est étrangère à la destination normale du mur mitoyen ; et 4) "il est d'ailleurs certain que pareil genre de publicité peut déprécier une maison" et être dès lors dommageable au copropriétaire mitoyen. La Ville de Bruxelles, également condamnée dans cette affaire dans le cadre de l'action en sous-garantie dirigée par Eugène Jean contre elle, se pourvut en cassation et invoqua, à l'appui de la critique dirigée contre l'arrêt de fond, l'argument suivant lequel le copropriétaire d'un mur mitoyen pouvait, sans le consentement de son coïndivisaire, utiliser privativement la face du mur située du côté de sa propriété à tous usages même non habituels dont elle est susceptible, notamment à l'apposition d'annonces, et concéder à un tiers le droit personnel d'en faire pareil usage, sauf si cette utilisation nuisait aux droits du copropriétaire voisin et lui portait préjudice, ce qui était contesté et n'était pas démontré en l'espèce. Cette théorie, renvoyant à un droit d'utilisation privatif du mur mitoyen en fonction d'une localisation sur chaque face du mur, était singulièrement audacieuse et sans véritable fondement légal. Contre toute attente, elle fut suivie par la Cour de cassation. Après que la question centrale du droit d'affichage sur le mur mitoyen, a été posée, la Cour a livré les attendus de principe suivants : 1) prémice : théorie de la localisation d'un droit d'usage privatif de chaque face du mur mitoyen : "à la différence du régime de la copropriété ordinaire, où chacun des copropriétaires indivis ayant un droit égal sur la chose commune, peut, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, et à condition de ne pas changer la destination de la chose, user de la totalité de celle-ci, l'économie de la loi, en ce qui concerne l'usage du mur mitoyen, repose sur l'idée que chacun des copropriétaires peut agir comme s'il était seul propriétaire de la moitié du mur et face de son héritage" ; 2) mais énoncé d'une double limite quant au droit en question : "que par conséquent, le pouvoir de chacun des copropriétaires du mur mitoyen, à l'encontre de l'autre copropriétaire, ne trouve de limite que (i) dans l'obligation de respecter la destination du mur et (ii) de ne pas préjudicier de quel qu'autre manière aux droits de son voisin" ; 3) conséquence quant au droit d'affichage : "qu'ainsi défini, le droit de chacun des copropriétaires du mur comporte celui de se servir de la partie du mur qui fait face à son héritage, pour y faire de la publicité" ; 4) et conséquence plus précise également : caractère cessible de ce droit : "que, par conséquent, il lui est loisible de céder ce droit à des tiers, pour ceux-ci en jouir aux conditions et sous les réserves qui s'imposent à lui-même" ; 5) conclusions quant à l'arrêt attaqué : ce dernier est cassé parce qu'il n'avait pas constaté que la ville de Bruxelles, "par l'acte de concession, eût autorisé le concessionnaire de publicité à dépasser les limites, ci-dessus définies, de son propre droit de propriété". Cet arrêt n'est pas vraiment convaincant dans ses différents stades de raisonnement, que nous pouvons passer en revue suivant le même ordre que ci-dessus : 1) la prémisse relève de la pétition de principe et son fondement légal n'est nullement évident ; 2) il n'y a pas de lien logique entre cette prémisse et les limites que la Cour impartit au droit d'usage localisé, quoiqu'il soit indiqué (cfr. utilisation de l'adverbe "par conséquent") ; 3) l'affirmation de l'existence du droit d'affichage relève tout autant de la pétition de principe ; 4) il en est de même de son caractère prétendument cessible, qui n'est pas non plus une véritable "conséquence" nécessaire de ce droit ; 5) plus fondamentalement, le droit d'affichage ne s'intègre pas dans la destination classique du mur mitoyen, reconnue de façon restrictive depuis Pothier et auparavant, comme devant répondre au double objectif de la clôture et de l'appui des constructions (cfr. Décision n° 68) ; la contradiction dans les termes apparaît en effet lorsque l'arrêt fait référence à l'une des limites du "pouvoir" de chaque copropriétaire, qui est précisément "l'obligation de respecter la destination du mur" ; il est également difficilement conciliable avec la règle de l'unanimité énoncée par l'article 577-2, 6° ; il constitue en réalité une forme de dérogation à cette règle de l'unanimité ; 6) enfin, la conclusion de l'arrêt est elle-même surprenante : d'abord parce qu'en théorie, l'exercice d'un droit d'affichage sur le mur mitoyen peut s'avérer préjudiciable au copropriétaire voisin ; ensuite parce que la décision attaquée avait relevé, souverainement en fait, qu'une telle utilisation avait été préjudiciable à la dame de Neef, ce qui était aussi un motif décisoire permettant de faire droit à l'action en sous-garantie d'Eugène Jean contre la Ville de Bruxelles, qui concernait indirectement la concession qui avait été donnée par cette dernière. En conclusion, si l'on veut retenir la théorie de la localisation d'un droit d'usage, au profit de chacun des copropriétaires, sur chaque face du mur mitoyen, c'est au prix d'une extension importante donnée à la destination du mur mitoyen, et cela ne peut se faire que moyennant une analyse très scrupuleuse en fait, par le juge du fond, de ce que chaque copropriétaire exerce ce droit avec circonspection, sans préjudicier à son voisin. Ce droit, s'il existe (et il semble qu'on puisse en effet considérer qu'il fait partie de notre droit positif jusqu'à un éventuel revirement de la jurisprudence), serait aussi susceptible d'abus. Cela étant, le nouveau Code civil, en son Livre 3, a choisi de consacrer le mécanisme vu ci-dessus du droit de jouissance sur chaque face du mur mitoyen, à l'article 3.126, sans doute à des fins pragmatiques et même si le mécanisme est difficilement réductible à des catégories existantes du droit des biens. Il est en réalité sui generis et pourrait aussi être expliqué par une idée de droit d'usage exclusif reconnu à un copopriétaire, également admis dans le nouveau régime de la copropriété des immeubles bâtis. Il convient enfin de relever que la Cour de cassation a par la suite rendu un arrêt nettement plus restrictif, et beaucoup plus orthodoxe, au sujet de la destination du mur mitoyen.
(106) Cass., du 03 octobre 1975 - affaire de Montjoie
Dans cette affaire, la dame Eugénie Thys avait remis des biens meubles à Monsieur de Montjoie. Après le décès de la dame Thys, ses héritiers réclamèrent à Monsieur de Montjoie les biens en question. Le défendeur opposa l'application de l'article 2279 (règle de preuve). D'un côté, les demandeurs à l'action furent amenés à invoquer l'existence d'un dépôt, de l'autre le sieur de Montjoie invoqua un don manuel. La cour d'appel de Gand fit droit à l'action, au motif que la possession du défendeur était équivoque. Pourvoi en cassation de Monsieur de Montjoie qui invoqua la violation des règles de preuve : "le fait que le demandeur en cassation ne pouvait se prévaloir de l'article 2279 du Code civil ne dispensait pas les défendeurs de fournir la preuve, conformément à l'article 1315 dudit Code, que ces biens litigieux étaient demeurés la propriété de la testatrice et que celle-ci avait conclu avec le demandeur une convention de dépôt, telle qu'elle est prévue à l'article 1915 du même Code" ; double preuve donc : du droit de propriété et du contrat invoqué, soumise pour ce qui concerne ce dernier à l'exigence de la preuve civile le pourvoi invoquait également un argument de non-réponse aux conclusions. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a suivi le moyen : 1) Après avoir observé que, d'une part, l'action tendait "à la restitution" de biens, en référence à un dépôt, d'autre part que le demandeur en cassation avait fait valoir un don manuel et s'était prévalu de l'article 2279 du Code civil, la Cour a rappelé les énonciations principales du juge du fond ; 2) elle constate ensuite : "qu'il s'ensuit que la cour d'appel décide que le demandeur ne peut se prévaloir d'une possession qui, en vertu de la protection instaurée par l'article 2279 du code civil, vaut comme titre de propriété et que le demandeur n'établit pas que les biens litigieux lui aient été remis à titre de donation par la défunte" ; 3) suit cet attendu essentiel : "attendu toutefois que la circonstance que le possesseur d'un bien ne peut bénéficier de la protection de l'article 2279 du Code civil n'implique l'existence ni du droit de propriété de celui qui réclame le bien, ni de la cause de restitution alléguée, en l'espèce le dépôt ; que les défendeurs, qui en tant que demandeurs originaires, réclament la restitution des biens litigieux, continuent, dès lors, à assumer le fardeau de la preuve de leur droit de propriété et du dépôt" ; 4) conclusion : cassation : "que l'arrêt qui, sans constater que les défendeurs ont fourni une telle preuve, ordonne la restitution des biens litigieux, ne justifie pas légalement sa décision". Cet arrêt a été assez vivement critiqué par la doctrine pour la confusion à laquelle il semble succomber entre action en restitution et action en revendication. D'une part, la Cour fait référence à une action en "restitution", d'autre part, dans le cadre de l'article 2279 (règle de preuve), elle indique que le demandeur à l'action, après avoir renversé la présomption de titre, devrait rapporter la preuve de son droit de propriété et de la cause de restitution qu'il invoque, ce qui ne s'imposerait pas dans une véritable action en revendication, seule la preuve de la propriété, par toutes voies de droit, étant en principe requise. Il nous semble qu'il faut à nouveau tempérer cette critique. Toute la difficulté, dans le type de litige à l'origine de cet arrêt et comme dans l'affaire précédente d'ailleurs, réside en ce que le demandeur à l'action, en principe dans le cadre d'une action en revendication, s'est prévalu lui-même d'une cause contractuelle de restitution (le dépôt dans cette espèce). En quelque sorte, il s'est alors piégé lui-même, en ce que lui sera en conséquence imposée la preuve nécessaire, par écrit, du contrat qu'il invoque. En conclusion, dans ce type d'espèce où la référence à une cause contractuelle de restitution vient se greffer sur une action en revendication, nous craignons que la Cour de cassation ait raison de relever que la preuve, non seulement du droit de propriété (laquelle sera rapportée, le plus souvent aisément, sur la base de la possession antérieure ou dès lors qu'elle n'aura pas été contestée de part adverse), mais également de la cause de restitution, soumise en principe au prescrit de la preuve écrite, s'imposera au demandeur à l'action, après qu'il ait renversé la présomption de titre (en prouvant par exemple un vice de la possession), pour qu'il triomphe complètement dans son action et puisse se voir restituer la chose concernée.
(96) Cass., du 18 décembre 1975 - affaire Bastin/Stoffels
Dans cette affaire, un litige opposait Mr. Stoffels à Mr. Bastin. Le premier avait vendu au second, par acte du 11 septembre 1964, une maison d'habitation possédant un jardin et des dépendances, qui était située à l'arrière de sa propriété, rue du Paradis à Verviers. L'acte de vente prévoyait la constitution d'une servitude de passage au profit du fonds de l'acquéreur, s'exerçant sur le fonds du vendeur, de la rue du Paradis vers l'arrière du fonds du vendeur. Stoffels fit ériger de son côté, dès le mois d'octobre 1964, différentes constructions, dont des garages, sur son fonds et à la limite du fonds de Mr. Bastin. Un litige naquit entre parties, d'abord quant à l'exercice de la servitude. Bastin, examinant le dossier plus en profondeur, fut en effet amené à considérer, quelques années plus tard, que Mr. Stoffels avait usurpé une partie de son fonds, à l'arrière de celui-ci, notamment en ayant construit des garages partiellement en empiétement sur le fonds de Bastin. Ce dernier décida alors de prolonger un muret, à concurrence de 54 cm, ce muret séparant son fonds d'un terrain contigu qui se trouvait également appartenir à Mr. Stoffels, donc jusqu'à ce qui, pour Bastin, était la limite séparative exacte des fonds. Mais en prolongeant ce muret, Mr. Bastin réduisit également de 54 cm une voie menant vers le terrain contigu appartenant à Mr. Stoffels, sur lequel ce dernier avait également fait ériger des garages. Le passage depuis ces derniers vers une rue de l'Enseignement, perpendiculaire à la rue du Paradis, était donc en partie obstrué, de sorte que Mr. Stoffels décida d'intenter une action devant le juge de paix, action par la suite qualifiée de réintégrande, la voie de fait étant évidente. On notera (c'est un point important), que dans cette espèce le droit à protéger était un droit sur un passage en pleine propriété et non une servitude de passage, qui eût rendu la réintégrande impossible et irrecevable en raison de l'imprescriptibilité d'une telle servitude. Le juge de paix confronté à une action purement possessoire, mais également influencé par l'argumentation de Bastin contestant les limites des deux propriétés, fut mal inspiré de décider au possessoire un mesurage et un bornage. Il désigna un expert à cette fin, qui conclut effectivement que la limite exacte, séparative des deux fonds, se situait là où Mr. Bastin l'avait prétendu. Sur cette base (qui touchait en réalité au fond du droit de propriété concerné et à ses limites), le juge de paix décida de déclarer l'action possessoire du sieur Stoffels non fondée. Ce dernier interjeta appel contre cette décision. Celle-ci fut cependant confirmée en degré d'appel par le tribunal civil de Verviers, d'où le pourvoi en cassation diligenté par Mr. Stoffels. Le pourvoi en cassation invoqua dans son moyen unique deux arguments qui semblaient tout à fait convaincants : d'abord, le juge du fond avait (à tort) rejeté l'action en réintégrande au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'une possession réunissant les caractères conformes aux article 2228 à 2235 du Code civil (une possession utile) or c'était là statuer contra legem, puisque la réintégrande ne requiert pas la preuve d'une possession utile (violation des dispositions concernées, dont bien sûr l'article 1370 du Code judiciaire) ; ensuite (et cet argument est plus intéressant pour notre sujet) la décision attaquée avait violé la règle de l'interdiction du cumul du possessoire et du pétitoire parce qu'elle s'était basée sur le résultat d'un bornage touchant essentiellement au fond du droit, en tant qu'il avait pour objet de fixer les limites de la propriété litigieuse (cfr. la motivation plus précise du jugement et la critique dans le moyen). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Comme on pouvait s'en douter, la cassation fut prononcée sur les deux points. Le jugement attaqué a d'abord été cassé pour avoir violé l'article 1370 du Code judiciaire en requérant illégalement la preuve d'une possession utile à l'appui d'une réintégrande. Il a également été cassé sur pied de l'article 1371 du Code judiciaire, pour avoir violé la règle générale de l'interdiction du cumul du possessoire et du pétitoire, au motif "qu'en déclarant l'action du demandeur non fondée, pour des raisons touchant au fond même du droit, et parce que la preuve d'une possession conforme aux articles 2228 et 2235 du Code civil n'était pas rapportée, le jugement viole les articles 1370 et 1371 du Code judiciaire". Il convient d'approuver pleinement cet arrêt qui n'est, somme toute, qu'une application directe de la règle générale de l'interdiction du cumul du possessoire et du pétitoire, dans le cadre toutefois spécifique d'une action possessoire rejetée en raison d'une demande de bornage, qui touche quant à elle au fond du droit (il s'agit même d'une forme d'action pétitoire : cfr. Décision n°99).
(36) Cass., du 18 janvier 1990 - affaire Idat
Dans l'espèce à l'origine de cet arrêt, la société anonyme ldat avait dirigé une action pour troubles de voisinage à l'encontre de l'Etat belge (Ministère des communications) et du Fonds des Routes, du chef de troubles résultant de travaux de voirie, qui avaient compromis une action de liquidation de ses stocks par la société. La cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 9 octobre 1987, a refusé de faire droit à cette action aux motifs que, dans les faits, la liquidation avait été retardée par la faute de la société. Si ce retard n'était pas survenu, la société aurait pu en effet mener à bien la liquidation avant les travaux. La cour constata notamment "que la société ldat eût donc pu annoncer, à tout le moins dès décembre 1979, la liquidation de son magasin, laquelle aurait été normalement achevée au plus tard à la fin décembre 1980, soit avant le début des travaux ; et qu'en organisant tardivement la liquidation litigieuse, la demanderesse s'est placée elle-même dans la situation de devoir prolonger celle-ci exagérément au-delà de la cessation du bail ; qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre que cette prolongation est imputable aux travaux entrepris par les défendeurs ; que l'action de la demanderesse doit être déclarée non fondée". En d'autres termes, le juge du fond considérait que le dommage subi en l'espèce était dû, non au trouble excessif, mais à un fait de la victime qui était qualifié de fautif. La cour d'appel avait-elle cependant écarté avec suffisamment de précision la causalité à l'égard du trouble excessif résultant des travaux, pour exclure ce qui aurait pu être un éventuel partage de responsabilités découlant de la faute de la victime et du trouble dommageable ? On pouvait en douter et le moyen pris par la société Idat à l'encontre de la décision de fond, soutint dès lors à juste titre que : "il n'y a absence de relation causale à raison de cette faute ou de ce fait que si le dommage, tel qu'il s'est réalisé in concreto, se serait produit sans le trouble de voisinage dénoncé ; qu'à défaut de réunion de ces conditions, la faute ou le fait de la victime n'est susceptible que de donner ouverture à un "partage de responsabilités" ; d'où il suit que l'arrêt n'a pu légalement rejeter la demande formée par la demanderesse au seul motif que celle-ci aurait tardé à réaliser la liquidation de son stock, sans relever en fait que le dommage subi in concreto par la demanderesse se serait également produit sans le trouble anormal de voisinage causé par les défendeurs". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Il convient d'approuver pleinement l'arrêt de la Cour de cassation qui a accueilli le moyen en décidant que : "la cour d'appel n'a pu exclure le lien de causalité entre les troubles anormaux du voisinage et le dommage en raison de cette seule considération (relative au fait que la demanderesse s'était elle-même fautivement placée dans la situation litigieuse) ; qu'en rejetant la demande pour les motifs qu'il mentionne, sans constater que le dommage, tel qu'il s'est réalisé, se serait aussi produit sans les troubles, l'arrêt viole l'article 544 du Code civil". Ce faisant, la Cour de cassation reconnaît implicitement, d'une part, l'existence de la condition de lien causal dans la théorie des troubles de voisinage entre le trouble et le dommage, et d'autre part, que l'appréciation de ce lien causal doit être menée à bien en appliquant la théorie de l'équivalence des conditions venant, on le sait, du droit de la responsabilité pour faute (cfr. art. 1382 et 1383 du Code civil).
(129) Cass., du 16 mai 1952 - affaire Pasquier
En 1924, les consorts Pasquier avait acquis un hôtel particulier situé rue de Fer à Namur, contigu à un immeuble dont le vendeur demeurait propriétaire. L'acte de vente contenait la clause suivante, quelque peu alambiquée : "la porte existant au-delà du porche dans l'allée conduisant à la cour restera exister, mais seulement pour l'usage des sous-locataires de la maison ici vendue, et pour autant que les acquéreurs en restent propriétaires par eux-mêmes ou tant que durera l'indivision après leur décès". Cette clause profitait à l'immeuble des consorts Pasquier, mais s'agissait-il d'une servitude, plus précisément une servitude de passage du fait de l'homme, conclue par convention ? Par la suite, les vendeurs initiaux vendirent leur immeuble contigu, dans le cadre duquel existait l'obligation de laisser le passage, à un acquéreur, la société Union Coopérative, qui fut amenée à soutenir que la clause ne pouvait avoir fait naître une servitude au profit du fonds des consorts Pasquier (fonds dominant), à charge de l'immeuble qu'elle avait acheté (fonds servant). Pour cette société, la clause n'avait engendré qu'un droit personnel au profit des sous-locataires de l'immeuble "Pasquier", eu égard à la manière dont elle était libellée. L 'Union Coopérative soutint plus précisément que : 1) la clause n'était pas valable en tant que servitude, car une servitude ne peut profiter à des personnes et peser sur des personnes (cfr. art. 686 du Code civil) ; 2) la validité d'une telle "servitude" était affectée par le fait que la clause prévoyait une condition résolutoire, personnelle au propriétaire actuel du fonds, ce qui n'était pas admissible, une servitude ne pouvant être affectée d'une condition résolutoire et étant essentiellement perpétuelle. Cette belle affaire posait donc la double question de la définition de la servitude et du caractère perpétuel de cette dernière. Le juge du fond, à savoir le tribunal de première instance de Namur, répondit positivement sur les deux points : la clause litigieuse était bien, selon lui, constitutive d'une servitude, et une servitude pouvait être affectée d'une condition. L'Union Coopérative se pourvoit en cassation sur les deux plans (d'où un pourvoi articulé en deux branches), celui de la notion de servitude et celui de sa durée, en soutenant qu'une servitude ne pouvait être assortie d'un terme ou d'une condition, étant par essence perpétuelle. L'Union Coopérative se pourvoit en cassation sur les deux plans (d'où un pourvoi articulé en deux branches), celui de la notion de servitude et celui de sa durée, en soutenant qu'une servitude ne pouvait être assortie d'un terme ou d'une condition, étant par essence perpétuelle. C'est à juste titre que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur l'un et l'autre fronts. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Après le rappel des énonciations du juge du fond, la Cour de cassation s'est prononcée comme suit : 1) quant à la première branche sur la notion même de servitude : "attendu que les termes de l'article 686 du Code civil, dont le pourvoi fait particulièrement état, ne peuvent être pris dans un sens littéral ; que le service foncier, tout comme le droit personnel, profite toujours à des personnes : qu'il y a servitude et non droit personnel, dès que le service est en rapport direct et immédiat avec l'usage et l'exploitation d'un fonds, n'eût-il d'autre effet que d'accroître la commodité de cet usage ou celle exploitation ; qu'en accroissant la commodité de l'exploitation du fonds, le service lui procure une plus-value et est donc établi pour le fonds, au sens de l'article 686 du Code civil" ; la Cour a ensuite appliqué cette définition à l'examen de la décision de fond et a considéré que cette dernière avait légalement décidé, de façon implicite mais certaine, que le droit de passage litigieux était constitutif de servitude conventionnelle car ce droit avait été établi pour augmenter la commodité de l'usage et de l'exploitation de l'immeuble appartenant aux consorts Pasquier ; 2) quant à la seconde branche sur le caractère perpétuel des servitudes, reprochant au jugement d'avoir admis l'existence d'une servitude soumise selon le pourvoi à une condition résolutoire dépendant de la seule volonté du propriétaire du fonds dominant, la Cour décide que : "si la servitude réelle est en principe perpétuelle, aucune règle légale ne s'oppose à ce que le droit du propriétaire du fonds dominant soit affecté d'un terme ou d'une condition résolutoire ; que s'il est affecté d'une condition résolutoire, l'avènement de la condition ne produit toutefois effet que pour l'avenir, en raison de l'impossibilité d'effacer les effets de la servitude pour le passé ; attendu que le fait que le maintien de l'existence de la servitude est conditionné par le maintien du droit de propriété du fonds dominant dans le chef de l'acquéreur ou de ses héritiers demeurant dans l'indivision, n'a point pour conséquence que l'on ne peut reconnaître au service le caractère d'une servitude réelle ; attendu que le moyen en aucune de ses deux branches ne peut être accueilli". Deux principes et quelques précisions se dégagent de cet arrêt et s'imposent à son analyse. D'abord, l'arrêt nous livre une définition convaincante du droit réel de servitude, en tant que service foncier, en mettant en évidence que ce type de droit peut profiter indirectement à des personnes, mais non directement, au risque de devenir une "servitude personnelle", contradiction dans les termes en principe prohibée par l'article 686 du Code civil. Le juge du fond apprécie souverainement L'existence de la servitude dans les faits de la cause, sous le contrôle marginal de la Cour de cassation qui vérifiera si le juge n'a pas violé, essentiellement : 1) la notion légale de servitude ; 2) la convention-loi et la force obligatoire des conventions (cfr. art. 1134. al. 1er du Code civil) ; 3) la foi due à l'acte constitutif de servitude (cfr. art. 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Ensuite l'arrêt énonce le principe suivant lequel les servitudes sont naturellement, mais non essentiellement, perpétuelles. Les servitudes peuvent dès lors être affectées : 1) soit d'un terme extinctif : événement futur et certain, à tout le moins dans son principe, ou quant à sa date : à cet égard, on constatera que la clause litigieuse dans cette affaire était constitutive d'un terme extinctif et non d'une condition résolutoire (événement futur et incertain), car il était certain, quant au principe de l'événement, que les consorts Pasquier cesseraient un jour, fût-il très lointain, d'être propriétaires de l'immeuble en question, et l'indivision devrait également prendre fin entre leurs héritiers après leur décès ; 2) soit d'une condition résolutoire, événement futur et incertain, dont la Cour a eu raison de préciser qu'il ne pourrait opérer que pour le futur, dès lors qu'il serait sans influence sur les effets passés de la servitude, ayant engendré des prestations successives au profit du propriétaire du fonds dominant (cfr. aussi analyse de droit des obligations, au sujet de la résolution sans effet rétroactif à l'égard des contrats à prestations successives), et le principe eût bien évidemment été le même en ce qui concerne un terme extinctif. Reste à s'interroger sur la précision suivant laquelle la servitude pourrait être affectée d'une condition résolutoire dépendant de la cession de la propriété du fonds dominant. Est-ce que cela signifie implicitement qu'elle pourrait être affectée d'une condition résolutoire, en dépendant de la cession de la propriété du fonds servant, et quel serait le fondement d'une éventuelle réponse positive à cette question ? Une note sous l'arrêt, signée des initiales "R.H" (à savoir le procureur général Raoul Hayoit de Termicourt) est éclairante à ce sujet : "bien que l'une des caractéristiques de la servitude soit que celle-ci peut être exercée par le propriétaire du fonds dominant, quel qu'il soit, on ne considère généralement point cette caractéristique comme de l'essence de la servitude. C'est pourquoi une servitude peut légalement être limitée au temps pendant lequel le propriétaire du fonds dominant, conservera la propriété de ce fonds. En revanche, il semble que limiter le service au temps pendant lequel le propriétaire du fonds servant, au jour de l'acte constitutif de la servitude, conservera la propriété du fonds soit contraire à la notion légale de servitude. Le droit de servitude, en effet est non seulement de sa nature, mais par essence, un droit réel immobilier. On soutiendrait dès lors malaisément que ce droit pût s'éteindre par toute aliénation du fonds qu'il grève". Cette analyse est convaincante mais pourrait encore être nuancée à la lumière d'analyses doctrinales contemporaines. D'abord, ce n'est pas la notion même de servitude qui est en jeu et justifie cette argumentation. C'est plutôt le raisonnement suivant : une servitude qui dépendrait de la décision de vendre le bien grevé par le propriétaire du fonds servant, pourrait être qualifié de servitude affectée d'une condition résolutoire purement potestative dans le chef du débiteur, encourant un risque d'invalidation en application de l'article 1174 du Code civil. Si la question de l'application de cet article, non seulement aux conditions suspensives mais aussi aux conditions résolutoires, est discutée en doctrine, je souscris aux analyses du professeur P. A. Foriers sur le sujet, qui a démontré que cette application aux conditions résolutoires n'était pas exclue (ce qui va dans le même sens, au demeurant, que l'analyse du Procureur général Hayoit de Terrnicourt), ni conceptuellement ni au regard de la jurisprudence, et qu'il faudrait voir dès lors si la condition résolutoire en question aurait pour conséquence de priver de lien obligatoire l'obligation enjeu, sans utilité pour le créancier, ce qui pourrait en faire alors une condition purement potestative tombant dans le champ d'application de l'article 1174 du Code civil. A cet égard, de deux choses l'une : 1) soit la condition résolutoire réside dans la décision de vendre le fonds servant, par le propriétaire du fonds servant, d'où l'extinction de la servitude : la servitude, quoique purement potestative, ne serait pas nécessairement toujours nulle; en effet, il faudrait voir si le propriétaire ne paie pas d'un certain prix cette extinction, notamment au travers des autres conséquences de la vente de son bien, et en outre, ta servitude a selon toute vraisemblance impliqué un certain nombre de prestations passées ; 2) soit la condition résolutoire purement potestative réside dans une décision du propriétaire du fonds servant toujours, mais sans autre conséquence pour lui et sans contrepartie pour le propriétaire du fonds dominant : dans ce cas, cette condition résolutoire pourrait être qualifiée de purement potestative et pourrait être invalidée en application de l'article 1174 du Code civil. Il est vrai toutefois que ce genre de question se pose rarement en pratique. Les conditions résolutoires purement potestatives sont rares dans les conventions et elles le sont encore davantage dans les servitudes conventionnelles. Par cet important arrêt de principe que nous avons déjà analyse supra, la Cour de cassation, dans une affaire portant sur une servitude conventionnelle, a déjà décidé que "les ternies de l'article 686 du Code civil, dont le pourvoi fait particulièrement état, ne peuvent être pris dans un sens littéral ; que le service foncier, tout comme le droit personnel, profite toujours à des personnes ; qu'il y a servitude et non droit personnel, dès que le service est en rapport direct et immédiat avec l'usage et l'exploitation d'un fonds, n'eût-il d'autre effet que d'accroître la commodité de cet usage ou cette exploitation : qu'en accroissant la commodité de l'exploitation du fonds, le service lui procure une plus-value et est clone établi pour le fonds, au sens de l'article 686 du Code civil". La Cour a ensuite appliqué cette définition à l'examen de la décision de fond pour considérer que cette dernière avait légalement décidé que le droit de passage litigieux était constitutif de servitude conventionnelle, car il avait été établi pour augmenter la commodité de l'usage et de l'exploitation de l'immeuble appartenant aux consorts Pasquier. Cet arrêt est riche d'enseignements, d'abord dans la définition nuancée qu'il a donnée de la servitude, ensuite, dans la mise en évidence d'un critère de constatation et de qualification de la servitude : il convient, pour qu'il y ait service foncier, que cet dernier accroisse la commodité de l'usage ou de l'exploitation du fonds, en lui apportant ainsi une plus-value, ce qui profite au propriétaire du fonds dominant, mais indirectement seulement.
(4) Cass., du 13 mars 1986 - affaire Gritten
Il s'agissait une fois de plus d'un litige fiscal. Par une première opération litigieuse, la dame Gritten avait fait apport à la société "Sables et Graviers" de deux terrains contenant des gisements de sable. La valeur des deux terrains avait été déterminée par les parties en prenant en considération, de façon distincte, la valeur du sable contenu dans le sous-sol (40 FB le m3), et la valeur résiduelle du sol après exploitation des gisements de sable (évaluée à 10 FB le m2). A la suite d'une seconde opération, la dame Gritten avait cédé à l'Etat belge, par convention du 21 mai 1968, un ensemble d'autres terrains, ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation publique et dont la valeur avait aussi été établie en distinguant le terrain des gisements de sable qui y étaient contenus. L'administration fiscale a considéré qu'il fallait taxer les deux types d'opérations au titre de l'impôt des personnes physiques, et prendre en considération la valeur du sable pour fixer le bénéfice d'exploitation total, au sens des articles 20, 1°, et 21 du Code des impôts sur les revenus, ce qui a été contesté par la dame Gritten. Cette dernière a invoqué le bénéfice de l'article 34 du Code, en vertu duquel sont immunisées et donc non prises en considération pour la détermination du bénéfice taxable, les plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis par des contribuables dont l'activité professionnelle ne porte pas sur l'achat ou la construction et la vente ou la location d'immeubles. La cour d'appel de Liège, par un arrêt du 26 juin 1985, a fait droit à la thèse de l'administration et a écarté la qualification d'immeuble en retenant, à l'égard du sable contenu dans les terrains et pour les deux opérations de cession, la qualification de meuble par anticipation. La dame Gritten s'est dès lors pourvue en cassation, en invoquant essentiellement dans ses deux moyens, portant respectivement sur les chefs de la décision attaquée relatifs à la première puis à la deuxième opération de cession, la violation des articles 518, 520 et 521 du Code civil (outre les dispositions de droit fiscal concernées), au motif que la mobilisation par anticipation peut se produire par l'effet d'une transmission, mais à la condition que "celle-ci soit distincte de celle du fonds, et ne puisse être exécutée que par une séparation du fonds". Cette argumentation paraissait convaincante. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a refusé cependant d'y faire droit et a esquivé la question posée à la suite du premier moyen portant sur la première opération de cession. Pour la Cour, la décision attaquée était légalement justifiée : le juge du fond avait pu considérer "par une appréciation en fait que dans la commune intention des parties cette aliénation (portant sur le terrain) était distincte de la vente du sable". Plus claire encore était la réponse au second moyen. Rappelant le contenu de l'arrêt attaqué, la Cour a précisé que "la volonté des parties est, en l'espèce, décisive de la nature mobilière attribuée au sable ; attendu que la notion même de meuble par anticipation fait prévaloir cette volonté sur la règle prévue par les articles 520 et 521 du Code civil ; attendu qu'il importe peu que l'acte constatant la volonté des parties sur ce point contienne d'autre part une transmission de la propriété du fonds ; que partant, la cour d'appel n'avait pas à constater que la transmission des deux éléments que les parties avaient nettement dissocier, est contenue dans des actes séparés". Si ce dernier attendu est convaincant, n'emporte pas la conviction la définition de la mobilisation par anticipation sur la base de la seule prise en compte, comme critère déterminant, de la volonté des parties, telle qu'exprimée dans leur acte juridique, indépendamment de la réalité de la séparation du bien qualifié de meuble par rapport à l'immeuble sous-jacent, ou à tout le moins de la certitude que les parties ont bien convenu d'une telle séparation et, le cas échéant, de ses modalités, notamment en termes de délai fixé ou raisonnable. Cette critique vaut a fortiori à l'égard de la seconde opération en la cause, qui était une cession à la suite d'une expropriation et qui n'impliquait en réalité aucune volonté de séparation du sable et d'exploitation de celui-ci dans le chef des parties et de l'Etat en particulier : pouvait-on dès lors parler de l'anticipation d'une mobilisation qui en réalité ne devait jamais se produire ? N'était-il pas également paradoxal que la qualification de bien meuble par anticipation, justifiée par la seule référence à la volonté des parties, tant au stade de la décision de fond que devant la Cour de cassation, ait eu pour conséquence la taxation de l'opération litigieuse ? C'est parce que les gisements de sable ont été qualifiés de biens meubles par anticipation et non d'immeubles non bâtis, que Mme Gritten n'a pu bénéficier de l'immunisation de l'article 34 du Code des impôts sur les revenus.
(1) Cass., du 15 septembre 1988
Il était question dans cette affaire du statut fiscal de pompes distributrices d'essence (ainsi que de leurs réservoirs et des autres appareillages liés aux pompes) : fallait-il les qualifier d'immeubles par nature et était-il dès lors requis de prendre en considération leur valeur pour calculer le revenu cadastral et, partant, le précompte immobilier dû par le propriétaire de ces pompes, qui était la société G.B. lnno B.M., emphytéote de l'ensemble du bien ? Le juge du fond avait admis une telle qualification, en constatant notamment les deux éléments suivants : 1) "les pompes à essence sont ancrées et boulonnées au sol, les citernes étant enfouies dans le sol" ; et 2) "l'ouvrage présente ainsi une adhérence pondéreuse et durable avec le sol". Le moyen de cassation critiqua cette qualification et soutint que le juge avait non seulement violé la notion d'immeuble par nature (cfr. deuxième branche se référant à la notion restrictive d'immeuble par nature suivant laquelle : "pour être immeuble par nature, un bien doit physiquement faire partie intégrante d'un fonds ou d'un bâtiment de telle façon qu'il ne puisse en être séparé sans en affecter la nature physique, c'est-à-dire sans qu'il soit fracturé, brisé ou détérioré, ou sans que soit détérioré le fonds auquel il est attaché"), mais également confondu cette notion avec celle d'immeuble par destination (cfr. troisième branche). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : L'arrêt de la Cour de cassation a rejeté le moyen. En particulier, en réponse aux deuxième et troisième branches, la Cour s'est bornée à décider, après avoir cité le texte de l'article 518 du Code civil, d'abord "qu'aux bâtiments, doivent être assimilés les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle", ensuite que l'arrêt de fond n'avait pas violé la notion légale d'immeuble par nature en ayant relevé les deux éléments ci-dessus indiqués, ni confondu celle-ci, dans l'application qu'il en avait faite, avec celle d'immeuble par destination. Tout en reprenant la définition de l'immeuble par incorporation, qui implique une référence à une incorporation dite "durable et habituelle", l'arrêt admet donc en réalité, de façon créatrice mais peut-être trop audacieuse, une application extensive de ce critère de l'incorporation, sans retenir l'approche restrictive qui en avait été faite par le deuxième moyen basée sur le critère de l'incorporation nécessaire et de l'impossibilité de séparation sans détérioration. L'arrêt procède également ainsi en demeurant quelque peu ambigu puisqu'il ne livre pas de définition claire du critère et se réfère simplement à l'application qui en a été faite souverainement par le juge du fond, laquelle n'est pas censurée. On comparera cet arrêt à la jurisprudence singulièrement plus restrictive de la Cour de cassation qui distingue la théorie générale des impenses de celle de l'accession immobilière (cfr. art. 555 du Code civil), en retenant comme critère l'incorporation dans une chose principale d'une chose accessoire "dont l'existence comme telle se conçoit indépendamment", l'accession n'étant pas applicable (mais bien la théorie des impenses) lorsque : 1) la chose accessoire est désormais absorbée et confondue avec la chose principale, et 2) que cette chose n'est pas susceptible d'enlèvement "sans destruction de la chose même dans laquelle elle a été incorporée" ( cfr. Décision 115).
(27) Cass., du 10 janvier 1974 - affaire Bécassine
L'Etat belge s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Il le critiqua parce qu'il avait admis que le locataire puisse agir sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage. Le pourvoi soutint : "qu'un locataire n'est, comme tel, pas titulaire d'un démembrement du droit de propriété et que, lorsqu'il subit un trouble de jouissance à la suite de l'exercice non fautif par un propriétaire voisin de son droit de propriété, il ne peut disposer d'un recours contre ce propriétaire sur la base de l'article 544 du Code civil". Si la prémice était exacte, qu'en était-il de la conclusion ? La Cour de cassation pouvait-elle rectifier, en droit, la qualification juridique utilisée erronément par le juge du fond, sans prononcer la cassation ? ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Une rectification des motifs était tout à fait possible. C'est ce que fit implicitement la haute juridiction au terme de la motivation suivante qu'il convient d'approuver dans son ensemble : "l'article 544 du Code civil vise les restrictions au droit de propriété commandées par les nécessités du voisinage" ; que la rupture d'équilibre provoquée par un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage peut exister entre le droit du propriétaire et celui du locataire de biens voisins ; que si ces droits sont l'un droit réel et l'autre un droit personnel, ils portent néanmoins sur le même objet puisque le locataire détient en vertu du bail un des attributs du droit de propriété : la jouissance du bien ; que, dans la mesure où le trouble de voisinage porte atteinte à cet élément du droit de propriété, le locataire qui est un voisin peut agir contre le propriétaire qui est un autre voisin, en payement d'une compensation rétablissant l'équilibre des droits de jouissance". La Cour de cassation a donc rectifié la qualification de "démembrement du droit de propriété" retenue improprement par la cour d'appel à l'égard du locataire. La décision d'appel demeurait pour le reste légalement justifiée. Le critère retenu du "droit de jouissance", "attribut du droit de propriété", susceptible de s'appliquer tant au droits réels qu'aux droits de créance, est par ailleurs tout à fait convaincant, et permet une définition efficace, large et cohérente du champ d'application matériel et personnel" de la théorie des troubles de voisinage. On lira enfin attentivement les conclusions une fois de plus remarquables, rédigées par M. l'avocat général Paul Mahaux. On soulignera la mise en perspective éclairante qui s'y trouve sur la théorie des troubles de voisinage et son fondement. P. Mahaux cite en effet l'enseignement suivant de MM. Renard et Vieujean : "la théorie des troubles de voisinage concède au culte des textes le recours aux articles 544 du Code civil et 11 de la Constitution, mais, au-delà de cette assise confortable, c'est l'équité (ou si l'on préfère, un principe élémentaire de justice commutative) qui constitue le véritable fondement de la réparation, de la compensation accordée au propriétaire lésé". Le critère permettant de définir le champ d'application matériel (le type de droit lésé) et partant personnel (le type de titulaire de droit lésé) est ainsi défini très clairement par la Cour de cassation dans l'affaire "Bécassine". Il s'agit du droit de jouissance, en tant qu' attribut du droit de propriété, ce qui assure une relation éclairante avec le texte de l'article 544 du Code civil et l'un des attributs de base de ce droit. Le renvoi au droit de jouissance peut être en outre opéré aussi bien dans le cadre d'un droit réel (le droit de propriété, cela va de soi, mais aussi un usufruit par exemple) que d'un droit personnel et de créance (un bail par exemple, une concession ou même un contrat conférant un droit d'occupation précaire,...). La définition du "voisin" est donc à juste titre étendue du propriétaire au titulaire d'un droit de jouissance. Reste que c'est cet attribut-là du droit de propriété qui semble être décisif et non un autre (le "fructus" ou l'"abusus"). La raison en est que la situation caractéristique des troubles de voisinage concerne la jouissance que l'on a d'un fonds. Reste aussi que l'objet à l'égard duquel s'exerce ce droit de jouissance doit être précisé. Il ne s'agit pas de n'importe quel bien (un bien meuble par exemple), mais d'un bien immeuble, plus précisément un fonds de terre ou un bâtiment, dans le cadre duquel s'est noué la relation de voisinage. La Cour de cassation a rendu un arrêt ultérieur confirmant l'enseignement de l'arrêt du 10 janvier 1974 en des termes cependant moins heureux.
(105) Cass., du 26 avril 1968 - affaire Jorissen
L'action d'une dame Vandevoordt, épouse de feu Herman Bex, et de ce dernier, tendait à obtenir la condamnation du sieur Jorissen au paiement d'une somme de 50.000 francs, représentant la contre-valeur de diverses choses prêtées à usage, ayant appartenu antérieurement au sieur Herman Bex. Mr. Jorissen invoqua sa possession et la présomption de titre déduite de l'article 2279 du Code civil. La cour d'appel de Liège refusa de le suivre et décida de faire droit à l'action en revendication de Mme Vandevoordt, en raison de l'ambiguïté de la possession de Mr. Jorissen, qui avait invoqué, dans le cadre de l'information pénale diligentée suite à une plainte de Vandevoordt, des explications contradictoires quant à l'origine de sa possession (à savoir, d'abord le fait qu'il avait acheté les choses revendiquées, moyennant un paiement de 65.000 francs, puis le fait qu'il les avait acquises par dation en paiement, en raison de services rendus à Herman Bex). La cour releva que : "dès lors que la protection (découlant de l'article 2279 du Code civil) n'existe pas et qu'il ne peut être attaché ni valeur ni foi aux dires de l'intimé, les al/égarions des appelants (Vandevoordt et feu Herman Bex) doivent ipso facto être tenues pour vraies et admissibles", de sorte qu'il fut fait droit à leur action en revendication. Jorissen critiqua l'arrêt de la cour d'appel, au motif que : "le seul fait que le possesseur d'un meuble ne peut invoquer la disposition de l'article 2279 du Code civil, sa possession n'étant pas régulière, n'implique pas l'existence d'une cause de restitution dans son chef ou du droit de propriété dans le chef de celui qui revendique et ne décharge pas ce dernier de la preuve, soit de la cause de restitution, soit de son droit de propriété" (cfr. première branche du moyen). Ce moyen paraissait tout à fait justifié. En effet, le renversement de la présomption de titre déduite de l'article 2279 (règle de preuve) ne suffisait pas. Le demandeur à l'action devait encore, à tout le moins, prouver son droit de propriété. Mais devait-il également prouver la cause de restitution, en l'espèce le contrat de prêt qu'il avait invoqué et pour lequel s'imposait la preuve écrite en droit civil ? ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a répondu positivement à cette question. Après avoir relevé que : "l'action tendait à la restitution. par le demandeur, de certaines choses prétendument prêtées à usage", et rappelé le contenu de la décision de fond, l'arrêt décide : "que des circonstances que le possesseur d'une chose ne peut bénéficier de la protection de l'article 2279 du Code civil et qu'il ne peut être ajouté foi à ses dires, on ne peut déduire l'existence ni du droit de propriété de celui qui demande la restitution de la chose ni de la cause qui est attribuée à la demande en restitution, en l'espèce le prêt à usage" ; et : "que comme le demandeur niait l'existence d'un prêt à usage, que la valeur de la demande excédait 3.000 fr., qu'il ne s'agissait pas d'un engagement commercial dans son chef et que l'arrêt ne constate pas qu'il n'a pas été possible au défendeur de se procurer une preuve littérale, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence du prêt à usage de simples présomptions de l'homme", de sorte que le moyen est déclaré fondé et la décision de fond est cassée. Cet arrêt a été critiqué pour deux raisons : d'abord, il parle d'action en restitution alors qu'il s'agissait manifestement d'une action en revendication ; ensuite, dans le cadre d'une action en revendication, seule la preuve du droit de propriété devrait en principe s'imposer au demandeur, après qu'il ait renversé la présomption de titre profitant au défendeur. En ce qui nous concerne, nous défendons une analyse plus nuancée et qui tempère la critique : 1) il semble que le demandeur à l'action en revendication avait greffé sur sa demande l'invocation d'une cause contractuelle de restitution, donc d'un titre concret (erreur tactique dans son chef) : la preuve littérale de ce titre devait alors s'imposer à lui, outre celle du droit de propriété sur le plan de la revendication ; 2) il est vrai que la Cour de cassation aurait pu nuancer la terminologie qu'elle a utilisée, et indiquer qu'il s'agissait d'une action en revendication (d'où la référence qu'elle a faite à l'article 2279 du Code civil) sur laquelle était venue se greffer une demande en restitution, sur la base d'un contrat ; 3) "il est cependant exact que la cour d'appel ne pouvait déduire, de la constatation du caractère équivoque de la possession de Jorissen, la preuve de l'existence du prêt, en affirmant que les allégations des époux Bex doivent ipso facto être tenues pour vraies" : la décision de fond était en effet critiquable à cet égard ; 4) est-ce que la Cour de cassation aurait pu préserver la décision de fond au motif que le passage précité ne "suffisait pas pour entraîner la cassation", dès lors que c'était "l'occasion, pour la Cour de cassation, de se rappeler qu'elle peut rejeter le pourvoi tout en relevant une irrégularité dans la décision attaquée, si celle-ci reste étayée par un autre motif éventuellement substitué par la Cour à un motif erroné, et que la décision de reconnaître l'existence du prêt n'était en somme qu'un détour inutile" ? Je ne le pense pas, l'invocation du prêt avait en effet été faite de façon certaine par le demandeur à l'action et il en supportait la preuve, ce que l'arrêt de fond n'avait pas constaté. Nous allons retrouver un même type de problématique dans l'arrêt suivant.
(159) Cass., du 13 mai 1970 - affaire Duyck
L'affaire était particulière : le sieur Duyck avait reconnu à une Société des bétons, un droit de construire sur un terrain. La convention avait été verbale et non transcrite ; par conséquent elle n'était pas opposable aux tiers (cfr. art. 1er de la loi hypothécaire). Il s'agissait donc, dans cette intéressante affaire, d'un droit de superficie né d'une renonciation à l'accession, elle-même verbale et tacite, car étant la conséquence d'une cession d'un droit de construire sur un fonds, consentie par Mr. Duyck à la Société des bétons. Par la suite, d'une part des constructions furent érigées par la Société des bétons, d'autre part, le terrain fut finalement vendu à l'initiative de créanciers de Mr. Duyck. Le cahier des charges de la vente publique était clair : ce qui était vendu, c'était le terrain, uniquement le terrain, à l'exclusion des constructions, et le terrain avait été acquis par un sieur Vandervijvere. Le litige était de nature fiscale. Son élément central portait sur un problème de perception du précompte immobilier. L'Etat belge, Ministère des finances, réclama au sieur Duyck : 1) pour la période I, antérieure à la vente du terrain, un précompte immobilier calculé sur la base de la valeur du terrain et des constructions ; et 2) pour la période II, postérieure, un précompte immobilier calculé sur la valeur des constructions uniquement. En d'autres termes, le fisc n'a pas reconnu le droit de superficie consenti à la Société des bétons, pour la période antérieure à la vente, et a admis l'existence d'un droit sur les constructions (l'équivalent d'un droit de superficie donc) pour la période postérieure, dans le chef de Mr. Duyck. Pour la période antérieure, la fisc pouvait invoquer les articles 552 et 553 du Code civil : le sieur Duyck était présumé être propriétaire des constructions érigées sur le fonds, et la présomption applicable ne pouvait être renversée par l'existence d'un droit de superficie non rendu opposable. Pour la période postérieure à la vente, il convenait de constater que les présomptions de propriété des articles 552 et 553 n'avaient pu opérer à l'égard du nouveau propriétaire du terrain. la propriété de ce dernier, distinguée de celles des constructions, ayant été seule cédée à ce tiers par un acte valable et opposable. A la conservation des hypothèques, seule la vente du terrain avait en effet été transcrite, à la suite de la vente publique. Le juge du fond décida que Je fisc avait raison : puisque le droit de superficie consenti par le sieur Duyck n'était pas opposable à l'administration fiscale, à défaut de transcription du titre à l'origine de ce droit, au bureau de la conservation des hypothèques (cfr. art. 1er et 3 de la loi du 10 janvier 1824), il s'ensuivait que Mr. Duyck était resté, à l'égard du cadastre, tant avant qu'après la vente du Lerrain, propriétaire des constructions et par conséquent redevable sur celles-ci du précompte immobilier, en vertu de l'article 155 du Code des impôts sur les revenus, comme indiqué ci-dessus. Le juge du fond écarta aussi l'argument du contribuable Duyck suivant lequel les acheteurs du terrain étaient présumés propriétaires des constructions, en vertu des articles 552 et 553 du Code civil et de l'accession qui avait dû se produire selon lui. Mr. Duyck s'est pourvu en cassation, en développant une argumentation quelque peu spécieuse tentant de faire valoir des contradictions dans la motivation de la décision de fond, notamment dans la référence aux articles 552 et 553 du Code civil. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : L'arrêt rejette à juste titre le pourvoi. Il rappelle les énonciations et décisions du juge du fond, puis se structure comme suit : 1) rejet du vice de contradiction dans la décision de fond : "il n'est pas contradictoire de décider, d'une pan, qu'à bon droit le demandeur est considéré par l'administration comme propriétaire des constructions au motif que le droit de superficie qu'il a cédé à ladite société n'est pas, en raison de la méconnaissance des dispositions susdites, opposable à L'administration et, d'autre pan, que l'acheteur du terrain n'est pas devenu propriétaire des constructions parce que la vente n'avait pour objet que le transfert de propriété du terrain" ; 2) application des articles 552 et 553 du Code civil : cette application se fait en deux temps : "attendu que la règle des articles 552 et 553 du Code civil régit la situation créée par l'établissement de constructions, plantations et ouvrages sur un fonds, mais ne s'applique pas au cas où le fonds, sur lequel des constructions, plantations et ouvrages ont été établis, est aliéné ; que ce dernier cas est réglé par les principes régissant l'aliénation et que lesdites dispositions n'interdisent nullement la séparation de la propriété du fonds de celle des constructions, plantations et ouvrages érigés sur le fonds" ; - "attendu, en outre, que ces mêmes articles ne créent qu'une présomption de propriété sur les constructions en faveur du propriétaire du fonds, jusqu'à preuve du contraire ; que la cour d'appel a pu considérer que cette preuve contraire résulte, en l'espèce, des mentions de l'acte d'achat, aux termes duquel la propriété du sol et celle des constructions sont séparées et l'acheteur ne peut obtenir la propriété des constructions qu'à condition de respecter les délais et conditions expressément stipulés : que le moyen ne peut être accueilli". D'abord, de façon générale, l'arrêt est trop sibyllin. Il y manque l'expression d'une prémisse importante, ou en tout cas d'un chaînon du raisonnement de la Cour de cassation, à savoir la mise en évidence de ce qu'il y avait eu renonciation implicite mais certaine à l'accession en l'espèce, à la suite de la cession par Mr. Duyck du droit de construire sur le fonds, et partant constitution d'un droit de superficie, lequel n'avait pas été rendu opposable à l'administration fiscale (ce dernier point est relevé par la Cour). On eût souhaité que la référence aux "principes régissant l'aliénation" du terrain, soit précédée par ce type de raisonnement qui aurait été plus affirmatif, et plus éclairant, quant à la nature de la renonciation à l'accession en tant que mode de constitution d'une superficie. L'application par la Cour et par le juge du fond des articles 552 et 553 du Code civil est pour le reste tout à fait exacte. Le professeur C. Renard a fait une fine analyse de cet arrêt dans sa note publiée à la Revue critique de jurisprudence belge, en 1980, il s'est demandé si la Cour de cassation avait ou non reconnu implicitement la qualification de superficie, résultant de la renonciation à l'accession en l'espèce. Il conclut à juste titre positivement sur ce point après avoir écarté d'autres interprétations complémentaires de l'arrêt, plus complexes et plus incertaines, en ces termes : "en renonçant à l'accession, le propriétaire du fonds cède en réalité une partie de sa propriété; cette partie cédée doit normalement conserver aussi la même nature et les mêmes qualités que celles que possédait l'ensemble originaire. Il en irait ainsi si la loi n'était pas intervenue et c'est le cas en France. Mais en droit belge, la solution est toujours la même : avoir, par quelque procédé que ce soit, des constructions, plantations et ouvrages sur le sol d'autrui constitue un droit de superficie régi par la loi de 1824 et dès lors temporaire en vertu d'une règle d'ordre public. Rien, dans l'arrêt de 1970, n'autorise à penser que la Cour ait pu se livrer à des spéculations aussi hasardeuses : rien n'y apparaît qui fasse penser qu'elle refuse de donner à l'appropriation des constructions obtenues par rétention la qualification de superficie". Il est en effet certain qu' il faille raisonner ainsi. Au demeurant, la Cour de cassation se réfère expressément à un droit de superficie, même si elle n'en explicite pas le mécanisme de constitution et l'articulation avec les articles 552 et 553 du Code civil à cet égard, sous la forme d'une dérogation et d'un renversement des présomptions découlant de ces dispositions. Par rapport à l'article 553 du Code civil et à la présomption de propriété pour ce qui concerne ce qui est construit sur le fonds, le raisonnement correct était donc Le suivant : 1) la présomption n'avait pas été renversée pour la période antérieure à la vente, à défaut de superficie rendue opposable aux tiers ; Duyck était présumé propriétaire des constructions ; et 2) pour la période postérieure à la vente, la présomption avait été renversée en tant qu'elle concernait le nouveau propriétaire Vandervijvere, puisque ce dernier n'avait acquis, en vente publique, par un acte valable et opposable, que la propriété du terrain, et non celle des constructions. Enfin, on peut aussi affirmer, grâce à cet arrêt, avec le Professeur C. Renard, que certaines interprétations antérieures de la doctrine, à caractère minoritaire, voyant parfois dans la renonciation à l'accession, soit la constitution d'un droit personnel, soit la constitution d'une servitude réelle, et souvent faites pour contourner la durée limitée de la superficie, doivent être écartées. Une renonciation simple à l'accession, si elle n'est pas formulée sous la forme d'une cession d'un droit de construire et de jouissance sur le fonds d'autrui assimilable à une servitude, engendre donc purement et simplement un droit de superficie. Le principe est certain et il peut s'appuyer sur la "ratio decidendi" de l'arrêt du 13 mai 1970.
(115) Cass., du 23 décembre 1943 - affaire De Muynck
L'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Gand avait décidé que les propriétaires d'un immeuble ne pouvaient forcer les époux De Muynck, qui avaient fait des ouvrages dans l'immeuble, à enlever ces ouvrages. Le motif de la décision, tel que rapporté par le pourvoi en cassation, était que "l'article 555 du Code civil est exclusivement applicable à des ouvrages nouveaux effectués sur sol nu et non bâti, ou à des ouvrages séparables, à côté de bâtiments existants, mais non à des ouvrages par lesquels des bâtiments et ouvrages existants seraient changés, agrandis, transformés ou améliorés". Par conséquent, le juge du fond avait écarté la demande d'enlèvement des ouvrages, et condamné les propriétaires du fonds au paiement d'une indemnité calculée "selon la nécessité ou l'utilité reconnue par lui aux divers types d'ouvrages" effectués en l'espèce. Dans cette affaire, le juge du fond avait donc décidé d'appliquer la théorie des impenses, mais non celle de l'accession régie par l'article 555 du Code civil plus précisément la règle générale énoncée par cette disposition, permettant d'imposer au "tiers" autre que le possesseur de bonne foi l'enlèvement des ouvrages concernés. II est vrai que le juge, dans la motivation précitée, n'avait pas très clairement indiqué le critère distinctif lui permettant de retenir l'application de la théorie des impenses plutôt que celle de l'accession. Un pourvoi en cassation fut dès lors soutenu à cet égard, tentant d'invoquer la violation de l'article 555, entre autres dispositions. Toutefois, on peut penser que le juge ne s'était pas trompé dès lors que, en réalité, les travaux litigieux n'étaient pas susceptibles d'enlèvement, C'est ce que décida la Cour de cassation, qui précisa, à l'occasion de cette affaire, les critères distinctifs à appliquer entre la théorie des impenses et celle de l'accession. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : L'arrêt est un long arrêt de principe qui énonce de façon détaillée le raisonnement de la Cour. Nous pensons pouvoir en structurer le contenu comme suit, ce qui nous permet de faire l'un ou l'autre commentaire : 1) référence à la théorie des impenses en tant que théorie générale et résumé de celle-ci : "attendu qu'en matière de revendication, hors les cas où la loi règle spécialement la question des restitutions, celles-ci demeurent sous l'empire des principes généraux et des traditions, qui trouvent leur expression dans la théorie des impenses ; que suivant cette théorie, le propriétaire doit au possesseur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, l'indemnisation des impenses nécessaires, c'est-à-dire celles qui ont été nécessitées par la conservation de l'immeuble, et celles utiles, jusqu'à concurrence de la plus-value existante au moment de la restitution ; attendu que l'arrêt attaqué fixe le montant des restitutions dues au possesseur évincé, en raison et dans la mesure de l'utilité et de la nécessité qu'il reconnaît en fait et souverainement aux diverses sortes d'ouvrages effectués par le possesseur aux bâtiments du propriétaire". Commentaires : - on peut se demander s'il était bien pertinent de présenter la théorie des impenses comme étant une théorie très générale, et plus générale même que les règles spéciales de l'article 555 ; - en outre, la théorie des impenses s'applique bien sûr aussi à un détenteur, et non simplement au possesseur de bonne ou de mauvaise foi ; 2) distinction avec l'accession régie par l'article 555 du Code civil et première définition du critère distinctif : "attendu que, sans doute, ces règles générales doivent fléchir devant les dispositions spéciales de la loi, lorsque celle-ci réglemente elle-même les restitutions ; que tel est le cas dans les hypothèses que prévoit l'article 555 du Code civil ; mais attendu que cette disposition, fondée sur la notion que la chose accessoire accroît à la propriété de la chose principale, suppose une incorporation, dans celle-ci, d'une chose (construction, plantation ou ouvrage) dont l'existence comme telle se conçoive indépendamment de sa réunion à la chose principale ; qu'elle ne trouve pas à s'appliquer aux éléments d'ouvrages exécutés sur celle-ci et qui s'y trouvent désormais absorbés et confondus". La Cour énonce ici le critère de l'indépendance d'existence de la chose accessoire par rapport à la chose principale, valant pour l'accession, alors que pour la théorie des impenses les choses sont "absorbées et confondues". L'arrêt ajoutera dans un instant un critère supplémentaire, plus exigeant encore, consistant en la possibilité d'enlèvement de la chose accessoire sans dommage, dans l'accession ; 3) distinction de l'accession par rapport à la théorie des impenses suite : adjonction du critère de la possibilité d'enlèvement de la chose accessoire sans dommage valant pour l'accession : à juste titre, l'arrêt explique ensuite la ratio legis et le contenu de l'article 555 : cette disposition s'applique bien à des choses susceptibles d'enlèvement puisqu'il prévoit la faculté pour le propriétaire du fonds, dans la règle générale, d'imposer un tel enlèvement au tiers autre que le possesseur de bonne foi. Plus important est l'attendu suivant, où l'on voit réapparaître le critère distinctif des théories, exprimé de façon plus précise et stricte : "attendu que la question de savoir si une construction, une plantation ou un ouvrage, effectué sur le fonds du propriétaire, est à considérer comme une chose susceptible d'existence propre, et, par suite, comme susceptible d'enlèvement sans destruction de la chose même dans laquelle elle a été incorporée, relève de l'appréciation en fait, et par conséquent souveraine, du juge". Le critère de l'indépendance d'existence de la chose accessoire par rapport à la chose principale renvoie donc au critère de la possibilité d'enlèvement sans destruction de la chose principale et (ajoutons le) de la chose accessoire. En d'autres termes, à suivre la Cour de cassation, la théorie de l'accession s'applique en principe à des choses (ouvrages, plantations, constructions,...) susceptibles d'enlèvement, c'est-à-dire à des choses présentant cumulativement trois caractéristiques : 1) il faut une chose accessoire liée à une chose principale ; 2) il faut que la chose accessoire ait une existence indépendante par rapport à la chose principale ; 3) doit être constatée une possibilité d'enlèvement, de séparation des deux choses, sans destruction de celles-ci, sans dommage donc souffert par l'une ou par l'autre. La réunion de ces caractéristiques ou conditions est appréciée souverainement en fait par le juge du fond, sous le contrôle marginal de la Cour de cassation quant aux notions légales appliquées et quant à la régularité de la motivation de la décision. 4) conclusion en la cause : il y a lieu à rejet du pourvoi aux motifs que : "dans l'espèce, l'arrêt attaqué dénie ce caractère aux ouvrages en question, et ne voit en ceux-ci que "des travaux d'agrandissement et de changement, apportés à des bâtiments déjà existants", auxquels ils sont si intimement unis, qu'ils en sont absolument inséparables" ; attendu que cette appréciation justifie la décision de l'arrêt et qu'il s'ensuit que celle-ci n'a en rien contrevenu aux dispositions légales invoquées au moyen". La juge du fond avait donc eu raison d'appliquer la théorie des impenses en l'espèce plutôt que l'accession régie par l'article 555 dans sa règle générale. Cet arrêt est évidemment important. Il développe une conception stricte de l'accession qui pourrait ne pas être en phase avec les contraintes de la pratique, si on la prend au pied de la lettre : "on est frappé par le fait que la combinaison de ce double critère" avec celui qui est défini d'autre part pour entraîner à coup sûr le recours à la théorie des impenses (travaux "absorbés et confondus") risque finalement de créer un grand vide entre les domaines respectifs des deux systèmes. Que faut-il décider en effet à propos d'ouvrages qui, sans être "absorbés et confondus" dans le fonds, peuvent être enlevés, mais n'ont cependant pas "d'existence indépendante", du moins en ce sens qu'ils n'ont pas d'utilité par eux-mêmes, ou ne pourraient que difficilement être enlevés sans dégradation plus ou moins importante (par exemple l'annexe d'un bâtiment) ? Peut-on admettre que, malgré ce qui vient d'être dit, la solution se trouva dans la théorie des impenses (en raison de son prétendu caractère de principe général) ?. Nous répondrons à cette dernière question comme suit : 1) le critère de l'existence indépendante est important : des travaux ou ouvrages portant sur des éléments qui n'auraient pas, ou plus, d'existence propre, devraient se voir appliquer la théorie des impenses ; 2) il faut faire une lecture qui ne doit pas être trop stricte et littérale de l'arrêt quant au critère de la possibilité d'enlèvement sans dommage : un dommage véniel ou aisément réparable, à moindres frais, subi par la chose accessoire ou principale, ne devrait pas exclure l'application de la théorie de l'accession ; la question du droit à indemnisation du propriétaire du fonds, dans l'application de la règle générale de l'article 555, pour le préjudice qu'il a éprouvé éventuellement, est distincte de celle de l'enlèvement et n'empêche pas l'application de la règle ; 3) les cours et les tribunaux, au fond, ne s'y sont pas trompés et font généralement une lecture raisonnablement souple de l'arrêt de 1943 et admettent d'appliquer la théorie de l'accession à des cas d'ouvrages susceptibles d'enlèvement même au prix d'une légère dégradation de la chose principale ou accessoire. Enfin, il est important de relever, ce qui a été rarement fait, que le mécanisme de l'accession connaît en matière mobilière une définition qui confirme en partie ce que nous venons de voir. Selon l'article 566 du Code civil : "lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie". De cet article découle une confirmation importante de ce que l'accession : 1) implique un lien d'une chose principale à une chose accessoire ; 2) du caractère nécessairement séparable de ces choses, pour qu'il y ait accession proprement dite ; 3) et le fait qu'une fois séparées, les choses doivent pouvoir subsister l'une indépendamment de l'autre. L'arrêt de la Cour de cassation du 23 décembre 1943 ajoute dès lors un critère : celui de la possibilité de séparation des choses sans dommage. L'on pourrait dire (de lege ferenda) que cet élément est en quelque sorte implicite dans le mécanisme même de l'accession et qu'il est compris dans le critère de la possibilité de séparation des choses. Nous sommes tentés de soutenir qu'il n'est pas un critère pertinent et technique. essentiel en matière d'accession. On rejoindrait d'ailleurs les analyses faites supra sur la notion d'immeuble par nature à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, pour laquelle le mécanisme de l'incorporation durable est le critère pertinent, mais non celui de la seule impossibilité de séparation sans dommage des biens.
(71) Cass., du 08 février 1968 - affaire de l'évêché de Liège
L'évêché de Liège invoqua dans son moyen unique de cassation la violation des articles 656 et 663 du Code civil, en plaidant que le premier article ne pouvait être appliqué pour échapper à l'application du second, aux motifs (double argument de texte) que l'article 656 "ne vise que les réparations et reconstructions à un mur mitoyen existant et non la construction d'un mur, et que, en toute hypothèse, la généralité des termes de l'article 663 exclut, dans les villes et faubourgs, toute exception à l'obligation inconditionnelle, qu'il impose de contribuer aux frais de construction d'un mur séparatif des héritages". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour a suivi les conclusions du procureur général R. Hayoit de Termicourt, auxquelles l'on se référera utilement. En synthèse, elles se montrent prudentes sur l'analyse de la jurisprudence et de la doctrine et font apparaître certaines difficultés d'interprétation des travaux préparatoires du Code civiI ainsi que de la Coutume de Paris, dont les articles 656 et 663 seraient partiellement issus. M. Hayoit de Termicourt conclut que la solution doit être trouvée dans le seul article 663 et dans la présomption d'utilité commune sur laquelle repose cette disposition. Cette présomption n'opère bien sûr pas juris et de jure, l'article 663 n'étant pas lui-même d'ordre public. C'est en ce sens, in expressis verbis, que s'est également prononcée la Cour de cassation, en décidant que "l'obligation imposée par l'article 663 du Code est une obligation de voisinage fondée sur une présomption d'utilité commune du mur à construire ; que cette présomption n'est toutefois pas une présomption juris et de jure ; attendu, partant, que le jugement attaqué, en décidant que les défendeurs qui offrent de faire abandon à la demanderesse d'une bande de terrain sont ainsi déchargés de l'obligation de contribuer à cette construction, loin de violer l'article 663 du Code civil, en a fait une exacte application", d'où le rejet du pourvoi de l'Evéché de Liège. On voit que, dans cet arrêt, la Cour de cassation tranche la question de droit qui lui est soumise en appliquant le seul article 663 du Code civil, et qu'elle ne fait nullement application de l'article 656. Le système que retient l'arrêt, fondé exclusivement sur l'article 663, suscite plusieurs commentaires critiques : 1) la référence à l'existence d'une obligation de voisinage à l'origine de l'article 663, ainsi que d'une présomption d'utilité commune, me paraissent judicieuses parce que de nature à éclairer l'économie générale de la disposition ; 2) la solution retenue est finalement en adéquation avec la portée générale de l'article 656 dans les travaux préparatoires du Code civil, article qui s'applique aux reconstructions et constructions, dans les villes, faubourgs et les campagnes. On ajoutera que l'article 656 est cohérent avec l'article 699 du Code civil, qui énonce un mécanisme similaire de faculté d'abandon et qui est applicable de façon générale aux servitudes établies par le fait de l'homme ; 3) on peut se demander pourquoi la Cour de cassation ne fait pas aussi référence à l'article 656, ce qui serait beaucoup plus clair. En effet, le système bâti par la Cour paraît, en définitive, quelque peu boiteux, parce qu'il ne repose que sur un point d'appui, l'article 663, alors que la référence à l'article 656 eût été également nécessaire : le recours à la présomption d'utilité commune ne justifie en rien l'abandon du terrain qui sera appliqué in concreto, que seule la faculté d'abandon organisée par l'article 656 permettrait d'expliquer ; 4) dans le système de la Cour, est également incertaine la manière dont il sera possible de renverser la présomption d'utilité commune à la base de l'article 663 : "le refus du voisin de contribuer aux frais d'érection de la clôture pourra-t-il être considéré comme preuve du défaut d'utilité commune ?". Tel semble être le cas dans le système de la Cour de cassation. Il faudrait pourtant répondre négativement à cette question. Le juge du fond devrait se livrer à une analyse précise, au vu des éléments concrets de la cause, pour voir s'il existe des éléments objectifs qui permettent de conclure à l'éventuel renversement de la présomption d'utilité commune. L'enseignement à déduire de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1968, est toujours valable en droit positif belge. Observons toutefois qu'il ne fait pas l'unanimité, tant s'en faut, auprès des juridictions de fond (sans parler des critiques de la doctrine). Ainsi, pour le tribunal civil de Malines, dans un jugement du 15 octobre 1991, l'article 656 n'est-il pas applicable à la clôture urbaine. Le jugement se démarque de l'arrêt de la Cour suprême en invoquant les différences de fait existant entre les espèces (dans le litige soumis au juge, un mur avait existé, même s'il avait été détruit, ce qui permettait de supposer la présence d'un intérêt commun initial ; dans l'affaire de l'Evêché de Liège, il n'existait aucun mur à l'origine). Le juge de paix du premier canton d'Ixelles a quant à lui admis, par un jugement du 31 août 1995, de prendre en considération la faculté d'abandon résultant de l'article 656, nonobstant la règle de l'article 663, dès lors que le renonçant au mur ne continue pas à se servir du mur litigieux. Un jugement du juge de paix de Jumet, du 17 avril 1996, reprenant l'enseignement de De Page et Dekkers, décide que l'abandon ne peut opérer lorsque le mur n'est pas encore érigé. Il statue ensuite sur pied de l'article 663, dont il rappelle le caractère impératif. Mais, dans l'espèce concernée, à défaut pour les défendeurs d'avoir renversé la présomption d'utilité commune en démontrant l'absence d'utilité commune, ou de prouver que les demandeurs avaient renoncé au bénéfice de l'article 663, la demande de participer aux frais de construction du mur a été jugée fondée. La jurisprudence demeure donc contrastée même si, en définitive, "tout en se référant à l 'arrêt du 8 février 1968, les magistrats se montrent particulièrement stricts dans l'appréciation des éléments qui permettent de renverser la présomption d'utilité commune puisqu'ils exigent que le voisin démontre l'absence de toute utilité du mur alors que la Cour suprême permet de déduire le renversement de présomption de l'abandon de la bande de terrain servant d'assiette au mur et du refus de contribution".
(55) Cass., du 25 février 1932
La Commune de Ghoy avait érigé un bâtiment contre lequel Mme Delprée avait appuyé elle-même une construction. Rien ne se passa alors. Par la suite, Mme Delprée céda sa maison à Mr. Leroy, lequel se fit assigner en "acquisition forcée" de la mitoyenneté, au motif qu'il continuait de profiter du mur de la Commune sans lui demander la cession de mitoyenneté sur pied de l'article 661 du Code civil. Mr. Leroy résista à cette action en opposant trois moyens de défense : 1) d'abord, il considérait que la maison lui avait été cédée avec toutes ses servitudes actives et passives, en ce compris la mitoyenneté du mur ; 2) ensuite, il avait de toute façon acquis la mitoyenneté par prescription acquisitive, ayant possédé de bonne foi et pouvant produire un juste titre ; 3) enfin, la situation litigieuse dépendait en définitive du fait de Mme Delprée, qui avait construit le mur, et c'était à l'encontre de cette dernière que la Commune aurait dû diriger son action. La question centrale qui se posait dans cette affaire, était de savoir si Mr. Leroy pouvait être tenu d'acquérir la mitoyenneté et d'en payer le prix, sur le fondement de l'article 661 du Code civil. Le juge du fond répondit positivement à cette question et fit droit à l'action de la Commune, d'où un pourvoi en cassation introduit par Mr. Leroy, et un premier moyen pris, entre autres, de la violation de l'article 661 du Code civil mais sans plus de précision quant à la critique à cet égard. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen formé par Mr. Leroy et a élaboré le premier état du système juridique à l'origine d'une obligation pour celui qui usurpe le mur d'autrui, d'en acquérir la mitoyenneté et d'en payer le prix. Ce système s'articule comme suit : 1) précision préliminaire touchant à la procédure et à la technique de cassation : "le jugement consacre ce principe que l'édification de constructions contre le mur du voisin a pour conséquence l'acquisition forcée de la mitoyenneté par le propriétaire auteur de ces constructions ; cette théorie juridique non contestée devant le juge du fond n'est pas critiquée par le moyen" ; 2) énoncé de la théorie nouvelle : "c'est à tout propriétaire dont les constructions s'appuient contre le mur du voisin qu'incombe l'obligation d'acquérir la mitoyenneté et d'en payer le prix ; que cette obligation est le corollaire du droit qui lui appartient de contraindre son voisin, en cas de refus, à lui céder la mitoyenneté" ; 3) fondement de la théorie : "cette obligation découle de la volonté du législateur, qui règle les rapports de voisinage et notamment ceux qui se rattachent à la mitoyenneté par ce principe d'équité suivant lequel l'un des voisins ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ; qu'il doit en conséquence intervenir dans les frais de construction du mur dont il profite ; que pareille obligation est une des charges que les articles 653 et suiv. du Code civil érigent en servitude légale et qui s'imposent à tout détenteur du fonds assujetti" ; 4) "obiter dictum" : "au surplus, que l'acquéreur, en maintenant l'état de fait créé par le précédent propriétaire, fait nécessairement siens les agissements de ce dernier, et que, s'il fallait admettre que celui-ci n'a contracté vis-à-vis du voisin qu'une obligation personnelle, il y a même raison de décider que l'acquéreur, à raison de son attitude, a contracté à son tour vis-à-vis du voisin une semblable obligation ; qu'il suit que le dispositif du jugement est en tout cas justifié". Cet arrêt a été assez vivement critiqué par la doctrine, en particulier par H. De Page et Dekkers, pour les raisons suivantes : 1) d'abord, l'affirmation que l'obligation d'acquérir la mitoyenneté, dans le contexte litigieux que nous venons de voir, est "le corollaire du droit" de contraindre le voisin à vendre la mitoyenneté, en d'autres termes que la règle de l'acquisition forcée de la mitoyenneté, serait le corollaire de la règle expresse de la vente forcée, est une pétition de principe qui ne repose pas sur le texte de l'article 661, lequel érige uniquement la règle de la vente forcée ; 2) ensuite, la référence au principe général suivant lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, pourrait justifier tout au plus l'allocation de dommages-intérêts en ce type de cause, dès lors que les conditions de ce principe seraient remplies, mais non une obligation d'acquérir la mitoyenneté d'un mur et d'en payer le prix" ; 3) l'arrêt baignait donc dans un certain flou juridique et le système dégagé, manquant de rigueur, n'était pas propice à la sécurité juridique. La Cour de cassation, consciente de ces critiques, fit dès lors évoluer le raisonnement juridique par la suite, en développant l'idée d'un accord de volontés à l'origine d'une vente de mitoyenneté, entre le voisin usurpateur du mur et le voisin usurpé, idée qui avait été mise en avant par De Page et Dekkers.
(16) Cass., du 23 novembre 2000
La question de l'évaluation du dommage et de la prise en compte de l'incidence de l'intérêt collectif sur la réparation, dans le cas de troubles causés par un pouvoir public, était la question centrale de cet arrêt. La cour d'appel de Bruxelles, juridiction de fond qui allait à nouveau s'attirer le feu nourri des critiques formulées par le pourvoi, avait tenté d'esquiver cette question en décidant, dans une espèce concernant cette fois la Région de Bruxelles-Capitale, que : "la prise en compte des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif influe sur l'appréciation de l'importance du trouble afin de déterminer s'il est excessif ou non, mais non sur sa réparation, dès le moment où, compte tenu de cet élément d'appréciation, son caractère excessif est établi ; qu'en l'espèce, la compensation due pour rétablir l'équilibre rompu doit être fixée au montant du dommage, tel qu'il a été évalué". Le risque de cassation était important et la cassation survint effectivement après que la Région de Bruxelles-Capitale ait soutenu dans son pourvoi, en particulier dans la troisième branche du moyen, que le juge du fond devait tenir compte de l'incidence du trouble souffert dans l'intérêt collectif, également sur l'indemnisation elle-même, et ne pouvait aboutir à une réparation de l'intégralité du dommage subi par le particulier (d'où la violation de l'article 544 du Code civil, disposition invoquée en la cause plutôt que l'article 11 (16) de la Constitution et le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a ici également suivi le moyen. L'arrêt commence par un attendu identique à l'attendu de base de l'arrêt du 23 mai 1991, qui faisait référence à l'obligation pour le juge de tenir compte des "charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif". La Cour poursuit en ces termes : "que s'agissant de compenser une rupture d'équilibre, cette disposition légale (à savoir l'article 544 du Code civil) ne permet d'indemniser que ce qui excède la limite des inconvénients normaux de sorte que le juge doit également prendre en considération lesdites charges pour évaluer le montant de la compensation", d'où la cassation qui est prononcée ensuite puisque la cour d'appel avait refusé de tenir compte de l'incidence de l'intérêt collectif sur la réparation et le dommage, et accordé une réparation intégrale. Nous ferons ci-après un commentaire critique plus général concernant cet arrêt et le système d'indemnisation qui en découle en pratique. Voici les éléments certains (et une critique) qui se dégagent de ces trois différents arrêts, en synthèse. 1) lorsque le trouble excessif résulte de travaux publics imputables à une personne de droit public, le demandeur à l'action pour troubles de voisinage peut invoquer, à son choix, comme disposition légale lui permettant de préciser la cause de son action, l'article 544 du Code civil (qui est le plus souvent invoqué) et/ou le principe général de l'égalité des citoyens devant les charges publiques consacré par l'article 16 de la Constitution (ancien article 11). 2) lorsque le trouble excessif résulte de travaux publics, quel que soit le fondement de l'action, le juge a l'obligation de vérifier quelle a été l'incidence de l'intérêt collectif sur l'intérêt à agir mais aussi sur le montant qui sera attribué au demandeur à titre de compensation. En d'autres termes, en cas de travaux publics réalisés dans l'intérêt général, le trouble et le dommage doivent être pondérés, voire diminués, à concurrence de la part de trouble et de dommage que le demandeur à l'action aurait de toute façon supportée dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt de la communauté (outre la prise en compte de la plus-value éventuelle résultant des travaux). Si les travaux en question ne concernent pas l'intérêt général mais seulement l'intérêt privé de la personne de droit public en la cause, parce qu'ils portent par exemple sur le domaine privé de l'Etat, la prise en considération particulière de l'intérêt collectif ne doit pas alors opérer et le juge doit statuer comme il le ferait normalement dans le cadre d'un litige entre particuliers. 3) critique : ce système impliquant la prise en compte de l'incidence de l'intérêt collectif est convaincant en théorie mais difficile à appliquer en pratique. Le Professeur J. Hansenne a ainsi relevé, à juste titre : "si l'on peut retenir ce système pour le juge, on peut lui souhaiter bonne chance. Déterminer l'importance d'un dommage n'est jamais chose aisée. Préciser quelle est l'ampleur d'un dommage dépassant la limite des inconvénients ordinaires du voisinage est encore plus périlleux. Mais estimer, à tout coup, les charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif relève de la gageure".
(160) Cass., du 19 mai 1988 - affaire Immogaule
La société Etablissements Emile Fontaine a conclu une convention immobilière avec une société Immogaule, aux termes de laquelle la première a renoncé à l'accession à l'égard des constructions qui seraient construites par la seconde. L'acte notarié reprenant cette convention contenait hélas une référence supplémentaire, quelque peu perturbatrice, à l'article 577bis, § 9, du Code civil, visant la copropriété forcée à titre accessoire. Il était sûr toutefois que l'opération de base qui était visée était une renonciation à l'accession ; elle impliquait en effet une dissociation entre la propriété du sol, qui était conservée par la société E. Emile Fontaine, et celle des constructions, que détiendrait la société Immogaule. Cette dernière fit de mauvaises affaires de sorte qu'un de ses créanciers, la société Staes-Heynderickx, lança une procédure immobilière de vente publique portant sur des emplacements de garage construits par sa débitrice. Un problème de validité de la saisie-exécution en rapport avec les garages se posa, résultant de la référence dans l'acte constitutif à l'article 577bis du Code civil. La cour d'appel de Bruxelles déclara en effet nulle la saisie qui avait été pratiquée, au motif qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'article 577bis, § 9, qui prévoit que la saisie d'un bien principal en copropriété, dans sa partie privative, doit obligatoirement s'accompagner de la saisie de la quote-part sur le bien indivis accessoire (à savoir les quote-parts dans le sol et les parties communes). Or en l'espèce, les garages avaient été saisis tels quels, sans application de cette disposition. Était-ce pertinent alors que l'objet principal de la convention initiale était la constitution d'un droit de superficie résultant de la renonciation à l'accession au profit de la société Immogaule ? En d'autres termes, il semblait que la saisie qui avait été pratiquée sur les emplacements de parking, était parfaitement valable en tant qu'elle avait saisi ces biens en totalité, et il n'existait pas, en l'espèce, une véritable copropriété à titre accessoire entre parties. La société Staes-Heynderinckx se pourvut en cassation en soutenant, en substance, que le juge avait confondu la superficie avec la copropriété forcée à titre accessoire, et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer à un cas de superficie, la règle limitant la saisissabilité des biens en copropriété forcée accessoire, résultant de l'article 577bis, § 9, du Code civil. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a, avec raison, cassé la décision de fond. La motivation de l'arrêt se structure comme suit : 1) rappel de l'article 577bis, § 9, du Code civil, dont la Cour a déduit la conséquence suivante : "le caractère accessoire desdits biens implique que chacun des propriétaires des "héritages distincts" soit, en même temps, copropriétaire indivis des accessoires affectés à l'usage commun" ; 2) qualification de la renonciation à l'accession en tant que mode de constitution d'un droit de superficie : "attendu que, par la renonciation à l'accession des constructions érigées par la s.p.r.l. lmmogaule, la défenderesse (S.A. Etablissements Emile Fontaine) a consenti en faveur de celle-ci un droit de superficie et est restée seule propriétaire des quotités de terrain sur lesquelles s'élèvent ces constructions" ; 3) rejet de la qualification de copropriété forcée à titre accessoire, et de l'application de la cause d'insaisissabilité découlant de l'article 577bis, § 9, du Code civil, et partant cassation. Cet arrêt est un arrêt d'espèce. Il est toutefois doublement intéressant : - d'abord parce qu'il confirme le principe suivant lequel une renonciation à l'accession engendre un droit de superficie ; - ensuite parce qu'il précise que le propriétaire du terrain est resté seul propriétaire des quotités de terrain sur lesquelles s'élèvent les constructions du superficiaire. Par exclusion, ce dernier n'est donc pas propriétaire de quotités dans le sol; mais il est propriétaire de ses constructions. Ceci confirme le fait que la superficie engendre en principe, sauf volonté contraire des parties, une stricte dissociation dans l'espace entre les propriétés, le temps de sa durée du moins. Quelle est par ailleurs la différence avec une copropriété forcée à titre accessoire dans le cadre d'un immeuble bâti ? On peut la comprendre comme suit : 1) dans la superficie, le superficiaire devient plein propriétaire privatif des constructions, plantations et ouvrages qu'il a réalisés ou acquis auprès du tréfoncier, et il n'a pas de droit de propriété sur les quotités du sol afférentes à ces éléments. Ces dernières appartiennent au propriétaire du sol : en d'autres termes, ces quotités sont privatives mais non dans le chef du superficiaire ; 2) dans la copropriété forcée à titre accessoire, la situation est différente : le copropriétaire est, d'une part, propriétaire exclusif des éléments privatifs de l'immeuble, et, d'autre part, copropriétaire des éléments communs qui leur sont indissociablement liés, à savoir : (i) les quotités dans le sol (qui ne sont donc pas privatives) ; et (ii) celles dans les parties communes. Cette affaire peut être mise en parallèle avec l'affaire "Mi guet" examinée supra en matière d'accession (cfr. Décision n° 116).
(58) Cass., du 02 juin 1977
Le cas est classique. En l'espèce, le mur latéral d'un garage avait été construit en matériaux légers, à savoir des blocs de "bims" de 9 centimètres d'épaisseur, à quatre centimètres du mur pignon privatif et séparatif du voisin. Nous intéresse l'appréhension de l'espèce par le juge du fond. Celui-ci, "après avoir constaté en fait qu'il existe un espace entre le pignon du défendeur et le mur latéral du garage de la demanderesse et qu'il n'y a ni attache ni scellement de la construction de la demanderesse dans celle du défendeur", a dit pour droit, malgré tout, qu'il y avait prise de possession, et a appliqué la règle déduite de l'article 661 du Code civil, en relevant, entre autres, "qu'il convient d'adapter la notion et les modalités d'emprise au progrès de la technique et de l'étendre à tout avantage" retiré du mur. La décision de fond a dès lors relevé dans le chef de la partie concernée, qu'elle avait posé un acte d'appropriation de la mitoyenneté du mur pignon litigieux. Cette partie s'est pourvue en cassation et a invoqué notamment la violation de l'article 661 du Code civil, au motif "qu'il ne peut y avoir prise de possession d'un mur voisin que s'il y a usurpation ou voie de fait contre lesquelles le maître du mur peut réagir en exerçant des actions judiciaires tendant à faire cesser cette prise de possession" et à l'égard desquelles le voisin usurpateur pourra réagir lui-même, le cas échéant (ce moyen reprend l'articulation du raisonnement développée dans la note signée "FD" sous l'arrêt précédent, en y ajoutant le critère de l'usurpation ou de la voie de fait). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Cette fois, la Cour de cassation a fait droit au pourvoi et a décidé, après le rappel des énonciations du juge du fond, que : "le droit pour le propriétaire d'un mur séparatif de deux héritages de contraindre son voisin à acquérir la mitoyenneté de ce mur suppose que le voisin commette une usurpation ou une voie de fait valant prise de possession dudit mur, à laquelle le propriétaire de celui-ci puisse s'opposer ; qu'il faut que cette prise de possession revête un caractère tel qu'à défaut pour son auteur d'y mettre fin, la volonté de celui-ci d'acquérir la mitoyenneté du murs en déduise sans équivoque ; que l'existence de telles conditions ne se déduit pas des énonciations du jugement ; que, partant, la décision n'est pas légalement justifiée". La décision de fond est par conséquent cassée. Notre analyse est la suivante : 1) il est positif que la Cour de cassation précise la notion de prise de possession en requérant l'existence d'une usurpation ou d'une voie de fait "valant prise de possession". Il faut donc un acte d'usurpation physique et matérielle impliquant un contact direct avec le mur d'autrui, et, le cas échéant, un ancrage dans celui-ci. A cet égard, cet arrêt dégage ce qui est le critère opérationnel actuel de la théorie ; 2) il est cependant étrange que la Cour ne fasse plus référence à l'article 661 du Code civil ; et 3) qu'elle reprenne cette formulation quelque peu impropre renvoyant au droit "de contraindre le voisin à acquérir la mitoyenneté" ; 4) En revanche, élément à approuver, le dernier attendu reprend à bon escient les acquis du raisonnement que l'on avait pu déduire de la fin de la note "FD" sous l'arrêt précédent.
(156) Cass., du 10 avril 1981
Le schéma de ce cas était simple et classique. Les demandeurs X (dénommés "Vankets") possédait dans le mur jointif, non mitoyen, de leur maison, une vue illégale donnant sur le fonds de leurs voisines Mmes Y ("Vandereyckern"), lesquelles construisirent sur leur fonds. Les consorts X agirent pour obtenir l'enlèvement des constructions en question. Si l'on appliquait les principes énoncés par la Cour de cassation en 1939, le sort de cette action devait être clairement négatif. Les consorts X tentèrent de contourner la difficulté en soutenant une argumentation très alambiquée basée sur la théorie des troubles de voisinage. Elle était en substance la suivante : par l'existence de la fenêtre illégale, ils avaient causé un déséquilibre entre les fonds, d'une durée de plus de trente ans, impliquant une forme d'empiétement et leur conférant le droit de la conserver et surtout d'interdire à leurs voisines de construire sur leurs fonds comme elles l'entendaient. Une telle argumentation était évidemment totalement absurde et sans fondement, mais elle n'était pas, malgré tout, complètement innocente quant à la notion d'empiétement. Elle fut balayée par le juge du fond, qui releva par ailleurs l'absence d'abus de droit des constructeurs Y. X, qui n'avait pas froid aux yeux, réitéra son argumentation dans le pourvoi en cassation et ce dernier fut à juste titre rejeté. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Le raisonnement suivi par la Cour de cassation est à nouveau pleinement convaincant. Il s'articule, après quelques éléments de mise en contexte, par des développements en trois temps : l) mise en perspective de l'application de la théorie des troubles de voisinage soutenue par les demandeurs en cassation : "attendu que le moyen, partant de la thèse que les servitudes dites légales, comme celles de jour et de prise d'air, en tant que droit naissant du voisinage, appartiennent aux attributs ordinaires du droit de propriété, soutient que, en aménageant dans le mur séparatif une fenêtre qui ne correspond pas aux prescriptions restrictives des articles 676 et suivants du Code civil, les demandeurs ont rompu l'équilibre normal entre leur droit de propriété et celui des défenderesses, propriétaires du fonds voisin, en manière telle qu'ils ont empiété sur le droit de propriété des défenderesses et en concluent, sur la base d'une possession utile trentenaire desdites vue et prise d'air, qu'ils ont acquis par prescription une soi-disant servitude active d'interdiction de bâtir à charge du fonds des défenderesses" ; 2) référence au cas exceptionnel de l'empiétement réel de la vue ou du jour sur le fonds d'autrui, à l'origine possible d'une servitude de prospect : "attendu toutefois que le propriétaire d'un héritage qui pratique dans un mur non mitoyen des jours ou des prises d'air contraires auxdites prescriptions, n'empiète sur le fonds du voisin permettant d'acquérir par prescription trentenaire une servitude d'interdiction de bâtir, que lorsque et pour autant que la nature de l'ouvrage est matériellement en nécessairement en opposition avec le droit du voisin de bâtir librement sur son fonds, ce que la décision attaquée en constate pas en l'espèce" ; 3) combinaison des principes précités et rejet du pourvoi : "attendu que pour autant que le comportement des demandeurs ci-dessus décrit ait pu rompre l'équilibre entre les droits de voisins et ceux des défenderesses au sens où cette règle est contenue dans l'article 544 du Code civil, il ne pourrait uniquement être déduit de cette règle qu'ils sont tenus à l'égard des défenderesses d'une compensation, mais non qu'ils ont acquis en outre le droit d'interdire aux défenderesses de bâtir librement sur leur fonds ; que le moyen manque en droit". Par-delà le rejet, qui était évident, de l'application de la théorie des troubles de voisinage dans cette affaire, retenons l'expression d'un principe important opérant comme une exception : la possession d'une vue ou d'un jour à une distance illégale ne confère pas passé le délai de trente ans, une servitude de prospect, servitude active de vue interdisant au voisin de construire, sauf dans un cas : si la vue ou le jour a empiété physiquement sur le fonds d'autrui, étant "matériellement et nécessairement en opposition avec le droit du voisin de bâtir librement sur son fonds". Est alors né par prescription acquisitive, au bout de trente ans (cfr. art. 2262 du Code civil), une servitude de prospect, déduite d'un fait de l'homme (la possession), la suite d'une possession (corpus + animus) trentenaire, contre laquelle le voisin aurait dû réagir, et conférant en quelque sorte une apparence à la charge de non-construction ayant duré trente ans au moins. Ce raisonnement n'est pas nouveau. Il découle d'une jurisprudence déjà ancienne, semble-t-il. Mais l'on peut encore s'interroger : quel doit être le point de départ du délai de trente ans ? Logiquement, ou en tout cas simplement, ce devrait être le moment de la construction en empiétement, mais est-ce toujours le cas ? Un arrêt du 25 mai 1990 suscite la perplexité au sujet de cette question, appliquée à un cas de servitude d'aspect cette fois.
(155) Cass., du 21 décembre 1939
Le schéma est différent de celui rencontré dans l'affaire précédente. Une vue existe depuis plus de trente ans dans le mur de X, qui est un mur jointif. Cette fois, le voisin Y demande l'application de l'article 661 du Code civil, règle de la vente forcée, pour construire in futuro contre le mur de X, après l'avoir rendu mitoyen, ce qui aurait pour conséquence que la vue de X devrait immanquablement être obstruée. X pouvait-il faire valoir les conséquences de l'écoulement du délai trentenaire depuis la construction de la vue illégale, pour s'y opposer, et jusqu'où allaient les conséquences de cette prétention : pouvaient-elles aller jusqu'à interdire à Y d'exercer son droit d'acquérir la mitoyenneté pour construire sur son fonds, en vertu de l'article 661 du Code civil, qui entraînerait l'obturation de la vue de X. Le juge du fond eut la volonté de rendre une forme de jugement de Salomon, bien incohérent toutefois et difficilement compréhensible. Il décida que : 1) X avait acquis le droit de conserver la fenêtre illégale ; 2) tandis que Y avait le droit d'acquérir la mitoyenneté du mur où se trouvait la vue illégale ; 3) mais en ne pouvant construire sur son fonds qu'à une certaine distance pour respecter la vue de X. Cette décision surréaliste était totalement incompatible avec la lettre et l'esprit de l'article 661 du Code civil : comment Y pouvait-il se voir reconnaître une mitoyenneté dans un mur contre lequel il ne pourrait pas construire directement ? Y se pourvut dès lors en cassation, en invoquant qu'une servitude de vue avait été reconnue illégalement par le jugement à X, l'empêchant de construire sur son fonds, si ce n'est à une certaine distance, ce qui ne se pouvait, les règles en matière de mitoyenneté ayant aussi été violées. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Il fut fait droit par la Cour au pourvoi en cassation par une impeccable motivation : 1) référence au mécanisme de la prescription extinctive : après le rejet d'une fin de non-recevoir et le rappel de la substance du moyen ainsi que des énonciations essentielle du juge du fond, la Cour décide "qu'en limitant le droit du propriétaire de pratiquer des ouvertures dans son mur, la loi a créé à charge de ce propriétaire une obligation non faciendi ; qu'il suit de là qu'en vertu du principe "tantum praescriptum quantum possessum", le propriétaire qui, pendant plus de trente ans, a eu dans son mur des ouvertures à une distance moindre du fonds voisin que la distance légale, n'a pu, par l'effet de la prescription, que s'affranchir de ladite obligation". S'est donc réalisée une prescription extinctive de la servitude légale de vue, ou "vue de servitude" qui pesait sur le fonds soumis à la règle de distance légale (donc fonds servant), cette servitude étant continue et apparente, or une servitude continue, et le droit corrélatif bénéficiant au fonds voisin, peuvent s'éteindre par le non-usage, "du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude" (cfr. art. 707, en matière de servitude légale), c'est-à-dire du jour où il a été fait un acte contraire (une construction) à l'obligation découlant de la règle de distance légale. 2) rejet de principe de la prescription acquisitive d'une servitude de vue sensu stricto (servitude de prospect) et déduction quant au caractère illégal de la décision de fond : mais "il ne s'ensuit pas que cette prescription lui ait fait acquérir ipso facto une servitude active de vue sur ["héritage voisin, entraînant pour le propriétaire de celui-ci une obligation non altius tollendi ou non aedificandi ; au surplus pareille servitude est non apparente et aux termes de l'article 691 du Code civil, elle ne peut être acquise par prescription" ; et, dès lors ; "que le seul fait constaté par le juge du fond de l'existence, depuis plus de trente ans, de la fenêtre litigieuse, n'a pu faire acquérir au défendeur en cassation aucune servitude active sur le fonds voisin". Cette motivation est tout à fait pertinente. 3) argument a fortiori dans le cadre de l'application de l'article 661 du Code civil. le droit de demander la vente forcée de la mitoyenneté étant qualifié d'imprescriptible : "que d'autre part, le droit d'acquérir la mitoyenneté est imprescriptible et qu'en vertu de l'article 675 du Code civil, l'acquéreur de la mitoyenneté d'un mur a droit à la suppression des fenêtres et ouvertures pratiquées dans ce mur ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les dispositions légales reprises au moyen". S'ajoute donc un deuxième aspect au raisonnement juridique : le droit de demander la vente forcée (art. 661 du Code civil) ne peut se perdre pas prescription extinctive; cela peut se comprendre dès lors que le droit de propriété lui-même ne peut non plus se perdre par prescription extinctive (mais peut se perdre indirectement par une prescription acquisitive par autrui, comme d'ailleurs une mitoyenneté peut s'acquérir pas prescription acquisitive d'où la perte indirecte du droit découlant de l'article 661). Cet arrêt, pleinement convaincant, nous permet de dégager, essentiellement, le principe de l'imprescriptibilité acquisitive de la servitude active de vue, autrement dénommée servitude de prospect, en raison du caractère non apparent de ses éléments d'interdiction de construire ou d'exhaussement de constructions existantes "non aedificandï" et "non altius tollendi".
(54) Cass., du 16 novembre 1961
Le sieur Lepers fut amené à lancer une action sur le fondement de l'article 661 du Code civil à l'encontre de son voisin, le sieur Sluys, action tendant à la vente forcée par ce dernier de la mitoyenneté d'un mur de séparation des deux fonds. Sluys refusa la cession et résista à l'action au motif que les conditions de l'article 661 du Code civil n'étaient pas strictement remplies en l'espèce. En effet, le mur dont Lepers voulait obtenir la mitoyenneté n'était pas construit précisément à la limite des deux fonds, sur le fonds de Sluys. Une bande de terrain de 10 cm de large à une extrémité du mur, atteignant 30 cm à l'autre extrêmité et formant donc un triangle, se trouvait encore appartenir à Sluys, étant située par-delà le mur. Selon Sluys, le mur n'était dès lors pas "jointif". Il ne pouvait être question d'une propriété "joignant un mur" dans le chef du demandeur en vente forcée (le sieur Lepers), au sens de l'article 661. En outre, si une telle vente devait se produire (quod non selon Sluys), elle impliquait pour ce dernier une cession forcée d'une bande de terrain plus importante que celle correspondant à la moitié du sol se trouvant sous le mur, d'où une forme d'expropriation de sa propriété privée, non conforme au régime de l'article 661 du Code civil. Cette argumentation ne manquait pas de pertinence mais elle était également quelque peu excessive et abusive, ce qu'invoqua Lepers. Le juge du fond choisit effectivement de résoudre le litige en recourant à l'abus de droit (cfr. résumé de la décision attaquée dans le "en ce que" du moyen), d'où un pourvoi en cassation formé par Sluys, pris notamment de la violation des articles 11 de la Constitution, ainsi que 544 et 661 du Code civil. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a décidé que le juge du fond avait légalement justifié et régulièrement motivé sa décision. L'arrêt contient une définition de la mitoyenneté en tant "qu'état d'indivision forcée qui a sa source dans l'intérêt général". On lira par ailleurs avec attention la mise en évidence par l'arrêt de certains critères de l'abus de droit retenus par la Cour de cassation et valablement appliqués par le juge du fond en l'espèce, à savoir : 1) le choix de la façon la plus dommageable d'exercer son droit ; 2) "sans utilité" pour celui qui l'exerce et 3) la "méconnaissance de l'intérêt général" dans l'exercice du droit. Si les deux premiers critères sont orthodoxes, le troisième l'est moins. L'arrêt doit toutefois être remis en perspective par rapport aux évolutions ultérieures qui interviendront en matière d'abus de droit, annoncées par l'arrêt du 10 septembre 1971 (cfr. Décision n° 8), lequel a comme on le sait impliqué l'apparition d'une formule générique de l'abus de droit et la reconnaissance du critère de la disproportion, de plus en plus utilisé par la suite. Constatons également, afin d'identifier précisément le droit subjectif litigieux, qu'il s'agissait du droit du défendeur à l'action, de résister à la demande en vente forcée sur pied de l'article 661. Le droit du demandeur à l'action pourrait bien sûr donner lieu également à un éventuel constat d'abus de droit. On comparera enfin cette décision à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1983, analysé supra (cfr. Décision n° 50), qui a décidé que le droit de demander l'application de l'article 663 du Code civil était aussi susceptible d'abus, et partant n'est pas un droit discrétionnaire. On notera que cet arrêt est, en définitive, très audacieux dans l'application de l'abus de droit qu'il admet : est critiqué le voisin qui invoquait son droit de s'opposer à une application de l'article 661 dès lors que les conditions n'en étaient pas remplies, alors que l'autre partie n'avait pas, à proprement parler, un droit subjectif à faire valoir sur pied de l'article 661 puisque les conditions de cet article n'étaient pas totalement réalisées. Ceci revient à admettre une application raisonnablement souple de l'article 661 afin d'atteindre l'objectif visé par cette disposition. Le Code civil n'a pas expressément pris en considération une situation complémentaire à celle visée par la lettre de l'article 661 : que se passe-t-il en effet lorsqu'un voisin, sans faire application de l'article 661 du Code civil, parce qu'il ne veut pas payer le prix de la mitoyenneté, fait usage (première situation litigieuse), ou même usurpe directement le mur d'autrui en y appuyant ou ancrant un mur ou une construction (seconde situation litigieuse) ? La jurisprudence a apporté une solution à cette question en élaborant un mécanisme juridique faisant appel, de même que la vente forcée, à la logique contractuelle. Il sera en effet considéré qu'un contrat de vente s'est formé, à certaines conditions, entre le voisin ayant pris possession par usurpation (mais non simplement par usage) du mur d'autrui, et ne cessant pas cette usurpation, d'où l'obligation pour lui de payer le prix de la mitoyenneté. La jurisprudence, essentiellement de la Cour de cassation, a ainsi développé une mécanisme d'obligation de payer le prix de la mitoyenneté, proche d'une forme "d'acquisition forcée" de la mitoyenneté, même si cette expression est impropre puisque le voisin n'est pas légalement tenu d'acquérir cette mitoyenneté, mais est tenu d'en payer le prix à partir du moment où il a émis une volonté d'acquérir la copropriété du mur en prenant possession par usurpation du mur en question, et ce alors que l'autre voisin était, de son côté, en état d'offre permanente quant à la cession de mitoyenneté, état qu'il a confirmé par une action en justice diligentée sur le fondement de l'article 661 du Code civil.
(91) Cass., du 29 mai 1997
Les consorts Bertrand occupaient et exploitaient une pâture sise à Francorchamps, en qualité de fermiers et à la suite d'un bail à ferme. La pâture fut cédée aux consorts Legras, et les consorts Bertrand furent d'accord de déclarer dans l'acte d'achat de la parcelle, en leur qualité de locataires, qu'ils acceptaient de mettre fin purement et simplement, sans indemnité, à dater de l'acte en question, au bail existant entre eux et les vendeurs, et de renoncer à leur droit de préemption sur le bien. Les consorts Legras posèrent par la suite un acte agressif vis-à-vis de la parcelle, que les consorts Bertrand avaient continué de détenir, en arrachant la haie qui clôturait celle-ci, du côté de la route de Francorchamps. Les consorts Bertrand introduisirent en conséquence une réintégrande en considérant qu'il résultait du comportement des Legras une voie de fait, mais leur action fut déclarée irrecevable, par confirmation du jugement en appel, au motif que la réintégrande peut "être intentée par le détenteur d'un immeuble, le détenteur étant celui qui possède pour autrui, dans tous les cas en vertu d'un titre de précarité qui donne toujours un titre de légitimité à sa "possession". Selon le juge, ce n'était plus le cas des demandeurs Bertrand : leur qualité de détenteurs avait été contestée, et surtout, le bien litigieux avait été cédé par les vendeurs initiaux, libre de toute occupation et de tout bail à ferme, de sorte que le titre d'occupation des consorts Bertrand avait pris fin. A cette approche restrictive de la notion de détention, les consorts Bertrand opposèrent, à juste titre, l'argument suivant : "la disparition du titre légitime de détention ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en réintégrande". Les Bertrand avaient en effet continué d'occuper et de détenir la parcelle litigieuse, d'où la violation par le juge de l'article 1370 du Code judiciaire (cfr. troisième branche du moyen de cassation). Ils ajoutèrent un argument efficace touchant à la procédure, que l'on rencontre parfois en cassation, qui est le suivant : le juge du fond, en statuant comme indiqué ci-dessus au sujet de la détention, qu'il avait (à tort) défini en fonction d'une cause légitime de précarité, n'avait pas, ce faisant, pris en considération un moyen de défense soulevé par la partie défenderesse à l'action possessoire, au sujet duquel la partie demanderesse aurait eu l'occasion de développer une argumentation en conclusions ; partant, le juge du fond avait "élevé une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les conclusions des parties excluaient l'existence, violant ainsi le principe dispositif" (cfr. quatrième branche du moyen). Le principe dispositif est le principe général de droit en vertu duquel ce sont les parties au procès qui disposent de l'objet et des termes de leur action et de leurs défenses, le juge ne pouvant excéder ceux-ci (le juge du fond avait également violé le principe général de droit imposant le respect des droits de la défense des consorts Bertrand, non invoqué cependant dans la branche du moyen). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a cassé sur la base de ces deux critiques, de fond et de procédure. Retenons quant au fond la motivation convaincante répondant à la troisième branche, qui est la plus intéressante pour notre matière : "que l'action introduite par les demandeurs est une action possessoire qualifiée de réintégrande ; que celle-ci, qui tend au maintien de la paix publique, appartient à tout détenteur, à quelque titre que ce soit. d'un immeuble ou à tout titulaire d'un droit réel immobilier, troublé dans sa jouissance par violence ou voie de fait ; "qu'une telle action peut être exercée notamment par celui qui détenait un immeuble susceptible d'être acquis par prescription, en vertu d'un titre régulier de détention, mais auquel ce titre a été retiré, s'il est dépossédé de l'immeuble par violence ou voie de fait".
(64) Cass., du 07 septembre 1972
Les consorts Harmant, vendeurs forcés de mitoyenneté en application de l'article 661 du Code civil, ont lancé une action en paiement du prix de la mitoyenneté à l'encontre de leur voisin, la S.P.R.L. Etudes et Constructions Jean Draps, qui était acquéreuse de la mitoyenneté et tenue dès lors d'en payer le prix. Cette dernière résista à l'action en invoquant une clause de réserve de mitoyenneté dont elle avait appris l'existence, se trouvant dans l'acte d'achat de la maison des consorts Harmant, clause par laquelle ces derniers avaient déjà cédé leurs droits à un entrepreneur, constructeur initial du bien, et dont le texte était le suivant : "les mitoyennetés seront acquises par les maîtres de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, lequel restera propriétaire des murs et pignons susceptibles d'être utilisés par les constructions voisines". Ayant déjà cédé ce droit à un tiers, les consorts Harmant ne pouvaient plus, selon la S.P .R.L. Jean Draps, lui en demander à elle le paiement. Le tribunal de première instance de Bruxelles refusa toutefois de suivre l'argumentation de la S.P.R.L. Jean Draps et fit droit à l'action en paiement des consorts Harmant, aux motifs que la cession de droit qui était intervenue entre ceux-ci (cédants) et leur vendeur constructeur (cessionnaire de droit) était une simple cession de créance, "res inter alios acta" à l'égard de la S.P.R.L. Jean Draps, futur débiteur cédé mais tiers à cette convention, qui ne pouvait l'invoquer dès lors que cette cession ne lui avait pas été rendue opposable par signification conformément à l'article 1690 (ancien) du Code civil. La S.P.R.L. Jean Draps se pourvut en cassation et développa notamment un second moyen structuré en trois branches : 1) première branche : référence à la qualification de la clause de réserve de propriété en termes de droits réels ("caractère réel" de cette clause) de sorte que le jugement entrepris avait violé la foi due à la clause ; 2) deuxième branche : référence au principe de l'opposabilité des effets externes des conventions : l'existence même de la clause aurait dû avoir pour conséquence son opposabilité aux tiers ; cet argument ne pouvait bien sûr être suivi puisque l'on sait que la cession de créance n'est précisément opposable aux tiers, dans son existence même, que moyennant le respect préalable des formalités d'opposabilités, ou en cas de reconnaissance de la cession de créance par le débiteur cédé (théorie des actes équipollents à formalités d'opposabilité de la cession de créance) ; 3) troisième branche : c'est d'ailleurs cette dernière théorie qu'invoquait le moyen dans sa 3ème partie, mais là aussi l'argument n'était pas pertinent puisqu'il n'était pas démontré en l'espèce que la S.P.R.L. Jean Draps, débiteur cédé, avait reconnu l'existence de la cession. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a d'abord pris position au sujet de la première branche et de la qualification à donner à la clause de réserve de mitoyenneté. Le juge du fond avait retenu la qualification de cession de créance future ; ce faisant, selon la Cour, "le tribunal n'a pas méconnu la foi due aux actes et a attribué à la clause invoquée par la demanderesse le seul effet qu'elle pouvait avoir légalement, la mitoyenneté ne pouvant appartenir qu'aux propriétaires de fonds contigus". C'est donc la qualification personnelle (cession de droit de créance) qui est à juste titre ainsi retenue, pour une excellente raison, et non la qualification réelle (cession d'un droit réel de mitoyenneté). Il convient d'approuver pleinement l'arrêt sur ce premier aspect qui est le plus important. La Cour a par ailleurs rejeté les deuxième et troisième branches au terme d'une motivation également convaincante qui est la suivante : 1) rappel du principe d'opposabilité des effets externes des conventions, sans formalités : "sans doute, l'existence d'une convention étant opposable aux tiers, ceux-ci sont tenus en principe d'en reconnaître les effets entre les parties contractantes et peuvent les invoquer pour se défendre contre une prétention d'une de ces parties" ; 2) mais rappel aussi des exceptions, à savoir le caractère dérogatoire au principe d'opposabilité des effets externes, du régime résultant de l'article 1690 du Code civil, et rappel implicite de la théorie des actes équipollents à formalités d'opposabilité de la cession de créance, qui impliquent, plus qu'une simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ou le tiers, une reconnaissance ou une acceptation par lui de la cession : "mais attendu qu'en vertu de l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire d'une créance n'est saisi à l'égard des tiers que dans les conditions prévues par cette disposition ; qu'ainsi la simple connaissance de la cession, par le débiteur, ne suffit pas pour la lui rendre opposable et pour lui permettre de refuser la payement de sa dette au créancier envers lequel celle-ci a été contractée" ; 3) conclusion au sujet du jugement entrepris : rejet du moyen car : "attendu que le moyen n'invoque pas et qu'il ne ressort d'aucune constatation du jugement que le transport de la créance par les défendeurs (consorts Harmant) à un tiers ait été notifié (lire : signifié) à la demanderesse, débitrice de la créance, ni que cette cession ait été reconnue ou acceptée par elle avant l'intentement de l'action des défendeurs contre cette dernière". L'enseignement à déduire de cet arrêt de principe, concerne la qualification à donner aux clauses de réserves de mitoyenneté. Il s'agit, selon la Cour, de cessions de créance future, qui sont soumises au régime d'opposabilité de droit commun de la cession de créance, d'où le nécessaire respect des formalités légales prévues à cet effet. L'on sait à cet égard que par la loi du 6 juillet 1994, modifiant notamment l'article 1690 du Code civil, ont été substituées aux formalités lourdes et contraignantes qu'étaient la signification par exploit d'huissier ou l'acceptation du débiteur cédé par acte authentique, des formalités plus souples nouvelles, à savoir : 1) soit la prise en compte de la conclusion même de la convention de cession, qui la rend opposable aux tiers ; 2) soit la notification au débiteur cédé ou la reconnaissance par lui de la cession, en tant que formalités d'opposabilité à ce dernier (avec application éventuelle et supplémentaire de la théorie des actes équipollents à ces formalités). Dans le système antérieur de 1994, qui requérait la signification de la cession de créance au débiteur cédé ou son acceptation par acte authentique, se posait évidemment le problème de l'identification du débiteur cédé, impossible au moment de la cession à l'entrepreneur, puisque le mur du voisin n'était pas encore en situation d'être construit et d'être rendu alors mitoyen, et que l'on ne connaissait pas alors le débiteur cédé, et que dès lors la créance était future. Toute cette problématique était d'ailleurs en partie au coeur de l'affaire "Harmant/Draps". Ce problème a été en partie réglé par le nouveau système d'opposabilité de la loi de 1994 qui dissocie l'opposabilité aux tiers (sans formalités et découlant de l'opposabilité des effets externes de la cession, en vertu de l'article 1165 du Code civil) de celle au débiteur cédé (liée à un notification).
(157) Cass., du 25 mai 1990
Les consorts R. et S. avaient construit une terrasse surplombant le fonds de leurs voisins B. et V. Premier élément intéressant du litige : la terrasse était à l'origine d'une vue sur le fonds voisin, et celle-ci existait depuis plus de trente et un ans si l'on prenait comme point de départ du délai le moment de la construction de la terrasse (en janvier 1952). La vue résultant de la terrasse était trop proche du fonds voisin et n'avait pas ainsi respecté les règles de distance légale découlant du Code civil (cfr. 678 ou 679 du Code civil). Un litige naquit entre parties. Les voisins B. et V. incommodés par la vue sur leur fonds, demandèrent reconventionnellement la démolition de leur terrasse. Ils avaient en effet construit une maison sur leur fonds, qui existait depuis moins de trente ans, ayant été construite au cours de l'année 1954. Leur demande datant du 14 janvier 1983 (cfr. date de dépôt au greffe des conclusions exprimant la demande reconventionnelle), si l'on prenait comme point de départ la construction de la terrasse voisine (janvier 1952), elle devait être déclarée prescrite sur la base d'un raisonnement de prescription extinctive. Elle ne l'était plus si l'on prenait comme point de départ la construction de la maison voisine des consorts B. et V. survenue en 1954. Le juge du fond suivit cette seconde analyse. R.et S. se pourvurent en cassation contre cette décision en développant, dans le moyen unique de leur pourvoi, une argumentation apparemment imparable qui attaquait la décision de fond tant sur le terrain de la prescription extinctive que sur celui de la prescription acquisitive. Cette argumentation vaut le détour : 1) quant à la prescription acquisitive : les demandeurs avaient invoqué une "prescription acquise le 8 janvier 1982 soit une prescription acquisitive du droit de conserver la fenêtre par l'expiration du délai de trente ans depuis la date de la construction de leur terrasse (janvier 1952) ; "que les demandeurs ont dès lors fait valoir que la prescription trentenaire était acquise en ce qui concerne la demande reconventionnelle tendant à la démolition de la fenêtre ; que, d'une part, dans la mesure où il s'agit de la prescription acquisitive (par la possession trentenaire prévue à l'article 690 du Code civil), d'une servitude active au profit du fonds des demandeurs, fondée sur le fait que pendant trente ans au moins les demandeurs ont eu, de la terrasse litigieuse, une vue pratiquée à une distance illégale, le point de départ du délai de trente ans est indépendant du moment où l'on a construit sur le fonds servant (en l'espèce le fonds des défendeurs)". La référence à une servitude "active" de vue était inexacte ; aucune servitude de prospect ne pouvait avoir été acquise puisqu'il n'y avait pas eu d'empiétement sur le fonds voisin ; en revanche, un simple droit de vue, droit de conserver la vue illégale, résultant du fait de l'homme, et par prescription d'une servitude d'aspect donc, pouvait être invoqué. Or cette servitude était continue et apparente et, en outre, il paraissait convaincant de soutenir que le point de départ de son acquisition était le premier acte de possession du droit de vue, à savoir le moment où la vue illégale avait été construite, en vertu du droit commun de la possession, et non le moment où le voisin avait lui-même construit. 2) quant à la prescription extinctive : un raisonnement critique fut également développé par les demandeurs en cassation de façon alternative, s'il fallait considérer que le juge du fond avait raisonné en termes de prescription extinctive, et ce de façon impeccable, comme suit ; "d'autre part, dans la mesure où il s'agit de la prescription extinctive d'une servitude négative sur le fonds des demandeurs, à savoir la défense de construire une terrasse à une distance illégale, la servitude s'éteint par k non-usage pendant trente ans (article 706 du Code civil) et les trente ans commencent à courir, lorsqu'il s'agit (comme en l'espèce) d'une servitude continue, du jour où un acte contraire à la servitude a été fait (article 707 du Code civil), à savoir, en l'espèce, du jour où la terrasse a été construite à une distance illégale". Cette argumentation était, me semble-t-il, pleinement convaincante. La Cour de cassation refusa toutefois de suivre ces critiques en les rejetant sur le terrain de la prescription acquisitive d'une servitude d'aspect, avec prise en compte du point de départ de la prescription déduit du moment, non de la construction de la terrasse litigieuse, mais de la construction de la maison voisine. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Je cite presqu'in extenso la motivation de l'arrêt en présentant son articulation : 1) mise en perspective de la décision de fond en tem1es de prescription acquisitive d'un droit de vue ou servitude d'aspect : "attendu que la demande reconventionnelle des défendeurs tendait à mettre fin à la vue directe que les demandeurs ont de leur terrasse au premier étage sur le fonds des défendeurs ; "attendu que le droit de vue depuis une terrasse constitue une servitude continue et apparente qui s'acquiert par la possession de trente ans" ; 2) détermination du point de départ du délai trentenaire de prescription : expression d'un principe puis d'une exception : - principe : "que, en règle, la prescription acquisitive de pareille servitude court du jour de l'achèvement de l'ouvrage par lequel la servitude est exercée" ; - exception : "que la prescription ne court cependant pas tant que le propriétaire du fonds servant ne fait que tolérer que son fonds soit ainsi grevé ; que dans ce cas, la prescription acquisitive du droit de vue ne commence à courir qu'à partir du moment où ce propriétaire cesse de tolérer cette situation" ; 3) application de ces principes et règles à l'examen de la décision de fond et rejet du pourvoi : "attendu que le jugement attaqué décide "que le point de départ de la prescription en l'espèce est non pas le moment où les demandeurs ont construit leur maison mais celui où les (défendeurs) ont construit leur maison contre celle des demandeurs". Que le juge relève ainsi que les défendeurs n'ont en fait pas subi d'inconvénient de la vue que les demandeurs avaient de leur terrasse jusqu'à ce que les défendeurs aient construit une maison sur leur fonds. Que cette constatation, qui implique que les défendeurs ont toléré la vue litigieuse jusqu'à ce qu'ils aient construit leur maison sur leur fonds, justifie légalement la décision que la prescription acquisitive au profit des demandeurs n'a commencé à courir qu'à partir du moment où les défendeurs ont construit leur maison contre celle des demandeurs ; que le moyen ne peut être accueilli". Cet arrêt complexe suscite une certaine perplexité. Il a d'ailleurs été rendu sur conclusions contraires du ministère public. Première lecture : on pourrait lui opposer les critiques principales suivantes, qui sont de quatre ordres : 1) quant à la prescription acquisitive d'une servitude d'aspect : il n'est pas du tout certain que le juge du fond avait raisonné ainsi ; et n'était-il pas plus simple de raisonner en termes de prescription extinctive de la prescription légale de vue au bout de 30 ans à dater de la construction par les constructeurs de la terrasse, comme la Cour de cassation l'a fait dans son arrêt de 1939 (cfr. Décision n° 155) ? 2) quant au point de départ àe la prescription acquisitive de la servitude d'aspect : il semble qu'il devait être fixé au premier acte de possession de la vue illégale, le droit sujet à prescription, c'est-à-dire au moment de la construction de la terrasse, et non de la construction de l'immeuble voisin; d'autre part, d'où est tirée la règle, valant à titre d'exception d'après ce que dit la Cour, suivant laquelle le point de départ de la prescription serait à fixer à partir du moment où le voisin cesse de tolérer la situation ? 3) quant au point de départ de la prescription acquisitive éventuelle : il ne peut en outre être différent de celui de la prescription extinctive de la servitude légale de vue ; ce serait incohérent; or il est certain que le début de la prescription extinctive doit être fixé à dater du premier acte contraire à la servitude légale (au moment de la construction de la vue illégale donc en principe), en cas de servitude continue (cfr. art. 707, in fine, du Code civil) ; 4) quant à la prétendue constatation par le juge du fond de ce que le voisin avait cessé de tolérer la vue litigieuse, à dater de la construction par lui de la maison voisine : la juge du fond n'a pas dit ni constaté cc fait semble-t-il ; la Cour de cassation ne prête-t-elle donc pas au juge un raisonnement et une constatation en droit et surtout en fait, qu'il n'a pas réellement effectués ? Cet arrêt serait donc, sur ces bases, peu convaincant. Une autre lecture est toutefois possible, permettant de sauver l'arrêt, basée sur l'article 2232 du Code civil : 1) le point de départ des prescriptions serait la date de Ia construction de la maison voisine de la terrasse litigieuse, car ce serait à cette date que le voisin aurait cessé de tolérer la vue litigieuse ; 2) jusque là, les actes accomplis par la propriétaire de la terrasse auraient été posés à titre de simples actes de tolérance de la part du voisin ; ces actes seraient dès lors présumés précaires et ne pourrait fonder une prescription acquisitive en vertu de l'article 2232 du Code civil ; pendant toute la période en question où le voisin a simplement toléré cet élément de fait, il ne pourrait pas non plus être considéré comme ayant perdu son droit par prescription extinctive : on dérogerait logiquement à l'article 707 du Code civil ; 3) et le juge aurait constaté valablement en fait le premier acte de cessation de la tolérance, qui ne pourrait être que l'acte de construction de la maison voisine. Il aurait été judicieux alors que l'arrêt se réfère expressément à l'article 2232. On aurait pu mieux le comprendre. Cela étant cet arrêt se veut de principe et dégage une règle qui appartient au droit positif, semble-t-il. Cet arrêt fait en effet jurisprudence. Il implique une exception à la règle de la computation du délai trentenaire à dater de la construction de la vue ou du jour illégal. En règle, le point de départ de la prescription acquisitive d'une servitude d'aspect découle de la construction de la vue, sauf s'il y a eu une simple tolérance de la part du voisin, qui par exemple a laissé son fonds libre de toute construction. Dans ce cas, le premier acte par lequel le voisin aura cessé de tolérer la vue, à savoir essentiellement (mais pas seulement), lorsqu'il aura construit lui-même sur son fonds, fera courir les délais. Cela risquera d'allonger, et même de faire durer éternellement, le délai trentenaire, qui pourra ne pas prendre cours. Ce système n'est pas propice à la sécurité juridique, mais il est dans la logique d'une certaine équité entre voisins. Il y aurait donc dans l'arrêt de 1990 une exception à l'arrêt de 1939. L'enseignement de l'arrêt du 25 mai 1990 peut-il s'appliquer à la prescription d'une servitude de prospect par le fait de l'homme, du chef d'un empiétement sur le fonds d'autrui ? Ici aussi, notre nouvelle analyse de l'arrêt de 1990 nous permet de penser que si, en principe, ce sera à dater de l'empiétement que l'usurpation du droit d'autrui commencera à être réalisée juridiquement et à produire ses effets prescriptifs, et qu'autrui devra en principe réagir au risque de devoir souffrir la prescription s'il a laissée courir celle-ci pendant plus de trente ans, il pourra être dérogé à cette règle chaque fois que l'on pourra dire que le voisin n'a en réalité fait que tolérer la situation, et qu'il a cessé de la tolérer en construisant sur son fonds, le point de départ des prescriptions étant alors cette construction.
(128) Cass., du 22 janvier 1970 - affaire Egimo
Les faits de cette affaire étaient les suivants. La société Egimo était gérante d'un immeuble à appartements situé avenue Franklin Roosevelt, à Bruxelles, et dans lequel divers travaux importants concernant la copropriété et les parties communes avaient dû être exécutés, dont à nouveau, semble-t-il, des travaux en rapport avec la chaudière (outre des travaux de dallage d'entrée et de reconstruction de descente de garage et de muret). L'un des appartements faisait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier. Il fallait donc déterminer qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire devait supporter la quote-part des charges afférente à ces travaux. La gérante Egimo porta la question devant les cours et les tribunaux en assignant tant l'usufruitier que le nu-propriétaire. La question se posait ainsi de déterminer si les travaux en question devaient être qualifiés de "grosses réparations", de sorte qu'ils devaient être à charge du nu-propriétaire. La question du droit d'action de l'usufruitier contre le nu-propriétaire ne se posait pas dans cette cause car c'était un tiers à l'usufruit (le gérant de la copropriété, au nom de cette dernière), qui agissait, ayant un intérêt manifeste à agir et un droit d'action, de sorte que son action pouvait être déclarée recevable. Le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel, considéra "qu'en raison de leur importance même", les travaux litigieux pouvaient être qualifiés de grosses réparations dont les frais devaient être mis à charge du nu-propriétaire. Ce dernier s'est pourvu en cassation en invoquant dans son unique moyen que ce critère n'était pas compatible avec l'article 606 du Code civil, et que cette disposition ne visait pas, dans son énumération limitative, le type des travaux litigieux. La Cour de cassation fut convaincue par l'argument et cassa la décision au terme d'un arrêt de principe remarquable qui dit le droit sur la question de la définition des grosses réparations. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : L'arrêt, dont je cite la motivation presque in extenso en raison de son grand intérêt, s'articule comme suit : 1) triple mise en garde préalable de la Cour de cassation au sui et de la portée limitative pour les juges de l'article 606 du Code civil, quant aux grosses réparations, et de la définition extensive des dépenses d'entretien, avec rappel de l'économie générale de l'usufruit et du lien entre l'article 605 et l'article 618 du Code civil concernant l'usufruitier , et rejets : (i) de tout parallèle avec les réparations locatives ou d'entretien pesant sur le locataire ; (ii) du parallèle avec le régime des charges des articles 608 et 609 du Code civil : - "toutes les réparations autres que les grosses réparations limitativement déterminées par l'article 606 sont réputées d'entretien et sont à charge de l'usufruitier, lequel, en vertu de l'article 605, répondra même des grosses réparations occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, et, en vertu de l'article 618, pourra être privé de l'usufruit s'il laisse dépérir le fonds faute d'entretien" ; - "le juge méconnaîtrait dès lors l'obligation de l'usufruitier quant aux réparations d'entretien en limitant son étendue à celle de l'obligation aux réparations locatives ou de menu d'entretien, dont est tenu le locataire aux termes de l'article 1754 du Code civil" ; - le juge ne peut davantage confondre l'obligation aux charges, dont il est question aux articles 608 et 609 du Code civil, et l'obligation aux réparations prévue par les articles 605 et 606, chacune de ces obligations ayant un objet et un régime distincts". Ces mises au point préliminaires correspondent bien à l'économie générale de l'usufruit. Le rejet du parallèle avec le régime des charges des articles 608 et 609, qui, à un moment donné, a été prôné par René Dekkers, dans la 2ème édition du tome V du Traité de Henri De Page, est tout à fait pertinent et implique une distanciation avec le glissement, ou l'amalgame à cet égard, qui se trouvait dans l'arrêt antérieur du 3 février 1927. C'est une bonne chose, même si la Cour ne sera pas tout à fait cohérente sur ce point, une certaine tendance au glissement réapparaissant dans les attendus suivants, ci-après soulignés. 2) nouvelle définition des grosses réparations au regard d'une mise en évidence da la ratio legis de l'article 606 du Code civil, et pouvoir souverain d'appréciation du luge à cet égard : voici sans doute la partie principale de l'arrêt, qui propose une nouvelle définition des grosses réparations à la lumière de ce que fut la volonté du législateur en 1804 : - "que, par la disposition de l'article 606 qui limite les grosses réparations de l'immeuble d'habitation à celles des gros murs et des voûtes, au rétablissement des poutres et des couvertures entières et qualifie toutes autres réparations comme étant d'entretien, le Code civil n'a voulu laisser à la charge du propriétaire que les gros travaux de rétablissement et de reconstruction avant pour objet la solidité générale et la conservation du bâtiment dans son ensemble, qui revêtent un caractère de réelle exception dans l'existence même de la propriété et dont les frais requièrent normalement un prélèvement sur le capital" ; - "attendu, certes, qu'en déterminant restrictivement les grosses réparations, l'article 606, emprunté à la coutume de Paris, n'a envisagé que les bâtiments servant aux usages ordinaires de la vie d'alors : qu'ainsi le législateur n'a pu prévoir l'incorporation aux immeubles d'habitation d'agencements nouveaux qui répondent aux exigences de confort et d'efficacité de la vie moderne" ; - "qu'il appartient dès lors au juge d'apprécier si la réfection ou le remplacement, dans ces immeubles, de semblables dispositifs ou de certains de leurs éléments peuvent être assimilés aux grosses réparations dont il est question aux articles 605 et 605, en faisant application de ces dispositions conformément à leur esprit, sans altérer l'institution de l'usufruit telle que l'a consacrée le Code civil ; qu'il appartient au juge, en s'entourant, s'il y a lieu, de l'avis d'hommes de l'art, de mettre en lumière si les réparations revêtent, sinon la nature des travaux expressément visés à l'article 606, tout au moins le caractère comparable d'exception et d'importance, ou si, au contraire, ce caractère extraordinaire ne peut leur être reconnu, les travaux effectués apparaissant comme la contrepartie, normalement prévisible dans l'état de la technique, de la jouissance et de la rentabilité accrues conférées au bien par des dispositifs sujets à usure et à dégradation par le fait même de leur mise en oeuvre". Cette motivation très complète et remarquablement rédigée doit être approuvée, en particulier la nouvelle définition qui est donnée aux grosses réparations sur le fondement et de l'esprit du Code civil. A nouveau, la Cour de cassation interprète la volonté du législateur de 1804 et livre une définition de ce que les grosses réparations étaient censées être plus généralement, définition qui permet d'appréhender les nouvelles nécessités de la pratique aux 20 et 21èmes siècles. Il y a là une forme d'induction du sens de la loi, sur la base du devenir et des besoins de la société, induction sociale donc, proposée par H. De Page et que nous partageons. Une légère réserve s'impose toutefois à l'égard de cet arrêt : le glissement vers un parallèle avec le régime des charges des articles 608 et 609 du Code civil, quoique condamné par la Cour dans un premier temps à titre de principe, n'est pas totalement évacué puisque la Cour fait encore un certain parallèle entre les charges d'entretien d'une part qui sont "la contrepartie, normalement prévisible dans l'état de la technique, de la jouissance et de la rentabilité accrues conférées au bien", et les grosses réparations de l'autre, "dont les frais requièrent normalement un prélèvement sur le capital". On se doute qu'à la suite de cette motivation, la Cour de cassation ait cassé la décision de fond qui avait qualifié à tort les travaux litigieux de grosses réparations.
(12) Cass., du 07 avril 1949 - affaire Rummens
Les faits ont été résumés dans les conclusions du ministère public, précédant l'arrêt. Monsieur Rummens, propriétaire de maisons sises rue d'Or avait vu ces dernières subir des dégradations, et avait encouru des troubles de jouissance excessifs, suite aux travaux de construction de la jonction Nord-Midi entrepris à la fin des années 1930. Il dirigea dès lors une action en réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil (droit commun de la responsabilité) et sur l'article 544 du Code civil (théorie des troubles du voisinage) contre le pouvoir public qui était le maître de l'ouvrage voisin (O.N.J) et contre l'entrepreneur, à savoir les entreprises Van Rymenant. La cour d'appel de Bruxelles, statuant sur pied de l'article 1382 du Code civil, a déclaré l'action recevable contre les deux défendeurs sur ce fondement, mais a considéré qu'une condamnation ne pourrait être prononcée à la charge des entreprises Van Rymenant, que pour autant que serait démontrée une faute qui leur serait imputable dans la conception des plans de l'entreprise ou l'exécution des travaux. Statuant ensuite sur la base de l'article 544 du Code civil, la cour a décidé que le maître de l'ouvrage était tenu en principe à cet égard (en émettant par après des considérations sur l'importance du trouble) à apprécier en tenant aussi compte de la plus-value qui résulterait des travaux (cfr. moyen de cassation), mais non l'entrepreneur (la société Van Rymenant), qui était étranger aux rapports de voisinage sur lesquels se base l'article 544 du Code civil. Il n'a pas non plus été fait droit, par conséquent, à l'action en garantie du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur, dans le cadre de la théorie des troubles du voisinage. Monsieur Rummens a dès lors introduit un pourvoi en cassation contenant un moyen unique qui développa trois types d'arguments : 1) d'abord, la sanction du droit de propriété consacré par l'article 544 du Code civil devait être trouvée dans l'article 1382 du même Code (cfr. thèse du rattachement de la théorie des troubles de voisinage au droit commun de la responsabilité pour faute) : celui qui par son fait porte atteinte à la propriété d'autrui, notamment en bâtissant ou en faisant bâtir sur une propriété voisine, commet un acte illicite qui engage sa responsabilité, quand bien même les travaux seraient exécutés selon les règles de l'art ; 2) ensuite, le juge du fond avait eu tort de réduire l'appréciation de la faute éventuelle de l'entrepreneur en fonction de la conception ou l'exécution de l'entreprise ; 3) enfin, la mise hors cause de l'entrepreneur ne se justifiait pas non plus sur pied de l'article 544 du Code civil, "dès l'instant que celui-ci avait concouru à l'atteinte portée et au dommage causé à la propriété du demandeur". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : L'arrêt de la Cour de cassation demeure fidèle au principe du lien entre la théorie des troubles du voisinage et l'article 1382 du Code civil. Voyons in extenso la motivation de l'arrêt en faisant apparaître son articulation : 1) premier temps : point de départ du raisonnement : référence à l'article 544 du Code civil : "attendu que l'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir paisiblement de sa chose ; qu'à l'exercice du droit de propriété correspond l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à autrui". Si la référence de départ à l'article 544 est convaincante, l'affirmation de l'existence d'une obligation générale de ne pas nuire à autrui est quant à elle critiquable car elle ne se fonde ni sur l'article 544 ni sur l'article 1382 du Code civil. On voit en réalité apparaître ici la thèse du Procureur général Leclercq. 2) deuxième temps : lien exprès avec l'article 1382 du Code civil et définition extensive de la faute sur la base du dommage : cohérente avec elle-même, la Cour poursuit ainsi : "attendu que cette obligation trouve sa sanction dans l'article 1382 du Code civil ; que comme une faute le propriétaire qui néglige de prendre les précautions nécessaires pour empêcher les voisins de subir par son fait des inconvénients excédant la mesure ordinaire des obligations du voisinage". Cette définition extensive de la faute sur la base du dommage est contraire à la notion légale de faute au sens d'une imprudence, d'une négligence ou tout autre comportement que n'aurait pas eu un bonus vir dans les circonstances de l'espèce. 3) troisième temps : conséquence de la définition extensive de la faute : rejet implicite de la définition restrictive donnée in specie par le juge du fond : "qu'ainsi, celui qui exécute ou fait exécuter des travaux sur son fonds est tenu de s'assurer que, tels qu'ils sont conçus et seront exécutés, ces travaux n'apporteront pas aux biens voisins un trouble excédant cette mesure ; que le respect des règles ordinaires de l'art, tant dans la conception que dans l'exécution, n'est pas exclusif de faute". 4) quatrième temps : rappel du lien entre les articles 544 et 1382, et définition extensive de la faute (liée - à tort - au dommage) : "qu'il s'ensuit que l'article 544 du Code civil ne peut être isolé de l'article 1382 ; qu'il découle de la combinaison de ces deux dispositions que celui qui use de son bien d'une manière telle qu'il inflige à son voisin un dommage dépassant la mesure normale des inconvénients du voisinage est tenu à la réparation intégrale du dommage causé par sa faute". 5) cinquième temps : conséquence : cassation sur les deux points soulevés par le moyen : 1) le juge du fond a eu tort de restreindre l'appréciation de la responsabilité de l'entrepreneur à la seule faute "déterminée dans la conception de l'entreprise", la responsabilité pouvant se trouver également engagée par le fait que l'entrepreneur aurait "contribué à la lésion du droit de propriété" du voisin ; 2) le juge du fond ne pouvait dès lors pas mettre hors cause l'entrepreneur sur pied de l'article 544 du Code civil, pour le seul motif que celui-ci était étranger aux relations de voisinage; eu égard à la définition extensive de la faute donnée par la Cour, faute à laquelle pouvait en quelque sorte participer l'entrepreneur, puisque l'article 544 était rattaché à l'article 1382. Cet arrêt était d'abord critiquable de façon générale en raison du lien artificiel établi entre l'article 544 et l'article 1382 du Code civil, aboutissant à une définition de la faute qui est artificielle et extensive, contraire à sa notion légale. Il l'était ensuite parce qu'il intégrait l'entrepreneur dans la relation du voisinage, au bénéfice de cette définition trop extensive de la faute à l'origine du trouble de voisinage, à laquelle l'entrepreneur était susceptible de contribuer dans la logique (erronée) de l'arrêt. La Cour de cassation reviendra heureusement tant sur le point de départ de ce raisonnement que sur des conséquences, difficilement justifiables, par ses deux arrêts du 6 avril 1960.
(116) Cass., du 28 novembre 1969 - affaire Miguet
Les sieurs Miguet et D. sont copropriétaires d'un terrain situé à Hasselt et y font édifier deux immeubles à appartements, l'un en bordure de la "Bosstraat" et l'autre de la "Maastrichtersteenweg". Ils ont fait établir des actes de base par le notaire S., le 3 mars 1961. Ils vendent tous les appartements du côté "Bosstraat", tandis que, dans l'autre immeuble, ils conservent la propriété d'un appartement et vendent les autres. Suite aux opérations de vente, le terrain a été divisé en deux parties et deux copropriétés sont nées en rapport avec chaque immeuble à appartement. Par ailleurs, logiquement, les consorts Miguet et D. ne sont plus titulaires que d'une part indivise de la parcelle sise du côté de la "Maastrichtersteenweg", puisqu'ils y ont un appartement. D'autre part, en application du droit commun et en vertu des actes de base et des actes de vente. le sol de chaque immeuble appartient en copropriété forcée, pour chacune des deux parcelles, aux propriétaires des appartements édifiés sur ces parcelles. Jusque-là, cette affaire ne présente pas de difficulté. Le problème naîtra de ce que les consorts Miguet et D. revendiqueront un droit de propriété propre sur la zone de parking qui a été aménagée sous les deux bâtiments. Ils s'avisent en effet que les actes de base et les actes de vente ne contenaient aucune mention concernant cette zone et prétendent en avoir conservé la propriété. A la demande des sieurs Miguet et D., le notaire S. invite tous les propriétaires d'appartements à venir signer en son étude, le 8 juin I 961, un acte complémentaire qui prévoit qu'en cas de destruction des complexes d'appartements, la reconstruction devra se faire selon les plans originaux et qu'après cette reconstruction, le niveau sous-terrain, à l'exception des caves privées et des parties communes, "restera réservé" aux sieurs Miguet et D. Le litige naît de ce que les époux B. et M. refusent de signer un tel acte. Entre-temps, un autre propriétaire d'appartement du côté "Bosstraat" (le sieur V.), qui acceptait de payer un loyer aux sieurs Miguet et D. pour l'occupation d'un emplacement de parking, apprend l'opposition des époux B. et M. et suspend le paiement des loyers. Il est assigné par les consorts Miguet et D. Le litige finit par se généraliser à tous les copropriétaires, qui soit interviennent volontairement à la cause, soit y sont appelés en intervention forcée. La question du statut réel de la zone souterraine de parking peut ainsi être examinée et réglée. Par un arrêt du 7 juin 1968, la cour d'appel de Liège dit recevables les interventions volontaires et forcées des parties, et décide que les sieurs Miguet et D. sont bien propriétaires de l'espace souterrain servant de garage dans les deux complexes d'appartements en question. Le sieur V., les époux B.et M. (propriétaire du côté "Bosstraat") et un couple Vandenbrouck et consorts, propriétaires du côté "Maastrichtersteenweg", se pourvoient en cassation. A l'appui du pourvoi, le moyen est le suivant : "sans doute conformément aux articles 552 à 555 du Code civil et 1er de la loi du 10 janvier 1824, on peut dans certaines circonstances être propriétaire de certains bien matériels immobiliers se trouvant sur le fonds d'un tiers, que cependant un espace ouvert n'est pas un bien matériel immobilier au sens des articles 517 à 525 dudit code ou de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824, qu'un droit de propriété sur pareil espace ouvert n'est pas davantage un des droits pouvant être établi sur un immeuble conformément à l'article 526 du même code". L'argument est intéressant. Le pourvoi invoque en conséquence la violation des dispositions qu'il met en évidence (d'où l'absence de justification légale de la décision au fond : cfr, première branche), et une absence de réponse aux conclusions des parties demanderesses qui avaient invoqué que les sieurs Miguet et D. ne pouvaient être titulaires d'un droit de propriété sur un "espace ouvert". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rejeté les deux branches. Rejet de la première branche : "l'arrêt décide que le sous-sol litigieux est demeuré la propriété des deux premiers défendeurs : attendu que la disposition de l'article 552 du Code civil aux termes de laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous n'implique pas qu'une personne ne puisse être propriétaire du sous-sol d'un bien immobilier dont le sol n'est pas sa propriété ; attendu que l'arrêt ne fait pas application des articles 517 à 526, 553 à 555 du Code civil et 1er de la loi du 10 janvier 1824 ; qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli". Quant à la seconde branche : "attendu qu'en décidant que les vendeurs sont demeurés propriétaires du sous-sol, la cour d'appel entend décider que leur droit de propriété a pour objet non un espace ouvert mais un emplacement propre à servir de parking ; qu'en cette branche, le moyen manque en fait". On aurait souhaité que la Cour de cassation soit plus explicite quant à la première branche : si les époux Miguet et D. sont considérés comme étant demeurés propriétaires d'une partie du sous-sol, c'est parce qu'ils n'ont pas cédé ce dernier. Ils sont donc considérés comme s'en étant réservé tacitement, mais de façon certaine, la propriété. En d'autres termes, la présomption de l'article 552 ne joue pas pleinement au profit des nouveaux propriétaires, dès lors qu'un droit de propriété en sous-sol avait été réservé antérieurement au profit des précédents. Relevons aussi qu'ici le droit s'exerce bien sur une partie du sous-sol et non sur un volume : une assiette du sous-sol délimitait celui-ci (formant le revêtement du parking), ainsi que le volume du parking en question, arrêté par les plafonds et murs situés alentours. Sur ces éléments, constituant "l'emplacement propre à servir de parking", existait donc un droit de propriété privative distinct : 1) des éléments de copropriété commune (droits dans les parties communes et autres éléments du sol et sous-sol) ; et 2) des éléments de propriété privative des autres copropriétaires. Une dissociation dans l'espace est ainsi née entre la propriété du sol et celle du tréfonds (ici partiellement isolée, qui est parfaitement possible). Tel est l'enseignement à déduire de l'arrêt, qui peut être exploité dans la pratique notariale, dès lors que l'article 552 ne constituée qu'une présomption "juristantum". Cet arrêt nous éclaire également sur le régime de la superficie: ici, c'est une propriété pleine et entière qui est constituée sur le tréfonds, et non un droit de superficie. Ce dernier impliquait d'ailleurs, jusqu'à la loi de 2014, une propriété de bâtiments ou de plantations, "sur un fonds" appartenant à autrui, en vertu de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824. Cet article a été modifié et il est maintenant possible d'avoir un droit de superficie, sur, en-dessous ou au-dessus du fonds d'autrui (à ce sujet, cfr. Décision n° 160). Dès lors, s'il s'agit de prévoir une propriété distincte en sous-sol, l'on devra en principe recourir maintenant à la superficie et non à une propriété perpétuelle, outre la copropriété (sous réserve d'examen plus approfondi de cette question).
(127) Cass., du 03 février 1927 - affaire du Théâtre Molière
Madame veuve Dewit était usufruitière du théâtre Molière tandis que l'Etat belge en était nu¬propriétaire. Elle avait dû exécuter un certain nombre de travaux dont elle demandait le remboursement à l'Etat. Les travaux étaient plus précisément de deux types : d'abord, des travaux de plomberie, de menuiserie et d'électricité qui avaient été imposés par l'autorité publique (à savoir la députation permanente du conseil provincial du Brabant et l'administration communale d'Ixelles), pour conserver à l'immeuble la destination qui était la sienne ; ensuite des travaux de remplacement de l'installation de chauffage, non visés par les décisions des autorités. Le premier type de travaux pouvait être envisagé sous l'angle du régime des charges de la propriété, énoncé par les articles 608 et 609 du Code civil, en vertu desquels l'usufruitier est tenu des charges annuelles, qui sont en principe payées au moyen des fruits, tandis que les charges "qui peuvent être imposées sur la propriété" incombent normalement au nu-propriétaire. Le second type de travaux pouvait être appréhendé à la suite du régime des charges d'entretien et des grosses réparations (cfr. art. 605 et 606 du Code civil), mais les deux questions classiques se posaient à cet égard : premièrement, la veuve Dewit disposait-elle d'une action contre l'Etat belge pour obtenir le remboursement de ces travaux à titre de grosses réparations, et deuxièmement s'agissait-il vraiment de grosses réparations alors que les frais de remplacement d'une installation de chauffage (à savoir la chaudière et les installations qui lui étaient liées), ne sont pas compris dans l'énumération en principe limitative de l'article 606 du Code civil ? Il est renvoyé à l'arrêt en ce qui concerne le rejet du premier moyen portant sur le premier type de travaux et les articles 608 et 609 du Code civil (régime des charges), et nous reviendrons brièvement sur ce point infra. Le second moyen a aussi été rejeté au terme d'une longue motivation très riche qui contient un véritable bréviaire des principes sur la matière des grosses réparations dans l'usufruit à la disposition des juges et des plaideurs. Le raisonnement de la Cour s'articule comme suit et j'émets à l'occasion l'un ou l'autre commentaire : 1) mise en évidence de la ratio legis de l'article 606 du Code civil, en rapport avec le problème se posant en la cause : l'article 606, emprunté à la coutume de Paris, lorsqu'il a défini restrictivernent les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire n'a eu en vue que les maisons et les bâtiments servant aux usages ordinaires de la vie d'alors ; 2) mise en évidence d'un régime spécial applicable aux immeubles ou choses à destinations spéciale en fonction de la ratio legis de la loi, appréciation souveraine du juge en la matière sous le contrôle marginal de la Cour de cassation : - lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de choses à destination spéciale, lesquels ne tombent pas sous les prévisions de cet article, il appartient au juge de déterminer si un travail constitue une grosse réparation ou une réparation d'entretien, en s'inspirant de sa nature, de son importance et de l'esprit de la loi ; que celle-ci a voulu que l'usufruitier, qui recueille les revenus de la chose et doit jouir de celle-ci en bon père de famille, l'entretienne en bon état et en conserve la substance au moyen de ses revenus, à peine, aux termes de l'article 618, de sen voir retirer l'usufruit ; - mais que, d'autre part, la loi n'a pas entendu faire supporter, par l'usufruitier, des réparations qui lui enlèveraient en majeure partie le bénéfice de sa jouissance ou qui, suivant l'observation de Pothier, "seraient plutôt reconstruction que réparation" ; qu'elle considère celles-ci comme incombant a la propriété et non au revenu". La première partie de cette motivation est convaincante. Ne l'est pas le parallèle qui est fait dans la deuxième partie, avec le régime des charges des articles 608 et 609 du Code civil. Il convient en effet de bien distinguer celui-ci du régime des dépenses d'entretien et des grosses réparations prévu par les articles 605 et 606. On voit d'autre part que la Cour de cassation a fait une certaine interprétation des dispositions du Code civil, suivant laquelle les auteurs de celui-ci auraient visé "les maisons et habitation servant aux usages ordinaires", d'où la nécessité de combler une forme de lacune pour les biens à destination spéciale. Cette lecture du Code était audacieuse mais pertinente et fondée sur les nécessités de la pratique. Dans les années 1970, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser encore la notion de grosses réparations.
(141) Cass., du 16 septembre 1966 - affaire du casino de Coxyde
Plus extraordinaire mais demeurant quelque peu insaisissable, est cette belle affaire du "Casino de Coxyde". A l'origine, en 1927, une convention était intervenue entre le sieur Blieck et la société "La Plage de Coxyde" par laquelle, d'une part, fut vendu à cette dernière un terrain sur lequel elle construisit le Casino, d'autre part lui fut cédé un droit de jouissance gratuite d'une durée indéterminée sur un fonds dénommé le Parc, à charge pour la société de construire, entre autres, des cours de tennis et de les entretenir, avec stipulation d'un "droit de retour" au cas où les obligations en question ne seraient pas remplies. Le droit de jouissance au profit de la société s'était vu adjoindre une obligation de ne pas construire autre chose que les terrains de tennis, que l'on pouvait qualifier de servitude "non aedificandi". Il était aussi prévu que les habitants de la commune de Coxyde pourraient aussi accéder au Parc et bénéficier de la jouissance de celui-ci, sous la forme d'une charge d'utilité publique. Apparaissait ainsi une autre forme de droit de jouissance, pour les habitants de la commune. Il s'agissait donc d'un ensemble de droits et obligations enchevêtrés, assez complexe, dont la qualification en termes de droits réels ou de droits personnels était délicate. Étaient ainsi liés : 1) le droit de jouissance de la société, élément que l'on peut qualifier de principal ; 2) la servitude de non aedificandi ; 3) et la "charge d'utilité publique" constitutive de droit de jouissance pour la habitants de la commune, portant sur le Parc ; ce dernier était l'accessoire du premier élément et elle consistait dans le fait de devoir laisser jouir les habitants de la ville de Coxyde, du parc en question ; il était même antérieur au droit de jouissance, semble-t-il, car il s'imposait à l'origine au sieur Blieck et il avait été imposée à nouveau par ce dernier à la société cessionnaire du droit de jouissance, en profitant donc aux habitants de la commune de Coxyde ; il existait ainsi un lien entre le droit de jouissance de la société et la charge d'utilité publique (autre droit de jouissance moins largement défini). En 1928, la société "Casino-Tennis de Coxyde St Idesbald" a été constituée et la première société lui a fait apport du casino et du droit de jouissance sur le Parc (ainsi que des droits et obligations liés). La société "Plage de Coxyde" fut par ailleurs dissoute en 1934. Un litige est né entre la société "Casino-Tennis" et les héritiers du sieur Blieck. Ces derniers ont prétendu que le droit de jouissance s'était éteint pour différents motifs que l'on verra ci-après, mais était-ce le cas ? Tous ces motifs ont été rejetés par le juge du fond. Celui-ci a décidé que le droit de jouissance litigieux (qui était donc au centre du litige), était un ""droit réel "sui generis" ou une servitude" et qu'en l'espèce le droit litigieux ne fait pas obstacle au principe de libre circulation des bien, le droit ne devant pas nécessairement être perpétuel. Le juge ajouta que le casino tire directement profit du parc y attenant et des courts de tennis qui y ont été construits, que le fonds a été assujetti à une servitude non aedificandi et que la jouissance dudit fonds a été accordé non seulement à la société "La plage de Coxyde", mais aussi au public, l'auteur des demandeurs ayant déclaré avoir pour objectif principal de coopérer à la prospérité de la plage de Coxyde" (on voit ici apparaître la charge d'utilité publique, d'une façon qui n'est pas des plus claires toutefois). Le juge décida également que le droit avait été cédé à la société sus-visée qui avait succédé à la société Plage de Coxyde. Comment saisir et critiquer cette motivation qui brouillait quelque peu les pistes : 1) la qualification de droit réel "sui generis" n'était pas admissible en vertu du principe du "numerus clausus" des droits réels ; 2) mais elle était complétée par celle de servitude qui pouvait sauver la décision de fond, mais paraissait peu pertinente pour qualifier un droit de jouissance ; 3) à cette qualification était jointe la constatation que Mr. Blieck avait voulu conférer un droit de jouissance non seulement à la société en question mais aussi répercuter et réitérer la charge d'utilité publique, permettant au public de Coxyde d'accéder et jour du Parc, et ce droit semblait être de nature personnelle. Les héritiers Blieck se pourvurent en cassation et invoquèrent un moyen structuré en cinq branches, très ramassées dans leur formulation, attaquant les hypothèses d'interprétation les plus critiquables de la décision de fond, comme suit : 1) violation de la foi due à la convention car le droit de jouissance litigieux aurait uniquement été accordé à la société "Plage de Coxyde" ; 2) violation du principe du "numerus clausus" des droits réels (art. 543 du Code civil) même si le pourvoi ne s'y réfère pas comme tel. En outre, étaient soutenues ; 3) l' exclusion de la qualification de servitude applicable au droit de jouissance car il "excluait toute jouissance dans le chef du propriétaire du fonds assujetti", c'est-à-dire le fonds servant de Blieck, si l'on comprend bien les choses: en effet, le droit de jouissance avait été cédé à la société Plage de Coxyde : pouvait-clic dès lors être titulaire d'une servitude dans le cadre d'un tel droit de jouissance, sur le fonds en question et donc sur le fonds dont elle avait la jouissance ? Cela paraissait étrange, d'où une nouvelle violation de la foi due aux actes, les demandeurs ayant par ailleurs soutenu dans leur pourvoi la qualification de droit d'usage, qui est une forme de droit d'usufruit ; 4) et s'il fallait admettre une telle qualification dans le chef de la société Plage de Coxyde, le droit aurait dû s'éteindre à la dissolution de la société en 1934, ou à tout le moins 30 ans après sa formation (cfr, art. 619 et 625 du Code civil), ce que n'avait pas constaté le juge du fond. Il convient de relever que le moyen n'a pas invoqué la violation de l'article 686 du Code civil, ce qu'il aurait pu sans doute faire également. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rejeté le moyen, tout en rectifiant la motivation du juge du fond, dont la décision demeurait justifiée selon l'arrêt (à savoir, décider que le droit litigieux n'avait pas pris fin). Voici comment l'arrêt se structure et son contenu : 1) rappel des énonciations du juge du fond : la Cour rappelle d'abord les énonciations du juge du fond au sujet de l'origine du droit de jouissance gratuite ; 2) rappel de la décision de fond : ensuite la Cour rappelle le lien qui a été établi par le juge du fond entre ce droit et la servitude "non aedificandi", ainsi que la qualification de droit réel également retenue : "le jugement en déduit que la parcelle, dénommée "Parc", a été assujettie à une servitude non aedificandi en faveur des terrains avoisinants et du casino, que cet avantage tend à procurer aux fonds avoisinants une vue dégagée, que la jouissance du fonds ainsi assujetti a été accordée non seulement à la société "Plage de Coxyde", mais aussi au public, et qu'en vertu des dispositions précitées, chacun en a à ce jour tiré avantage" ; 3) rectification de la qualification de droit réel et substitution d'une autre motivation retenant la qualification de droit personnel : "qu'il résulte des constatations du jugement que le droit litigieux confère un avantage à la commune et aux habitants, voisins du parc ; que le jugement constate, en outre, qu'il peut être mis fin à ce droit au cas où les conditions ne seraient pas remplies, ce qui n'a pas encore eu lieu jusqu'à présent ; attendu qu'il apparaît ainsi que le droit litigieux qui a été créé non pas en faveur d'un fonds ou d'une personne déterminée, mais en faveur d'une communauté, c'est-à-dire la commune de Coxydc et ses habitants, comporte une charge d'intérêt public, dont la durée dépend de l'observation des conditions stipulées lors de son établissement ; que pareille charge doit être considérée, non comme un droit réel, mais comme une obligation personnelle, dont les conditions sont établies par la convention conclue entre les parties" ; 4) rejet du moven après constat du caractère justifié de la décision de fond :"ainsi, bien que le jugement considère à tort ledit droit comme un droit réel, son dispositif n'en est pas moins légalement justifié ; attendu dès lors que, ne critiquant pas les observations du jugement relatives au but d'intérêt public du droit litigieux, mais seulement les effets que le jugement reconnaît au prétendu droit réel, le moyen n'est en aucune de ses branches recevable, à défaut d'intérêt". Les commentaires que l'on peut faire au sujet de cet arrêt doivent être prudents. Il ne s'agit pas en effet d'un arrêt de principe mais d'un arrêt d'espèce, et encore d'un simple arrêt de rejet. Les grands axes de notre analyse sont les suivants : 1) la charge de ne pas construire, est qualifiée de servitude ; 2) reste le droit de jouissance de la société et la charge d'intérêt public, qui est qualifiée de droit personnel au profit de la généralité des habitants de la commune ; il peut certes en être ainsi. 3) on arrive dès lors au constat de l'existence de trois droits, deux sont personnels et le troisième est réel : - il y a d'abord le droit de jouissance conféré à l'origine par le sieur Blieck à la société Plage de Coxyde ; - ensuite la servitude de non aedificandi, qui est clairement un droit réel et un accessoire du droit de propriété conféré sur le fonds originaire et dans une moindre mesure du droit de jouissance litigieux ; ce droit vise à assurer la vue libre sur le fonds dit Parc ; - enfin se trouver la charge d'utilité publique : l'obligation de laisser jouir les habitants de Coxyde du Parc), autre droit de jouissance donc qui était de nature personnelle et constituait une forme d'excroissance du droit de jouissance de la société, liant aussi celle-ci. 3) la Cour de cassation ne fait pas apparaître très clairement la distinction et l'articulation entre le droit de jouissance de base (profitant à la société) et la charge d'utilité publique portant sur le Parc (liant Mr. Blieck à l'origine semble-t-il, puis la société et profitant aux habitants de la Commune), même si l'on comprend qu'elle retient également la qualification de droit personnel à son égard, lorsqu'elle relève que la jouissance du fonds a été accordée non seulement à la société "Plage de Coxyde" mais aussi au public ; il aurait été préférable que la Cour fasse plus clairement la distinction entre les droits concernés (le droit de jouissance et la charge d'utilité publique), et ensuite qualifie directement et expressément le droit de jouissance principal, qui était au centre du litige sur la durée de ce droit; on aurait pu retenir une qualification de droit de jouissance "sui generis" à l'égard de ce droit puisqu'il s'agissait d'une droit personnel ; 4) cela étant, le raisonnement de la Cour est cohérent : le droit de jouissance et la charge d'utilité publique sont donc des droits de nature personnelle et la précision se trouvant dans l'arrêt suivant laquelle la nature personnelle de la charge d'intérêt public permettrait de justifier la décision de fond sur l'absence d'extinction du droit de jouissance litigieux, n'est pas vraiment critiquable : les deux droits sont complémentaires et de nature personnelle même si c'était le droit de jouissance litigieux qui était l'élément central du litige, et non à la charge d'utilité publique ; 5) quant au droit principal, est-il certain qu'un tel droit de jouissance gratuite et à durée indéterminée puisse être qualifié de droit personnel ? Il me paraît que l'on peut l'admettre et il s'agit alors d'un droit de jouissance "sui generis , gratuit" et a durée indéterminée ; et quant à la nature gratuite de ce droit, on peut aussi s'interroger ? N'était-il pas dépourvu de cause-contre-prestation au sens de l'article l 108 du Code civil ? Non, semble-t-il : il me paraît en effet qu'une analyse faisant apparaître la contrepartie de la jouissance, résidant dans l'obligation de construire et d'entretenir des terrains de tennis, avait permis de dire que le droit était doté d'une cause (mais ce point n'avait pas été discuté par les parties, semble-t-il).
(109) Cass., du 17 mai 1990
Un bail avait été conclu en 1966 entre la société A.G.F., bailleresse, et l'Etat belge, locataire. Ce bail contenait une clause d'indexation des loyers. En 1967, il semble que la société A.G.F. la modifia unilatéralement en sa faveur, ce que l'Etat ne remarqua pas. Il paya donc pendant des années les loyers calculés suivant la nouvelle formule, à caractère non contractuel. En 1984, il releva son erreur et demanda à la société le remboursement, à titre de paiement indu, de la différence entre ce qui était dû en vertu de la clause et ce qu'il avait payé depuis le 1er juin 1980 (soit les indus d'indexation). L'Etat de belge pouvait-il réclamer le remboursement de ces sommes alors que, de 1967 à 1984, il n'avait pas réagi et n'avait pas demandé un tel remboursement ? La société A.G.F. soutint que l'Etat ne le pouvait plus par extinction du droit à la suite du comportement même de l'Etat ("Rechtsverwerking") ? La thèse était assez choquante en équité et se basait sur un fondement de droit faible. Le jugement rendu en degré d'appel refusa à juste titre de suivre la société A.G.F. en estimant notamment que la "Rechtsverwerking" ne pouvait faire échec aux principes de droit civil, dont le principe de la convention-loi. La société A.G.F. se pourvut alors en cassation et se prévalut directement dans son moyen, de l'existence de la théorie de la "Rechtsverwerking", originaire du droit des Pays-Bas. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Aux termes de ce remarquable arrêt de principe, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, en refusant de consacrer la "Rechtsverwerking", au motif notamment qu'il existe déjà en droit civil le régime de la prescription extinctive des droits. L'arrêt s'articule comme suit : 1) rejet de la "Rechtsverwerking" en tant que théorie autonome et principe général du droit : "il n'existe pas de principe général du droit selon lequel "un droit subjectif se trouve éteint ou en tout cas ne peut plus être invoqué lorsque son titulaire a adopté un comportement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant ainsi la légitime confiance du débiteur et des tiers" ; que, dans la mesure où il se fonde sur l'article 1135 précité et sur ledit principe, le moyen est irrecevable" ; 2) référence au principe d'exécution de bonne foi et réserve de l'application possible de l'abus de droit : "attendu que l'article 1134, alinéa 3, du Code civil consacre le principe de l'exécution de bonne foi des conventions ; qu'une partie ne viole ni cet article ni ce principe lorsqu'elle fait usage du droit qu'elle trouve dans la convention légalement formée, sans qu'il soit établi qu'elle en a abusé" ; 3) référence au régime de la prescription extinctive : "que, dans ces limites, le Code civil reconnaît implicitement à une partie la possibilité de ne pas exercer immédiatement le droit qui lui est conféré par le contrat, en établissant les règles de la prescription extinctive" ; 4) validation de la décision de fond et rejet du pourvoi : "qu'en rappelant que la convention forme la loi des parties, en considérant, alors qu'il n 'était pas soutenu que le défendeur avait abusé de son droit, que "s'il doit être admis que le négligences ou omissions d'une des parties à une convention doivent être sanctionnées dans le temps au détriment de la susdite partie, il ne peut être admis que cette sanction doit inclure la suppression, ab initio, du point de la convention auquel le comportement, inconsidéré ou autre, d'une des parties se rapporte", et en faisant application des règles de la prescription, le tribunal a justifié légalement sa décision". L'enseignement à déduire de cet arrêt est double : - d'une part, la "Rechtsvetwerking" n'existe pas en droit belge en tant que principe général du droit autonome ; - mais, d'autre part, il peut être fait application de l'abus de droit, qui est bien un principe général du droit quant à lui, pour appréhender dans certains cas des situations de "Recntsverwerking" à la suite du comportement d'une partie", sans préjudice des règles de droit civil en matière de prescription extinctive. La Cour de cassation a rappelé ces principes à plusieurs reprises et nous verrons notamment infra un des arrêts de la Cour, rendu en matière de vue et de servitude de vue. La haute juridiction a affirmé la possibilité de recourir à l'abus de droit en matière de "Rechtsverwerking", par un important arrêt du 1er octobre 2010, qui a fait dire à certains, dont Mme le professeur S. Stijns, que la "Rechtsverwerking" serait devenue un critère de l'abus de droit, ce à quoi nous souscrivons, l'ayant également soutenu dans le passé. Cela étant, il conviendra bien sûr d'appliquer l'abus de droit avec circonspection dans ce genre de contexte.
(7) Cass., du 01 octobre 1976 - affaire Van Laethem
Un différend similaire au précédent a confronté la S.N.C.B. à un particulier essentiellement, Monsieur Van Laethem, qui prétendit s'opposer à la décision de la S.N.C.B. tendant à mettre fin au droit conféré sur une prairie et à récupérer celle-ci ainsi que d'autres biens. Le juge du fond a décidé que les biens en question, dont la prairie, avaient perdu leur nature de bien du domaine public en raison de la non-réalisation des desseins d'utilité publique les concernant, et que la désaffectation en rapport avec les terrains avait été contenue dans la convention litigieuse du 6 janvier 1959 octroyant précisément certains droits à Monsieur Van Laethem, cette désaffectation des biens de leur destination antérieure ayant au surplus été reconnue par l'Etat belge. La S.N.C.B. a critiqué cette motivation dans son premier moyen au motif que le jugement attaqué n'avait déduit d'aucune des circonstances de fait qu'il avait constatées, l'existence de la décision de l'autorité compétente désaffectant le bien. Un second moyen a critiqué la décision attaquée qui avait retenu la responsabilité de la S.N.C.B. pour avoir trompé Monsieur Van Laethem par la convention conclue avec lui, la culpa in contrahendo n'ayant pas été légalement constatée. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a cassé et fait droit aux deux moyens. On se reportera à l'arrêt concernant le second moyen qui présente de l'intérêt en droit des obligations. Quant au premier, la Cour a fait le rappel des éléments de la cause qui avaient été pris en considération par le juge du fond pour décider que le juge s'était légalement trompé dans sa constatation d'une décision de désaffectation. Cette dernière ne pouvait en effet être déduite ni de la convention litigieuse (il n'était d'ailleurs pas certain qu'il s'agissait d'une location et non d'une concession à titre précaire), ni d'une mention figurant dans un acte de transfert de la prairie indiquant que le bien appartenait au domaine privé de l'Etat. Dans les deux cas, il ne s'agissait pas d'une décision de désaffectation, de sorte que le jugement n'était pas légalement justifié. Cet arrêt confirme l'enseignement à déduire de l'arrêt précédent. Nous en avons ainsi terminé avec la classification subjective des biens et les autres classifications que le Code reconnaît. Soulignons le fait que nous trouvons encore, sous le chapitre "Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent", un important article qui échappe le plus souvent à l'attention et qui a peu à voir avec la classification subjective. Il s'agit de l'article 543, énonçant l'important principe du "numerus clausus" des droits réels, en prélude au grand article 544 qui portera sur le droit de propriété, le premier droit réel par excellence. Ces principes ont été confirmés par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2007, précité. Le critère permettant d'apprécier si un bien appartient au domaine public de l'Etat ou de toute autre personne de droit public réside donc dans l'existence d'une décision d'affectation "à l'usage de tous du bien", expresse ou implicite mais certaine, par l'autorité compétente de la personne de droit public en question. Ne faut-il toutefois pas préciser ce qu'il faut entendre par "usage de tous" ? Une réponse positive s'impose et l'on verra apparaître un critère à cet égard, d'affectation à un service public, qui pourrait aussi être alternatif et s'ajouter alors à celui de l'affectation à l'usage de tous. La doctrine a défendu au demeurant, comme on le constatera ci-après, des conceptions plus ou moins extensives de ce processus permettant de définir la domanialité publique. Quant au statut de la domanialité publique, l'on voit également qu'il convient de défendre un principe et régime de domanialité dynamique, et non statique, comme il résulte notamment de l'important arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2007, que nous avons signalé supra et que nous analyserons plus avant dans le droit de la superficie (cfr. Décision n° 161bis). Cet arrêt a décidé en effet, en exprimant d'abord un principe, puis ensuite une importante exception, que : - "si un bien constitue une dépendance du domaine public, il est ainsi destiné à l'usage de tous ; nul ne peut, dès lors, acquérir un droit privé pouvant constituer un obstacle à cet usage et porter atteinte au droit des pouvoirs publics de le réglementer à tout moment, eu égard à cet usage ; - toutefois, dans la mesure où un droit privé de superficie ne fait pas obstacle à la destination précitée, il peut être établi sur un bien du domaine public". Cet arrêt tout à fait pertinent permet le développement d'une domanialité publique souple et moderne. Le principe énoncé par cet arrêt sera d'ailleurs repris dans l'article 3.59 du nouveau Livre 3.
(132) Cass., du 19 décembre 1958
Un fonds appartenant à X bénéficiait d'un chemin vers la voie publique, constituant un passage acquis en pleine propriété allant vers cette voie, et d'une largeur de 2 mètres. Le passage résultait d'un acte d'acquisition du terrain datant de 1886. Le chemin était devenu insuffisant en raison des contraintes nouvelles d'une exploitation agricole (passage de tracteurs,...), et X agit pour obtenir la reconnaissance d'un droit de passage légal sur pied de l'article 682 du Code civil, d'une largeur de 3 mètres au moins. L'action tendait donc précisément à l'obtention d'une servitude s'exerçant sur une bande de terrain d'un mètre venant compléter le passage en pleine propriété. L'action fut déclarée fondée en première instance mais rejetée en degré d'appel au motif que X ne rapportait pas la preuve d'un droit de passage de trois mètres de large découlant de l'acte d'achat de 1886. X s'est pourvu en cassation. La 20ème branche de son moyen est la plus intéressante et la plus efficace. Elle soutient que le juge du fond n'a pas répondu à ses conclusions et a mal interprété les termes de son action (violation de la foi due à l'exploit introductif d'instance) : il ne s'agissait pas pour lui d'obtenir une modification des termes de la convention de 1886, ce qui était au demeurant impossible en vertu de la convention-loi, mais d'obtenir le bénéfice d'une nouvelle servitude de passage légale du chef de fonds enclavé, sur une largeur d'un mètre, complémentaire de la servitude conventionnelle. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a déclaré fondée la deuxième branche du moyen, au terme d'une motivation allant étrangement plus loin que ce qui avait été soutenu dans le pourvoi, en concluant à un vice d'ambiguïté de la décision de fond. Cette motivation est la suivante : "attendu que les motifs de la décision de fond sont ambigus : qu'ils laissent, en effet, incertain si le juge d'appel a entendu décider que la demande avait pour objet non point, comme l'avait admis le premier juge, une servitude de passage, sur une bande de terrain d'un mètre de largeur, au profit d'un fonds enclavé, mais l'acquisition de la propriété de cette bande de terrain, ou s'il a considéré que, l'auteur du demandeur n'ayant acquis qu'un chemin d'une largeur de deux mètres, le demandeur ne pouvait plus se prévaloir de l'article 682 du Code civil, même si le chemin était devenu insuffisant pour les besoins de l'exploitation". Cet arrêt est un pur arrêt d'espèce puisqu'il se borne à casser une décision de fond pour un vice d'ambiguïté affectant la régularité de sa motivation (violation de l'ancien article 97 de la Constitution), ce qui est aussi suffisamment rare pour être signalé. L'arrêt est cependant significatif parce que, bien qu'étant un arrêt d'espèce, il a été l'occasion de l'admission implicite d'un principe qui sera consacré plus tard en tant que véritable règle de droit se trouvant dans l'article 682 du Code civil, à savoir la règle suivant laquelle un fonds peut être considéré comme enclavé non seulement s'il n'a pas d'issue vers la voie publique, mais aussi lorsque cette issue est "insuffisante pour les besoins de son exploitation" (état d'enclave relative).
(40) Cass., du 04 décembre 1941
Un incendie avait eu lieu dans un appartement loué par un copropriétaire, Mr. Deheselle, à Mr. Nokin, locataire. Le bailleur copropriétaire avait recherché la responsabilité du locataire sur la base de l'article 1733 du Code civil, qui, à l'époque des faits, prévoyait que : "le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine". Le locataire opposa à cette action en responsabilité contractuelle une exception d'irrecevabilité, le bail en question ayant été conclu par le seul copropriétaire Deheselle et non avec l'accord de tous les indivisaires. Pour Nokin, ce bail n'était donc pas "valable", et ne pouvait produire d'effets, même entre parties, en raison du non-respect de la règle de l'unanimité (cfr. art. 577, bis,§ 6). La cour d'appel de Liège a suivi l'argument du locataire et a décidé que les demandes formulées par le bailleur étaient irrecevables au motif que "le bail avait été affecté de nullité radicale en tant qu'il avait été conclu par le bailleur sans l'intervention de ses copropriétaires". Le bailleur s'est dès lors pourvu en cassation, en soutenant, dans son moyen unique, que "le bail de la chose indivise, consenti par l'un des indivisaires sans le concours des autres copropriétaires, est valable en droit et doit produire ses effets dans les rapports entre le preneur et le bailleur", d'où le droit pour ce dernier de se prévaloir de l'article 1733 du Code civil, et l'absence de justification légale de la décision de fond. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a suivi le moyen et a cassé la décision attaquée au terme d'une motivation en deux temps, établissant d'abord une comparaison entre le bail et la vente de la chose d'autrui, puis se prononçant spécifiquement sur la portée de la règle de l'unanimité invoquée par le "tiers" à la copropriété. En ce qui concerne la première partie de la décision, on se référera à la motivation de l'arrêt, axée sur la constatation que, si la vente de la chose d'autrui est en principe nulle (cfr. art. 1599 du Code civil), il n'en va pas de même du bail de la chose d'autrui. On opposera cependant d'emblée à cette argumentation que l'analogie n'est pas pertinente et que la comparaison entre la vente et le bail de la chose d'autrui est quelque peu boiteuse, déjà parce qu'il existe des cas où la vente de la chose d'autrui n'est pas nulle (cfr. 1 : cas d'une vente de la chose d'autrui moyennant un transfert différé de la propriété, qui est valable ; et cfr. 2 : cas de vente portant sur des "genera" qui peuvent appartenir à autrui, une telle vente étant valable puisqu'il s'agira pour le vendeur de délivrer des choses de genre du même type que celles initialement convenues). Plus intéressante et importante pour notre matière est la deuxième partie de la décision. La Cour de cassation y énonce ce qui suit : "vainement le défendeur (locataire) soutient qu'à supposer qu'en principe le bail de la chose d'autrui ne soit pas nul, il le serait du moins dans le cas de la copropriété, ce aux termes de l'article 577bis du Code civil (loi du 8 juillet 1924), dont le §6 porte que ne sont valables que moyennant le concours de tous les copropriétaires, les actes d'administration autres que les actes d'administration provisoire et les actes de disposition ; attendu que le seul objet de cette disposition légale est de régir les rapports existant entre plusieurs personnes propriétaires indivis; qu'elle est étrangère aux rapports entre ces personnes et des tiers, rapports qui demeurent régis par le droit commun". On peut donc déduire deux principes de cet important arrêt : 1) d'abord, les "tiers" sensu lato à la copropriété, qui sont toutes personnes autres que les copropriétaires et étrangères à la copropriété (à savoir en l'espèce le locataire, qui n'est pas copropriétaire), n'ont pas le droit d'invoquer directement le non-respect de la règle de l'unanimité, et sa sanction, pour contester la validité de l'acte conclu avec un copropriétaire ; 2) pour le reste, la validité de l'acte conclu entre ces "tiers" et le copropriétaire, ainsi que les effets de cet acte vis-à-vis des autres tiers sensu stricto (en tant que n'étant pas parties à l'acte en question), demeurent régis "par le droit commun".
(99) Cass., du 23 février 1995
Un litige est né entre voisins au sujet des modalités d'exercice d'une servitude de passage en milieu agricole, servitude entravée suite à la construction d'une terrasse et d'un muret. Le sieur Schrobiltgen, ayant subi cette entrave, lança une action en réintégrande contre ses voisins dénommés Persico et Leest. Ces derniers argumentèrent comme suit : 1) d'une part, ils opposèrent l'irrecevabilité de l'action dès lors que la première condition prescrite par l'article 1370 du Code judiciaire (caractère nécessairement prescriptible du droit ou du bien concerné) ne pouvait être remplie à l'égard d'une servitude de passage en principe imprescriptible (cfr, art. 684 du Code civil) ; 2) d'autre part, formèrent une demande reconventionnelle qui était elle-même une réintégrande et subsidiairement une complainte, et enfin revendiquèrent également dans le cadre de leur demande reconventionnelle, la propriété d'une cour située à l' arrière de leur bâtiment ; ils sollicitèrent enfin en conclusions le bornage judiciaire des propriétés. Il semble, quant à ce dernier point, que les parties s'entendirent pour demander conjointement la désignation d'un expert afin de procéder au bornage et au mesurage de leurs propriétés contiguës, ce qui fut acté par le juge. En degré d'appel, le tribunal de première instance d'Arlon déclara recevable et fondée l'action en réintégrande principale, en dépit de l'absence d'existence de la première condition de l'action, en se fondant sur la théorie de la prescriptibilité de l'assiette de la servitude. Quant à l'action reconventionnelle, elle fut déclarée irrecevable, semble-t-il, le tribunal décidant toutefois de déclarer recevable l'action pétitoire en bornage qui avait été introduite par les parties. Les consorts Persico et Leest se pourvurent en conséquence en cassation en invoquant, dans leur premier moyen, la violation de l'article 1370 du Code judiciaire ainsi que de l'article 684 du Code civil qui prévoit, en son alinéa 2, qu'aucune prescription ne peut être invoquée à l'appui d'une servitude de passage du chef de l'état d'enclave, et dans leur second moyen, la violation de la règle de l'interdiction du cumul du possessoire et du pétitoire (cfr. art. 1371 du Code judiciaire). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour cassa effectivement sur la base du premier moyen qui ne pouvait qu'aboutir, à l'époque du moins. Notons qu'aujourd'hui, l'action en réintégrande est possible en matière de servitude conventionnelle ou légale, en vertu du nouveau texte de l'article 1370 résultant de la loi d'avril 2014, elle-même trouvant son origine dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 octobre 2011 (cfr. Décision n° 99bis). C'est une très bonne chose. Nous reviendrons infra sur cette question liée au fond du mécanisme de la prescription de la servitude, et sur les décisions à cet égard. Quant au second moyen, la Cour décida qu'il manquait en droit aux motifs que : "le bornage tend à reconnaître les limites des propriétés et conduit à une solution définitive ; qu'en sollicitant le bornage de la parcelle litigieuse, les demandeurs (défendeurs dans le cadre de l'action originaire) ont, dès lors, introduit une action pétitoire ; attendu que l'article 1371 du Code judiciaire interdit le cumul du possessoire et du pétitoire et dispose que le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire ; que l'intentement de l'action pétitoire implique donc la renonciation du demandeur à agir au possessoire ; attendu qu'en déclarant l'action pétitoire recevable et implicitement l'action possessoire (reconventionnelle des défendeurs) irrecevable, le jugement attaqué fait une exacte application de l'article 13 71 du Code judiciaire". Cette motivation rigoureuse est conforme aux principes. Il faut donc se méfier des pièges qui peuvent survenir suite au diligentement d'une action en bornage, qui est une action pétitoire et qui exclut en principe que le demandeur en bornage puisse par la suite agir au possessoire, sauf élément neuf justifiant l'instance possessoire. Par cet arrêt, confronté à une décision de juge du fond qui avait déclaré recevable une action en réintégrande diligentée à l'encontre de voies de fait faisant obstacle à une servitude de passage légale, la Cour de cassation a fait droit au moyen et a cassé pour violation des articles 684, alinéa 2, du Code civil et 1370, al.1, 1° du Code judiciaire. Conclusion provisoire : la boucle paraissait donc bouclée : en droit belge, de lege Lata, l'on ne pouvait intenter des actions possessoires à l'appui de servitudes légales ou conventionnelles de passage par définition imprescriptibles car discontinues même si elles se fondent sur un titre légal ou conventionnel. La Cour constitutionnelle a heureusement mis fin, il y a quelques années, à ce système totalement absurde.
(143) Cass., du 06 janvier 1944
Un père de famille et son épouse, les consorts Nicolas, avaient établi un passage (trottoir bordé d'une rigole) permettant d'accéder à l'arrière d'une maison. Cette dernière, d'un seul tenant à l'origine, avait été séparée en deux parties distinctes et le passage longeait le mur latéral de la partie gauche, semble-t-il, puis l'arrière de la maison, pour desservir l'arrière de la partie droite du bien, qui était sans accès sinon à la voie publique. Un lien de servitude avait ainsi été établi par un "père de famille", mais il s'agissait d'une servitude de passage, par définition discontinue, donc ne pouvant faire l'objet d'une véritable destination par le père de famille (cfr. art. 692 du Code civil). Au décès des consorts Nicolas, les deux maisons revinrent à leurs enfants, et ceux qui héritèrent de la partie droite de la maison, desservie par le passage, soutinrent l'existence de la servitude. Le juge du fond en a reconnu l'existence en appliquant l'article 694 du Code civil qui ne requiert que la condition d'apparence. Les demandeurs en cassation invoquèrent essentiellement la violation des articles 692, 693 et 694 du Code civil, au motif que le juge du fond avait appliqué l'article 694 alors que, manifestement, il aurait dû se référer aux articles 692 et 693 : il s'agissait d'un cas de destination de père de famille qui ne pouvait donner naissance à une servitude puisqu'elle était discontinue. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation, après le résumé du contenu de la décision de fond en rapport avec la situation litigieuse, a considéré, à juste titre, qu'il s'agissait bien en l'espèce d'une question d'acquisition d'une servitude par destination du père de famille, qui n'avait pu sortir ses effets dès lors que la servitude de passage litigieuse était discontinue. La Cour a ensuite expliqué quel était le cadre précis de l'article 694, distingué des articles 692 et 693 : "attendu que c'est donc à tort que le jugement attaqué décide que le cas de l'espèce rentre dans les prévisions de l'article 694 du Code civil ; qu'il ressort des travaux préparatoires de ce Code, notamment du rapport d'Albisson au Tribunal, qu'à la différence de l'article 693, qui vise l'établissement, par le père de famille, d'une servitude nouvelle, c'est-à-dire n'existant point antérieurement, l'article 694 suppose l'existence antérieure d'une servitude ; qu'il s'applique au cas où le propriétaire de deux héritages dont l'un, avant la réunion dans sa main, devait un service à l'autre et entre lesquels un signe apparent de servitude a subsisté, dispose ensuite de l'un de ces héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude ; attendu, en dernière analyse, qu'il s'agit, dans le cas prévu à l'article 694 du Code civil, d'une servitude légalement préexistante et se manifestant, entre les deux héritages, par un signe apparent, servitude dont l'exercice s'est trouvé nécessairement suspendu par suite de la réunion de ces deux héritages dans les mains d'un même propriétaire, mais qui a recommencé à produire tous ses effets à dater du jour où le propriétaire a disposé de l'un des deux fonds sans rien stipuler à cet égard ; qu'il se voit des constatations du jugement ci-dessus reproduites, que les conditions d'application de l'article 694 ne se rencontrent pas en l'occurrence ; attendu que la théorie exposée par le juge du fond ne saurait prévaloir contre les termes clairs, précis et formels du rapport d'Albisson au Tribunal, avec lesquels le texte de l'article 694 se trouve en parfaite concordance". La cassation est dès lors prononcée sur ces bases. On le voit, les situations visées par les articles 692 et 693 du Code civil d'une part, et 694 d'autre part, sont très différentes : 1) naissance d'une servitude nouvelle par destination du père de famille (art. 692 et 693) : dans ce cas. il s'agit : 1) d'un fonds originaire, entre deux parties duquel existe un lien continu et apparent de servitude établi par le père de famille, propriétaire du fonds ; 2) et d'où la naissance de la servitude (nouvelle) au moment de la séparation du fonds en deux. Le mécanisme fait intervenir un fait de l'homme résidant dans la destination du père de famille ; il est vrai toutefois qu'il est essentiellement légal ; 2) renaissance d'une servitude ancienne après réunion du fonds, puis nouvelle sénaration (art. 694) : dans ce cas, le processus fait renaître une servitude ancienne préexistante et opère en trois temps (et non en deux) : 1) une servitude ancienne a d'abord existé entre deux fonds ; 2) l'existence de cette servitude a été suspendue pendant la période où les deux fonds ont été réunis entre les mains d'un même propriétaire ; 3) la servitude antérieure est "réactivée" lors de la nouvelle séparation du fonds en deux parties distinctes, correspondant à la situation ancienne du rapport foncier, et ce à partir du moment où cette servitude était à tout le moins apparente, sans devoir présenter en outre un caractère continu. Ce mécanisme est légal mais l'on peut se demander quelle est la nature de la servitude lorsqu'elle était, à l'origine, conventionnelle et que la convention des parties avait prévu la servitude mais non la situation de réunion puis de nouvelle séparation ultérieure des fonds. Il me paraît que la servitude qui réapparaîtrait alors en quelque sorte, conserverait son caractère conventionnel d'origine et, partant, se verrait appliquer les règles en matière de servitudes conventionnelles, dont la perpétuité de principe de la servitude.
(23) Cass., du 14 octobre 1976 - affaire du viaduc de Beez
Dans l'espèce à l'origine de cet arrêt, les travaux de construction du viaduc de Beez, dont l'Etat belge était le maître de l'ouvrage, avait impliqué en tant que l'un des entrepreneurs, la société Prorefa, chargée de travaux de peinture. Or, dans le cours des travaux, des projections de peinture au minium avaient atteint les arbres situés en contrebas, se trouvant dans les vergers appartenant au baron Fallon. Ce dernier dirigea en conséquence une action en responsabilité contre l'Etat belge, en application de l'article 544 du Code civil, et contre la société Prorefa, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil. La cour d'appel de Liège, par un arrêt du 5 juin 1975, après avoir relevé que les fruits des vergers avaient été rendus impropres à la consommation en raison des pulvérisations au minium de plomb, que la société Prorefa (sous-traitante des entrepreneurs généraux chargés des travaux de peinture du viaduc) avait effectués, a rejeté la demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat Belge sur pied de l'article 544 du Code civil, au motif que, entre autres, "sans la faute de Prorefa, les préjudiciés c'est-à-dire le demandeur et un tiers n'auraient pu se plaindre d'une rupture inexistante en l'espèce, de l'équilibre devant exister dans les rapports entre propriétaires voisins". A l'encontre de cette décision, le baron Fallon invoqua le caractère illogique du raisonnement et l'absence de justification de la décision, et partant l'absence de contrôle possible de sa légalité par la Cour de cassation, au motif que l'arrêt ne pouvait déduire de l'affirmation sus-visée, que le demandeur était dépourvu de toute action contre le défendeur (l'Etat belge), du chef de pareille rupture d'équilibre. Surtout, le moyen invoqua, de façon plus explicite et précise, le principe dégagé dans l'arrêt précédent du 14 juin 1968 (et que l'on retrouvera à la base de celui du 13 février 1987), suivant lequel le propriétaire bâtisseur est susceptible de devoir répondre, au titre du trouble de voisinage, de la faute de l'entrepreneur à l'origine de ce trouble : l'application du principe de responsabilité s'impose en effet même "quand une faute personnelle a été commise par l'entrepreneur ou le sous-traitant qui a effectué les travaux sur le fonds du propriétaire bâtisseur". On devait donc en principe s'acheminer vers une cassation. Il n'en a rien été, la Cour rendant un arrêt qui, sous le couvert d'une décision d'espèce et non un arrêt de principe, exprime sans doute une volonté de la haute juridiction de circonscrire plus strictement le cadre de la théorie des troubles du voisinage dans certaines limites, et de mettre un frein à son développement. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Plein d'habileté et se situant sur le terrain de la technique de cassation, l'arrêt de la Cour a manifestement tout fait pour sauver la décision de fond. Il a constaté d'abord que, "sans être critiqué de ce chef", l'arrêt de fond n'avait retenu aucune responsabilité à charge de l'Etat belge sur pied de l'article 1382 du Code civil. Est venu ensuite ce qui concernait l'aspect le plus délicat de la cause, portant sur la justification de la non-application en l'espèce de l'article 544 du Code civil à l'Etat belge, maître de l'ouvrage. La Cour de cassation a répondu à cette question en prenant en considération le passage de la décision de fond, cité ci-dessus dans le cadre du moyen. Elle a déduit dès lors de cette énonciation du juge du fond ce qui suit : "attendu qu'il ressort de cette considération, replacée dans le contexte de l'espèce, que la cour d'appel constate : 1) premier élément de motivation de la décision attaquée, non seulement que, sans la faute de Prorefa, les faits sur lesquels le demandeur fondait sa demande, dirigée par lui contre le défendeur (Etat belge) eussent été inexistants, mais que, de toute façon ; 2) deuxième élément de motivation) ces faits ne révélaient pas l'existence, entre les propriétés voisines du demandeur et du défendeur, d'une rupture d'équilibre de nature à justifier, par application de l'article 544 du Code civil, l'obtention d'une compensation par le demandeur à charge du défendeur". La Cour de cassation procède donc par une forme de tour de passe-passe. L'arrêt de fond est sauvé en fait parce que le juge du fond a pu déduire, dans le cadre de son souverain pouvoir d'appréciation de l'espèce (qui échappe en principe au contrôle de la Cour de cassation), et donc "dans le contexte propre à celle-ci", l'inexistence du fait non fautif qui aurait été constitutif de trouble excessif engageant l'Etat belge sur pied de la théorie des troubles de voisinage. A cet égard, si le premier élément de motivation est sujet à discussion, en théorie du moins, puisqu'on a vu que la faute de l'entrepreneur n'implique pas nécessairement que le fait non fautif, constitutif de trouble, soit inexistant dans le chef du maître de l'ouvrage, le second paraît quant à lui imparable et place l'examen de l'arrêt de fond sur le terrain de la pure espèce, appréciée souverainement par le juge du fond. L'arrêt de fond pourrait aussi se justifier, en fait à nouveau, par une constatation implicite de l'absence de lien causal entre le dommage et le trouble (mais celui-ci avait de toute façon déjà été qualifié "d''inexistant"). Tout était peut-être question de point de vue dans cette affaire et un facteur de politique juridique n'est sans doute pas absent de ce qui justifie la motivation de la Cour de cassation dans cet arrêt. La juridiction suprême aurait pu en effet rendre un arrêt reprenant les principes dégagés dans sa décision de 1968, et confirmés en 1987, pour prononcer une cassation sur cette base. Tel n'a pas été le cas, la Cour souhaitant sans doute, répétons-le, marquer un temps d'arrêt dans le développement de la théorie des troubles de voisinage. En outre, on peut se demander ce que la Cour de cassation aurait décidé si le baron Fallon avait développé un moyen spécifique sur la question du lien causal en soutenant que la constatation du lien causal avec la faute de Prorefa n'excluait pas la causalité à l'égard du trouble de l'état, causalité qui aurait dû être écartée de façon certaine sur pied de la théorie de l'équivalence des conditions (à ce sujet, cfr. Décision n° 36). Peut-être y aurait-il pu y avoir une cassation sur la base d'une telle critique. En conclusion, même s'il faut être prudent dans l'interprétation de cet arrêt, parce qu'il ne s'agit pas d'un arrêt de principe mais d'un arrêt d'espèce, il convient de relever, à tout le moins, que cette décision est en décalage certain par rapport au courant des arrêts de la Cour de cassation que nous avons analysé ci-dessus. Ceux-ci bénéficient par rapport au dernier, quant à l'enseignement à en déduire, d'une forme de supériorité puisqu'ils ont dit le droit, en tant qu'arrêts de principe. Il se confirmera toutefois, avec l'arrêt suivant, que la portée indirecte de l'arrêt du 14 octobre 1976 ne saurait être négligée, la Cour de cassation confirmant le type d'approche qui le caractérise, en des termes pratiquement identiques, par cet arrêt du 2 juin 1983.
(14) Cass., du 28 janvier 1991
Dans les faits, des troubles de voisinage dommageables avaient été causés à la suite de travaux publics impliquant différents pouvoirs publics, dont la S.N.C.B., maître de l'ouvrage. La cour d'appel de Bruxelles a décidé, par un arrêt du 17 février 1989, que, si l'on pouvait admettre que le fondement de l'obligation de voisinage devait être, pour ce type de litige, le principe de l'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 11 de la Constitution, il en découlait une condition supplémentaire de la théorie des troubles du voisinage, à savoir que le demandeur à l'action devait démontrer avoir subi un "dommage spécial" (condition de la spécialité du dommage), dommage que n'avaient pas subi les riverains autres que lui. Cette façon de raisonner était-elle admissible dès lors qu'elle ajoutait à la condition de dommage excessif, à apprécier dans la relation entre l'auteur du trouble et la victime, celle de dommage spécial, à apprécier en faisant intervenir la relation entre la victime du troubles et les autres riverains, sujets de droit voisins et victimes potentielles des troubles résultant des travaux publics concernés (ce qui paraissait critiquable puisque cela emportait un déplacement du centre de la théorie et une complexification de celle-ci) ? A juste titre, le pourvoi en cassation a opposé que tel n'était pas le cas et que "le dommage à prendre en considération doit s'apprécier en fonction des charges que la défenderesse pouvait imposer dans l'intérêt collectif et que les demandeurs pouvaient supporter dans l'intérêt collectif et non en fonction de la situation des demandeurs par rapport aux autres voisins ; que le caractère excessif des troubles doit s'apprécier dans la relation de voisinage entre celui qui cause le trouble et celui qui le subit et non entre ce dernier et ses voisins qui se trouvent dans une même situation". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a suivi cette argumentation et a cassé la décision entreprise, aux motifs que : "après avoir constaté que les demandeurs n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande, l'arrêt considère que ce fondement réside dans le principe de l'égalité devant les charges publiques ; que ce principe, consacré notamment par l'article 11 de la Constitution, implique que l'autorité publique ne peut, sans compensation, imposer des charges qui excèdent celles qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif ; que l'arrêt viole l'article 11 de la Constitution en limitant le droit des demandeurs à la compensation des charges que ne subissent pas les autres riverains du chantier de la défenderesse". L'enseignement de cet arrêt est double : 1) d'une part, la Cour de cassation se réfère pour la première fois au principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 11 de la Constitution (qui deviendra l'article 16 dans la coordination de 1994) ; 2) d'autre part, s'il ne faut pas retenir une condition de spécialité du dommage (c'est ce qui justifie la cassation en la cause), il convient de relever que le juge du fond, sous le contrôle marginal de la Cour de cassation, doit tenir compte, pour l'appréciation des charges qui excèdent celles qu'un particulier doit supporter, de l'influence de l'intérêt collectif (cfr. contenu implicite de l'arrêt). La Cour de cassation exprimera ce principe, de façon expresse cette fois, dans les deux arrêts ultérieurs ci-après examinés, en précisant l'influence du critère de l'intérêt collectif, de même qu'elle reconnaîtra que le principe d'égalité devant les charges publiques ne s'impose pas de façon exclusive, mais peut être combiné, comme fondement d'action, avec l'article 544 du Code civil, même en cas de troubles résultant de travaux imputables à une personne de droit public.
(20) Cass., du 14 juin 1968
Dans les faits, un ensemble de copropriétaires, les Bemaert et consorts, ont fait réaliser des travaux dans leur immeuble, qui ont causé des troubles dommageables à Gion et consorts. Les premiers ont été dès lors assignés par les seconds sur la base de la théorie des troubles de voisinage. L'entrepreneur a été appelé en intervention et garantie par Bemaert et consorts. L'arrêt rendu en degré d'appel a constaté qu'une partie des dégâts litigieux était imputable à la faute de l'entrepreneur, mais a retenu également la responsabilité de Bernaert et consorts, qui devaient répondre d'une partie des dommages en vertu de la théorie des troubles de voisinage. Etait-ce possible ? En d'autres termes, le fait non fautif résultant du trouble excessif et dommageable dont avait à répondre le propriétaire du fonds, qui était à l'origine des dommages litigieux, comprenait-il et intégrait-il éventuellement, le fait fautif d'un entrepreneur, de sorte que ce propriétaire devait également en être déclaré responsable, en définitive ? L'arrêt de fond a répondu positivement à cette question, alors que "Bernaert et consorts ont soutenu dans leur pourvoi que les articles 544 et 1382 du Code civil s'excluent mutuellement et ne peuvent être admis conjointement", ce qui était à l'origine du principe, violé au fond selon eux, selon lequel : "le propriétaire d'un fonds sur lequel est érigé un bâtiment dont la construction cause un dommage à l'immeuble contigu, n'est pas tenu de payer une indemnité compensatoire si le dommage est causé par une faute qui ne lui est pas imputée", à savoir en l'espèce la faute d'un entrepreneur. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a parachevé l'élaboration de l'énoncé des principes de responsabilité applicables à la situation de l'entrepreneur, en ce compris lorsque ce dernier a commis une faute. Retrouvons et distinguons l'articulation de ces principes au sein des attendus fondamentaux de l'arrêt : "1) si l'indemnité compensatoire, due par un propriétaire bâtisseur, au propriétaire voisin en raison de la rupture par lui de l'équilibre devant exister dans les rapports entre propriétaires voisins n'est pas due aussi par l'entrepreneur qui a érigé le bâtiment, érection cause de ladite rupture, cet entrepreneur n'étant pas voisin du propriétaire et ne pouvant avoir comme entrepreneur semblables obligations ; 2) il n'en est pas moins vrai que l'entrepreneur, qui commet une faute personnelle ou une négligence dans la construction du bâtiment, est responsable, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil, du dommage qu'il cause au propriétaire bâtisseur ; 3) qui, ensuite de ladite faute personnelle devient à l'égard du propriétaire voisin débiteur d'une indemnité compensatoire ou d'une indemnité compensatoire plus lourde". La Cour précise le troisième principe comme suit : "la circonstance que le propriétaire bâtisseur est tenu à indemnité compensatoire à l'égard du propriétaire voisin par application de l'article 544 du Code civil, n'exclut pas qu'un tiers, en l'espèce l'entrepreneur, soit tenu au profit du propriétaire bâtisseur, à indemniser le dommage à lui causé par sa faute personnelle, faute qui ou bien donne naissance à l'indemnité compensatoire due en application de l'article 544 du Code civil ou bien contribue à rendre cette indemnité plus lourde". La Cour apporte une précision supplémentaire : "la circonstance que le propriétaire bâtisseur est tenu de ladite indemnité compensatoire n'exclut pas non plus que ledit tiers puisse être appelé en garantie du chef de ce dommage" (précisons : pour peu que cet appel en garantie soit fondé sur le droit commun de la responsabilité pour faute). Enfin, le pourvoi est rejeté en conséquence de ces principes au motif que le juge du fond a pu, sans contradiction, admettre la responsabilité du propriétaire bâtisseur, bien qu'il n'ait pas lui-même commis de faute, même si l'indemnité compensatoire qui était due par lui, "est résulté à tout le moins pour partie, de la faute personnelle commise par l'entrepreneur". Cet arrêt doit être approuvé. On relèvera l'une des conséquences qui semble s'en dégager, à savoir faire supporter par le propriétaire bâtisseur, dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage, la responsabilité de l'entrepreneur pour faute, non pas seulement à concurrence de la part excessive de trouble et de dommage, mais même à concurrence de la totalité du dommage, imputable à la faute de l'entrepreneur, ce qui est surprenant par rapport aux limites imparties en principe à la réparation dans la théorie des troubles du voisinage. On retiendra aussi l'appel de note dans le texte de l'arrêt (ce qui est rare) à un développement explicatif du deuxième principe précité, donné par le ministère public près la Cour de cassation, renvoyant aux principes gouvernant le cumul des responsabilités en droit commun.
(38) Cass., du 14 décembre 1995
Dans une espèce où il était question de troubles anormaux ayant pris la forme de nuisances sonores résultant de l'usage excessif d'un batterie par le fils d'un voisin, à toute heure du jour, le juge du fond avait décidé que "le fait de jouer de la batterie dans l'habitation des demandeurs "entraîne un dérangement énorme et un bruit particulièrement énervant", d'où la constatation d'un trouble excessif de voisinage, même si par ailleurs "les défendeurs ne prouvent pas l'existence d'un acte illicite dans le chef des demandeurs, de sorte que leur demande est non fondée en tant qu'elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil" (fondement alternatif de la demande en responsabilité originaire). Mais quelle sanction fallait-il prononcer dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage ? Le juge du fond alla très loin puisqu'il décida, ni plus ni moins, en confirmant la décision de première instance, "d'interdire aux demandeurs, à leur fils ou à tout autre membre de la famille, de jouer ou de s'exercer à jouer de la batterie ou de tout instrument assimilé dans leur habitation sous peine d'une astreinte de cinq mille francs par infraction à cette interdiction", sanction que le jugement qualifia de sanction "en nature" et "directe", qui devait être prononcée selon lui ''par préférence". S'ensuivit un pourvoi de la partie défenderesse ainsi condamnée d'une façon qui paraissait excessive. Pour cette partie, la sanction du trouble excessif "ne peut avoir lieu que par une juste et adéquate compensation ne portant pas atteinte à la manière licite d'exercer le droit de propriété", d'où la violation des articles 544, 1382 et 1383 du Code civil. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a fait droit au pourvoi et a cassé la décision entreprise aux motifs que : "le propriétaire d'un immeuble qui, sans commettre un fait fautif rompt l'équilibre établi entre son droit de propriété et celui de son voisin en imposant au propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant l'équilibre rompu ; que lorsque le trouble a été causé par un fait non fautif, la juste et adéquate compensation rétablissant l'équilibre rompu ne peut consister en l'interdiction absolue de ce fait, même si, selon le juge du fond, l'interdiction absolue est la seule manière de rétablir l'équilibre rompu". La cassation a été prononcée en raison de la portée absolue de la sanction qui avait été décidée en la cause, la Cour relevant in fine que cette sanction avait eu pour conséquence de "priver les demandeurs de la jouissance de leur propriété". Deux commentaires s'imposent au sujet de cet arrêt. D'abord, il contient une distinction entre la sanction du fait fautif, opérant en nature et pouvant sans doute aller jusqu'à la prohibition infuturo de l'activité fautive, et celle du fait non fautif, qui ne peut revêtir une telle intensité car elle impliquerait alors une interdiction de l'usage, pourtant non fautif, du droit de propriété ou d'une modalité de celui-ci, et ce sans limites. Ensuite, il se confirme implicitement que la notion de "juste et adéquate compensation" doit s'entendre au sens large du terme : elle englobe la réparation en nature qui est le principe général, et, si cette dernière n'est pas possible, la réparation par équivalent. On regrettera peut-être que la Cour de cassation n'ait pas saisi l'occasion que présentait cette affaire pour affiner la présentation de la sanction du trouble dommageable, et faire apparaître sa composante de réparation en nature, même si elle en a précisé par ailleurs certaines limites.
(47) Cass., du 05 décembre 1968 - affaire de l'immeuble de la rue de la Chancellerie / affaire Collet
La Cour de cassation a rendu un arrêt qui a suivi la décision de fond et a rejeté le pourvoi. Quant à la première branche du quatrième moyen, la Cour a décidé : 1) "qu'il est au pouvoir du juge qui, en vertu des articles 822 et 823 du Code civil, est saisi de l'action en partage d'une succession et a pour mission, notamment, de trancher les contestations relatives au mode d'y procéder, lorsqu'il constate que, par la division en appartements d'un immeuble dépendant de la succession, celui-ci peut être commodément partagé par l'attribution privative d'appartements entre les cohéritiers, d'ordonner ainsi, plutôt que la licitation de l'immeuble, le partage en nature de celui-ci que consacrent les articles 826, 827 et 832 du Code civil" ; et 2) "qu'un tel partage, loin de laisser subsister l'indivision précaire et inorganisée que vise l'article 815 du Code civil, a pour effet d'y mettre un terme ; que cet article est étranger à l'indivision, nécessaire et accessoire, des parties de l'immeuble affectées à l'usage commun des appartements appartenant à des propriétaires différents". Quant à la seconde branche, la Cour a considéré que la décision de fond avait répondu aux conclusions des demandeurs. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Le commentaire critique que je ferais sur l'arrêt se structure comme suit : 1) il est conforme à la loi que la Cour de cassation privilégie le partage en nature, qui constitue le principe général, le partage par licitation n'étant que l'exception ; 2) le raisonnement suivi par la Cour de cassation n'est cependant pas des plus logiques et esquive l'argument de poids des demandeurs en cassation : - n'est pas tout à fait pertinent, semble-t-il, le fait de répondre qu'un tel partage, "loin de laisser subsister l'indivision précaire et inorganisée que vise l'article 815 du Code civil, a pour effet d'y mettre un terme", cet article étant étranger à l'indivision forcée ; en effet, ce faisant, la Cour prend en considération la période non problématique du litige, à savoir celle qui suit le décès du sieur Collet (caractérisée par l'existence d'une simple indivision ordinaire, et qui précède le partage en nature), or c'est ce dernier qui créera une difficulté en engendrant une indivision forcée ; - ce qui était en effet délicat en l'espèce et au cœur du litige (esquivé donc en quelque sorte, tant en degré d'appel qu'en cassation), c'était la situation résultant du partage en nature ; celui-ci mettait certes fin à l'indivision ordinaire mais engendrait une indivision d'un nouveau type, à caractère forcé, s'imposant aux héritiers Collet et ne pouvant faire l'objet, quant à elle, d'un sortie d'indivision sur pied de l'article 815 du Code civil, cet article étant inapplicable à l'indivision forcée ; - une réponse plus logique aurait dès lors peut-être pu résider dans les éléments suivants : (i) le rappel du principe général du partage en nature, auquel la Cour de cassation procède d'ailleurs ; et (ii) le rappel, ainsi que l'avait fait en partie la cour d'appel, qu'en situation de copropriété forcée, suite au partage en nature du bien, les héritiers pourraient toujours sortir d'indivision en vendant leur héritage dans la copropriété, leurs droits à titre accessoire dans les parties communes suivant celui-ci (cfr. l'article 577, bis (2), § 9, al. 2 : "la quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable"). Relevons toutefois que, dans cet arrêt, la Cour de cassation présente l'article 815 du Code civil comme ne s'appliquant pas à la copropriété forcée et, surtout, comme s'appliquant naturellement à la copropriété ordinaire. La Cour fait en effet référence à "l'indivision précaire et inorganisée que vise l'article 815 du Code civil, qui a pour effet d'y mettre un terme ; cet article étant étranger à l'indivision, nécessaire et accessoire" à caractère forcé. Cette motivation appuie la thèse, que nous soutiendrons dans un instant, de la non-application de l'article 815 du Code civil à la copropriété volontaire, en définitive non visée par cet article. D'autre part, cette motivation confirme le principe d'application de l'article 815 à des cas d'indivision : s'il n'y a pas indivision, sensu stricto, le principe de s'applique pas. Nous en avons ainsi terminé avec l'examen du mécanisme de sortie d'indivision, impliquant à titre principal un partage en nature, et à titre d'exception un partage par licitation si le bien concerné n'est pas commodément partageable. Il convient enfin de remarquer qu'une demande d'un coindivisaire, aussi bien tendant à un partage par licitation qu'en nature est susceptible de faire l'objet d'un abus de droit, le juge du fond appliquant le droit commun (cfr. Cass., 3 juin 1977, arrêt par lequel une décision de la cour d'appel d'Anvers qui avait ordonné la vente publique de la nue-propriété de tous les biens d'une succession, a été cassée pour défaut de réponse à des conclusions qui avaient notamment soutenu que les frais de vente publique seraient supérieurs à la part du demandeur qui exigeait la vente, de sorte que la vente ne lui procurait aucun avantage et ne pouvait que nuire à l'autre partie).
(102) Cass., du 20 décembre 1974 - affaire Evenepoel
La dame Evenepoel demandait le remboursement de trois sommes d'argent qu'elle disait avoir prêtées aux consorts Jacobs et Grijseels. Ces derniers prétendaient que les sommes leur avaient été données. Etrangement, les parties au litige ont situé le débat judiciaire sur le terrain de l'article 2279 du Code civil (règle de preuve), alors que, manifestement, cette disposition n'était pas applicable puisqu'il était question du remboursement de sommes d'argent et non de la revendication d'un bien meuble à considérer "ut singuli". Dans le cadre de l'article 2279, les consorts J. et G. invoquaient leur possession et l'existence d'un don manuel. Ils avaient fait des déclarations en ce sens à l'occasion d'une information pénale qui avait eu lieu suite à une plainte déposée par Madame Evenepoel. De son côté, cette dernière, à défaut de pouvoir prouver l'existence d'un prêt, a concentré ses critiques sur la possession des consorts J. et G, et a prétendu que cette possession était équivoque. La cour d'appel de Gand a estimé que la possession n'était pas équivoque et a rejeté l'action en revendication, d'où le pourvoi de la dame Evenepoel qui a invoqué, notamment, que la juridiction de fond avait donné une portée trop absolue à l'article 2279 (cfr. en particulier la première branche du moyen). En réalité, la dame Evenepoel avait échoué à établir le vice d'équivoque et l'argumentation développée par son pourvoi était assez faible. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour a rejeté le pourvoi. Après le rappel des énonciations principales du juge du fond, l'arrêt a décidé que : "la possession de biens meubles corporels ne fait naître le droit de propriété que si la possession est utile, c'est-à-dire lorsqu'elle présente les qualités énumérées à l'article 2229 du Code civil ; que la demanderesse soutient que, comme elle invoquait le caractère équivoque de la possession, la preuve que la possession n'était pas équivoque incombait aux défendeurs ; attendu toutefois que c'est à celui qui réclame la restitution de meubles corporels qu'incombe la charge de la preuve que la possession invoquée par la partie adverse est, eu égard aux circonstances, susceptible d'interprétations diverses ; attendu que, d'après les constatations précitées, l'arrêt considère que la possession du défendeur n'étant pas entachée d'un vice a pu légalement en déduire qu'aux termes de l'article 2279 du Code civil sa possession valait titre sans que le défendeur dût établir l'origine de sa possession ; que l'arrêt, qui est régulièrement motivé, ne viole pas les dispositions légales citées au moyen". Cet arrêt confirme, de façon plus claire encore, le principe dégagé par l'arrêt précédent quant à la charge de la preuve du vice de la possession pesant sur le possesseur antérieur, ou son ayant cause, demandeur à l'action. Le vice d'équivoque est également défini en fonction d'une possession "susceptible d'interprétations juridiques diverses". L'arrêt suscite pour le reste trois observations critiques touchant à la terminologie utilisée : 1) il était inexact de dire que la possession "ne fait naître le droit de propriété que si la possession est utile" ; la Cour ne confond-elle pas alors la règle de preuve déduite de l'article 2279 avec la règle de fond ? Si, pour cette dernière, la possession fait naître le droit de propriété, l'état de possession, dans la règle de preuve, ne permet en principe que de présumer un titre de propriété ; 2) est dès lors critiquable la formule suivant laquelle, dans cette cause, la possession "valait titre", propre à la règle de fond ; la possession valait en effet simplement "présomption de titre", la nuance étant d'importance, théoriquement du moins ; 3) par ailleurs, la qualification de l'action en tant qu'action en "restitution", était également grandement source d'ambiguïté : il devait s'agir plutôt d'une action en revendication, si du moins l'on demeurait dans le cadre de l'article 2279 du Code civil. Enfin, l'arrêt est bien étrange, replacé dans le contexte de l'article 2279 du Code civil qui n'aurait pas dû, répétons le, s'appliquer à la restitution de sommes d'argent. On ne peut cependant déduire de ce constat une critique à l'encontre de l'arrêt : en effet, les parties avaient elles-mêmes accepté ("contra legem" en quelque sorte) l'application de la disposition, et la Cour de cassation devait demeurer dans le cadre de la cause juridique qui lui était soumise, dans les limites du pourvoi, sans pouvoir soulever une violation de l'article 2279, à partir du moment où cette disposition n'est pas d'ordre public, que l'on était en matière civile et que les parties en avaient admis l'application.
(45) Cass., du 20 novembre 1964 - affaire Moens
La particularité de cet arrêt justifie qu'on l'isole de l'évolution que nous venons de voir, classée chronologiquement. Une indivision ordinaire avait existé, portant sur la communauté née entre les époux Moens. L'épouse étant décédée, une seconde indivision ordinaire était née entre le père survivant, Mr. Ludovic Moens, et ses enfants, héritiers de leur mère. Mr. L. Moens avait par la suite consenti par contrat à sa fille, Mme I. Moens, et à son gendre Mr. De Coninck, une servitude de passage s'exerçant sur un bien de la succession. Mr. L. Moens et sa fille n'avaient toutefois pas respecté la règle de l'unanimité et n'avaient pas pris l'accord des autres héritiers indivisaires au sujet de cet acte de disposition. L. Moens décéda lui-même. Il y eu donc deux indivisions successorales successives : 1) la première issue du décès de Mme Moens, existant entre M. Moens et les héritiers du couple, et à l'occasion de laquelle M. L. Moens avait consenti la servitude à sa fille sans obtenir l'accord des autres héritiers copropriétaires ; et 2) la seconde découlant du décès de M. Moens. Le litige naquit ultérieurement, les consorts I. Moens-De Coninck agissant pour faire reconnaître leur droit de servitude conventionnelle, et les autres héritiers copropriétaires contestant la validité de cette servitude qui avait été octroyée par leur auteur en violation de la règle de l'unanimité dans le cadre de la succession de leur mère. Comment trancher ce différend : fallait-il privilégier la qualité d'héritier et d'ayant droit des parties défenderesses, tenues de respecter le droit conféré par leur auteur M. Moens (cfr. art. 1122 du Code civil), ou bien leur qualité de copropriétaire leur permettant d'attaquer personnellement l'acte litigieux pour non-respect de la règle de l'unanimité par ce même M. Moens ? En d'autres termes, il existait un conflit de qualités dans le chef des héritiers, défendeurs à l'action, entre : 1) leur qualité d'ayant droit et 2) leur qualité de copropriétaire. La décision de fond a déclaré la prétention à la servitude conventionnelle de Mme I. Moens et de son mari non fondée au motif que : "malgré leur qualité d'héritiers du vendeur, les défendeurs ne sont pas tenus de respecter le droit de passage établi par leur auteur et copropriétaire". C'était donc faire prévaloir la qualité de copropriétaire sur celle d'ayant droit en constatant implicitement le non-respect de la règle de l'unanimité. Pourvoi des consorts De Coninck-I. Moens, qui ont invoqué notamment la violation de l'article 1122 du Code civil au motif que les défendeurs étaient tenus de respecter le droit consenti par leur auteur, en leur qualité d'ayant droit de ce dernier. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation, après avoir relevé que le fonds servant faisait partie de la communauté conjugale existant entre Mr. L. Moens et son épouse, et que les défendeurs en avaient acquis la copropriété suite au décès de leur mère, avant que ne fût établie la servitude, a décidé que : "si postérieurement à cet acte, ils sont aussi devenus héritiers de leur père, il ne s'ensuit pas nécessairement que, par application de l'article 1122 du Code civil, tous les actes de ce dernier, et notamment l'établissement de la servitude litigieuse, leur soient opposables ; attendu, en effet, que les ayants cause universels ne sont pas liés par les actes de leur auteur, lorsqu'ils peuvent invoquer contre cet acte un droit propre que leur confère la loi et auquel l'acte de cet auteur porte atteinte ; que tel est le cas en l'espèce, puisque l'article 577bis, § 6, du Code civil accordait aux demandeurs le droit d'ignorer la servitude établie sans leur concours, par leur auteur, sur le fonds indivis ; attendu qu'il en résulte que la servitude litigieuse est inopposable aux défendeurs et qu'il est dès lors, sans intérêt d'examiner si l'auteur des parties pouvait s'exonérer de toute garantie relativement à une servitude qu'il n'a pu consentir sans le concours des copropriétaires". Si la référence à une inopposabilité est convaincante et meilleure que celle qui renvoyait à un défaut de "validité", trouvée dans l'arrêt précédent, on peut s'interroger sur le fondement de la solution retenue, à savoir la notion de droit propre, qui aurait pour conséquence que le droit à faire valoir la règle de l'unanimité, sur le fondement de la qualité de copropriétaire, serait précisément "propre" au copropriétaire lésé par le non-respect de la règle de l'unanimité, et devrait prendre le pas sur la qualité d'ayant droit. Selon le professeur M. Hanotiau, ce concept de "droit propre" utilisé par la Cour serait critiquable car il relèverait du droit des successions et renverrait notamment au droit des héritiers réservataires de faire valoir leur réserve afin d'obtenir la réduction de libéralités faites par le défunt et qui porteraient atteinte à la réserve. Rien de tel dans notre espèce et la transposition de la notion de droit propre dans le droit de la copropriété serait "déroutante" et peu convaincante. Elle serait une pétition de principe, et serait aussi peu fondée ou à tout le moins inexpliquée, la décision de privilégier le droit propre par rapport à la qualité d'héritier. Nous ne partageons pas cette analyse. La notion de droit propre vient ici non du droit des successions mais du droit des obligations, en vertu duquel un ayant cause est tenu pas les actes de son auteur, selon l'article 1122 du Code civil, sauf lorsqu'il peut invoquer un droit propre précisément. C'est exactement ce qui s'était passé dans cette espèce. Les héritiers n'étaient pas tenus par les actes de leur père à partir du moment où ils pouvaient invoquer leur droit propre de contester l'acte litigieux en vertu de la règle de l'unanimité. Il faut donc ne plus critiquer de l'arrêt sur ce point. Reste que l'on peut se demander ce que devient par ailleurs, dans ce système, le droit contractuel du tiers à la copropriété, lésé et évincé ? Il n'est pas répondu à cette question dans le système de l'arrêt, mais elle n'était pas posée directement à la Cour, de sorte qu'à nouveau l'on ne peut en déduire une critique de l'arrêt. Il est vrai aussi que Mme I. Moens était elle-même à la fois héritière et copropriétaire et qu'en cette dernière qualité, elle était censée savoir qu'elle devait respecter la règle de l'unanimité et obtenir raccord des autres indivisaires au moment de la constitution de la servitude de passage. Elle pouvait donc difficilement plaider la responsabilité de son co-contractant, liant les héritiers de ce dernier, en raison de la faute qu'elle avait elle-même commise.
(117) Cass., du 17 novembre 1883
Monsieur Dupriez a occupé un bâtiment d'école en tant que détenteur. Il n'avait pas la qualité de locataire. Le bâtiment en question fut d'abord la propriété du bureau de bienfaisance de la Commune d'Essen puis fut vendu à cette dernière. Monsieur Dupriez, qui fut amené à quitter les lieux, dirigea une action contre le bureau de bienfaisance et la commune, en remboursement des dépenses d'aménagements divers qu'il avait engagées dans le bâtiment. Son action fut accueillie sur le fondement de la première règle générale de l'article 555. Le bureau de bienfaisance et la commune critiquèrent cette décision, par un pourvoi en cassation, en soutenant qu'elle avait méconnu la notion de "tiers" déterminant le champ d'application de la règle générale : le "tiers" ne pouvait être un détenteur et la règle générale s'appliquait en réalité au cas du possesseur de mauvaise foi (que n'était pas Monsieur Dupriez), par opposition à la règle spéciale applicable au possesseur de bonne foi. On perçoit immédiatement que cette argumentation était quelque peu boiteuse et tendancieuse, et que la notion de "tiers" devait être plus généralement entendue, en comprenant le cas du détenteur. C'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation qui a par conséquent rejeté le pourvoi. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : L'arrêt est précédé des importantes conclusions du ministère public. Celles-ci rappellent notamment le fondement d'équité de l'article 555 et l'histoire de la disposition remontant à l'ancien droit. Notons que dans l'Ancien droit, et comme l'écrivait Dornat, le fermier, qui avait la qualité de locataire, avait le droit d'obtenir le remboursement de ses améliorations, de la part du propriétaire du fonds. Une importante référence est faite par le premier avocat général aux travaux préparatoires du Code civil. Ces derniers indiquent assez clairement la manière dont il faut comprendre l'article 555 et ses deux règles. Voici comment l'avocat général résume le processus d'élaboration de l'article 555 : "la première rédaction du projet s'arrêtait à la phrase finale (se trouvant à la fin de la règle générale), et c'est à la demande du Tribunal, qu'une exception à la règle générale fut introduite en faveur de celui qui, ayant joui de bonne foi, animo domini, a fait les constructions sur un sol qu'il croyait à lui. La loi attache tant de faveur à la bonne foi qu'elle lui laisse les fruits qu'il a perçus ; il serait donc contre les principes de le traiter avec la même sévérité que l'individu dont la jouissance est entachée de mauvaise foi. II ne doit pas perdre ses dépenses. Dans cette vue, le Tribunal proposa d'obliger le propriétaire à lui payer ou le prix des matériaux et de la main d'oeuvre, ou la plus-value du fonds". Il en résulte que le mot tiers, dans l'article 555, revêt deux acceptions bien distinctes. Dans toute la première partie et jusqu'au mot "néanmoins", il s'entend de quiconque a détenu le fonds, par opposition au propriétaire : ainsi, le détenteur précaire, le locataire et autres qui n'ont pas possédé pro suo, anima domini. Dans la partie finale, au contraire, et grâce à l'amendement du Tribunal, une position meilleure est réservée au possesseur juridique, en voie "d'usucaper" ; celui-ci a fait acte de propriétaire, il ne peut être tenu à enlever les constructions faites par lui". Reste la question de savoir si l'on peut appliquer l'article 555, dans sa règle générale, lorsqu'il existe un lien contractuel ou une relation quasi-contractuelle entre parties. Le ministère public émet ici un avis négatif, sans véritablement justifier cette opinion, du moins à la lumière des travaux préparatoires du Code qui ne contiennent pas expressément cette restriction, et en s'inspirant sans doute de l'enseignement de Laurent à l'époque. La Cour de cassation a suivi l'avis du ministère public, au terme d'une motivation très complète que l'on peut présenter comme suit, en émettant l'un ou l'autre commentaire plus spécifique : 1) point de départ de l'arrêt : dans un premier attendu, la Cour rappelle la question qui se posait en la cause ; il s'agissait de statuer au sujet de travaux opérés par le sieur Dupriez dans le bâtiment des demanderesses en cassation, qui n'avaient pas "fait l'objet de conventions expresses ou tacites entre les parties" ; "par suite, le défendeur se trouve dans la situation d'un tiers, constructeur d'ouvrages sur le fonds d'autrui, réglée par les trois premiers paragraphes de l'article 555 du Code civil". Commentaires : (i) la définition du "tiers" au sens de l'article 555, est pertinente : il s'agit d'un sujet de droit qui a été constructeur sur le fonds d'autrui ; (ii) la Cour annonce une prise de position dans le sens de l'application de la règle générale de l'article 555 ; 2) prémices du raisonnement : "attendu que, dans le cas constaté également pour l'espèce, par le jugement attaqué, où le propriétaire use du droit de retenir les constructions faites par le tiers, il doit à celui-ci le remboursement de ses impenses ; que cette obligation n'est soumise à aucune condition autre que celle indiquée ci-dessus, à savoir que les travaux opérés par le constructeur sur le terrain d'autrui n'aient pas fait l'objet d'un contrat ou d'un quasi-contrat faisant la loi entre les parties". Commentaires : (i) "impenses" s'entend bien sûr au sens large de dépenses ; (ii) la Cour pose cette condition présentée comme unique au sujet de laquelle nous réservons notre commentaire, que l'article 555 ne s'applique qu'à défaut de contrat ou de quasi-contrat faisant la loi des parties ; il faudra revenir sur ce point important ; 3) confirmation de l'application de la règle générale au détenteur : "qu'on ne saurait donc, comme le pourvoi le soutient, exiger, en outre, du tiers, constructeur qui réclame l'application de l'article 555, § 3, la preuve de sa possession juridique du fonds sur lequel il a opéré, dans les termes des articles 2228 et 11 du Code civil" ; qu'en effet, le texte de l'article 555, dans sa disposition principale, ne fait aucune distinction entre les tiers constructeurs qui auraient la possession du fonds et ceux qui n'auraient pas cette possession ; que, du reste, l'obligation imposée au propriétaire, dans le cas où il retient les ouvrages, est uniquement motivée par le principe d'équité que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui et que l'application de ce principe est également justifiée à l'égard de tous les constructeurs, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas la possession ; attendu, il est vrai, que, dans sa partie finale, l'article 555 prévoit le cas où le tiers constructeur a la possession du fonds dans les termes de l'article 550, mais que cette partie de l'article 555, ajoutée après coup, sur l'initiative du Tribunal, constitue une exception au principe général admis par le premier paragraphe du dit article et a pour but d'accorder, pour des motifs spéciaux, des droits plus étendus au tiers constructeur qui peut, en outre, établir sa qualité de possesseur de bonne foi. Commentaires : ces attendus sont convaincants et la référence au principe de l'enrichissement sans cause opère comme un rappel indirect du principe d'équité qui sous-tend l'ensemble de l'article 555, mais n'implique pas une application directe dudit principe ; 4) conclusion en la cause : "que de ces considérations il suit que le jugement attaqué a pu, sans contrevenir à l'article 555 du Code civil, condamner les demanderesses à rembourser au défendeur ses frais et impenses et que le premier moyen n'est pas fondé". Les enseignements à déduire de cet arrêt, concernant le champ d'application de l'article 555, sont les suivants : 1) il se confirme que la règle spéciale de la fin de l'article 555 s'applique au possesseur de bonne foi tandis que la règle générale s'applique au cas du possesseur de mauvaise foi et du détenteur (toute autre personne que le possesseur de bonne foi). 2) une restriction importante toutefois est faite quant à l'application de l'article 555 : ce dernier s'applique à la condition que "les travaux opérés par le constructeur sur le terrain d'autrui ne doivent pas avoir fait l'objet d'un contrat ou d'un quasi-contrat faisant la loi des parties". C'est ce qui expliquerait implicitement, dans le raisonnement de la Cour de cassation, l'utilisation du terme "tiers" par l'article 555 : le constructeur n'est plus un "tiers", lorsqu'il n'a pas construit sur le fonds "d''autrui", mais a construit sur le fonds de son cocontractant, ou de son "quasi-cocontractant", à savoir un sujet de droit auquel il est lié par contrat un acte juridique ou quasi-contrat, et qui n'a donc pas la qualité "d'autrui", pour lui ; on ne lui appliquerait pas alors l'article 555 ; 3) notons que la Cour de cassation, en exprimant ce principe, ne se base ni sur l'ancien droit ni, véritablement, sur les travaux préparatoires du Code civil qui n'abordent pas directement ce point. La Cour suit le ministère public et à travers lui, semble-t-il, l'enseignement de François Laurent qui faisait autorité à l'époque ; 4) découle de cette mise en évidence des principes, la conclusion importante suivant laquelle l'article 555, dans sa règle générale, ne devrait pas s'appliquer à la situation du locataire et aux travaux faits par ce dernier en cours de bail dans les lieux loués, susceptibles d'enlèvement. C'est ce que la Cour de cassation semble avoir confirmé, comme on va le voir, en décidant qu'il fal1ait appliquer au locataire la théorie de l'enrichissement sans cause et non l'article 555 dans sa règle générale.
(48) Cass., du 05 octobre 2000 - affaire Agydel
Un syndic, ayant pris la forme d'une société anonyme dénommée Agydel, avait lancé une action en justice contre un copropriétaire, en récupération de frais dus à la copropriété, qui étaient des "frais privatifs". Il ne s'agissait donc pas de charges communes mais de frais résultant de travaux de renouvellement des parkings dans l'immeuble concerné, qui avaient été financés grâce au fonds de roulement de l'association, chaque copropriétaire devant ensuite rembourser sa part, à caractère privatif. Il avait été fait droit à cette action en première instance, à concurrence d'un montant principal de 164.908 FB augmenté de différents accessoires. Le tribunal civil de Bruxelles réforma toutefois en degré d'appel la décision entreprise et condamna la S.A. Agydel à rembourser toutes les sommes qu'elle avait perçues en exécutant de façon provisoire la décision de première instance. L'action intentée par cette société a ainsi été déclarée irrecevable. Pour justifier cette irrecevabilité, la tribunal releva que la S.A. Agydel n'avait pu faire valoir un "mandat exprès" afin d'agir en justice. Pour le tribunal, le syndic avait postulé un paiement strictement privatif. Certes, l'article 577-8, § 4, 6) prévoit que le syndic est chargé de représenter l'association en justice, mais l'article 34 de l'acte de base de la copropriété concernée n'habilitait la S.A. Agydel à agir que pour recouvrer des frais généraux, à savoir essentiellement les charges communes. En dehors de ce mandat général donné par l'acte de base, la S.A. Agydel devait donc, selon le tribunal, bénéficier d'un mandat exprès l'habilitant à agir en justice pour récupérer des frais privatifs, ce qui n'était pas le cas, son action devant par conséquent être déclarée irrecevable. La S.A. Agydel s'est pourvu en cassation et fit valoir la violation des articles 577-9, § 1er (qualité de l'association pour agir en justice), 577-8, § 4, du Code civil (représentation de l'association par le syndic pour agir en justice), ainsi que de l'article 703 du Code judiciaire, prévoyant que les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes. Selon le moyen, le syndic est de façon générale l'organe légal de l'association, compétent notamment pour représenter celle-ci dans les actions en justice. Il était dès lors indifférent que les frais que le syndic cherchait à récupérer en l'espèce soient communs ou privatifs. La décision de fond n'était donc pas légalement justifiée en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action litigieuse parce qu'elle portait sur des frais dits privatifs. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a fait droit au pourvoi en cassation en se basant sur les termes des articles 577-9, § 1er et 577-8, § 4, 6°. La haute juridiction aurait sans doute pu ajouter une référence à l'article 703 du Code judiciaire, qui éclairait le rôle du syndic en tant qu'organe légal de l'association. Nous pouvons déduire de l'arrêt "Agydel'' que le syndic est l'organe de représentation de l'association et non un simple mandataire. La distinction entre son rôle plein et entier d'organe et celui de simple mandataire, qu'il n'est pas, engendre d'importantes conséquences : 1) puisqu'il est organe, le syndic ne doit pas justifier vis-à-vis des tiers d'un mandat exprès (procuration sur la base d'une décision expresse de l'assemblée générale) ; la seule preuve de sa désignation en tant que syndic suffit en principe ; 2) les pouvoirs de représentation de l'organe-syndic ne peuvent en principe être limités par les statuts ou par un contrat ; ces pouvoirs sont en effet issus directement de la loi, laquelle est, qui plus est, impérative ; 3) puisque l'association agit par l'intermédiaire de son organe-syndic, son bras directement opérationnel en justice en quelque sorte, les fautes extra-contractuelles de ce syndic, vis-à-vis des tiers, sont celles directement imputables à l'association (qui pourra se retourner contre le syndic, le cas échéant) ; la faute du syndic est donc celle de la personne morale elle-même qu'est l'association ; le syndic engagera par ailleurs sa responsabilité en tant qu' organe dans les conditions limitées du cumul ou de la coexistence des responsabilités à l'égard d'organes de sociétés ou associations.
(123) Cass., du 10 juillet 1957 - affaire Mertens
Un usufruit avait été consenti par donation dans un contrat de mariage, portant sur deux maisons (rune sise à Anderlecht et l'autre à Saint Gilles), par Mr. Jules Pontus à son épouse, Mme Catherine Mertens, dans l'hypothèse où cette dernière survivrait. Le nu-propriétaire initial était le frère de Jules Pontus. Félix Pontus, mais ce dernier avait cédé sa nue-propriété à des tiers, les époux Gyselinck-Vandesanden, qui l'avaient acquise dans un but quelque peu spéculatif. Ils spéculaient sur le décès à venir de Mme Catherine Mertens, pour qui l'usufruit était essentiellement alimentaire. Comme l'écrivait le Professeur M. Hanotiau : "à la décharge (si on peut dire) des consorts Gyselinck-Vandesanden, il faut noter qu'au moment de la cession de la nue-propriété par Félix Pontus, en 1933. Catherine Mertens, âgée de 61 ans, avait selon les tables de mortalité qui avaient été consultées pour le calcul du prix de la vente, une survie probable de treize ans ; il est facile de calculer qu'au moment où l'arrêt a été rendu, elle avait atteint (à un mois près) l'âge de 85 ans (tandis que Mme Vandesanden était décédée dans l'intervalle)". La situation était donc proche de celle du film "Le Viager", et l'on voit ainsi que l'usufruit est essentiellement aléatoire en tant qu'il implique une chance de gain ou de perte pour l'usufruitier et le nu-propriétaire résultant des aléas liés à la vie et l'espérance de vie de l'usufruitier. Le litige découla de l'absence de volonté des consorts Gysclinck-Vandesanden d'effectuer les grosses réparations dans les deux maisons concernées, réparations qui étaient devenues indispensables. Mme Catherine Mertens lança une action contre eux en exécution des grosses réparations. Mais le pouvait-elle alors que, dans la thèse traditionnelle l'usufruitier est dépourvu d'une telle action en raison du caractère réel du droit d'usufruit ? La cour de Bruxelles, par cet arrêt du 10 juillet 1957, répondit positivement à cette question, contrairement à la décision de première instance. Elle le fit à la suite d'une longue motivation. d'avant-garde sur certains points mais qui n'est pas convaincante dans tous ses éléments de motivation. L'arrêt de la Cour d'appel contient les arguments suivants, qu'il oppose à la thèse traditionnelle concluant à l'absence d'action : 1) d'abord, l'arrêt insiste sur le caractère alimentaire de l'usufruit en la cause, Mr. Jules Pontus ayant eu l'intention "d'assurer" à son épouse "de pouvoir continuer à vivre ainsi qu'elle avait l'avait fait avec son conjoint" grâce à l'usufruit, or ce n'était plus le cas si l'on ne permettait pas à Mme Mertens de contraindre les nu-propriétaires à effectuer les grosses réparations. Commentaire : cet élément d'opportunité est important mais il ne constituait pas un véritable argument en droit ; 2) le contrat de cession de l'usufruit au consorts Gyselinck-Vandesanden contenait une clause renvoyant expressément aux articles 605 et 606 du Code civil, et les acquéreurs de la nue-propriété ne pouvaient pas avoir plus de droits que leur vendeur (le sieur Félix Pontus). Commentaire : certes, mais ces considérations ne réglaient pas la question technique de savoir si l'usufruitier disposait d'une action contre le nu-propriétaire, et surtout comment justifier une telle action, sauf pour la cour à préciser que l'action était devenue contractuelle, car elle avait été voulue et organisée paries parties, au bénéfice de l'usufruitier, ce qui ne semblait pas être le cas, les parties s'étant contentées d'une référence aux articles 605 et 606 ; 3) la cour fit également référence à la nécessaire égalité devant régner entre usufruitier et nu-propriétaire, vidée de contenu en cas d'absence d'action de l'usufruitier contre le nu-propriétaire : admettre que le nu-propriétaire ne pourrait pas être contraint à exécuter les grosses réparations, alors que l'usufruitier est "tenu" aux réparations d'entretien en vertu de l'article 605 du Code civil, impliquerait que l'on considère que "le législateur aurait entendu consacrer entre le propriétaire et l'usufruitier une inégalité telle de leur situation juridique respective que le premier disposerait seul d'une action judiciaire contre le second, alors qu'au contraire, celui-ci n'en aurait aucune contre celui-là". Commentaire : peut-être est-ce le cas de lege ferenda", mais précisément le Code civil n'a pas prévu une action au profit de l'usufruitier alors qu'il a organisé une telle action au profit du nu-propriétaire en rapport avec les charges d'entretien, qui font l'objet d'une obligation réelle de l'usufruitier ; 4) enfin, et c'est sans doute l'argument le plus convaincant, ou le moins faible en tout cas, la cour fit référence à l'article 599, alinéa 1er, du Code civil; en vertu de cette disposition : "le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de I'usufruitier" ; dès lors, pour la cour d'appel, les nu-propriétaires ne pouvaient nuire l'usufruitière en n'exécutant pas les grosses réparations, et ils furent condamnés à rembourser à la dame Mertens, les frais qu'elle avait exposés dans le cadre de ces réparations. Au total, voici un bel arrêt mais dont l'argumentation, sur le plan technique, n'est pas totalement convaincante et ne rencontre pas l'argument de l'absence d'action, il est vrai difficilement parable.
(42) Cass., du 09 juin 1978
Une action en réduction de la durée d'un bail a été introduite par certains copropriétaires mais non par tous. La partie défenderesse a invoqué, semble-t-il, le non-respect de la règle de l'unanimité. La décision de fond a écarté cette défense au motif que : "en l'espèce, conformément à l'article 577bis, § 5, alinéa 2, du Code civil, chaque copropriétaire peut agir seul", ce qui revenait à qualifier l'action en justice litigieuse d'acte conservatoire ou d'administration provisoire. Tel n'était manifestement pas le cas à nouveau, et la partie déboutée de sa défense a invoqué la violation de l'article 577bis, § 6, du Code civil, au motif qu'une action en réduction de la durée d'un bail constituait un acte d'administration au sens de cet article. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rendu à l'occasion de cette affaire un arrêt de principe qui éclaire la compréhension globale que l'on peut avoir de ce type de litige, et ce comme suit : 1) "tout comme la résiliation d'un bail, l'introduction d'une action en réduction de la durée du bail n'est ni un acte conservatoire du bien, ni un acte d'administration provisoire, au sens de l'article 5 77bis, § 5, qui peut être accompli par un seul copropriétaire" ; 2) suit une définition générique des actes conservatoires et des actes d'administration provisoire : "en effet l'action en réduction du bail ne vise pas à protéger la chose ou ses fruits contre des événements soudains ou passagers ou à ne pas se laisser perdre des avantages soudains ou passagers, mais vise à modifier la durée des droits sur la chose et notamment à y mettre fin anticipativement d'une manière qui intéresse les autres copropriétaires, qui désirent éventuellement maintenir le bail originaire" ; 3) il y a lieu ensuite à un rappel du premier principe posé par l'arrêt du 4 décembre 1941 : "le preneur ne pourrait certes sur la base de l'article 577bis, § 6, contester la validité du bail concédé par un des copropriétaires" ; 4) mais un important tempérament à ce principe est également exprimé : "toutefois, à l'égard du preneur le caractère indivisible du bail empêche qu'un copropriétaire puisse valablement demander la réduction de la durée du bail sans appeler les autres copropriétaires à la cause", d'où la cassation qui est finalement prononcée sur ces bases à l'encontre de la décision attaquée. Cet arrêt important assure une certaine conciliation entre les arrêts précédents de 1941 et de 1951, en ce sens : 1) certes, le "tiers" à la copropriété ne peut en principe invoquer directement le non-respect de la règle de l'unanimité pour contester la validité et plaider la nullité de l'acte qu'il a conclu avec un copropriétaire (l'acte est pleinement valable entre parties), ou d'un acte subséquent accompli seul par un tel copropriétaire à son égard ; 2) si le "tiers" ne peut invoquer le non-respect de la règle de n'unanimité pour plaider la nullité de l'acte, par exemple d'un bail, il me semble qu'il peut invoquer la violation de la règle pour plaider l'irrecevabilité de l'action qui ne l'a pas respectée ; 3) il convient aussi d'analyser les actes en question et leurs effets au regard du "droit commun" (cfr. arrêt de 1941), or il est un principe, tant du droit commun des obligations et des contrats que de droit judiciaire privé ( cfr. art. 31 et 1053 du Code judiciaire), qu'un acte ou une action à caractère indivisible doit impliquer toutes les parties concernées par cet acte ou action, aussi bien pour le/la faire naître que pour en modifier les effets ou y mettre fin ; 4) c'est donc en vertu de cette indivisibilité du bail en l'espèce, et de l'action subséquente, qui touchent au droit commun, et non du régime de la copropriété, que le preneur a pu critiquer la validité de l'acte accompli par un copropriétaire, sans que les autres indivisaires aient été parties à cet acte, ou à tout le moins qu'ils aient été appelés à la cause pour le ratifier, le cas échéant ; 5) en conclusion : le "tiers" à la copropriété qu'est le locataire ne peut invoquer directement le non-respect de la règle de l'unanimité, comme la Cour de cassation l'a décidé en 1941, pour plaider la nullité de l'acte (par exemple un bail), mais il peut invoquer, conformément au droit commun, le non-respect de l'indivisibilité de l'acte accompli par un seul alors qu'il aurait dû impliquer toutes les parties concernées. Ce raisonnement est cohérent. On relèvera que la Cour de cassation a examiné la nature de l'acte au regard du droit de la copropriété, et que c'est en raison de la déficience de qualification à cet égard, qui entachait la décision de fond (l'acte étant d'administration et non conservatoire ou d'administration provisoire), que cette dernière a été en définitive cassée. Sans doute est-ce parce que si le "tiers" ne peut plaider l'absence de validité substantielle de l'acte litigieux pour non-respect de la règle d'unanimité, il peut plaider l'irrecevabilité de l'action qui serait un acte d'administration ou de disposition, sur le terrain du droit judiciaire.
(161BIS) Cass., du 18 mai 2007
Une rampe flottante dite "Ro-Ro" a été installée au Port d'Anvers, le long de l'Escaut, pour permettre le chargement et le déchargement de containers sur des bateaux dans le cadre d'un terminal de containers. Cette rampe a été construite lors d'une première concession sur le domaine public, consentie par la Région flamande à la Ville d'Anvers. Une seconde concession a ensuite été conclue entre la Ville d'Anvers et un exploitant dénommé "Hesse-Noordnatie". Il s'agit sans doute du constructeur de la rampe. Concrètement, la rampe est une forme de long radeau flottant sur I'Escaut, ancré dans les murs à quais. Les concessions de domaine public portaient sur les zones de quais et aux alentours, là où était situé le terminal, mais non spécifiquement sur la zone où se trouvait la rampe, qui empiétait donc sur l'Escaut, bien du domaine public de la Région flamande. Il semble qu'il découlait du système de concessions, une renonciation à l'accession, car le concessionnaire avait été autorisé à construire la rampe sur l'Escaut et en était en principe propriétaire. S'était donc réalisée la construction d'un bien immobi1ier (la rampe RoRo), portant sur le domaine public (l'Escaut). Mais était-ce possible ? La constitution d'un droit de superficie est-elle légale lorsqu'elle porte sur un bien du domaine public ? N'est-elle pas contraire au régime de la domanialité publique ? Si une réponse positive était apportée à cette question, les conséquences de l'application de la loi sur la superficie s'enchaînaient comme suit, de façon sans doute assez surprenante pour les parties qui ne les avaient pas prévues dans leur convention de concession : 1) la superficie avait une durée limitée à 50 ans ; 2) au terme de 50 ans, l'accession se produisait avec obligation pour le tréfoncier de payer une indemnité au superficiaire en application de l'article 6 de la loi (outre le droit de rétention du superficiaire). Si une réponse négative était apportée à cette question, c'était l'article 555 qui pouvait s'appliquer, dans sa règle générale, ou plus vraisemblablement la théorie de l'enrichissement sans cause car le superficiaire n'était pas un tiers par rapport à la personne publique concédante. Dans cette magnifique affaire en tous points remarquable, se croisaient ainsi des questions touchant à la domanialité publique, à l'accession et à la superficie, plus précisément une superficie qui découlait d'une renonciation à l'accession. La cour d'appel d'Anvers a accordé à la société "Hesse-Noordnatie" une indemnité à charge de la Région flamande, à concurrence de + ou - 1.300.000 euros, sur le fondement de l'article 555 du Code civil. Il semble que la cour ait appliqué la règle générale posée par cet article, puisqu'elle a observé que la Région flamande n'avait pas obligé la concessionnaire à démolir la rampe à ses frais (non-exercice du droit de demander l'enlèvement du propriétaire du fonds: premier choix possible en vertu de l'article 555, règle générale). Il s'imposait selon la cour d'appliquer la règle générale car la société concessionnaire pouvait être qualifiée de codétentrice du bien, et non de possesseur de bonne foi. La Région ayant conservé la rampe, elle en était en principe devenue propriétaire par l'accession différée de l'article 555. Elle devait en conséquence "indemniser la société des frais exposés par elle", d'où la condamnation de la Région à payer une lourde indemnité de 1.304.391,98 euros en principal, outre les intérêts et les dépens. Mais la cour d'appel décida aussi que la superficie n'était pas possible sur un bien du domaine public, et que la renonciation à l'accession n'était pas certaine en l'espèce (ce deuxième point est moins clair, mais l'argument de l'absence de superficie avait été invoqué par la société concessionnaire). La Région flamande s'est pourvue en cassation. Sans doute l'indemnité qu'aurait pu demander le superficiaire en vertu d'une superficie aurait été moindre, à savoir : - une indemnité à concurrence des frais de constructions (main d'œuvre et matériaux), d'un côté, dans le cadre de l'article 555, règle générale ; - ou une indemnité équivalente à la "valeur actuelle" de la rampe, de l'autre, en application de l'article 6 de la loi sur la superficie. Dans son moyen, la Région flamande a soutenu une conception large de la domanialité publique permettant l'octroi de droits réels, dont la superficie, sur des biens du domaine public, pour peu qu'ils ne soient pas incompatibles avec la finalité de domaine public du bien en question. Or, en l'espèce, l'octroi d'un droit de superficie, suite à une renonciation à l'accession, s'exerçant sur Je côté du fleuve Escaut et en vertu duquel la rampe litigieuse avait été construite, n'était pas incompatible avec le caractère de domaine public du fleuve. Le juge du fond avait dès lors eu tort de décider le contraire et de considérer que la superficie n'était pas valable. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a fait droit au moyen et a cassé la décision de fond par cet excellent arrêt de principe, dont la motivation est tout à fait complète et exprime, de façon très didactique, le raisonnement de la Cour, en débordant même la question strictement posée• Cette motivation est la suivante, numérotée par la Cour elle-même : "1) aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie, le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Aux termes de l'article 4 de la même loi, le droit de superficie ne pourra être établi pour un terme excédant cinquante années, sauf la faculté de le renouveler. Aux termes de l'article 6 de la même loi, à l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations passe au propriétaire du fonds, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu'au remboursement, aura le droit de rétention. 2) au sens de la loi précitée, le droit de superficie constitue une dérogation temporaire aux articles 552 et 553 du Code civil relatifs à l'accession, qui posent en règle que toutes constructions, ouvrages et plantations appartiennent au propriétaire du sol. 3) un bien constitue une dépendance du domaine public du fait qu'en raison soit d'une décision explicite soit d'une décision implicite des pouvoirs publics, il est destiné à l'usage de tous sans distinction entre les personnes. En vertu de l'article 538 du Code civil, les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et, généralement, toutes les portions du territoire belge qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. 4) si un bien constitue une dépendance du domaine public il est ainsi destiné à l'usage de tous; nul ne peut dès lors, acquérir un droit privé pouvant constituer un obstacle à cet usage et porter atteinte au droit des pouvoirs publics de le réglementer à tout moment, eu égard à cet usage. 5) toutefois, dans la mesure où un droit privé de superficie ne fait pas obstacle à la destination précitée, il peut être établi sur un bien du domaine public. 6) en considérant, sans faire une distinction, qu'un droit de superficie ne peut être exercé sur le domaine public, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision". Je ferai deux brefs commentaires au sujet de cet arrêt tout à fait convaincant : 1) d'abord, il eût été sans doute meilleur de faire référence à l'affectation du bien au domaine public, plutôt qu'à sa destination. C'est en effet l'affectation du bien, par décision de l'autorité compétente, qui lui confère sa destination de bien du domaine public; l'une est la cause de l'autre, mais cette précision touche à un détail et à un raccourci du raisonnement ; 2) ensuite, l'on voit que la portée de l'arrêt dépasse l'octroi d'un droit de superficie sur un bien du domaine public : c'est tout "droit privé", personnel ou réel, de jouissance essentiellement, qui est visé et peut être octroyé, pour peu qu'il ne porte pas atteinte à la destination de service public du bien. Quant aux droits personnels, ils prendront la forme de concessions publiques à caractère précaire. Est en revanche exclue la cession d'un droit de propriété, non temporaire, qui porterait définitivement atteinte au statut de domanialité publique du bien en question. La Cour de cassation consacre ainsi une conception de la domanialité publique qui est dynamique et susceptible de rencontrer les besoins de la pratique. On ne peut qu'approuver cette vision des choses permettant au droit privé de faire vivre le droit public et le droit administratif. Complétons enfin notre analyse de l'article 6 de la loi par celle de l'article 7 qui s'applique aux constructions n'appartenant pas au superficiaire. Il est logique que le régime de cette disposition soit en quelque sorte l'opposé de celui découlant de l'article 6. Article 7 : accession sans indemnité et droit de rétention pour les autres types de constructions restés la propriété du tréfoncier : "si le droit de superficie a été établi sur un fonds sur lequel se trouvaient déjà des bâtiments, ouvrages ou plantations dont la valeur n'a pas été payée par l'acquéreur, le propriétaire du fonds reprendra le tout à l'expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité pour ces bâtiments, ouvrages ou plantations". Qu'en est-il par ailleurs du sort des charges affectant la propriété superficiaire (telles qu'une affectation hypothécaire), ou autres droits réels ou personnels octroyés par 1e superficiaire, à la fin de la superficie ? Ils prendront :fin en principe de plein droit puisqu'ils s'éteindront avec le droit principal de superficie. Quant aux charges et droits accordés par le tréfoncier, elles s'étendront en principe aux biens de la superficie devenus automatiquement la propriété du tréfoncier par accession.
(150) Cass., du 17 janvier 1969
Une servitude conventionnelle prévoyait à l'origine un passage sur une largeur de 2,60 mètres et un hauteur de 2,30 mètres maximum, Le propriétaire du fonds dominant plaida que la servitude avait en réalité été exercée sur une largeur de 3 mètres et sans limites en hauteur, et qu'elle avait été exécutée en ce sens de l'accord des parties. Le juge du fond fut convaincu par cette argumentation et décida de consacrer les nouvelles modalités de la servitude au motif "qu'en l'absence d'un titre écrit ces modalités peuvent être prouvées par l'exécution donnée par les parties à leur convention verbale, ainsi que par la disposition des lieux telle qu'elle existait au moment de l'établissement de la nouvelle servitude". Le propriétaire du fonds servant attaqua cette décision en cassation en invoquant la violation des articles 686. 691, 695, 1315 et 1341 du Code civil (première branche), ainsi que 1134 et 1319 à 1322 (violation de la convention-loi et de la foi attachée à la convention initiale) (seconde branche). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que : "l'article 691 du Code civil dispose que les servitudes discontinues ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre : que, hormis le cas, non applicable en l'espèce, prévu par l'article 695 dudit Code, il faut entendre par titre le fait juridique donnant naissance à la servitude, indépendamment des modes de preuve qui en constatent l'existence ; "attendu que le juge relève qu'à défaut de preuve littérale les modalités d'exercice de la servitude de passage, concernant la largeur et la hauteur de celle-ci sont prouvées par l'exécution donnée par les parties à leur convention verbale ; qu'ainsi le juge se fonde sur un aveu extra-judiciaire des demandeurs : qu'aucune des dispositions légales visées au moyen ne fait obstacle à pareil mode de preuve". La notion inexacte ici de "fait juridique" doit être bien sûr remplacée par "acte juridique" ("Rechtshandeling"), l'arrêt ayant été improprement traduit à cet égard du néerlandais, dans la Pasicrisie. Cette décision doit pour le reste être approuvée dans son ensemble et n'est qu'une application d'un raisonnement classique du droit des obligations : à défaut pour les parties d'avoir été claires dans leur acte juridique, leur volonté réelle (cfr. art. 1156 du Code civil) peut être interprétée et recherchée par le juge, après examen des éléments intrinsèques, sur la base d'éléments extrinsèques, déduits essentiellement de l'exécution donnée par elles à la convention, et pouvant faire apparaître une volonté modifiant ou précisant la convention initiale, à caractère tacite mais certain, c'est-à-dire verbale. Une interprétation du même type pourrait aussi porter directement sur l'acte écrit de base, à clarifier sur l'un ou l'autre point concernant les modalités de la servitude. Dans ce cas, serait interprété non un acte verbal ultérieur à caractère modificatif: comme dans l'affaire que nous venons d'examiner, mais l'acte originaire, obscur ou imprécis à l'un ou l'autre égard, d'où la prise en compte de l'exécution donnée par les parties à cet acte. On voit aussi à la lumière de cet arrêt, qu'en pratique, une servitude ou une modification de servitude, ainsi que l'ajout d'un terme extinctif ou d'une condition résolutoire, peuvent parfaitement résulter d'un accord verbal entre parties. Cet accord sera valable entre parties mais ne sera pas opposable aux tiers tant qu'il n'aura pas été confirmé par un acte authentique régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques en application de l'article premier de la loi hypothécaire. La Cour considère par ailleurs dans cette affaire que la volonté hi latérale d'étendre les modalités d'exercice initiales de la servitude, a fait l'objet d'une reconnaissance unilatérale de la part du propriétaire du fonds servant, sous la forme d'un aveu de nature extra-judiciaire. Pourquoi cette précision ? La Cour de cassation n'est-elle pas allée plus loin que ce qu'avait constaté le juge du fond. Ne s'est-elle pas mêlée à cet égard du fait ? Nous sommes gagnés par une certaine perplexité au moment de poser ces questions. Certes, le rappel de la constatation de l'aveu était utile car ce dernier était Je mode de preuve de l'accord modificatif de la servitude, émanant du propriétaire du fonds servant. Mais le juge du fond avait-il relevé effectivement cet aveu dans les circonstances de la cause ? La Cour de cassation semble considérer que le juge l'avait fait implicitement, mais de façon certaine, par la motivation qu'elle relève. Cela n'est point évident : si le juge avait relevé l'existence d'un accord, il paraissait ne pas avoir constaté, avec suffisamment de précision en tout cas, l'aveu permettant de rapporter la preuve de cet accord et d'échapper à l'argumentation de violation des règles de preuve littérale invoquée par le moyen. Il est vrai toutefois que le mécanisme de l'aveu en action, déduit de certaines circonstances d'une cause et du comportement des parties, est assez souvent appliqué au fond et admis par la Cour de cassation.
(144) Cass., du 07 décembre 1967 - affaire de la motocyclette
Une servitude de passage conventionnelle existant en vertu d'un acte datant du 8 avril 1841 prévoyait un passage "pour aller en toute saison, à pied et avec brouette, à la portion du fonds concerné". Le propriétaire du fonds dominant avait fait usage de la servitude en passant à pied mais en poussant une mobylette, moteur arrêté. Le propriétaire du fonds servant, particulièrement tracassier et procédurier, lança une action en justice sur le fondement de l'article 702 du Code civil en prétendant que l'autre partie avait aggravé la condition de la servitude, contrairement à cette disposition, et que la finalité de la servitude était limitée au "défruitement" du fonds dominant et n'avait donc pas été respectée. Le juge du fonds rejeta avec raison l'action car il n'y avait pas eu, selon lui, d'aggravation ni de changement de finalité en l'espèce. Le propriétaire du fonds servant se pourvut en cassation en invoquant, entre autres, la violation de la servitude, de la foi due au titre de la convention-loi et de l'article 702 du Code civil. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Il était évident que la Cour de cassation devait rejeter le pourvoi. Elle l'a fait au terme d'une motivation qui se référa aux énonciations du juge du fond, écarta sur cette base l'existence d'une volonté des parties à la servitude de limiter le but de celle-ci, le juge du fond n'ayant donc pas violé la foi duc à la convention, et conclut de la façon suivante : "c'est aussi sans méconnaître la force probante et la force obligatoire de l'acte du 8 avril 1841, et sans violer aucune des dispositions légales relatives aux servitudes, indiquées par le moyen, que le juge, après avoir souverainement constaté que le passage, sur l'assiette de la servitude, d'un piéton poussant à la main une motocyclette, moteur arrêté, ou tout autre objet insonore dont le volume n'excède pas celui d'une brouette chargée, n'est pas de nature à aggraver la condition du fonds servant, décide que pareil passage est un mode d'exercice normal de la servitude, conforme au titre constitutif de celle-ci". La formulation est belle et précise. Elle est le reflet d'une réalité entachée d'une certaine mesquinerie, mais le droit réside aussi dans les détails et les litiges de détails, qui ne devraient pas être, sont hélas légion. Les limites imparties à l'appréciation par le juge du fond du respect, dans les faits, de la servitude et de la non-aggravation de la condition du fonds dominant, sont donc évidentes et classiques. Elles résident dans : 1) la servitude elle-même (cfr. art. 63 7 et 686); 2) la convention-loi (art. 1134, al. 1er et principe général du droit du même nom) ; 3) la foi duc a la convention (cfr. art. 1317, 1319 et 1320 du Code civil en cas d'acte authentique), et 4) la règle posée par l'article 702 et la notion légale d'aggravation qui s'y trouve. Le juge du fond peut également admettre une certaine évolution du cadre de la servitude, et une adaptation aux contraintes nouvelles de la pratique après écoulement d'un certain laps de temps depuis sa conclusion, sans pour autant devoir relever une aggravation de ce1le-ci. Une interprétation téléologique du texte de la servitude, surtout en matière de servitudes anciennes, est donc admissible et n'est pas incompatible avec le titre. La recherche de la volonté réelle des parties (cfr. art. 1156 du Code civil), le cas échéant sur la base des éléments extrinsèques découlant de l'exécution donnée par elles à la convention de servitude, sera aussi éclairante et parfois déterminante.
(140) Cass., du 06 janvier 1967
Une vente immobilière était intervenue entre X et Y. Le contrat de vente du 19 août 1959 contenait une clause prévoyant que : "les acquéreurs renoncent au droit pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit d'utiliser ou de laisser utiliser comme débit de boisson le bien acheté suivant le présent acte, ce aussi longtemps que la venderesse ou le futur propriétaire exploiteront un débit de boissons dans l'immeuble contigu, qui demeure la propriété de la venderesse". Cette clause était-elle à l'origine d'une servitude réelle ou d'un droit personnel découlant d'une qualification en simple clause de non-concurrence ? La deuxième qualification paraissait de loin la plus convaincante, la clause étant en effet constitutive d'une forme de clause de non-concurrence, à caractère personnel. Elle permettait en outre d'échapper à la qualification intermédiaire de servitude personnelle, qui eût rendu la clause en principe illicite sur pied de l'article 686 du Code civil. Dans les faits, l'acquéreur Y ne respecta pas son obligation de non-concurrence de sorte qu'il fut assigné en responsabilité contractuelle par la venderesse X, laquelle exploitait encore un débit de boissons dans l'immeuble contigu. Comme on pouvait s'y attendre, Y, assigné devant le tribunal de commerce mais, avec une certaine mauvaise foi, souleva une exception d'incompétence ratione materiae en prétendant que la clause était constitutive de servitude réelle et dès lors n'était pas de la compétence du tribunal de commerce mais du juge du paix du lieu. A juste titre, tant le premier juge que la cour d'appel rejetèrent cette exception. Y se pourvut dès lors en cassation en invoquant, entre autres, la violation de la notion de servitude (article 63 7 du Code civil), de l'article 686, de la convention-loi (article 1134, alinéa 1er), et de la foi due à l'acte authentique de vente (articles 1319, 1320 et 13 22 du Code civil), outre un argument de non-réponse aux conclusions. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : A juste titre encore, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, à la suite de la motivation suivante : 1) énoncé d'un critère de distinction : "attendu que l'interdiction, imposée par le vendeur à l'acquéreur d'un immeuble, d'y exploiter une entreprise déterminée, peut être stipulée ou bien en vue de l'intérêt personnel du vendeur, auquel cas la convention fait naître une créance dans le chef de celui-ci et une obligation personnelle dans le chef de l'acquéreur ou bien en vue de l'usage et de l'utilité d'un fonds du vendeur, auquel cas elle crée une servitude" ; 2) pouvoir souverain d'appréciation du juge : "attendu qu'il appartient à l'appréciation souveraine du juge du fond de déterminer, par l'interprétation de la clause, l'objet et la nature de l'obligation, pourvu que cette interprétation ne méconnaisse pas la portée du texte légal qui définit la notion de servitude" ; 3) application au cas d'espèce : après le rappel du contenu de la clause litigieuse, la Cour a considéré que "sans méconnaître la foi due à la clause, le juge a pu décidé que l'obligation contractée par les demandeurs ne constituait pas une servitude ; qu'en reconnaissant au contrat l'effet qu'il avait entre les parties dans l'interprétation qu'il en donne, il ne viole pas l'article 1134 du Code civil ; que par sa constatation il répond de manière adéquate aux conclusions des demandeurs, et qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui de leur thèse". Le juge du fond, dans le processus de qualification et d'interprétation d'une clause à l'origine d'une servitude, est donc tenu de respecter, essentiellement : 1) la notion même de servitude réelle (cfr. art. 637 et 686 du Code civil) ; 2) la convention-loi ; 3) et la foi due à l'acte de servitude, qui est généralement un acte authentique.
(35BIS) Cass., du 25 juin 2009 - affaire de la bouteille de White Spirit
(vu ex cathedra)
(36BIS) Cass., du 15 novembre 2013
(vu ex cathedra)
(38BIS) Cass., du 08 février 2010 - affaire de l'abattage des arbres
(vu ex cathedra)
(47BIS) Cass., du 02 avril 2009
(vu ex cathedra)
(24) Cass., du 02 juin 1983 - affaire de la commune de Courcelles
Des travaux d'égouttage, entrepris en 1962, avaient engendré des dommages soufferts par les riverains. Les travaux en question avaient été commandés par la Commune de Courcelles et exécutés par la société Trajabar, entrepreneur. Les riverains Ducarme et Laurent ont intenté une action en responsabilité, notamment sur la base de la théorie des troubles de voisinage, à l'encontre de la Commune de Courcelles. Ils ont cependant été déboutés de leur action par la cour d'appel de Mons, au motif, entre autres, "qu'il n'est pas démontré qu'en décidant l'égouttage de la rue litigieuse, la commune de Courcelles a rompu l'équilibre desdits droits par un trouble excédant la mesure des inconvénients normaux du voisinage ; qu'il n'est même pas établi que les demandeurs auraient subi le moindre dommage s'il n'y avait pas eu de faute commise par l'entrepreneur". A l'encontre de cette décision, les particuliers lésés ont invoqué, dans la deuxième branche de leur moyen, que le fait que le trouble excessif dommageable était aussi causé par la faute d'un entrepreneur, n'était pas de nature à exclure la demande de compensation en tant qu'elle était dirigée contre le maître de l'ouvrage, à savoir la Commune de Courcelles, d'où la violation des articles 544, 1382, 1383 du Code civil, 11 de la Constitution "et des principes généraux du droit concernant l'équilibre des droits entre propriétaires voisins et l'égalité devant les charges publiques". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rendu un arrêt du même type que celui prononcé dans l'affaire du viaduc de Beez. Relevons ainsi l'attendu final : "attendu qu'il ressort de ces énonciations (de la décision de fond), replacées dans le contexte de l'espèce, que la cour d'appel considère non seulement que, sans la faute commise par l'entrepreneur, les faits sur lesquels les demandeurs fondaient leur demande, dirigée par eux contre la défenderesse sur la base des articles 11 de la Constitution et 544 du Code civil, eussent été inexistants, mais que, de toute manière, ces faits ne révélaient pas l'existence, entre les propriétés voisines d'une rupture d'équilibre". Avouons qu'il est remarquable que la motivation d'un arrêt de pure espèce qui est par nature tout à fait particulier et tout à fait relatif, puisse ainsi se répéter à plusieurs années d'intervalles. Ce fait démontre la spécificité de la jurisprudence résultant de ces deux arrêts, jurisprudence qui demeure en décalage par rapport aux arrêts de principe, nous semble-t-il plus convaincants. En l'état de cette jurisprudence, les juges du fond, et les plaideurs qui ne manqueront pas de tenter de s'en inspirer, sauront en tout cas comment procéder lorsqu'ils ne voudront pas qu'il soit fait droit à une demande d'indemnisation dirigée contre un propriétaire bâtisseur tenu en principe pour troubles de voisinage même à raison de la faute d'un entrepreneur : il s'agira alors de constater en fait, souverainement, l'inexistence du trouble, par une formule similaire à celle rencontrée dans les deux décisions de fond que nous venons de voir et qui ont été validés en quelque sorte par la Cour de cassation, voire, plus subsidiairement, l'inexistence du lien causal entre le trouble et le dommage.
(104) Cass., du 16 février 1973 - affaire du cheval Austerlitz
Monsieur Moris a acquis les deux chevaux de course "Austerlitz" et "Sirène", auprès de la dame Gobeyn. Dans le milieu des courses, il n'était pas d'usage, semble-t-il, de conclure ce genre de contrat de vente par écrit. Pourtant, Monsieur Moris avait besoin d'un écrit pour faire courir les chevaux, en particulier le cheval "Austerlitz". Il s'adressa donc à Madame Gobeyn qui refusa de le lui remettre. Monsieur Maris décida dès lors d'intenter une action en justice contre Madame Gobeyn, tendant "à dire pour droit qu'il est propriétaire des chevaux de course Sirène et Austerlitz, à entendre condamner la défenderesse à lui remettre les documents nécessaires pour lui permettre de se faire reconnaître comme propriétaire par les institutions et associations intéressées", et "à entendre dire qu'au besoin le jugement à prononcer vaudra comme titre de propriété et d'acquisition régulière", outre une demande de dommages-intérêts à concurrence de 10.000 francs. La dame Gobeyn opposa une demande reconventionnelle tendant à se voir reconnaître un droit de propriété sur les chevaux, à la restitution de ceux-ci et à l'allocation de dommages-intérêts. Le juge du fond a fait droit à l'action de Monsieur Moris, au motif que : "ce dernier a la possession des chevaux litigieux, que la dame Gobeyn n'apporte pas la preuve des vices de la possession du sieur Moris ; qu'il ressort au contraire d'une information de police ouverte à ce propos que le demandeur à l'action peut invoquer une possession pro domino non équivoque, continue, non interrompue, paisible ; qu'il est établi par ladite information qu'il a acheté le cheval Austerlitz et a payé le prix d'achat stipulé" (le juge ajoute que, dans la branche de commerce concernée, il n'est pas d'usage d'établir un titre écrit). Madame Gobeyn s'est pourvue en cassation, en invoquant que l'action du sieur Moris se fondait sur des obligations contractuelles (dès lors qu'elle résultait d'un contrat de vente), excédant dans leur quantum la somme de 3.000 francs, montant applicable à l'époque sur le fondement du texte ancien de l'article 1341 du Code civil, et par conséquent soumise au prescrit de la preuve écrite : "il s'ensuit que le fait que le défendeur peut invoquer une possession au sens des articles 2229 et 2279 du Code civil, ne le dispense pas d'apporter, conformément aux articles 1315, 1341, 1345, 1353 et 1355 du Code civil, la preuve littérale des prétendues obligations de la demanderesse, et ne lui permet pas de recourir à des preuves par témoins". Le juge du fond, en n'ayant pas appliqué ces principes, les avait violés, selon le moyen. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Tout l'arrêt s'articule au départ d'une mise en perspective de l'action, dont était saisi le juge du fond, qui est qualifiée de réelle et non de personnelle. Les termes en sont les suivants : 1) "il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande du défendeur tend à la reconnaissance du droit de propriété sur les chevaux Sirène et Austerlitz, à la délivrance des titres de propriété, et à l'allocation de dommages-intérêts ; que le défendeur fonde cette demande sur ce que les deux chevaux sont en sa possession et que, conformément à l'article 2279 du Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre ; que par demande reconventionnelle la demanderesse sollicitait la consécration de son droit de propriété" ; "que la demanderesse ne critique pas l'arrêt en tant qu'il rejette sa demande reconventionnelle tendant à la restitution des chevaux" ; 2) "que l'arrêt, se fondant sur des présomptions déduites de certains éléments de l'information de police, constate que le défendeur peut invoquer une possession pro domino et que le demandeur n'établit pas les vices de cette possession" ; 3) "que l'arrêt accueillant la demande sur la base de l'article 2279 du Code civil et non sur la base d'obligations contractuelles, la question de la preuve littérale ne se pose pas". L'arrêt de fond est en conséquence déclaré légalement justifié et régulièrement motivé, d'où le rejet du pourvoi. Cet arrêt a généralement été critiqué par la doctrine, en particulier par les Professeurs J. Hansenne et M. Hanotiau, pour des motifs qui sont, jusqu'à un certain point, justifiés mais doivent être nuancés et relativisés : 1) l'arrêt serait d'abord critiquable en raison de l'erreur de terminologie consistant à avoir relevé que "la possession valait titre", alors qu'elle ne valait que "présomption de titre", puisque nous étions dans le cadre de la règle de preuve ; peut-être est-ce exact, mais la Cour de cassation n'a, semble-t-il, fait que citer le texte même de l'article 2279, qui concentre en son alinéa Ier l'expression des deux règles ; on a vu déjà qu'elle procédait ainsi pour la règle de preuve et on le verra encore ; 2) l'arrêt serait ensuite critiquable parce qu'il aurait admis une application inhabituelle de l'article 2279 du Code civil, à savoir, non l'invocation de la disposition par le possesseur actuel, en tant que défendeur et à titre d'exception et de moyen de défense pour résister à une action en revendication d'un verus dominus, mais son application dans le cadre d'une action même de ce possesseur en tant que demandeur à l'action. Si la remarque permet de faire apparaître l'indiscutable spécificité de cette affaire, elle ne peut, selon nous, donner lieu à une critique décisive de l'arrêt de cassation. En effet, cet aspect des choses n'était pas critiqué par la demanderesse en cassation. En outre, pourquoi ne pas admettre une telle application de l'article 2279 du Code civil, même à l'appui d'une action du possesseur actuel, application qui n'est pas exclue par le texte de l'article. Il devrait toutefois en résulter que ce serait alors au possesseur, en tant que demandeur à l'action, de faire la preuve de sa possession utile (comme ce fut d'ailleurs le cas dans cette affaire "Moris/Gobeyn") ? 3) l'arrêt a également été critiqué pour avoir admis une application de l'article 2279 à l'égard d'une cause où il était question, essentiellement il est vrai, d'obligations contractuelles. Qu'en pensez ? - à l'encontre de cette critique, il faut à nouveau relever que la cause avait été qualifiée, et articulée par les parties dans un cadre de demandes concernant essentiellement la possession du demandeur et le droit de propriété des parties (cfr. attendus ci-dessus, résumant les termes de la cause auxquels la Cour de cassation pouvait avoir égard) ; - ce qui est sans doute l'élément le plus critiquable de cette jurisprudence, c'est qu'elle semble avoir fait preuve d'une certaine souplesse en décidant que la preuve des obligations contractuelles ne devait pas être rapportée et prise en considération par le juge, alors que dans d'autres affaires (les affaires "Jorissen" et "de Montjoie"), la Cour a été plus sévère et a cassé pour non-respect des règles de preuve en droit civil ; mais à nouveau, le juge devait-il statuer à cet égard, et la Cour de cassation était-elle de même critiquable de ne pas casser, alors que les parties ne s'était pas placées sur le terrain contractuel ? Ce type de question se pose et se posera encore régulièrement dans la jurisprudence en fonction de ce que les parties à un procès ont déterminé comme étant la cause de leurs demandes. On sait à cet égard qu'il faut respecter le principe dispositif, mais la perspective semble changer grandement depuis que la Cour de cassation a consacré une conception large de la cause, dite conception factuelle, par un arrêt du14 avril 2005, ayant décidé que : "le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions". Ces questions nous mènent aux confins du droit civil et du droit judiciaire.
(120) Cass., du 18 avril 1881
Nous disposons de peu de précisions au sujet des éléments de fait de cette affaire. L'on sait simplement qu'un locataire a dirigé contre un bailleur une action en paiement du chef de travaux d'amélioration faits dans les lieux loués, et qu'il a postulé le remboursement de la plus-value apportée ainsi à l'immeuble. Il y a donc tout lieu de penser que son action se basait sur la théorie de l'enrichissement sans cause et non sur la règle générale de l'article 555. Ce point ne fit pas l'objet de discussions entre parties, semble-t-il. Le bailleur contesta cependant dans son principe le droit du locataire à obtenir le paiement d'une indemnité. Il fut suivi par le juge du fond qui débouta le locataire de son action aux motifs (empruntés à la décision de première instance), qu'il appartenait au locataire "d'avertir le propriétaire et de lui demander son accord, voire de le contraindre à effectuer les travaux nécessaires, ainsi que l'y autorisait l'article 1720 du Code civil ; et il résulte de la correspondance examinée que le locataire s'est borné à dire au propriétaire qu'il "avait remplacé la fenêtre" ou "qu'il envisageait la remise en état d'une corniche", sans jamais formuler de réclamation précise ; et que certains travaux l'ont été, comme l'affirme la défenderesse, exclusivement dans l'intérêt du preneur". Cette motivation n'était pas convaincante : s'il est vrai que le locataire ne s'était pas plaint de troubles de jouissance dûs au mauvais état des lieux loués et n'avait pas demandé au bailleur d'effectuer telle ou telle réparation dans le cadre de son obligation de faire jouir le locataire (cfr. art. 1719, 3°, du Code civil), la question se posait, de façon distincte, de la détermination du sort des travaux d'amélioration faits d'initiative par le locataire. Or, en ce qui concernait ces travaux, le bailleur aurait dû être mis en situation de pouvoir décider, en fin de bail, soit de leur enlèvement, soit de leur conservation, et c'est alors que surgissait le problème de l'indemnisation éventuelle du locataire. Le raisonnement du juge du fond aurait donc dû être le suivant, en deux temps : 1) le bailleur avait-il été mis en position de demander l'enlèvement des travaux, ce enfin de bail (ce qui était possible pour des travaux relevant de l'accession mais non pour des travaux de types impenses, qui sont inséparables) ; 2) le bailleur avait-il donc été informé et invité à donner son accord au sujet des travaux ? Il était sans doute à conseiller au locataire d'informer le bailleur dans le cours du bail des travaux effectués par lui (surtout s'ils incombaient en réalité au bailleur dans le cadre de ses obligations), mais le moment-clé où était susceptible de se poser le problème d'indemnisation, était, encore une fois, la fin du bail ; d'ailleurs, avant cela, le locataire pouvait enlever les travaux et améliorations qu'il avait faites (d'où un droit d'enlèvement), comme on l'a vu dans les deux affaires précédentes, bien sûr sans endommager irrémédiablement les lieux loués. Ces questions étaient bien sûr liées et le juge du fond avait manqué quelque peu de rigueur dans cette affaire en s'étant borné à relever que le locataire devait "avertir" le bailleur des travaux dans le cours du bail, ce qui n'était pas suffisant : il devait permettre au bailleur de décider si oui ou non il gardait les travaux et améliorations en fin de bail. Il fallait donc aussi voir préalablement quelle était la nature des travaux (travaux séparables ou non), ce qui pouvait avoir une incidence sur la position du bailleur. Du moins, le raisonnement du juge semblait-il lacunaire. A sa décharge, on relèvera que la question était assez subtile et liée également à la différence entre l'accession et les impenses, non faite, semble-t-il, par les parties elles-mêmes. On lira avec grand intérêt le pourvoi en cassation du locataire (en particulier la deuxième branche de son moyen unique), qui a adroitement développé une argumentation, reprenant les deux fondements possibles d'action et d'indemnisation (accession ou enrichissement sans cause pour les travaux susceptibles d'enlèvement, et théorie des impenses pour les travaux non susceptibles d'enlèvement), en mettant en évidence l'inadéquation de l'argumentation du juge du fond par rapport à ceux-ci, et la violation des dispositions invoquées et du principe général du droit de l'enrichissement sans cause. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Après un bref rappel des énonciations du juge du fond, la décision de la Cour, prononçant à juste titre une cassation, a été lapidaire : "attendu qu'à défaut de stipulations entre parties, le locataire peut en vertu du principe général du droit suivant lequel nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui, être indemnisé pour les améliorations apportées à l'immeuble, à condition que le bailleur ne se soit pas trouvé dans l'impossibilité d'exiger leur enlèvement ; attendu qu'en déclarant la demande non fondée sans constater, même implicitement, que les travaux litigieux n'étaient pas susceptibles d'enlèvement, et pour les motifs reproduits ci-dessus, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'en cette branche le moyen est fondé". Cet arrêt casse la décision de fond parce qu'elle n'a pas constaté que les travaux en question étaient non susceptibles d'enlèvement, ce qui impliquait une situation d'impenses, en réalité incompatible avec le bail et partant ne pouvant être imposée au bailleur, ni a fortiori ne pouvant justifier une indemnisation par ce dernier. L'arrêt nous donne l'impression qu'il en irait autrement en cas de travaux susceptibles d'enlèvement, ce qui ne nous convainc pas comme nous l'expliquons au numéro suivant. L'arrêt prend en tout cas parti indirectement dans le sens de la l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause à la situation où les travaux sont susceptibles d'enlèvement, et non du régime de l'accession déduit de l'article 555 du Code civil, règle générale.
(11) Cass., du 14 novembre 1997
Plus particulier mais non moins pertinent est l'enseignement à déduire de cet arrêt du 14 octobre 1997. Dans les faits, des travaux avaient été effectués par les consorts Mendolia sur l'assiette d'une servitude de passage. A la suite de ces travaux, deux marches d'escalier en béton empiétaient sur l'assiette de la servitude de passage. Une action en démolition, semble-t-il, fut intentée par les titulaires de la servitude, les parties Bajic et Lecocq. Il n'a cependant pas été fait droit à cette action par la décision de fond, au motif, notamment, que "la portion de l'assiette de la servitude sur laquelle les défendeurs ont construit n'est que d'une utilité toute théorique pour les demandeurs ; que c'est abusivement que les demandeurs postulent la démolition des constructions réalisées en empiétement et le retour des lieux dans leur pristin état". Les auteurs de l'abus de droit (droit de servitude et droit de demander la démolition) étaient donc pour le juge du fond les Bajic et Lecocq, tandis que les consorts Mendolia étaient en quelque sorte les victimes de cet abus de droit. Les parties Bajic et Lecocq se sont dès lors pourvues en cassation en invoquant, dans la troisième branche de leur moyen, "que tout abus de droit suppose les trois éléments de la responsabilité civile, faute, dommage et lien de causalité ; qu'une personne ne peut se prétendre victime d'un abus de droit lorsque le dommage caractérisant cet abus résulte pour elle d'une situation qu'elle a délibérément créée ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que, en l'espèce, les défendeurs ont réalisé délibérément l'empiétement ; qu'à tout le moins, le jugement ne constate pas que cet empiétement aurait été réalisé de bonne foi, ce que les demandeurs avaient contesté dans leurs conclusions précitées". Les parties Mendolia (victimes de l'abus de droit) pouvaient-ils en effet invoquer l'abus de droit des consorts Bajic et Lecocq (auteurs de l'abus), alors qu'il aurait pu être relevé qu'ils avaient été à l'origine de la situation par la construction des deux marches litigieuses ? Tout dépendait du caractère délibéré de l'attitude des premiers, les victimes de l'abus de droit. La Cour de cassation ne pouvait bien sûr pénétrer le fait à cet égard et eut égard à ce qu'avait constaté le juge du fond (à savoir l'absence de caractère délibéré de comportement de provocation de l'abus de droit par la victime de celui-ci). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rejeté le moyen au motif que la décision attaquée avait par sa motivation "énoncé de manière implicite mais certaine que les défendeurs n'avaient agi ni délibérément ni de mauvaise foi". La Cour a énoncé préalablement le principe suivant : "pour déterminer s'il y a abus de droit, le juge doit, dans l'appréciation des intérêts en présence, tenir compte de toutes les circonstances de la cause ; qu'il a l'obligation de vérifier, notamment, si l'auteur de la violation du droit d'autrui n 'a pas agi délibérément, sans se soucier du droit qu'il doit respecter, commettant ainsi une faute qui le priverait de la faculté d'invoquer à son profit l'exception d'abus de droit". Le juge du fond n'avait pas relevé un tel comportement délibéré des Mendolia. Bel effort donc de leurs adversaires, mais manquant en fait. Cet arrêt enrichit la théorie de l'abus de droit d'un élément neuf et doit être approuvé. Il revient à poser le principe suivant lequel la victime d'un abus de droit ne doit pas avoir elle-même agi délibérément et de mauvaise foi à l'origine de l'abus de droit par autrui, ce dont il résulterait une faute la privant d'invoquer un tel abus. Comment expliquer en droit qu'elle soit privée d'invoquer l'abus de droit dans un tel contexte ? 1) soit, une analyse constatant l'absence de causalité entre la faute par abus de droit et le dommage, la faute volontaire de la victime ayant été exclusivement à l'origine de de son propre dommage ; 2) soit (et c'est l'explication qui nous paraît la plus convaincante) une analyse mettant en évidence le fait que la faute de la victime serait constitutive d'un acte de fraude, ou plus précisément de faute intentionnelle (un dol sensu lato), la privant d'invoquer l'abus de droit en application du principe général du droit "fraus omnia corrumpit", exception de fraude ou exception de dol.
(136BIS) Cass., du 14 octobre 2010
(vu ex cathedra)
(49) Cass., du 06 janvier 1914
Des maisons avaient été construites par la Société liégeoise de maisons ouvrières. Dans les différents actes de vente de ces maisons, figurait la clause suivante : "l'acquéreur s'interdit formellement de construire des murs de quelque nature que ce soit, dans les jardins ; cette stipulation constitue une servitude absolue au profit des maisons voisines". Le propriétaire Beaudon demanda cependant l'application de l'article 663 du Code civil et agit à l'encontre d'un voisin, en construction, à frais communs, d'un mur mitoyen. Le voisin, dénommé De Looz, opposa la clause d'interdiction de construire, constitutive de servitude non aedificandi, contraire toutefois à la lettre de l'article 663 du Code civil. Une telle clause était-elle licite ? Il fallait dès lors s'interroger sur la portée de l'article 663 du Code civil. La Société liégeoise des maisons ouvrières fut mise à la cause et conclut, avec le propriétaire De Looz, à la validité de la clause d'interdiction de construction. Tant la juridiction de première instance que celle d'appel donnèrent cependant raison au demandeur Beaudon : l'article 663 du Code civil devait primer sur la volonté des parties. Le raisonnement suivi en degré d'appel fut le suivant, s'articulant en un argument principal et un argument subsidiaire : 1) pour le tribunal, en ordre principal, la clause litigieuse visait une autre hypothèse que celle couverte par l'article 663 du Code civil; il s'agissait, selon la clause, d'interdire la construction d'un mur "dans" les jardins, or l'article 663 porterait sur l'édification à frais communs d'un mur de séparation "entre" jardins, ce qui serait à l'origine d'un hypothèse différente ; la clause ne ferait donc pas obstacle à l'application de l'article 663 du Code civil ; 2) en ordre subsidiaire, le tribunal considéra qu'à supposer qu'il faille appliquer la clause, elle se heurtait alors, en tout état de cause, à l'article 663 du Code civil, qui revêtait une portée d'ordre public. Le premier argument était spécieux et pas du tout convaincant. Le second posait la question de la portée de l'article 663 du Code civil. Le sieur De Looz, demandeur en cassation, attaqua sur les deux fronts la décision de fond, et invoqua essentiellement, par deux moyens distincts : 1) la violation de la foi due à la clause par l'interprétation qui en avait été faite par le tribunal ; 2) et la violation de l'article 663 du Code civil. Dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour de cassation, qu'on lira avec attention, le procureur général près la haute juridiction, manifestement désireux de sauver le type de clause litigieux et de privilégier la volonté des parties sur l'article 663 du Code civil, conclut à la cassation sur le fondement des deux moyens invoqués. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Le ministère public fut suivi par la Cour de cassation qui cassa pour les motifs suivants : 1) le juge du fond avait d'abord violé la foi due à la clause litigieuse; en effet, "le jugement déclare que par la clause litigieuse les parties n'ont pas dérogé à la disposition de l'article 663 du Code civil, invoqué par Beaudon comme lui donnant le droit d'exiger l'érection à/rais communs d'un mur sur la limite séparative de leurs jardins ; que cette décision du jugement, directement contraire aux termes précis des titres, méconnaît la foi qui leur est due et viole l'article 1319 du Code civil" ; 2) le juge s'était ensuite trompé en assignant à l'article 663 du Code civil une portée d'ordre public. Selon la Cour de cassation : "ce texte consacre, au profit de chacun des voisins, une simple faculté dont, suivant l'appréciation qu'il a de son intérêt, il est libre d'user ou non ; que l'article n 'a donc par le caractère d'une disposition de police dont l'application, à raison de ce caractère même, s'impose à tous ; que c'est au contraire, une disposition de droit privé ; qu'elle établit une servitude dans l'intérêt des particuliers, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles 649 à 652 du Code civil ; que si, par l'intérêt même qu'elle protège, en ce que cette protection importe à tous, elle se rattache à l'ordre et l'intérêt général, et si, intéressant la sûreté des voisins, elle contribue par là-même à la sûreté publique, il n'en résulte pas et il n'a pas été affirmé lors de son élaboration qu'elle garantisse la sûreté publique, c'est-à-dire qu'elle lui soit indispensable, portée qui seule pourrait lui attribuer le caractère de disposition d'ordre public". La Cour de cassation a ainsi conclu à l'absence de portée d'ordre public de l'article 663 du Code civil, ce qu'il convient d'approuver. Cet enseignement sera confirmé indirectement par une jurisprudence ultérieure de la Cour qui admettra la possibilité d'échapper à l'application de l'article 663 du Code civil en démontrant l'absence d'utilité commune du mur. Trois commentaires plus précis s'imposent encore au sujet de cet arrêt : 1) relevons que l'arrêt fut rendu à un moment où la Cour de cassation n'avait pas encore donné à la notion d'ordre public la définition proposée par H. De Page, ce qu'elle fit par son arrêt du 9 décembre 1948, en distinguant les lois d'ordre public proprement dites (qui protègent l'intérêt général) des lois d'ordre public sensu lato protégeant des intérêts privés (dénommées par la suite "lois impératives") ; 2) à cet égard, la fin de l'attendu que nous venons de voir pourrait nous inciter à conclure que l'article 663 serait protecteur d'intérêts privés, et par conséquent il serait, si ce n'est d'ordre public, du moins à caractère impératif. Mais le régime contraignant des lois impératives et notamment la possibilité pour la partie dont les intérêts privés sont protégés par une telle loi, de ne renoncer contractuellement à la protection assurée par cette loi qu'à partir du moment où la protection légale aura pu jouer (et non antérieurement), empêcherait une dérogation anticipée, par convention, à l'article 663 du Code civil, du type de celle qui était discutée dans l'affaire que nous venons de commenter. L'article 663 du Code civil, si l'on suit jusqu'au bout le raisonnement de la Cour de cassation, n'est donc pas non plus impératif et revêt une portée qui ne peut être que supplétive de la volonté des parties ; 3) reste que l'on ne peut s'empêcher de constater la spécificité et l'ambivalence du mécanisme résultant de l'article 663 du Code civil : n'oublions pas en effet qu'il organise à la fois une faculté, mais également une contrainte pouvant s'imposer, dans une certaine mesure, au propriétaire concerné. On ne peut omettre l'existence de ce mécanisme. Il ne sera possible d'y échapper qu'en renversant la présomption d'utilité commune qui gouverne l'article 663, ainsi que la Cour de cassation le dira par son arrêt du 8 février 1968, dans l'affaire de "l'Evéché de Liège". La particularité de ce mécanisme nous incite aussi à réfléchir sur les types de normes. Aux trois catégories de base que sont les normes d'ordre public, celles impératives et celles essentiellement supplétives, on pourrait sans doute ajouter une dernière catégorie intermédiaire : les normes supplétives mais ayant une certaine portée contraignante mais facultative, dépendant du choix du sujet de droit qu'elles protègent (ce point devrait être aussi approfondi en droit des obligations).
(50) Cass., du 10 mars 1983
Des propriétaires voulaient obtenir de leur voisin, sur pied de l'article 663 du Code civil, la construction d'un mur de briques pleines d'une épaisseur de 20 cm, d'où un coût important de plus de 150.000 FB à supporter à concurrence de près de 100.000 FB par le voisin, alors que les demandeurs ne supportaient eux-mêmes que + ou - 50.000 FB. En degré d'appel, le juge refusa de faire droit à l'action des demandeurs car la construction mitoyenne ainsi postulée apparaissait "anormale" et était une "opération économique déraisonnable", résultant d'une "construction d'un coût exorbitant et disproportionné", "alors que différentes solutions techniques peu coûteuses leur permettraient d'atteindre le résultat qu'ils recherchent, sans imposer à autrui un dommage inutile". Le juge du fond avait donc ainsi constaté un abus de droit dans le chef des demandeurs, ces derniers "choisissant la solution de clôture la plus dommageable pour les défendeurs". Les demandeurs, déboutés de leur action, se pourvurent en cassation et invoquèrent, dans la deuxième branche de leur moyen, le caractère "discrétionnaire" du droit résultant de l'article 663 du Code civil et partant la violation de celui-ci, le juge du fond n'ayant pas pu légalement justifier le constat qu'il avait fait d'un abus de droit. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : A bon droit, la Cour de cassation a rejeté cette branche du moyen, en relevant, après le rappel du texte de l'article 663, que : "si celui qui entend contraindre son voisin à contribuer à la construction d'une clôture a le droit, sous réserve de respecter les prescriptions légales et réglementaires prévues par ledit article 663, d'édifier le mur de séparation selon les modalités qu'il choisit, il ne peut néanmoins exercer ce droit d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente". Le juge du fond avait en outre souverainement constaté en fait l'abus de droit, par les énonciations que nous avons vues ci-dessus, et sa décision n'était pas critiquable. Cet arrêt concernant l'abus de droit se situe dans la lignée de l'arrêt du 10 septembre 1971 commenté supra. Il doit être approuvé, la Cour ayant ainsi implicitement admis une application par le juge du fond, soit du critère de la disproportion, soit du critère du choix le plus dommageable dans l'exercice du droit litigieux, parmi différentes modalités d'exercice. Il en découle certainement que l'article 663 du Code civil ne peut être à l'origine que d'un droit non discrétionnaire, par conséquent un droit susceptible d'abus conformément au droit commun. Est peut-être moins convaincante la précision se trouvant dans l'arrêt, suivant laquelle le droit du demandeur en construction pourrait tendre à édifier un mur "selon les modalités qu'il choisit". Ce droit est certes un droit subjectif et l'exercice d'un faculté individuelle, mais il n'est pas purement unilatéral. Comme il s'agit en définitive de tendre à la construction d'un mur en copropriété, à frais communs, il est normal que l'avis et l'accord du propriétaire voisin soit pris, les deux propriétaires étant censés se concerter avant la construction et "s'aboucher au préalable", ainsi qu'il sera dit dans l'affaire de la "Veuve Douxchamps", que nous examinons ci-après.
(133) Cass., du 21 octobre 1965
Voici l'arrêt de principe qui manquait dans la jurisprudence. Un terrain de fond avait été utilisé pendant un certain temps comme jardin. Il fut vendu par la suite à un nouveau propriétaire, X, qui y construisit un garage. Le fond était enclavé et il fallait pouvoir en sortir. Un chemin vicinal existant vers la voie publique, au travers du fonds voisin appartenant à Y. Ce dernier n'appréciant pas que son voisin l'utilise dorénavant pour y passer en voiture, ramena le chemin à ce qui étaient probablement ses limites véritables et initiales, à savoir 1 mètre et 20 centimètres de large. X lança dès lors une action pour se voir reconnaître un droit de passage légal plus large lui permettant de passer avec son véhicule, et ce sur pied de l'article 682 dans son texte initial qui ne prévoyait que l'octroi d'un droit de passage au fonds totalement enclavé, ne bénéficiant d'aucune issue vers la voie publique. L'action allait donc plus loin que le texte légal. Elle fut rejetée en degré d'appel, pour deux motifs : d'abord parce que le fonds n'était pas enclavé au sens légal du terme ; ensuite parce que X demandait l'octroi d'un droit de passage pour une affectation de pur agrément, et non en vue d'une exploitation du fonds à des fins industrielles, agricoles ou commerciales. X a introduit un pourvoi en cassation attaquant la décision de fond sur ces deux plans : d'abord, presque contra legem à l'époque, il plaida l'évolution nécessaire de la loi vers un concept d'enclave relative (première branche) ; ensuite. il soutint que la vision du juge sur la finalité du droit de passage était trop restrictive (deuxième branche). X triompha sur les deux plans, ce qui démontre que la Cour de cassation a su dire et faire évoluer le droit quand cela était nécessaire. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour a déclaré fondées les deux branches du moyen. Elle a cassé la décision de fond et a validé ainsi, à l'occasion de cette affaire, deux principes déterminant les deux conditions préalables d'octroi de la servitude de passage : 1) quant à l'état d'enclave, la Cour de cassation consacre la notion d'enclave relative : "un fonds, qui a une issue sur la voie publique, est néanmoins un fonds enclavé, au sens de l'article 682 du Code civil, lorsque cette issue est insuffisante pour les besoins de l'exploitation de ce fonds" ; 2) la condition d'affectation du fonds est également nouvellement définie : "en attribuant dans l'article 682 dudit Code un droit de passage pour "l'exploitation" de l'héritage enclavé, le législateur a entendu assurer à cet héritage l'accès à la voie publique qui s'avère indispensable à la mise en valeur du fonds enclavé, c'est-à-dire à son utilisation normale d'après sa destination" ; sur la base de ce principe, la décision du juge du fond, trop restrictive et n'ayant pas constaté que le passage demandé n'était pas indispensable à l'utilisation normale du fonds litigieux, est également cassée. Il convient d'approuver cet arrêt. Notons qu'il en découle une interprétation téléologique de la loi (recherche du but de celle-ci, en équité), qui prime sur une interprétation qui aurait pu être stricte, voire restrictive, au motif que la servitude déroge au droit commun de la propriété individuelle et à l'article 544 du Code civil. Ce type de raisonnement nous paraît tout à fait raisonnable et convaincant. Le législateur a consacré au mot près cet arrêt par la loi du 1er mars 1978, rédigeant comme suit le texte actuel de l'article 682 § 1er du Code civil : "le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur le voie publique, qui en peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins, pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". La Cour de cassation a encore étendu la notion d'enclave en décidant, par un arrêt du 1er mars 1996, qu'un fonds pouvait être enclavé s'il ne dispose pas de l'accès souterrain nécessaire aux installations techniques d'évacuation et de connexion vers la voie publique.
(8) Cass., du 10 septembre 1971
Le constructeur d'un bâtiment avait empiété, sans s'en rendre compte et de bonne foi, pendant 23 ans, sur le fonds de son voisin, à concurrence d'une bande de terrain limitée, d'une longueur de plus ou moins 6 mètres et d'une largeur de 20 à 21 centimètres (la largeur d'une demi-brique). Il avait ainsi construit un mur formant séparation entre son immeuble et le jardinet de son voisin. Ce dernier, dont le droit de propriété avait été usurpé, introduisit une action en démolition contre les ayants-cause de l'auteur de l'empiétement. Le fondement de l'action paraissait incontestable, puisé dans le droit de propriété, mais l'action présentait également un caractère excessif. Il n'y fut finalement pas fait droit par le juge du fond au motif que le demandeur à l'action ne pouvait "pousser à l'extrême la poursuite de ses droits", l'auteur des défendeurs ayant édifié le mur "de bonne foi". Le juge a également constaté qu'il n'y avait "pas de commune mesure entre le préjudice que la démolition occasionnait et l'avantage qu'elle procurait au demandeur". Le jugement attaqué a en conséquence accordé simplement des dommages-intérêts au demandeur à l'action, mais non la réparation en nature qu'il postulait, sous la forme d'une démolition du mur. Le demandeur s'est par la suite pourvu en cassation en invoquant la violation d'un certain nombre de dispositions, dont l'article 544 du Code civil et les articles relatifs au régime du mur mitoyen (cfr. art. 647, 653, 660 et 663) ainsi que l'ancien article 11 de la Constitution (le demandeur étant privé illégalement de sa propriété, dans la thèse soutenue par le moyen du moins). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Par ce premier arrêt de la théorie de l'abus de droit dans son acception moderne, la Cour de cassation a refusé de faire droit au pourvoi, en considérant que la décision attaquée était légalement justifiée. L'arrêt a énoncé : 1) d'abord la formule générale de l'abus de droit : "pareil abus peut résulter non seulement de l'exercice d'un droit avec la seule intention de nuire, mais aussi de l'exercice de ce droit d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente" ; 2) ensuite le nouveau critère particulier de l'abus de droit qui est celui de la disproportion : "tenant compte de cette situation existant depuis 23 ans, de l'importance limitée du dommage et de sa disproportion avec le préjudice qu'une démolition éventuelle causerait aux défendeurs, le tribunal a pu considérer que, dans les circonstances présentes", il y avait abus de droit. Il convient d'approuver pleinement cet arrêt qui est essentiel aussi bien dans sa formule générale que dans la reconnaissance du critère particulier de l'abus de droit résidant dans la disproportion. C'est aussi à l'occasion d'une affaire impliquant le droit réel par excellence qu'est le droit de propriété, droit "plein" et "dur" et aux larges prérogatives, sans être pour autant discrétionnaire, que la Cour de cassation a lancé la théorie de l'abus de droit sur la voie de son acception moderne et contemporaine. Nous reviendrons sur la portée de cet arrêt dans la conclusion de cet ouvrage et il est renvoyé pour le reste aux traités de droit des obligations. Il est important de noter que la Cour de cassation de France a développé une jurisprudence diamétralement opposée à celle que nous venons de voir en droit belge, ayant décidé, par plusieurs arrêts, que "la défense du droit de propriété contre un empiétement (sous la forme d'une action en démolition) ne saurait dégénérer en abus". Le premier arrêt a été rendu sur la base de l'article 545 du Code civil français, prévoyant que : "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et adéquate compensation".
(56) Cass., du 26 avril 1934
L'usufruitière d'un immeuble, Mme Duvivier, veuve Latinne, avait élevé des constructions qui s'appuyaient en partie sur le mur séparatif du fonds de son voisin, Mr. Antoine. Ce dernier lança dès lors une action en justice pour se faire payer le prix de la mitoyenneté du mur. Il fut fait droit à cette action par le juge du fond qui releva, à l'appui de sa décision, que l'usufruitière avait manifesté la volonté d'acquérir la mitoyenneté du mur litigieux, cette volonté "résultant à suffisance de droit de l'usage qu'elle en a fait pour les constructions par elle édifiées". Mme Duvivier introduisit un pourvoi en cassation. On retiendra le premier moyen critiquant la décision attaquée parce qu'elle avait refusé de prendre en considération l'exception d'irrecevabilité que la dame Duvivier avait soulevée sur la base de sa qualité d'usufruitière. Selon elle, il fallait en effet lancer l'action contre le nu-propriétaire. Comme dans l'affaire précédemment examinée, ce moyen ne contenait pas une critique tout à fait structurée à l'encontre du raisonnement du juge du fond, qui avait retenu l'existence d'un accord de volontés entre parties obligeant l'usufruitière à payer le prix de la mitoyenneté. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Le raisonnement de la haute juridiction s'articula comme suit, en commençant par un élément de procédure du même type que celui vu dans l'affaire précédente : 1) précision préliminaire quant à la procédure et à la technique de cassation : c'est "sans être attaqué de ce chef'' que le jugement dénoncé ayant relevé en fait la volonté d'acquérir la mitoyenneté, est déféré à la censure de la Cour ; 2) la Cour de cassation développe ensuite un nouvel état de la théorie de l'acquisition forcée de la mitoyenneté et de l'obligation d'en payer le prix, basé sur un accord de volontés, comme suit : "lorsque l'usufruitière d'un des immeubles contigus manifeste cette volonté (d'acquérir la mitoyenneté), qu'elle réalise en construisant sur le mur séparatif et que le propriétaire de ce mur ne s'y oppose pas, puisqu'il réclame le prix de la mitoyenneté, il s'établit, entre l'usufruitière et lui, un concours de volontés dont l'effet est de permettre au vendeur d'exiger de sa contre-partie, soit la somme convenue, soit, à défaut de convention expresse, la somme équivalant à cet enrichissement ; qu'aucune disposition légale n'interdit au maître d'un mur séparatif d'en céder la mitoyenneté à l'usufruitière du terrain voisin". 3) suit un refus par la Cour de cassation de prendre en considération l'article 661 du Code civil et une précision quant à la décision de fond qui demeurait justifiée : "que l'article 661 du Code civil, invoqué dans les développements du moyen, est sans application à la situation ici envisagée ; qu'en vertu de cette disposition, tout propriétaire joignant un mur a, il est vrai, la faculté de le rendre mitoyen, c'est-à-dire d'exiger que la mitoyenneté lui en soit cédée, mais que ce droit n'implique nullement qu'elle ne puisse être cédée par le maître du mur à l'usufruitier de l'héritage voisin ; que l'exception tirée par la demanderesse de sa qualité d'usufruitière n'était donc pas fondée ; qu'en la rejetant, le juge du fonds 'est conformé à la loi; que le moyen est, dès lors, dépourvu d'intérêt". Par conséquent, la Cour de cassation a rejeté le moyen de l'usufruitière, ainsi d'ailleurs que la totalité de son pourvoi. Les critiques principales sont les suivantes : 1) on relèvera d'abord, dans le sens d'une critique positive de l'arrêt, que la Cour de cassation engage le raisonnement juridique dans une voie résolument nouvelle, dotant le juge du pouvoir de relever en fait un accord de volontés à l'origine de la vente de mitoyenneté. C'est là un raisonnement beaucoup plus sûr et rigoureux que celui développé dans le premier arrêt ; 2) est cependant critiquable le fait que la Cour de cassation n'ait pas jugé bon d'inscrire la recherche de cet accord de volontés dans le cadre de l'article 661 du Code civil, qui justifiait l'existence de la volonté du cessionnaire de la mitoyenneté, cette volonté étant à déduire d'un état de pollicitation ou offre permanente dans lequel se trouve légalement ce cessionnaire ; 3) le système de l'accord de volontés et de la vente amiable qui avait été relevée par le juge du fond, était également en partie démenti par les faits : l'usufruitière s'opposait à la vente, puisqu'elle en niait l'existence dans son pourvoi et invoquait que l'action litigieuse aurait dû être dirigée contre le nu-propriétaire : où était donc la volonté d'acquérir la mitoyenneté dans son chef et cette volonté n'était-elle pas inexistante ? Le juge du fond (et la Cour de cassation) auraient donc dû être plus rigoureux, et auraient dû déduire cette volonté du fait que, mise en demeure de cesser l'usurpation du mur, l'usufruitière avait persévéré dans son usurpation, et manifesté alors, de façon certaine, en refusant de mettre fin à la situation litigieuse, la volonté d'acquérir la mitoyenneté, d'où l'obligation pour elle d'en payer le prix.
(120BIS) Cass., du 31 mai 2012
(vu ex cathedra) Cet arrêt semble opérer un revirement de jurisprudence par rapport au précédent en se référant à la règle générale de l'article 555. Il est très critiquable car il perd de vue l'économie générale de l'article 555, non applicable en principe à la sphère contractuelle.
(158BIS) Cass., du 13 septembre 2013
(vu ex cathedra) Notons que la nouvelle loi permet plus de souplesse quant à la superficie mais elle ne valide pas encore les superficies portant sur un volume d'air. Enfin, il n'y aura encore un autre cas d'exception où l'on pourrait admettre une application de l'article 553 du Code civil donnant lieu à une propriété perpétuelle en sur-sol, au-dessus du fonds d'autrui, ce serait le cas de constructions en surplomb sur le fonds d'autrui, imbriquées avec celles d'autrui. Dans ce cas, au nom de la défense des relations de bon voisinage à long terme, la propriété perpétuelle serait admissible. Ce cas devrait être examiné plus en détails.
(163) Jugement du tribunal de commerce de Charleroi, du 17 mai 1999 - affaire Kinvest
(vu ex cathedra) Voici une bien belle affaire qui nous plonge au coeur de la mécanique de l'emphytéose. Elle a donné lieu à trois décisions au fond. la première rendue par le tribunal de commerce de Charleroi et les deux suivantes par la cour d'appel de Mons.
(15) Cass., du 23 mai 1991
A nouveau, des travaux publics, ici commandés par l'Etat belge, avaient occasionné des troubles dommageables à des riverains qui en poursuivaient la réparation. L'Etat belge ne contestait ni la matérialité des faits ni le fondement de l'action, puisé dans le principe d'égalité devant les charges publiques, mais invoquait l'enseignement d'une doctrine autorisée qui soutenait que lorsque l'auteur du trouble du voisinage est un pouvoir public, il convient d'appliquer le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Plus précisément, "pour condamner le pouvoir public, maître de l'ouvrage, à réparer le dommage en application de l'article 544 du Code civil", le juge doit alors constater qu'ont été en l'espèce dépassés les inconvénients "que tout citoyen doit supporter dans l'intérêt de la communauté" ou l'intérêt collectif. On retrouvait là une argumentation qui pouvait se réclamer de l'enseignement implicite à déduire de l'arrêt précédent. Pourtant, la cour d'appel de Liège a refusé de suivre cette thèse, et a décidé qu'était sans incidence le point de savoir si les inconvénients étaient ou non utiles à la communauté, d'où le pourvoi de l'Etat reprenant les principes s'inspirant de la doctrine que nous venons de voir. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a suivi l'Etat belge et a cassé l'arrêt entrepris pour le motif principal que : "l'arrêt constate que les défendeurs "fondent leur demande sur l'article 544 du Code civil" ; que, si cette disposition oblige l'auteur d'un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, fût-il un pouvoir public, à compenser la rupture d'équilibre causée par ce trouble, encore faut-il, lorsque l'auteur est un pouvoir public, que le juge tienne compte, dans son appréciation de l'importance du trouble, des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif ; attendu qu'en refusant d'examiner si en l'espèce, les troubles du voisinage excédaient ces charges, l'arrêt viole l'article 544 précité". Le contenu de cet arrêt doit être approuvé. On remarquera qu'il se réfère cette fois à l'article 544 du Code civil et non au principe d'égalité devant les charges publiques. Cette référence s'explique sans doute par le fait que les plaideurs eux-mêmes avaient accepté de centrer leur débat au fond sur cette seule disposition (cfr. "attendu" ci-dessus cité). Les rapports entre le principe d'égalité et l'article 544 du Code civil sont pour le reste très clairement synthétisés par les conclusions du ministère public, précédant l'arrêt : "en résumé, toute personne, victime d'un trouble de voisinage, peut demander une indemnité sur la base de l'article 544 du Code civil, lequel s'applique tant aux pouvoirs publics qu'aux particuliers. Si l'auteur du trouble de voisinage est un pouvoir public, la victime de ce trouble peut donc fonder sa demande sur cet article du Code civil, elle peut aussi invoquer seulement l'article 11 de la Constitution".
(107) Cass., du 04 décembre 1986 - affaire Billen
A nouveau, le point de départ du litige découle de la liquidation d'une succession, à savoir celle d'un sieur Theophiel Billen, et oppose un groupe d'héritiers à un autre. Les héritiers qui habitaient sous le même toit que le sieur Billen, sont assignés par les autres qui leur demandent le rapport et la restitution à la succession d'un certain nombre de biens meubles ayant appartenu au défunt et que les premiers ont conservé par devers eux. Les héritiers défendeurs opposent toutefois qu'ils étaient copropriétaires des biens litigieux, pour les avoir acquis avec T. Bilien, et se prévalent de l'article 2279 du Code civil (règle de preuve). La cour d'appel de Bruxelles a fait droit à l'action en revendication au motif que la possession des défendeurs est équivoque dès lors qu'il est impossible de déterminer s'ils ont possédé les biens "comme propriétaires (de ceux-ci) ou comme cohabitant avec le défunt". Pourvoi des héritiers concernés qui invoquent, comme dans les affaires précédentes, la violation des règles de preuve. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Cette fois, la Cour a rejeté le pourvoi au motif que : "suivant l'arrêt, la demande des défendeurs n'a pas pour objet la restitution de biens mobiliers par un détenteur, sur la base d'une action en restitution de biens dépendant de la succession, mais constitue une demande en revendication de ces biens formée par les défendeurs" ; qu'étant donné que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une possession non équivoque", les défendeurs sont en droit d'établir leur droit de propriété par toutes voies de droit, en ce compris par présomptions déduites d'actes, d'écrits ou de tous autres moyens". L'arrêt se poursuit par un rappel du contenu de la décision de fond à cet égard, et par le rejet de la deuxième branche du moyen, l'arrêt attaqué ayant légalement statué. Cet arrêt doit être approuvé. Il distingue clairement l'action réelle en revendication de l'action personnelle en restitution, et pose le principe, tout à fait exact, de la liberté de la preuve quant à son droit de propriété, dans le chef de la partie ayant agi en revendication, après qu'elle ait renversé la présomption de titre déduite de l'article 2279 en tant que règle de preuve. On regrettera simplement que la Cour n'ait pas fait référence également à l'article 2230 du Code civil, ce qui eût permis de montrer l'articulation de cette importante disposition avec l'article 2279, alinéa Ier, règle de preuve. Mais la Cour ne joue pas le rôle de professeur de droit ... Enfin, si la Cour a pu statuer avec autant de clarté dans cette cause, c'est sans doute parce que les parties demanderesses avaient exclusivement agi en revendication, sans qu'une équivoque apparaisse quant à une qualification de l'action en tant qu'action en restitution. Il n'existait donc pas un risque de confusion, à la base du litige, entre action en revendication et action en restitution, comme dans les deux affaires précédentes.
(35) Cass., du 12 mars 1999
Cette affaire présente des similitudes avec la précédente (cfr. Décision n°34). Le juge d'appel, réformant la décision de première instance, avait également mis à charge d'une dame Debrie une responsabilité pour troubles de voisinage du chef des dommages causés à son voisin Plessers à la suite d'un incendie (il s'agissait de dégâts des eaux ayant suivi un incendie dans une discothèque). Dans son pourvoi, la dame Debrie critiqua la décision attaquée au motif qu'elle n'avait pas constaté que le trouble lui était imputable (cfr. le long exposé de la critique dans le "alors que" du moyen). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a fait droit au moyen et décidé que : " nul ne peut être obligé de compenser un trouble anormal de voisinage, que si ce trouble a été causé par un fait, une omission ou un comportement qui lui est imputable ; que l'arrêt constate que le trouble anormal de voisinage invoqué consiste en les conséquences d'un incendie qui s'est déclaré dans l'immeuble de la demanderesse ; qu'il décide que, le défendeur ayant subi un trouble, il y a eu rupture de l'équilibre entre voisins, sans indiqué le moindre comportement susceptible d'être imputé à la demanderesse ; que dès lors, il viole les dispositions légales citées au moyen". Cet arrêt confirme l'enseignement à déduire des arrêts précédents et pose le problème des troubles de voisinage dont la cause est difficilement décelable. La Cour de cassation réaffirmera encore la condition d'imputabilité dans l'arrêt du 25 avril 2003 examiné supra (cfr. Décision n° 24bis). Au sujet de la condition d'imputabilité objective, on se référera par ailleurs aux conclusions du Procureur général M. Dumon ayant précédé l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 1981 (cfr. Décision n° 30), ainsi, analogiquement, qu'à la condition d'imputabilité dégagée en matière d'apparence sans base de faute (autre cas de responsabilité objective fondé sur le principe général d'équité), par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2000. En matière d'apparence sans faute, volet du principe générale du droit de l'apparence, constitutif comme la théorie des troubles de voisinage d'une responsabilité extra-contractuelle sans faute, il faut aussi relever que la situation d'apparence est imputable à un sujet de droit qui l'a créée, par un comportement d'action ou d'omission, à l'origine de l'erreur légitime du tiers et finalement du dommage subi par ce dernier. La condition d'imputabilité est donc pour cette théorie exactement de même nature qu'en matière de troubles de voisinage.
(2) Jugement du tribunal de commerce d'Anvers - affaire Minerva
Dans un litige de droit de la faillite concernant des biens de la société Minerva, le jugement rendu a approfondi la compréhension de l'immobilisation par destination à la suite d'une affectation, en mettant en évidence les éléments suivants : 1) l'immobilisation par destination est une fiction juridique puisqu'un bien qui est naturellement meuble, est présumé par la loi immeuble en raison de son affectation à un immeuble, pour l'utilité économique de ce dernier et ce aux fins de développer une forme d'unité économique des biens ; 2) ce qui importe, ce n'est pas le simple fait que le bien meuble se trouve dans le bâtiment concerné (première thèse extensive soutenue en la cause), ni, à l'opposé, que l'immeuble en question ait été "spécialement destiné à une industrie déterminée" et "ab initio" spécialement construit, adapté ou aménagé pour l'exploitation de cette industrie afin d'accueillir dans ce cadre précis les biens meubles y étant affectés (seconde thèse restrictive), mais la réalité de l'affectation économique ; 3) cette dernière est elle-même déduite d'éléments divers tels que : le fait que l'immeuble doit avoir été agencé pour contenir les machines y affectées ; le fait que les machines "doivent être installées selon les exigences d'une industrie déterminée au service de laquelle elles peuvent être utilisées" ; et "il importe ainsi de préciser quels sont les objets mobiliers qui participent à cette destination d'ensemble de l'immeuble industriel", "en étant utilisés à l'accomplissement du processus de production", avec pour conséquence que le tribunal a admis en l'espèce la qualification d'immeubles par destination à l'égard des biens litigieux.
(151) Cass., du 03 juin 1937
Deux fonds apparemment enclavés accédaient à la voie publique par un chemin de desserte commun se situant à cheval sur la limite séparative des fonds. Une contestation naquit entre les propriétaires des fonds au sujet du statut du chemin. L'un des propriétaires plaida adroitement la prescription de la copropriété du chemin, par lui-même et ses auteurs, le chemin ayant été "copossédé" pendant au moins trente ans. Le premier juge fut convaincu en estimant qu'il fallait tenir compte de la possession exercée par les propriétaires successifs du terrain. La cour d'appel de Bruxelles admit également la prescription de la copropriété, mais releva qu'il suffisait de tenir compte de la possession des propriétaires actuels du fonds, et même simplement de celle de leurs auteurs, le délai trentenaire étant déjà établi dans le chef de ces derniers. Les demandeurs en cassation, contestant cette "usucapion" de la copropriété du chemin dans le chef de leur voisin, se pourvurent en cassation en soutenant : 1) dans un premier moven, que la décision d'appel était contradictoire dans sa constatation de la possession par les parties concernées, et 2) dans un second moyen, cet argument étant encore plus intéressant, que l'on ne peut prescrire un droit sans être conscient de l'étendue précise de celui-ci, or en l'espèce il n'y avait pas eu une telle conscience, un véritable "animus domini", dans le chef des défendeurs (violation des règles de base du Code civil en matière de possession et de prescription). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation rejeta le premier moyen en considérant que la décision de fond n'était pas entachée de contradiction, dès lors qu'elle avait relevé que les auteurs des défendeurs avaient déjà prescrit par eux-mêmes le droit de copropriété, le délai de prescription étant acquis à leur niveau. Quant au second moyen, la Cour décide "qu'aucune des dispositions légales dont la violation est invoquée n'exige, comme condition de la prescription acquisitive par possession trentenaire, que la partie qui s'en prévaut connaisse exactement l'étendue de ses droits : que l'incertitude du possesseur à cet égard n'est nullement incompatible avec l'exercice d'une possession à titre de propriétaire ; que le moyen manque en droit". Cet arrêt est important, d'abord par le principe qu'il énonce au sujet du mécanisme de la prescription dans sa composante "d'animus domini", ensuite par la possibilité qu'il illustre, en pratique, de régler des situations d'acquisition de droit sur des chemins communs à des propriétaires voisins par la prescription d'un droit de copropriété. Cette copropriété me paraît devoir être qualifiée de copropriété forcée à titre accessoire à laquelle l'article 815 du Code civil ne peut s'appliquer. L'on ne peut donc en sortir en demandant le partage. En pratique encore, pour que l'on puisse parler d'une copropriété, il faut qu'il s'agisse en principe d'une chemin de desserte, desservant deux fonds voisins.
(112BIS) Cass., du 01 janvier 2005
La Cour d'arbitrage avait été saisie d'une question préjudicielle portant sur l'article 2277 du Code civil lui demandant si cette disposition en tant qu'elle créerait une distinction injustifiée entre des débiteurs tenus de dettes périodiques, serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'elle distinguerait plus précisément entre des débiteurs de sommes dues à titre d'intérêts, et de sommes dues dans le cadre de demandes comprenant des éléments autres que des intérêts ou des revenus, donc en capital. La Cour fut amenée à préciser si, dans l'affirmative quant à la réponse à la première question, il existerait une autre interprétation de l'article 2277 qui rendrait cette norme compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Ces questions furent posées dans une affaire portant sur une dette purement en capital à caractère périodique, à savoir une dette de consommation d'eau. La Cour répondit positivement aux deux questions. Nous retenons les passages suivants de la motivation de l'arrêt : 1) rejet du critère de distinction entre dette d'intérêt et dette de capital : "le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante. En effet, par rapport à cet objectif, la dette relative à des fournitures d'eau est semblable aux dettes visées par l'article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu'elle est périodique et que son montant augmente avec l'écoulement du temps, elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce point importante qu'elle pourrait causer la ruine du débiteur ; 2) constat de violation des articles 10 et 11 de la Constitution à la suite de cette dernière interprétation, mais constat également d'une autre possible interprétation conciliante permettant d'éviter le constat du caractère discriminatoire de la norme : "interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu'il prévoit s'applique aux dettes périodiques relatives à la fourniture d'eau, l'article 2277 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution". Cet arrêt est tout à fait convaincant. Il est basé sur une interprétation raisonnablement extensive et téléologique de l'article 2277 qui est dans la ligne des travaux préparatoires du Code civil. L'article doit pouvoir s'appliquer en effet à d'autres dettes qu'en intérêts, donc même en capital, à savoir des fournitures de biens et de services, pour autant qu'elles soient caractérisées par une périodicité dans leur existence même", telles que les dettes de consommation d'eau, d'électricité, de gaz,... C'est d'ailleurs ce que la Cour de cassation admettra finalement elle-même par un arrêt du 25 janvier 2010, et qui sera consacré par le législateur en juillet 2017.
(34) Cass., du 03 avril 1998
La partie "en ce que" du moyen nous indique que le jugement attaqué, rendu en justice de paix, en premier et dernier ressort (en raison du montant modique de la demande, inférieur à 75.000 FB), a condamné le demandeur à payer une somme de 35.164 FB en principal, "en raison de la fumée qui avait envahi l'appartement du défendeur en provenance de l'appartement du demandeur où un incendie s'était déclaré". La décision était motivée comme suit : "l'énoncé des faits établit à suffisance qu'il y a eu rupture d'équilibre dans les relations de voisinage et que le trouble subi par le défendeur trouve son origine dans l'incendie survenu à l'appartement du demandeur ; l'énoncé même des faits assoit à suffisance la demande sur pied de l'article 544 du Code civil". Cette motivation était-elle suffisante pour établir que l'incendie lui-même était imputable à un comportement du demandeur en cassation ? On pouvait en douter et le demandeur a dès lors développé un moyen unique posant, en des termes remarquables, la condition d'imputabilité : "pour pouvoir obtenir la condamnation de son voisin sur pied de l'article 544 du Code civil, le demandeur à l'action doit établir que le fait à l'origine du trouble 'anormal' de voisinage est imputable au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble voisin ; que la seule constatation d'un trouble anormal en provenance du fonds voisin ne suffit pas à faire naître la responsabilité du voisin sur pied de l'article 544 du Code civil ; qu'en effet, si le trouble et le dommage en résultant ne sont pas dus à un quelconque comportement (fait ou omission) du voisin, propriétaire ou usufruitier, celui-ci ne peut être tenu pour responsable en vertu de l'article 544 du Code civil, l'application de cette disposition supposant que le voisin ait usé d'une manière quelconque du droit de 'propriété' sur son immeuble et/ou d'un attribut de ce droit et qu'il ait créé de ce fait une rupture d'équilibre". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a fait droit au moyen et cassé aux motifs que : "le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait ou une omission ou un comportement quelconque, rompt l'équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l'égalité rompue", et "qu'en admettant l'existence d'un trouble anormal de voisinage sans constater qu'il trouve son origine dans le comportement du demandeur, le jugement ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur sur la base de l 'article 544 du Code civil". Le premier attendu est, me semble-t-il, meilleur que l'attendu central de l'arrêt précédent, dans la mesure où il distingue à juste titre le trouble de sa cause, à savoir le comportement de la partie concernée. La formule de base aurait pu sans doute être condensée davantage, par une référence uniquement à un comportement, action ou abstention (en ce compris donc une omission). Le second attendu insiste bien sur la condition d'imputabilité objective, non constatée dans les faits de la cause, d'où la cassation qui est prononcée.
(138) Cass., du 14 décembre 1962
La servitude de passage était d'origine conventionnelle dans cette espèce. Une action en justice portait sur la question de la disparition de cette servitude, qui a été admise par un juge de paix aux termes d'un raisonnement de droit des obligations assez subtil : 1) le juge a constaté que la volonté des parties avait été de faire cesser la servitude avec l'état d'enclave ; 2) la volonté tacite mais certaine des parties, résultant de l'exécution que les parties avaient donnée à leur convention, a pu être dégagée par le juge en ce sens ; 3) il en a découlé la constatation de l'existence d'une condition résolutoire tacite affectant la servitude conventionnelle. Ce raisonnement fut attaqué par la propriétaire du fonds dominant qui plaida la violation de la convention-loi et de l'irrévocabilité des servitudes conventionnelles. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : C'est à juste titre que la Cour de cassation a validé le raisonnement du juge du fond, et a rejeté le pourvoi sur la base d'un pur raisonnement de droit des obligations qui est le suivant : 1) rappel de principe : après référence au contenu de la décision de fond, la Cour rappelle que : "une servitude de passage établie par convention est, en principe, perpétuelle, de sorte que le droit ne s'éteint pas, comme le droit légal de passage, du seul fait de la disparition de l'état d'enclave du fond dominant" ; 2) exception au principe : "qu'aucune règle légale ne s'oppose cependant à ce que les parties dérogent à ce principe en affectant le droit du propriétaire du fonds dominant d'un terme ou d'une condition résolutoire et notamment en stipulant, comme en l'espèce, que le droit de passage prendra fin avec l'état d'enclave de ce fonds" ; 2) exception au principe : "qu'aucune règle légale ne s'oppose cependant à ce que les parties dérogent à ce principe en affectant le droit du propriétaire du fonds dominant d'un terme ou d'une condition résolutoire et notamment en stipulant, comme en l'espèce, que le droit de passage prendra fin avec l'état d'enclave de ce fonds" ; 3) application à l'examen de la décision de fond : "attendu que, pour décider que les parties ont entendu limiter la durée du droit de passage, le jugement ne se fonde pas, comme le suppose le moyen, sur ce que l'établissement d'un droit de passage conventionnel trouve nécessairement sa cause dans le fait de l'enclave et ne peut avoir comme cause et fondement une autre utilité pour le fonds dominant ; qu'il constate que "l'intention des parties a été de donner une issue au fonds dominant en raison de son état d'enclave", et qu'"il est manifeste qu'il n'y a pas d'autre raison pour consentir un droit de passage" ; que le moyen ne peut être accueilli". Il convient d'approuver cet arrêt astucieux, qui pourra inspirer les juges du fond dans certaines situations et venir au secours de propriétaires de fonds servants, qui auraient oublié de faire régler expressément par la convention la question de la cessation de la servitude avec l'état d'enclave en en prévoyant expressément ou de façon implicite mais certaine le principe dans la convention.
(148) Cass., du 14 février 1969
La situation était encore plus extrême que dans l'affaire précédente puisque, cette fois, les demandeurs X agissant dans le sens de la reconnaissance d'une servitude légale au profit de leur fonds enclavé, plaidaient avoir acquis cette dernière, non sur le fonds de Y, où elle aurait dû s'exercer normalement en tant que fonds offrant une assiette et un accès vers la voie publique le plus court et le moins dommageable (cfr. art. 683 el 684 du Code civil), mais sur le fonds de Z, où le chemin litigieux était plus long, en permettant d'accéder à une autre voie publique. Une prescription trentenaire de l'assiette et des modalités d'exercice du chemin litigieux était-elle, dans ses conditions, admissible ? La situation était plus extrême que dans l'affaire précédente puisque dans cette affaire, le passage était revendiqué sur un autre fonds que celui sur lequel il aurait dû normalement porter si l'on avait appliqué les articles 682 à 684 du Code civil. Le juge du fond rejeta la demande de X tendant à se voir reconnaître une servitude légale en rapport avec le chemin passant sur le fonds de Z. X attaqua cette décision en se basant essentiellement sur la théorie de la prescription de l'assiette et du mode d'exercice de la servitude admise dans l'arrêt antérieur, et en soutenant que le juge d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions à cet égard. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Comme dans l'affaire précédente, la Cour de cassation a déclaré fondé le pourvoi aux motifs que : - "en ses conclusions devant le juge d'appel, le demandeur a offert la preuve de ce qu'il avait acquis par prescription l'assiette de la servitude de passage réclamée à charge du fonds des défendeurs" ; - "après avoir constaté que le fonds du demandeur est enclavé et qu'il n'existe pas en sa faveur de titre conventionnel de servitude, le jugement décide que le demandeur ne peut prendre passage sur le fonds des défendeurs, par le motif que le passage sur ce fonds ne répond pas aux conditions déterminées par les articles 683 et 684 du Code civil ; attendu qu'ainsi le jugement ne rencontre pas de manière adéquate les dites conclusions" ; -''qu'en effet, le propriétaire d'un fonds enclavé, qui trouve le titre de la servitude de passage dans la loi même, peut faire reconnaître en justice que l'assiette de la servitude légale de passage n 'est pas celle que déterminent les articles 683 et 684 susdits, mais celle qu'il a acquise par prescription trentenaire, même si cette assiette ne se trouve pas sur le fonds qui permet le trajet le plus court et le moins dommageable". Cet arrêt, plus condensé que le précédent dans sa motivation et se situant sur le terrain plus limité de la régularité de ta motivation du juge du fond, est toutefois plus critiquable encore puisqu'il admet la prescription de l'assiette d'une servitude légale sur un fonds qui n'aurait pas dû être le fonds assujetti si l'on avait appliqué correctement les articles 682 à 684 du Code civil. En outre, la Cour de cassation avait toutefois déjà mis fin à ce type de raisonnement, plus d'une décennie plus tôt, en matière de servitude conventionnelle de passage, ce qui rend l'arrêt de 1969 encore plus critiquable.
(135) Cass., du 12 mars 1981
Le fonds de X bénéficiait d'un chemin vers la voie publique, d'une largeur de 2,25 mètres. Une maison d'habitation se trouvait sur le fonds qui était à usage privé. En 1975, X se mit à exercer sur son fonds un commerce de garagiste ferronnier. Le chemin servit donc régulièrement au passage de véhicules qui dépassèrent les limites du chemin. Le voisin Y plaça dès lors une clôture constituée de piquets en béton et d'un treillis métallique, pour limiter le passage à sa largeur d'origine. X intenta en conséquence une action en justice pour obtenir une servitude légale de passage à concurrence d'un mètre supplémentaire, ce qui lui fut refusé en degré d'appel par le tribunal civil de Charleroi au motif qu'en transformant sa propriété en garage, il en avait changé la destination et ne pouvait légalement, sur cette base, obtenir une servitude légale de passage. X s'est pourvu en cassation et a soutenu qu'un changement de destination d'un fonds pouvait fonder une demande d'octroi d'une servitude légale de passage, ce qui fut rejeté par la Cour de cassation. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour motive comme suit le rejet du pourvoi : ''si l'article 682 (nouveau) reconnaît au propriétaire du fonds enclavé le droit de réclamer un passage sur le fonds de ses voisins, même lorsque l'insuffisance de l'issue sur le voie publique résulte d'une mise en valeur par lui de sa propriété, elle subordonne néanmoins l'attribution de ce droit à la condition que le fonds soit utilisé normalement d'après sa destination ; attendu que le jugement constate d'une part, que la destination du bien est celle d'une maison d'habitation, d'autre part, que le passage réclamé par les propriétaires pour disposer d'une accès suffisant à la voie publique dans l'activité de l'activité commerciale du garagiste, que le premier demandeur a établie sur sa propriété, dont il a ainsi transformé la destination, n'est pas indispensable à l'utilisation d'une maison d'habitation ; qu'en se fondant sur ces constatations, le jugement a pu légalement décider que la demande n'était pas fondée''. Nous approuvons cet arrêt : la mise en valeur d'un fonds enclavé est admissible et peut justifier l'octroi d'une nouvelle servitude légale de passage, ou d'une servitude plus importante quant à son assiette et ses modalités d'exercice ; il n'en va pas de même en cas de changement de la destination du fond. L'équité s'y oppose ainsi que la sécurité juridique.
(103) Cass., du 14 novembre 1985 - affaire Poussart/Imbiscuso
Le sieur Poussart avait diligenté une action en remboursement d'une somme de 150.000 FB contre des consorts Imbiscuso et Poussart. Le premier prétendait que la somme avait été prêtée tandis que les seconds invoquaient qu'elle leur avait été donnée. Le juge du fond a condamné les défendeurs au remboursement de la somme d'argent au motif que ceux-ci avaient échoué à rapporter la preuve d'une intention libérale dans le chef du prétendu donateur. Le juge du fond a précisé que : "les défendeurs ne peuvent utilement, en la cause, prétendre au bénéfice de l'article 2279 du Code civil". Que signifiait cet élément de la motivation ? Simplement que nous n'étions pas dans le champ d'application de l'article 2279, la cause étant une demande personnelle de remboursement d'une somme d'argent, et non une demande en revendication de la propriété d'un bien meuble corporel individualisé. Cette fois, les parties avaient engagé le débat juridique sur de bonnes bases. Imbiscuso et Poussart se sont pourvus en cassation contre la décision de fond, au motif que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la seule circonstance qu'une partie reconnaît la réalité de la remise matérielle d'une somme d'argent, en indiquant qu'il s'agit d'un don, ne dispense pas celui qui, se prévalant de la qualité de prêteur, demande le remboursement de cette somme, d'établir l'existence et les modalités du contrat de prêt, et ce même si celui contre lequel l'action est dirigée ne peut bénéficier de l'article 2279 du Code civil parce que la somme d'argent n'a pas été individualisée" (d'où la violation essentiellement de l'article 1315 du Code civil). Le pourvoi était en effet tout à fait pertinent et justifié : le juge avait fait droit à l'action en remboursement en mettant à charge des défendeurs originaires (Imbiscuso et Poussart) une preuve de l'intention libérale, alors qu'il aurait dû également examiner si le demandeur (Poussart) avait bien rapporté la preuve de l'obligation qu'il invoquait, conformément au droit commun des obligations et des contrats. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : A juste titre, la Cour a fait droit au pourvoi et a cassé aux motifs que : "s'il ressort de l'arrêt que la preuve a été rapportée, par l'aveu judiciaire de la demanderesse, de la remise à celle-ci par le défendeur de la somme de 150.000 francs, par contre, il n'apparaît pas des énonciations de l'arrêt que le défendeur, qui soutenait avoir remis cette somme à titre de prêt et qui en réclamait le remboursement en principal et intérêts, ait apporté la preuve de l'existence d'un tel contrat de prêt ; qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen est fondé". Il convient d'approuver pleinement cet arrêt qui n'est pas une application de l'article 2279 du Code civil, la cause en question ne portant pas sur une action en revendication, mais une application du droit commun de la preuve civile à une action personnelle en remboursement d'une somme d'argent soumise au droit des obligations.
(18) Cass., du 28 juin 1990
Les éléments de base de l'espèce, tels que relevés par l'arrêt de fond, sont résumés ainsi par la Cour de cassation : "l'arrêt constate que les défendeurs (auteurs des troubles de voisinage) ont, en 1971, décidé la construction d'un hôtel qui a nécessité jusqu'en avril 1973 des travaux de démolition puis, en juin 1973, le placement de pieux et étançons ; que le demandeur a signalé, le 20 juin 1973, l'apparition de fissures dans son immeuble qu'il a vendu en 1974, c'est-à-dire deux ans avant l'intentement de l'action". Le demandeur Evans possédait-il dès lors encore un intérêt à agir en responsabilité sans faute sur pied de la théorie des troubles de voisinage, alors qu'il n'était plus propriétaire de son immeuble et l'avait vendu près de deux ans avant d'introduire son action en justice ? La cour d'appel de Bruxelles a répondu négativement à cette question et a décidé que Mr. Evans n'avait pas d'intérêt à agir au sens du droit judiciaire, n'étant plus propriétaire de l'immeuble. Mr. Evans s'est dès lors pourvu en cassation, en invoquant "qu'en vertu du principe général d'équilibre des droits relatifs aux propriétés consacré par les articles 11 de la Constitution et 544 du Code civil, la victime d'un trouble excessif de voisinage acquiert par ce fait et contre l'auteur du trouble, un droit personnel à juste et adéquate compensation". ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a prononcé la cassation de la décision entreprise au motif qu'elle "n'a pu, sans violer les dispositions légales invoquées en cette branche du moyen, déduire le défaut d'intérêt du demandeur de la circonstance qu'au moment de l'intentement de l'action, il n'était plus propriétaire de l'immeuble". La Cour de cassation aurait pu donner un fondement de principe exprès à cette déduction. Elle ne l'a pas fait et l'arrêt laissera le commentateur quelque peu sur sa faim. La solution retenue est cependant convaincante et l'on peut en déduire que l'action en responsabilité sans faute pour troubles de voisinage, revêt, comme toute action en responsabilité pour faute de droit commun, un caractère personnel attaché à la personne de celui qui a subi le dommage résultant du trouble, cette personne conservant donc en principe un intérêt à agir contre l'auteur du trouble même si elle cède ultérieurement son bien. L'action ne suit donc pas le sort du bien litigieux. Il n'y a aucune raison pour qu'il en soit ainsi et pour que l'action acquière une nature que l'on pourrait qualifier de "réelle", à défaut de disposition légale qui poserait un tel principe, qui serait au demeurant lui-même dérogatoire au droit commun.
(43) Cass., du 05 octobre 1989
Plusieurs "roussoirs" (à savoir des machines à tisser le lin) étaient en copropriété et avaient d'abord été exploités par les différents copropriétaires ensemble jusqu'en 1980. Par la suite, cinq des copropriétaires décidèrent de donner à bail cinq machines et le matériel lié à celles-ci à des tiers, sans la participation de l'un des copropriétaires. Ce dernier attaqua le contrat de location pour non-respect de la règle de l'unanimité. Dans cette affaire, à la différence des cas précédents, c'était donc un copropriétaire lésé n'ayant pas été partie à l'acte litigieux, et non un tiers à la copropriété, qui se prévalait directement du non-respect de la règle de l'unanimité et attaquait l'acte en question, en demandant qu'il soit déclaré nul ou à tout le moins inopposable à son égard. La décision de fond n'a pas fait droit à cette action, qui paraissait pourtant fondée, d'où le pourvoi en cassation du copropriétaire intéressé dont nous n'avons pas le texte dans la publication au R. W mais dont on peut imaginer le contenu (violation de la notion légale d'acte d'administration et de la règle de l'unanimité). ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : Comme on pouvait s'y attendre, la Cour de cassation a, à juste titre, cassé la décision entreprise en rappelant que la conclusion d'un bail n'était ni un acte conservatoire ni un acte d'administration provisoire au sens de l'article 577bis, § 5, et qu'un tel acte, pour être "valable", devait avoir été passé moyennant la participation de tous les copropriétaires. Cet arrêt illustre donc un cas où c'est un copropriétaire, et non un "tiers" à la copropriété, qui a demandé l'application de la sanction résultant du non-respect de la règle de l'unanimité. Cette sanction aurait dû être prononcée par le juge du fond. Elle aurait dû résider dans le défaut de "validité" de l'acte en question, du moins si l'on se réfère, à la lettre, aux termes mêmes de l'article 577bis (-2) § 6 (c'est d'ailleurs ce que la Cour de cassation a fait). On peut penser cependant qu'il eût été plus exact de parler d'inopposabilité de l'acte au copropriétaire lésé : 1) l'acte était en principe valable entre parties (à savoir entre le bailleur et le locataire) ; 2) avant d'être déclaré inopposable au copropriétaire (tiers à l'acte) l'ayant attaqué avec succès ; 3) cette inopposabilité impliquant par voie de conséquence, en finale, l'anéantissement de l'acte en question entre parties, car il ne peut de toute façon sortir ses effets vis-à-vis du ou des copropriétaires lésés ; 4) et impliquant aussi le possible engagement d'une responsabilité contractuelle du(es) copropriétaire(s) ayant contracté avec le tiers sans respecter la règle de l'unanimité, si ce tiers peut lui (leur) reprocher une faute en relation causale avec son dommage.
(136) Cass., du 01 mars 1984
Plusieurs petites maisons assez anciennes se trouvaient sur des fonds enclavés. A l'origine, elles ne bénéficiaient pas d'un passage vers la voie publique permettant d'y accéder en voiture. Il s'agissait de petites maisons rurales, sans confort moderne et sans garage, acquises à bon marché par des citadins, ainsi que le releva le juge du fond saisi du litige. Les propriétaires de ces maisons agirent en justice pour se voir reconnaître une servitude légale de passage, permettant d'accéder en voiture vers les maisons et vers les garages qui y seraient construits. Le nouveau chemin en question serait long de près de deux cent mètres sur le fonds servant, à supposer la servitude accordée. Le tribunal civil de Courtrai refusa de faire droit à l'action eu égard à la situation des fonds et au fait que les servitudes ne pouvaient être octroyées en ayant pour conséquence l'obtention d'une plus-value pour les fonds dominant et la création de grands inconvénients imposés au fonds servant. Les demandeurs originaires invoquèrent la violation de l'article 682 du Code civil, qui fut cependant écartée par la Cour de cassation. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que : "si le passage réclamé peut entraîner de grands inconvénients pour le fonds servant et procurer une plus-value inhabituelle au fonds dominant, le juge peut prendre entre autres en considération ces éléments de fait pour apprécier le caractère normal de l'utilisation visée ; qu'en considérant que l'utilisation normale des biens litigieux ne requiert pas d'y accéder en voiture, le tribunal ne viole pas l'article 682 § 1er, parce qu'il s'agit de très petites maisons". Cet arrêt est très restrictif, sans doute trop à la lumière d'un récent arrêt de la Cour de cassation ci-après examiné. De l'arrêt se déduit également le principe suivant lequel le juge du fond apprécie souverainement l'existence en fait de la seconde condition de l'article 682, § 1er (conformité de la servitude à l'affectation normale du fonds d'après sa destination). Ce pouvoir d'appréciation est large et échappera au contrôle de la Cour de cassation dès lors que le juge aura justifié concrètement la manière dont il a entendu appliquer l'article 682 du Code civil en l'espèce.
(90) Cass., du 29 septembre 1972
Sur une bande de terrain de 3,90 m de large, s'exerçait un droit de passage au profit des deux voisins X et Y. La limite des fonds respectifs passait quelque part endéans cette bande, sans que l'on sache exactement la déterminer. A un certain moment, le voisin Y ferma le droit de passage sur une largeur de 2,40 m, en considérant que la limite de sa propriété s'exerçait jusque-là. La partie X. intenta dès lors une action en réintégrande, en invoquant l'existence d'une voie de fait. Le tribunal de première instance d'Audenarde, statuant en degré d'appel, rejeta l'action pour deux types de motifs : 1) le tribunal tira d'abord argument de ce qu'il n'était pas possible d'acquérir par prescription acquisitive l'assiette d'un chemin d'issue ; 2) il décida ensuite ("contra legem") que l'action dont il était saisi impliquait la démonstration d'une possession utile, non rapportée en l'espèce. Le pourvoi en cassation introduit par la partie qui avait été déboutée de sa réintégrande, invoqua en conséquence : 1) essentiellement la violation de la foi due aux actes (plus précisément de l'exploit introductif d'instance), en ce que l'action intentée ne l'avait pas été sur la base de la violation d'une servitude de passage, mais bien d'un droit exercé à titre de propriétaire ; 2) était également invoquée la violation, cette fois tout à fait évidente, de l'article 1370 du Code judiciaire, dont le dernier alinéa ne requiert pas la condition de possession utile dans le cadre de la réintégrande. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : La décision de fond a été cassée suite au deuxième argument que nous venons de voir. Quant au premier, la Cour de cassation a considéré qu'il manquait en fait au motif que le juge du fond s'était prononcé sur la base d'un droit de propriété, en relevant toutefois que "rien n'était établi à ce sujet". Quant au second argument, la cassation fut évidemment prononcée sur cette base, la Cour précisant que : "le demandeur, qui a intenté une action possessoire en se fondant sur un trouble possessoire causé par une voie de fait des défendeurs, à savoir la fermeture partielle du chemin d'accès et de sortie situé entre les deux héritages, ne devait pas, en vertu de l'article 1370, dernier alinéa, du Code judiciaire, établir une possession civile, avec les caractères requis par les articles 2228 et suivants du Code civil, sur le passage litigieux ; que l'action en réintégrande, qui vise à assurer le maintien de la paix publique et qui applique à cet effet la maxime Spoliatus ante omnia restituendus, est accordée à tout détenteur du bien quel qu'il soif.
(52) Cass., du 13 novembre 1952
Un mur avait été édifié par une sieur Bayet, empiétant sur le fonds du sieur Artois, sans que Mr. Bayet ait demandé l'application de l'article 663 du Code civil. Artois avait par conséquent agi en démolition du mur, en se fondant essentiellement sur l'usurpation de sa propriété, qui avait été faite sans titre ni droit. Pouvait-il être fait droit à cette action alors que, si elle aboutissait à une démolition du mur, le voisin Bayet se serait par la suite, de toute façon, retrouvé en situation de demander l'application normale de l'article 663 du Code civil, d'où une nouvelle construction, à frais communs cette fois, du mur (ce qui aurait été une solution du litige passablement absurde et excessive dans ses conséquences) ? Le juge du fond refusa, dans un tel contexte, de faire droit à l'action en démolition. Sa décision fut dès lors attaquée en cassation pour avoir violé le droit de propriété, dit absolu, du demandeur Artois (violation de l'article 544 du Code civil et autres dispositions liées), ainsi que, entre autres, l'article 663 du Code civil. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION ET COMMENTAIRE : A juste titre, la Cour de cassation a décidé que le juge du fond n'avait violé aucune disposition légale : "si, en effet, le propriétaire du fonds sur lequel empiète une construction élevée sur le fonds voisin, peut exiger l'enlèvement de cette construction, dans la mesure de l'empiétement, c'est sous la réserve qu'il n'ait pas donné un consentement, soit exprès, soit tacite, à la dite construction ou qu'il ne soit pas légalement tenu d'y consentir" ; ajoutons : en vertu de l'article 663 du Code civil. Il convient d'approuver cet arrêt, qui laisse cependant dans l'ombre la question de l'indemnisation éventuelle des conséquences de l'usurpation. En réalité, il n'y aurait pas lieu à indemnisation, puisque : 1) de toute façon, dans le système de l'article 663 du Code civil, le voisin devrait accepter que le mur mitoyen soit construit "à cheval" sur son fonds, sans indemnisation de ce chef ; c'est là chose normale puisqu'il devient copropriétaire du mur qui par ailleurs profite à sa propriété ; et 2) d'autre part, le voisin constructeur qui a anticipé la construction du mur, s'il ne peut être obligé de le démolir à la demande de l'autre voisin, dès lors que les conditions légales de l'article 663 sont réunies et que le mur a été construit en toute légalité, ne peut bien sûr demander au voisin qui subit la construction une participation dans les frais de cette dernière, en vertu de l'enseignement à déduire de l'arrêt de la "veuve Douxchamps".