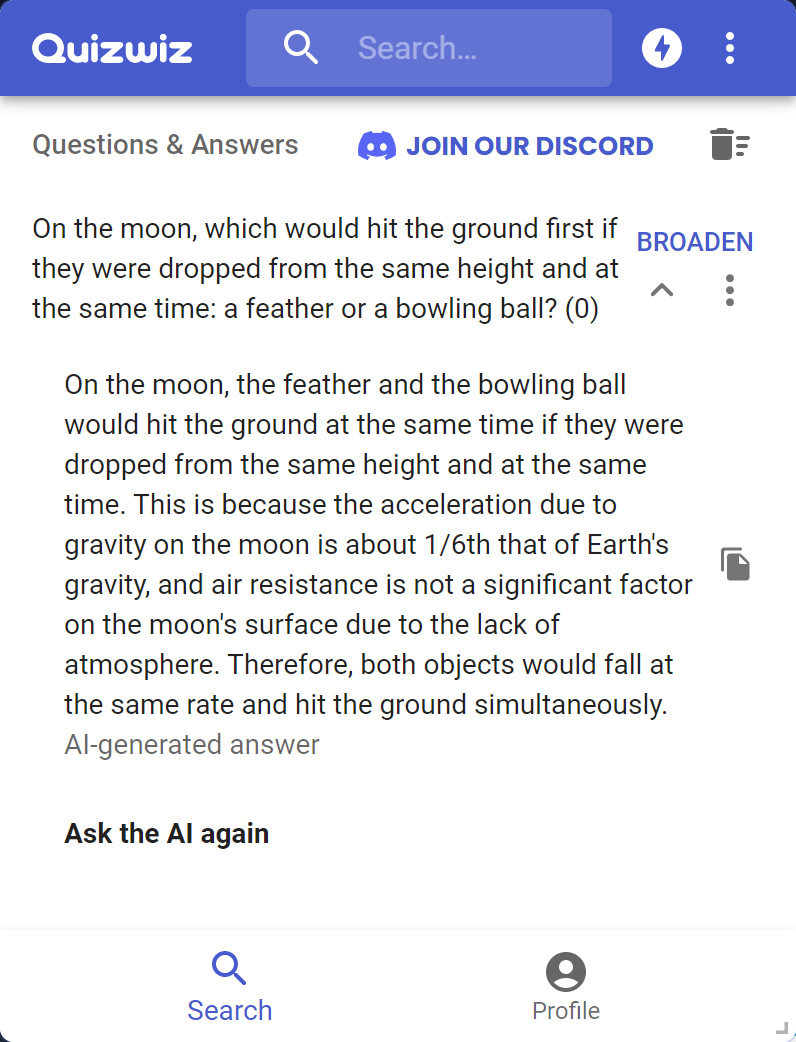👑 Arrêts droit constitutionnel
(22) Crise catalane
Une attention particulière mérite d'être portée à la crise institutionnelle liée aux revendications indépendantistes de la Catalogne. Rappelons sommairement les faits. La Cour constitutionnelle espagnole, saisie par une minorité parlementaire appartenant au Parti polaire, dans un arrêt n°31/2010 du 28 juin 2010, annule une partie de l'accord constitutionnel entre l'Etat espagnol et la Catalogne, accord qui avait été approuvé, lors d'une consultation populaire, par 74% des Catalans. Ainsi, notamment sont jugés inconstitutionnelles les références à la Nation catalane et à la réalité nationale de la Catalogne qui figuraient dans le Préambule du Statut de la Catalogne. Cette décision accentue les revendications indépendantistes en Catalogne. Lors des élections régionales de septembre 2015, les partis indépendantistes sont majoritaires en siège, mais non en voix. Ayant accédé au pouvoir, ils promettent l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. Celui-ci doit se tenir le 1er octobre 2017. Saisie par le gouvernement espagnol présidé par le leader du Parti populaire, Mariono Rajoy, revenu au pouvoir en 2011, la Cour constitutionnelle suspend la loi d'organisation du référendum. Dans un climat d'extrême tension et de violences policières, le référendum se tient néanmoins. Les autorités catalanes annoncent une participation de 43,03% et une victoire du oui à 90,18%. Après plusieurs semaines de tensions et de tergiversations, le Parlement catalan déclare d'indépendance de la Catalogne le 27 octobre 2017. Le même jour, à la demande du Premier ministre, le Sénat espagnol autorise le gouvernement à faire application de l'article 155 de la Constitution selon lequel, "si une communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt général de l'Espagne, le gouvernement, après une mise en demeure au président de la communauté autonome et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue du Sénat, peut pendre les mesures nécessaire pour obliger cette communauté à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt général mentionné" et "pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le gouvernement peut donner des instructions à toutes les autorités des communautés autonomes". Il est aussitôt décidé par le gouvernement espagnol de destituer le Président du Gouvernement de Catalogne, Carles Puigdemont, de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections régionales. On constate donc qu'en vertu de l'article 155 précité, la mise sous tutelle d'une communauté autonome suppose l'intervention du Sénat qui, en vertu de l'article 69 de la Constitution, est "chambre de la représentation du territoire", soit une assemblée qui est composée d'élus directs dans les provinces espagnoles (qui, comme en Belgique, sont à la fois des collectivités territoriales et des circonscriptions électorales) et de sénateurs désignés par les assemblées législatives ou par l'organe collégial supérieur de chaque communauté autonome, à concurrence d'un sénateur par communauté autonome, auquel s'ajoute "un autre sénateur pour chaque tranche d'un million d'habitants de leurs territoires respectifs". (p.720 - leçon 22)
(21) Cass., du 19 décembre 1991 - Anca I + Cass., du 08 décembre 1994 - Anca II
Par un arrêt du 19 décembre 1991, la Cour de cassation opère un REVIREMENT DE JURISPRUDENCE à ce sujet. En l'espèce, le Tribunal de commerce de Bruxelles a décrété d'office la faillite de la SPRL ANCA sans respecter les principes de la publicité et du caractère contradictoire des débats. En appel, la faillite est rapportée. Se fondant sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la SPRL ANCA introduit une action en responsabilité contre l'Etat afin d'obtenir la réparation du dommage occasionné par la décision illégale du tribunal. La demande est rejetée par le Tribunal de première instance de Bruxelles, puis par la Cour d'appel de Bruxelles, par application de la jurisprudence classique en la matière. Après avoir repris sa formule déjà utilisée 70 ans plus tôt lors de l'arrêt La Flandria, selon laquelle IL N'IMPORTE PAS D'AVOIR EGARD A LA QUALITE DES PARTIES, NI A LA NATURE DES ACTES QUI ONT CAUSE UNE LESION DE DROIT, "MAIS UNIQUEMENT A LA NATURE DU DROIT FAISANT L'OBJET DE LA CONTESTATION", la Cour de cassation estime que l'Etat peut être rendu responsable du dommage résultant d'une faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses attributions judiciaires. Elle indique, à cet égard, "que les principes de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent, ainsi que de l'autorité de la chose jugée n'impliquent pas que l'Etat serait, d'une manière générale, soustraite à l'obligation, résultant des articles articles 1382 et 1383 du Code civil, de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l'administration du service public de la justice, notamment dans l'accomplissement des actes qui constituent l'objet directe de la fonction juridictionnelle". Elle relève également "que la responsabilité de l'Etat n'est pas nécessairement exclue par le fait que celle de son organe ne peut, quant à elle, être engagée à la suite de l'acte dommageable que celui-ci a commis" et que "en l'état actuel de la législation, l'Etat peut, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, être, en règle, rendu responsable du dommage résultant d'une faute commise par un juge ou un officier du ministère public lorsque ce magistrat a agi dans les limites de ses attributions légales ou lorsque celui-ci doit être considéré comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent". L'arrêt du 19 décembre 1991 ne met pas fin au différent existant entre l'Etat belge et la SPRL ANCA. La Cour de cassation est, en effet, appelée à connaître d'un second pourvoi introduit par cette société contre l'arrêt rendu sur renvoi par la Cour d'appel de Liège et qui avait refusé l'octroi de dommages-intérêts en l'absence de faute et de lien de causalité. La Cour, dans un arrêt du 08 décembre 1994, rejette les prétentions de la demanderesse en affirmant que la FAUTE DU MAGISTRAT DOIT S'APPRECIER SUIVANT LE CRITERE DU MAGISTRAT NORMALEMENT SOIGNEUX ET PRUDENT, PLACE DANS LES MÊMES CONDITIONS. Elle précise que la Cour d'appel de Liège a, à bon droit, indiqué qu'à "l'époque où la faillite a été déclarée, une controverse existant tant en jurisprudence qu'en doctrine au sujet des normes applicables à la procédure de déclaration de faillite d'office et, la procédure suivie par le tribunal de commerce ne s'écartant pas à ce point des normes établies qu'un magistrat normalement soigneux et diligent aurait dû s'abstenir d'y avoir recours, l'arrêt a pu légalement déduire qu'aucune faute ne pouvait engager la responsabilité de l'Etat". Dans un arrêt du 26 juin 1998, la Cour de cassation constate d'ailleurs que toute erreur de droit d'un magistrat dans un acte juridictionnel, qui a ainsi commis une illégalité, ne s'analyse pas automatiquement comme une faute. Le magistrat dispose donc D'UN DROIT A L'ERREUR et il apparaît que le contrôle opéré sur la manière dont il a exercé sa fonction revêt un caractère marginal. La Cour d'appel de Bruxelles s'est également inscrite dans cette logique en affirmant que le juge ne peut être réputé avoir commis une faute lorsqu'il opte pour une thèse pouvant se réclamer d'une doctrine et d'une jurisprudence autorisées, quoique non unanimes. Dans son deuxième arrêt Anca, la Cour de cassation est également animée par le souci de préserver la cohérence du système judiciaire et pose d'autres restrictions à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de la fonction juridictionnelle. En effet, affirme-t-elle, lorsque l'acte dommageable "constitue l'objet direct de la fonction juridictionnelle, la demande tendant à la réparation du dommage ne peut, en règle, être reçue que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie et n'est plus, dès lors, revêtue de l'autorité de la chose jugée". En l'occurence, la faillite ayant été rapportée par la Cour d'appel de Bruxelles, une action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour la faute commise par le Tribunal de Bruxelles était possible. Il est requis, en outre, que le recours ait été accueilli en raison de "la violation d'une norme juridique établie", c'est-à-dire d'une règle de droit connue au moment où l'acte juridictionnel incriminé est intervenu. C'est, en effet, cette violation qui révèle le caractère illicite de la décision et, par voie de conséquence, la faute de son auteur. En application de cette jurisprudence, de nombreuses "fautes" commises par des juridictions ne peuvent faire l'objet d'une réparation dès lors que ceux qui les subissent ne disposeraient pas de moyens d'engager tous les recours nécessaires au retrait, à la réformation, à l'annulation ou à la rétraction de la décision qui leur font grief. Se pose aussi la question de la réparation d'un dommage causé par la faute d'une juridiction qui statue en dernier recours, sauf à considérer qu'elle a été censurée par une juridiction internationale. (p.695 - leçon 21)
(4) Avis SLCE - Traité de Maastricht + CJUE 323/97, du 09 juillet 1998 - Traité de Maastricht
Peut-on appliquer le même raisonnement que dans l'arrêt Fromagerie Franco-suisse Le Ski en cas de contradiction entre la Constitution et une norme de droit international ? Cette question s'est posée avec une acuité particulière en raison de la contradiction qui existait entre l'article 8 B §1 du Traité de Maastricht et l'article 8 ancien de la Constitution. En effet, la première de ces dispositions consacre le principe selon lequel "tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (...)". L'article 8, alinéa 2 de la Constitution, quant à lui, prévoyait simplement que : "la qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits". La Constitution posait donc le principe selon lequel, pour bénéficier d'un droit politique (et donc notamment celui d'être électeur et d'être éligible), il convenait d'être Belge. La section de législation du Conseil d'Etat, après avoir relevé l'existence d'une contradiction entre ces 2 textes, estime qu'il est indispensable de procéder à une révision de l'article 8 de la Constitution avant que ne soit votée la loi d'assentiment au Traité de Maastricht. Le gouvernement, se prévalant du fait que l'article 8 B §1 de ce traité n'était pas encore directement applicable en droit interne, refuse de s'engager dans cette voie, et reporte à une date ultérieure la révision de l'article 8. La loi d'assentiment est votée sans que cette disposition ne soit modifiée. Il est exact que l'article 8 B §1 du Traité de Maastricht n'était pas directement applicable en droit interne au moment du vote de la loi d'assentiment. Il l'est cependant devenu à la suite de l'adoption de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994. Or, à cette date, la Constitution n'avait toujours pas été modifiée. Il en était d'ailleurs de même au moment où, en application de cette directive, les principes contenus dans l'article 8 B précité devaient être traduits dans le droit interne de chaque Etat membre, ce qui impliqua la condamnation de la Belgique par la Cour de justice de l'Union européenne. Celle-ci s'est référée à sa jurisprudence constante selon laquelle UN ETAT MEMBRE NE PEUT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER L'INOBSERVATION DES OBLIGATIONS ET DES DELAIS PRESCRITS PAR UNE DIRECTIVE. Autrement dit, le droit européen est sans équivoque : une directive prime une disposition en sens contraire de la Constitution d'un Etat membre. Le 11 décembre 1998, avant les élections communales d'octobre 2000, l'article 8 de la Constitution est enfin modifié. (p.131 - leçon 4)
(1) CE 213.879, du 15 juin 2011 - De Coene et consorts
Se fondant sur l'article 15ter (parti politique hostile à la Convention européenne des droits de l'homme), des parlementaires ont engagé une procédure visant à priver le Vlaams Belang de sa dotation. Ils invoquent, à l'appui de leur requête, de très nombreux faits dont ils déduisent l'hostilité de ce parti envers les droits et libertés. Pour l'essentiel de ces griefs, le Conseil d'Etat, dans son arrêt De Coene et consorts, considère que le recours est tardif. Il se contente d'examiner un seul fait, à savoir des propos xénophobes tenus par des leaders du Vlaams Belang lors d'un meeting pour la sécurité tenu le 11 avril 2006. A titre d'exemple, Gerolf Annemans avait notamment déclaré à cette occasion : "On les connaît bien, ces jeunes, ce sont tout simplement des Marocains de merde, qui reçoivent un assistant social, un emploi (...) et de préférence une BMW en prime pour poser leur cul". Le Conseil d'Etat constate que "les propos critiqués ainsi épinglés sont acerbes et polémiques et ne témoignent assurément pas d'un sens aigu de la délicatesse et de la nuance. En ce sens, ils sont susceptibles de nourrir une animosité entre certaines fractions de la société et, à terme, de contribuer à une polarisation et à un climat d'intolérance". Ils sont, à son estime, "franchement inquiétants et de nature à offenser et à blesser". Cependant, ce simple constat ne suffit pas à sanctionner le Vlaams Belang. Le Conseil d'Etat déduit de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que l'hostilité aux droits et libertés doit impliquer une incitation à violer une norme juridique en vigueur. Il estime que la notion d'incitation signifie "encourager, stimuler, pousser à", ce qui implique de "donner une forte impulsion ou un stimulus psychologique qui contribue aux effets dommageables actuels, directs ou qui à tout le moins les rend très probables". Il ajoute que "la question de savoir si les opinions incitent indéniablement à violer un principe comme il est énoncé ci-dessus, doit être appréciée en fonction de leur contenu et de leur contexte. Elles doivent en outre faire apparaître qu'un élément moral spécifique est en cause. Être hostile implique l'existence de sentiments forts et de pensées de rejet et de haine, de malveillance". Or au "regard de tous les éléments de l'affaire, il n'y a pas de majorité au Conseil d'Etat pour considérer que les propos 'incitent' (au sens strict dans lequel ce mot doit être entendu) en outre clairement et délibérément à violer (un) des principes essentiels de la démocratie que les requérants invoquent". Que déduire de cet arrêt ? Tout d'abord, le Conseil d'Etat reconnaît lui-même avoir été divisé. Il y a tout lieu de penser que la ligne de fracture était de nature linguistique, les magistrats francophones étant enclins à sanctionner le Vlaams Belang, leurs homologues néerlandophones ayant tendance au contraire à ne pas le diaboliser. Cette ligne de fracture explique aussi sans doute la jurisprudence modérée de la Cour constitutionnelle, laquelle semble également constituer un compromis entre des thèses antagonistes. Ensuite, le Conseil d'Etat s'engouffre vigoureusement dans la brèche ouverte par la Cour constitutionnelle. Il ne suffit pas, pour qu'un parti soit sanctionné, que soient tenus des propos hostiles aux droits et aux libertés, il faut encore inciter expressément à les violer. Autrement dit, n'importe quel propos ignominieux pourrait être tenu pour autant que son auteur n'appelle pas explicitement les citoyens à en tirer les conséquences. Cette position est d'une grande hypocrisie car elle fait totalement l'impasse sur le processus de contamination des opinions. En effet, la tenue de propos xénophobes crée un climat qui conduit à banaliser le racisme et à favoriser sa prolifération. Or, cette banalisation s'analyse comme une incitation sinon à partager ces opinions, du moins à ne pas les trouver à ce point intolérables. En ne prononçant aucune sanction à la suite de leur expression, le Conseil d'Etat, peut-être inconsciemment, contribue à inciter à faire proliférer des opinions gravement attentatoires aux droits et libertés. Enfin, l'arrêt De Coene et consorts est un message adressé aux parlementaires. Ils sont invités à faire preuve d'une grande circonspection avant d'engager une procédure à fondée sur l'article 15ter, voire à y renoncer définitivement. Cette disposition a été à ce point vidée de sa substance par la Cour constitutionnelle et par le Conseil d'Etat qu'elle apparaît aujourd'hui comme un véritable tigre de papier et qu'elle perd tout effet utile. Il s'agit assurément d'un recul majeur dans l'autodéfense démocratique. Ce qui devait constituer une digue contre la montée des partis liberticides ne semble rien d'autre qu'un mensonge normatif. La règle existe sur le papier mais, étant privée d'effet utile, produit le résultat inverse de celui qui était recherché. Elle incarne, en effet, le témoignage cruel d'une démocratie dévalorisée, impuissante à se protéger. (p.34 - leçon 1)
(20) CE 227.776, du 20 juin 2014 - Thiéry + CE 227.775, du 20 juin 2015 - Caprasse, nomination des bourgmestres
A la suite des élections du 14 octobre 2012, la ministre flamande des Affaires intérieures, fidèle à sa position antérieure, refuse de désigner les bourgmestres désignés des communes de Crainhem, Linkebeek et Wezembeek-Oppen. L'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat décide de ne pas se prononcer directement et demande à la Cour constitutionnelle, qu'elle saisit à titre préjudiciel, de se prononcer sur la validité constitutionnelle de la procédure de désignation des bourgmestres mise en oeuvre par la loi spéciale du 19 juillet 2012. Dans son arrêt n°57/2014 du 03 avril 2014, statuant sur le recours en annulation dirigé contre les dispositions consacrant cette procédure, la Cour estime, pour l'essentiel, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur une différence de traitement ou une limitation d'un droit fondamental découlant d'un choix du constituant lui-même. Bien que ce choix, indique-t-elle, "doive en principe ressortir du texte de la Constitution, les travaux préparatoires peuvent en l'espèce suffire pour faire la clarté concernant ce choix, dès lors qu'il ressort indéniablement des développements précités, et sans que ces propos aient été contredits, que le Constituant non seulement connaissait les dispositions relatives à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, entrées en vigueur le même jour que la révision de l'article 160 de la Constitution, mais qu'il s'est en outre approprié les choix qui en découlent". Il appartient donc à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État de se prononcer au fond sur la désignation de Damien Thiéry, en qualité de bourgmestre de Linkebeek et de Véronique Caprasse en qualité de bourgmestre de Crainhem. Après avoir livré une interprétation nuancée des exigences de la législation linguistique, elle rend dans ces 2 affaires des arrêts contrastés. L'assemblée générale rejette le recours de Damien Thiéry. Elle considère que lorsqu'il convoque les électeurs en vue des élections communales, le collège des bourgmestres et des échevins accompli une mission d'intérêt générale et agit au nom de la Région. Elle observe aussi que lors des élections communales et provinciales du 14 octobre 2012, soit seulement quelques mois avant le refus de sa nomination, l'intéressé s'est écarté des instructions qui était données par le gouvernement régional, à un moment où aucune décision du juridictionnelle n'imposait à ce bourgmestre désigné d'écarter l'application de ces instructions. Compte tenu des circonstances, elle décide que le gouvernement flamand a pu estimer qu'il ne pouvait pas lui accorder sa confiance en le nommant bourgmestre. Elle ne voit pas dans la décision du gouvernement flamand une violation du principe d'égalité ou une méconnaissance du principe de proportionnalité, ni une sanction disciplinaire. L'intéressé ne disposait pas du droit d'être entendu préalablement à la décision prise à son encontre. Par contre, elle estime que, au moment du refus de la nomination de Véronique Caprasse, l'intéressée n'avait encore jamais organisé d'élections et que les reproches qui lui était adressés de se disposer à envoyer les convocations électorales en français ne pouvait être retenus par ce qu'ils ne reposaient sur aucun fait prouvé. En conséquence, elle infirme le refus de la nomination de la candidate, ce qui emporte sa nomination définitive en qualité de bourgmestre. La majorité francophone de Linkebeek n'entend cependant pas renoncer à la désignation de Damien Thiéry en qualité de bourgmestre. L'article 59, §1er bis, du décret communal flamand du 15 juillet 2005 prévoit : "un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté à nouveau pendant la même période d'administration, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données". La majorité constate que Damien Thiéry a déclaré, le 30 juin 2014, "qu'il respectera cette nouvelle interprétation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 imposée par le Conseil d'Etat, ainsi que, le cas échant, les instructions y relatives du Gouvernement flamand". Il s'agit là, à son estime, d'un fait nouveau qui justifie qu'il soit à nouveau présenté en qualité de bourgmestre. Cependant, la ministre flamande des Affaires intérieures, si elle admet l'existence d'un fait nouveau justifiant un réexamen de la question, décide, néanmoins, le 01 septembre 2014, de refuser cette nomination. Ainsi que le relève l'assemblée générale du Conseil d'Etat, "l'arrêté attaqué ne retient cependant pas un, mais 3 griefs, présentés comme des 'faits suffisants par eux-mêmes' à justifier le défaut de confiance à l'encontre du requérant comme candidat bourgmestre ; tout d'abord le fait 'qu'en qualité de membre du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Linkebeek, il a également décidé d'envoyer des lettres de convocation pour les élections communales de 2012, en violation de la législation linguistique', ensuite sur le fait 'qu'il a utilité le bulletin d'information communal à des fins politiques partisanes' et, enfin le fait 'qu'il s'est systématiquement abstenu de réagir à l'utilisation du français lors des séances du conseil communal de la commune de Linkebeek, de nouveau en violation de la législation linguistique' ". L'assemblée générale du Conseil d'Etat rappelle que "le Gouvernement flamand, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en cette matière, peut refuser de nommer le candidat présenté s'il existe des doutes sérieux, fondés sur des éléments convaincants et solides, concernant les qualités et garanties offertes par l'intéressé", que "les éléments pouvant être pris en compte peuvent concerner le passé, pour autant qu'ils demeurent actuels et pertinents. La gravité de ces faits antérieurs et la mesure dans laquelle ils influencent encore aujourd'hui l'aptitude du candidat présenté à exercer la fonction de bourgmestre sont déterminants à cet égard" et qu'en l'espèce, "il ressort (...) de l'arrêté attaqué que la partie adverse a procédé à cette mise en balance et que, ce faisant, elle est arrivée à la conclusion que 'la nouvelle intention du bourgmestre désigné n'est pas de nature à rétablir la fiance que l'intéressé a gravement trompée par les actes qu'il a posé par le passé' ". Elle constate, enfin, que Damien Thiéry ne s'est guère défendu sur les 2 derniers griefs retenus à son encontre. En conséquence, elle confirme la décision de la ministre flamande des Affaires intérieures. Il suffisait alors que le conseil communal de Linkebeek présente un autre candidat de sa liste à la fonction de bourgmestre pour que la crise connaisse son épilogue. Tel n'est pas le cas : le conseil communal désigne Damien Thiéry comme bourgmestre faisant fonction et refuse de proposer le nom d'un nouveau bourgmestre. La ministre des Affaires intérieures, après avoir annulé cette décision, nomme en qualité de bourgmestre le conseiller communal et échevin, élu sur la même liste que Damien Thiéry et bénéficiant du plus grand nombre de voix de préférence après ce dernier. L'intéressé refuse cette nomination qui est alors retirée par la ministre. Celle-ci nomme alors comme bourgmestre un conseiller communal flamand de la minorité. Lors de la séance du conseil communal du 26 octobre 2015, la majorité demande la démission du nouveau bourgmestre. Face au refus de ce dernier, tous les membres du conseil communal appartenant à la majorité donnent leur démission et il est décidé, en l'absence de suppléants, d'organiser des élections extraordinaires afin de pourvoir à nouveau aux 13 places devenues vacantes au sein du conseil communal. Ces élections extraordinaires se tiennent le 13 décembre 2015. Se prévalent de cet élément nouveau, le conseil communal décide à nouveau de présenter Damien Thiéry comme bourgmestre. La ministre refuse de le nommer, ce qui implique une troisième intervention de l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Celle-ci, irritée, confirme ses deux décisions précédentes : "cette persistance du conseil communal dans la volonté de proposé le requérant à la fonction de bourgmestre après le second arrêt de l'Assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat du 18 décembre 2014 et cette manière de créer une situation nouvelle ne sont pas conformes à la volonté du législateur de mettre fin aux carrousels. Elles ne peuvent, partant, conduire à une nomination de l'intéressé au cours de cette période d'administration communale". Le 08 mai 2017, près de 5 ans après les élections, le conseil communal propose la désignation d'une nouvelle bourgmestre appartenant à la majorité francophone qui est nommée, en juillet 2017, par la ministre flamande des Affaires intérieures. La question se pose cependant de savoir si la manière dont sont désignés les bourgmestres dans la périphérie bruxelloise respecte la Charte de l'autonome locale du Conseil de l'Europe. Dans un rapport du 19 octobre 2017, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe considère que "les faits et la situation concernant la non-nomination du maire proposé par le conseil communal de Linkebeek, décidée par la ministre flamande des Affaires étrangères, relèvent effectivement du champ d'application objectif de la Charte (en particulier de son article 8.3)", que le "système de nomination des maires en vigueur en Flandre permet à l'exécutif flamand de refuser de nommer un conseiller communal qui a été élu librement et démocratiquement par la population et proposé par le conseil communal", que "cette possibilité est réglementée de manière vague et imprécise, et de surcroît elle ne garantit pas le plein respect du principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé à l'article 8.3 de la Charte" et que "ce système n'est pas conforme aux normes et pratiques le plus fréquentes des pays démocratiques avancés d'Europe ni à la Recommandation 276 (2008) et à la Recommandation 253 (2008) du Congrès". Enfin, il indique que "la décision adoptée par le ministre régional des Affaires intérieures l'a été sans procédure contradictoire préalable respectant le droit d'être entendu et le droit de se défendre". Cet avis, cependant, ne revêt aucun caractère contraignant. (p.673 - leçon 20)
(11) CC 31/96, du 15 mai 1996 - Meester de Betzenbroeck + CC 54/2002, du 13 mars 2002 - Brouillard I + CC 89/2004 - Brouillard II + CC 17/2004, du 29 janvier 2004 - Verheyden
Chaque assemblée dispose d'une ADMINISTRATION dotée d'un d'un statut propre, distinct de celui des agents de l'Etat. Elle fixe, sans intervention du pouvoir exécutif, le régime statutaire de son personnel, et notamment ce qui concerne le recrutement des agents, les procédures d'avancement, de démission, de rémunération ou le régime disciplinaire. Les agents de ces assemblées étaient jadis singulièrement démunis lorsqu'ils entendaient faire valoir leurs droits en dehors de l'enceinte parlementaire. Le Conseil d'Etat refusait, en effet, de considérer les assemblées législatives comme des autorités administratives et se déclarait incompétent pour connaître des recours introduits devant lui par des fonctionnaires parlementaires. Charles-Antoine de Meester de Betzenbroeck avait introduit un recours au Conseil d'État contre la décision prise par un jury constitué par l'un des organes du Parlement de la Région de Bruxelles-capitale, par laquelle, faute d'avoir réussi l'épreuve linguistique organisé par le Parlement pour un examen de comptable, il avait pas été versé dans la réserve de recrutement constitué à la suite de cet examen. Le Conseil d'Etat saisit la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel et l'interrogea sur la question de savoir s'il n'est pas discriminatoire de rendre impossible tout recours contre une décision d'une assemblée parlementaire. La Cour affirme, tout d'abord, que le caractère propre des assemblées législatives qui sont élues et détentrices du résidu de la souveraineté, exige que leur indépendance soit totalement garantie. Elle indique néanmoins que LA NÉCESSITÉ DE SAUVEGARDER CETTE INDÉPENDANCE NE JUSTIFIE PAS QUE LES FONCTIONNAIRES DES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES SOIENT PRIVÉS D'UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES ACTES ADMINISTRATIFS DES ASSEMBLÉES. L'absence de garantie juridictionnelle, laquelle est part ailleurs reconnue aux fonctionnaires relevant des autorités administratives, est, à son estime, contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Selon elle, il ne peut être remédié à cette situation que par une intervention du législateur qui devra, en ayant égard à l'indépendance qui doit être assurée aux assemblées législatives, prévoir des garanties spécifiques auxquels il n'a pas pu veiller lors de l'élaboration des lois coordonnées sur le Conseil d'État. POUR LA COUR, LA DISCRIMINATION DONT SONT VICTIMES LES FONCTIONNAIRES PARLEMENTAIRES TROUVE SON ORIGINE, non pas dans la législation sur le conseil d'État, mais bien DANS UNE LACUNE LÉGISLATIVE. Tout d'abord, implicitement, la Cour semble considérer que le Conseil d'État n'offre pas de garanties suffisantes pour protéger l'indépendance des assemblées parlementaires. Ensuite, elle sanctionne la CARENCE DU POUVOIR LÉGISLATIF. Ce faisant, elle sort des limites institutionnelles de sa mission qui l'autorise à contrôler la constitutionnalité des normes législatives existantes, et non de juger en constitutionnelle une abstention de légiférer. Enfin, par sa réponse, elle ne permet pas à la juridiction qui l'a interrogée de donner gain de cause au requérant, lequel est pourtant reconnu victime d'une discrimination. Celui-ci se trouve singulièrement dépourvu de tout recours. Le Conseil d'Etat peut, en effet, à bon droit de se déclarer incompétent pur connaitre de son recours. Le LEGISLATEUR remédie à cette situation en MODIFIANT L'ARTICLE 14 DES LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. Sans avoir égard à la position de la Cour constitutionnelle selon laquelle le Conseil d'Etat n'était peut-être pas la juridiction idéale pour connaître des recours introduits par les fonctionnaires et assemblées parlementaires, il INVESTIT CETTE JURIDICTION DU POUVOIR DE CONNAÎTRE, au contentieux de l'annulation, des recours introduits contre LES DECISIONS DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES (ET DE NOMBREUSES AUTRES AUTORITES qui ne sont pas des autorités administratives) RELATIVES à LEUR PERSONNEL ET AUX MARCHES PUBLICS. Paradoxalement, cette modification législative, qui est une conséquence directe de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle, ne paraissait pas de prime abord être de nature à apporter une solution dans un litige de type de celui qui était soumis à la Cour. En effet, le recours avait été introduit par un candidat évincé à un emploi vacant dans une assemblée législative. Par définition, celui-ci ne faisait pas encore partie de son personnel et la décision prise, à son égard, n'était donc pas "relative à un membre de son personnel". Cet argument est soulevé par la Chambre des Représentants dans le cadre d'un recours en annulation formé par Alain Brouillard contre la décision de ne pas l'admettre à un concours de recrutement au motif que celui-ci n'était ouvert qu'à des candidats qui auraient une qualification moindre que la sienne. La Chambre, considérant que l'intéressé n'est pas membre de son personnel, invoque l'irrecevabilité de sa requête. Le Conseil d'Etat décide cependant d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel. Celle-ci estime que l'article 14, §1er des lois sur le Conseil d'Etat, VIOLE LES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONSTITUTION S'IL EST INTERPRÉTÉ EN CE SENS QUE LE CONSEIL D'ETAT NE SERAIT PAS COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE, en pareilles circonstances, D'UN RECOURS EN ANNULATION AU SEUL MOTIF QUE LE REQUÉRANT SERAIT CANDIDAT À UN EMPLOI AU SEIN D'UNE ASSEMBLÉE, ET NON ENCORE MEMBRE DU PERSONNEL DE CELLE-CI. L'affaire n'est pas terminée pour autant. La Chambre des représentants inscrit dans un RÈGLEMENT les principes dont elle fait application à Alain Brouillard. Or, de prime abord, depuis l'adoption du nouvel article 14, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des décisions individuelles relatives au personnel des assemblées, mais non des règlements en la matière. L'intéressé s'empresse de saisir le Conseil d'Etat d'un nouveau recours, lequel interroge une nouvelle fois, la Cour constitutionnel à titre préjudiciel. La Cour relève que la "nécessité de sauvegarder cette indépendance ne justifie toutefois pas que les fonctionnaires des assemblées législatives soient privés de la possibilité de contester, dans le cadre d'un recours en annulation formé contre des actes individuels, la légalité de l'acte réglementaire qui sert de fondements à l'acte attaqué, par voie d'exception ou via une procédure aboutissant au même résultat, ni qu'ils soient privés d'un recours en annulation contre ces actes réglementaires". Comme elle l'avait déjà fait dans son premier arrêt en la matière, elle constate que la discrimination ne trouve pas sa source dans l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, mais dans UNE LACUNE LÉGISLATIVE. Celui-ci remet son ouvrage sur le métier et prévoit que les ACTES ET RÈGLEMENTS des assemblées législatives et leurs organes, des médiateurs parlementaires, de la Cour de compte, de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat, des juridictions administratives, les organes du pouvoir judiciaire et du Conseil Supérieur de la Justice relatifs à leur personnel et aux marchés publics peuvent faire l'objet de recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Il prend aussi soin de relever que L'ARTICLE 159 DE LA CONSTITUTION TROUVE À S'APPLIQUER À CES ACTES et règlements. Il s'agit là d'une formulation maladroite qui ne correspond pas aux intentions du législateur. Son objectif, en effet, était de permettre l'application de l'article 159 de la Constitution à des règlements, et non à des décisions individuelles. Encore fallait-il que certains de ces recours revêtent un caractère effectif. Dans une affaire relative à une promotion à la Chambre des représentants, Carine Verheyden ne bénéficie pas de la promotion qu'elle convoitait. Elle saisit le Conseil d'État, comme le lui permet la nouvelle législation. Cependant, elle est SINGULIÈREMENT DÉMUNIE AU MOMENT DE FAIRE VALOIR SES DROITS DÈS LORS QUE LA DÉCISION DE LA CHAMBRE N'INDIQUE PAS LES RAISONS POUR LESQUELLES SA CANDIDATURE A ÉTÉ ÉCARTÉE ET LES RAISONS POUR LESQUELLES CELLES DE DEUX DE SES COLLÈGUES ONT ÉTÉ RETENUES. Or, la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991, a priori, ne trouve à s'appliquer qu'aux autorités administratives, et non à une assemblée législative. La Cour constitutionnelle considère que deux interprétations de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs sont possibles. Dans la première d'entre elles, laquelle serait inconstitutionnelle, les actes des assemblées législatives relatifs à leur personnel échappent à l'application de la loi du 29 juillet 1991. Dans une seconde interprétation, qui elle revêt un caractère constitutionnel, il y a lieu de tenir compte de LA VOLONTÉ DU LÉGISLATEUR, EXPRIMÉE DANS SES TRAVAUX PRÉPARATOIRES, DE FAIRE COÏNCIDER LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 29 JUILLET 1991 AVEC L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION D'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DONNÉE PAR LE CONSEIL D'ETAT. Dès lors que le législateur a décidé de soumettre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce qui concerne leurs personnels, au même régime de protection juridique que celui applicable aux actes des autorités administratives, il n'est pas justifié que l'obligation de motivation formelle ne soit pas applicable aux premiers. Outre le fait que les membres du personnel des assemblées législatives ou de leurs organes seraient privés d'une garantie contre l'arbitraire éventuel, l'absence d'obligation de motivation formelle ne permettrait pas au Conseil d'État d'exercer un contrôle efficace. Un nouveau pas est franchi avec une modification des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, opérée par la loi du 20 janvier 2014, à la suite de laquelle cette juridiction est désormais compétente pour censurer les actes et règlements des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, relatifs aux marchés publics, au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. (p.346 - leçon 11)
(3) Cass., du 10 avril 1987 - affaire Happart, consensus
Comment distinguer une coutume constitutionnelle d'une simple pratique ? Peut-on faire appel au critère de la SANCTION JURIDICTIONNELLE ? Si le juge connaît de la violation d'une règle, celle-ci revêtirait un caractère juridique. Pa contre, s'il se refuse à effectuer un tel contrôle, nous serions un présence d'une simple pratique. On peut, à cet égard, se référer à un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 1987, rendu sur les conclusions de l'avocat général Velu dans l'affaire Happart. Le défendeur (le leader de l'opposition flamande du conseil communal des Fourons, Huub Broers) soutient que le pourvoi en cassation formé par le ministre de l'Intérieur contre l'arrêt du Conseil d'Etat annulant la nomination de José Happart en tant que bourgmestre des Fourons (motif : il ne disposait pas d'une connaissance suffisante de la langue néerlandaise pour exercer la fonction de bourgmestre dans une commune située dans la région de langue néerlandaise) est irrecevable parce qu'il n'a pas été précédé d'une délibération en conseil des ministre. La Cour de cassation écarte cet argument au motif qu'aucune "disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire ne prescrit que pareil pourvoi soit précédé d'une délibération en conseil des ministres (...), qu'il n'existe pas de principe général du droit qui subordonnerait la validité d'actes gouvernementaux à une concertation préalable du conseil des ministres et que s'il est d'usage que le conseil des ministres délibère et décide lorsqu'il s'agit d'affaires présentant une certaine importance, l'absence de délibération n'affecte pas en elle-même la validité d'un acte accompli par un ministre en pareille matière". A l'estime de la Cour de cassation, la délibération en conseil des ministres de toute question politique importante de nature à engager la responsabilité politique du gouvernement n'est pas une coutume. Cette position, qui trouve sans doute sa véritable explication dans le contexte troublé de l'affaire Happart, n'échappe pas à la critique sur le plan juridique. En effet, la délibération en conseil des ministres de toute question politique importante revêt, nous semble-t-il, un caractère juridiquement obligatoire. Cette formalité constitue le corollaire des principes qui régissent l'action du gouvernement, et notamment la collégialité des décisions, la solidarité gouvernementale et la responsabilité politique du gouvernement devant la Chambre. Cependant, le critère de la sanction juridictionnelle, particulièrement efficace en droit privé, s'adapte mal aux spécificités du droit constitutionnel. Le précédent qui vient d'être évoqué en apporte un témoignage paradoxal. Rares, en effet, sont les règles relatives au fonctionnement des institutions qui sont portées à la connaissance du juge. Un ministre désavoué par la Chambre est juridiquement obligé de démissionner, mais aucune juridiction ne pourrait l'y contraindre. Si nous écartons le critère de sanction juridictionnelle, peut-être est-il possible de retenir celui de la SANCTION POLITIQUE. En effet, la plupart des coutumes constitutionnelles peuvent faire l'objet d'une telle sanction. Le ministre qui manifeste publiquement son désaccord avec l'action gouvernementale peut être contraint à la démission et, au besoin, révoqué par le Roi. Ce critère paraît cependant délicat à manier. Une sanction politique peut, en effet, intervenir sans qu'une règle juridiquement obligatoire ne soit violée. Tel sera le cas, par exemple, d'un vote de méfiance du Parlement à l'égard d'une politique gouvernementale qui ne satisfait pas à ses voeux, mais qui a été menée dans le respect de toutes les règles en vigueur. Ce critère doit donc également être écarté. Telle est la raison pour laquelle l'ensemble de ces critères doivent être écarté au profit du CRITERE SUPPLETIF qui veut que LA COUTUME, à l'inverse de la simple pratique, EST NECESSAIRE A LA MISE EN OEUVRE DU DROIT ECRIT, ET PARTANT EN CONSTITUE UN COMPLEMENT SANS LEQUEL LA REGLE ECRITE SERAIT PRIVEE DE SON EFFET UTILE. (p.117 - leçon 3)
(29) CC 54/96, du 03 octobre 1996 - Carrefour, budget Communauté flamande + CC 50/99, du 29 avril 1999 - budget Communauté flamande
En 1996, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt dit Carrefour, est amenée à se prononcer sur la délicate question de savoir si, au titre de ses compétences culturelles, la Communauté française peut prévoir, dans son budget, des sommes permettant de financer des associations culturelles dont le siège est établi dans la périphérie bruxelloise. Elle relève, tout d'abord, qu'il résulte de la lecture conjointe des articles 127, §1er, alinéa 1er, et 175, alinéa 2, de la Constitution que les Communautés sont compétentes pour régler les matières culturelles et, à ce titre, pour fixer les moyens financiers d'une politique culturelle. La MISE EN ŒUVRE DE MOYENS FINANCIERS EST INTIMEMENT LIEE A L'EXERCICE D'UNE COMPETENCE ET, PARTANT, SOUMISE AU MEME CONTROLE. Dans l'exercice de leurs compétences culturelles, les Communautés peuvent prendre toute initiative pour la promotion de la culture et pour concrétiser le droit de chacun à l'épanouissement culturel mais, dans une telle perspective, elles doivent avoir égard à la répartition exclusive de compétences territoriales établie par la Constitution en matière culturelle. Cette restriction apparente de compétences sur le plan territorial, à l'estime de la Cour, ne signifie pas, en raison de la nature même de la promotion de la culture, que la compétence communautaire en cette matière cesse d'exister au seul motif que les initiatives prises peuvent produire des effets en dehors de la région qui, dans le domaine des matières culturelles, a été confiée aux soins de la Communauté concernée. La Cour indique encore que CES EFFETS EXTRATERRITORIAUX potentiels des mesures de promotion de la culture NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, CONTRARIER LA POLITIQUE CULTURELLE DE L'AUTRE COMMUNAUTE. Elle constate que "telle qu'elle est conçue et rédigée", la disposition querellée permet, entre autres, "de financer des institutions francophones situées dans les communes périphériques, toutes situées dans la région de langue néerlandaise, et dans les communes de la frontière linguistique qui sont également situées dans cette région linguistique". Il s'agit, relève-t-elle, de communes dans lesquelles l'article 129, §2, de la Constitution reconnaît l'existence de minorités et pour lesquelles la législation contient des mesures de protection de ces minorités. Elle considère que la disposition querellée ne peut s'analyser comme visant la promotion de la culture par la Communauté française (sans quoi elle aurait semble-t-il échappé à toute critique) mais comme une MESURE DE PROTECTION DE LA MINORITE francophone établie dans ces communes. La Cour souligne, enfin, que dans les limites de ses compétences, CHAQUE LEGISLATEUR DOIT ASSURER LA PROTECTION DES MINORITES, garanties entre autres par l'article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Il n'appartient pas, dès lors, aux Communautés d'intervenir unilatéralement dans une région linguistique à l'égard de laquelle elles ne sont pas compétentes pour garantir cette protection. Cet arrêt ne fait, en réalité, que confirmer L'ETANCHEITE DE LA FRONTIERE LINGUISTIQUE. Si la Cour doit bien reconnaître que l'exercice d'une compétence culturelle se prête mal à être enserré dans un carcan géographique, elle parvient à réaffirmer le caractère territorial des Communautés en faisant un habile détour par la matière de la protection des minorités qui, quant à elle, ne se prête pas à un règlement extraterritorial. Autrement dit, cette jurisprudence aboutit au paradoxe singulier selon lequel le financement d'activités culturelles à l'étranger relève, à l'évidence, de la promotion culturelle alors que s'il trouve à s'appliquer, dans les mêmes conditions, dans une autre Communauté, il s'analyse comme une mesure de protection des minorités, et partant est interdit. Par la suite, la Communauté flamande a continué, de manière systématique, à poursuivre, avec des fortunes diverses, l'annulation des budgets successifs de la Communauté française qui visaient à financer des activités culturelles d ans la périphérie bruxelloise. En 1999, la Cour rejette le recours introduit par le gouvernement flamand au motif que le décret litigieux ne définissait pas son aire de compétences territoriale et qu'il était donc supposé respecter les règles de répartition des compétences en ce domaine. En effet, elle annule le budget de la Communauté française car il ressortait des travaux préparatoires que l'intention du législateur était d'affecter les crédits litigieux à la protection des minorités de langue française dans les communes périphériques et dans la commune de Fourons. Enfin, en 2001, elle met fin définitivement à toute velléité de la Communauté française de financer des associations culturelles francophones de la périphérie bruxelloise en annulant partiellement les budgets de 1998 et 1999 de la Communauté française. En effet, alors même que les travaux préparatoires du budget sont muets quant à a destination de certains crédits, elle constate que "ceux-ci étaient antérieurement destinés à réaliser des 'fins inconstitutionnelles' " et que le législateur ne fournit aucune explication permettant de justifier qu'ils auraient reçu une autre finalité. Autrement dit, elle affirme que s'il demeure silencieux, le législateur communautaire est présumé respecter les règles de répartition de compétence, mais que cette présomption n'est pas irréfragable. (p.950 - leçon 29)
(10) Cour d'appel de Bruxelles, du 28 juin 2005 - Eglise du Royaume universel de Dieu + Cass., du 01 juin 2006 - Eglise du Royaume universel de Dieu + CEDH, du 16 juillet 2009 - Féret c. Belgique, limite de l'immunité
Il existe, dans la jurisprudence, deux interprétations divergentes de l'article 58 de la Constitution. La première d'entre elles a été énoncée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt relatif à l'article 15ter de la loi du 04 juillet 1989 qui permet de priver un parti politique liberticide de sa dotation. Elle estime que L'ARTICLE 58 S'OPPOSE A CE QU'UNE SANCTION SOIT PRISE A L'EGARD D'UN PARTI POLITIQUE EN RAISON DES OPINIONS ET VOTES EXPRIMES, dans l'exercice de ses fonctions, PAR UN PARLEMENTAIRE DE CE PARTI. Elle considère donc que L'ARTICLE 58 A UN EFFET DIRECT DIFFUS. Directement, il prémunit le parlementaire contre toute mise en oeuvre de sa responsabilité pour les opinions et votes qu'il exprime dans l'exercice de son mandat. De manière diffuse, il interdit que des tiers voient leur responsabilité engagée à la suite de tel vote ou de tel propos émanant d'un membre d'une assemblée législative. A l'inverse, la Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 28 juin 2005, estime que si l'article 58 de la Constitution exonère les parlementaires de toute mise en oeuvre de leur responsabilité personnelle, il n'institue pas une irresponsabilité de principe au bénéfice de l'Etat belge qui pourrait ainsi être rendu responsable pour une faute commise par l'un de ses organes, en l'occurence une commission d'enquête parlementaire. En l'occurence, la cour d'appel a fait droit à une action en responsabilité engagée par l'Eglise universelle du Royaume de Dieu qui faisait grief à une commission parlementaire de l'avoir qualifiée "d'association criminelle dont le seul but est l'enrichissement" et d'avoir affirmé "qu'elle n'était en réalité qu'une vaste entreprise d'escroquerie". Pour la cour d'appel, à l'unité, le parlementaire est irresponsable, mais une fois additionné à ses pairs, il forme avec eux un organe de l'Etat qui doit rendre compte judiciairement d'une faute commise. L'interprétation réservée par la cour d'appel à l'article 58 de la Constitution doit être vigoureusement récusée car elle énerve l'indépendance du parlementaire. Celui-ci ne disposera plus de l'absolue liberté qui doit lui être reconnue s'il sait que des tiers peuvent voir leur responsabilité engagée pour les opinions ou les votes qu'il exprime. Elle méconnaît également l'indépendance du Parlement dès lors qu'elle dissocie artificiellement celui-ci de l'Etat dont il est l'un des pouvoirs constitués. Il ne se conçoit pas, en effet, que l'Etat, entité abstraite, soit rendu responsable d'une faute commise par le Parlement, et cela, alors même que dans une mesure clairement circonscrite, le constituant a entendu protéger celui-ci de toute mise en oeuvre de la responsabilité de ses membres. C'est d'ailleurs la position nette adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 01 juin 2006. Elle casse, en effet, l'arrêt précité de la cour d'appel et précise à cette occasion que "décider que le juge ne peut apprécier si une opinion d'un parlementaire ou d'une commission parlementaire constitue une faute susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat fédéral, ne porte pas de façon disproportionnée atteinte au droit d'accès au juge". Elle estime que la liberté d'expression des parlementaires ne vise pas seulement les déclarations orales des parlementaires, mais également leurs écrits. Il s'en déduite que l'article 58 de la Constitution interdit d'engager la responsabilité de l'Etat pour des propos contenus dans un rapport d'enquête parlementaire. Il convient donc de faire prévaloir une interprétation extensive, sinon globalisante de l'article 58 de la Constitution. Il ne pourrait, à notre sens, ÊTRE DEROGE A CELLE-CI QUE DANS L'HYPOTHESE OU CETTE DISPOSITION CONSTITUTIONNELLE SERAIT UTILISEE AFIN DE SAPER LES VALEURS FONDAMENTALES DU REGIME DEMOCRATIQUE. Il serait ainsi fait application, par analogie, du principe exprimé par l'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales QUI INTERDIT D'USER DE LIBERTES garanties par la Convention AFIN DE DETRUIRE OU DE REDUIRE CELLES-CI. En suivant une pareille voie, il eût été possible de remettre en cause l'enseignement de l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle sans pour autant énerver, pour le surplus, le caractère globalisant de l'article 58 de la Constitution. Si la Cour européenne des droits de l'homme ne s'est pas engagée dans cette voie, elle ne semble pas s'en être éloignée. Ainsi, dans son arrêt Féret contre Royaume de Belgique, elle affirme que si "dans un contexte électoral, les partis politiques doivent bénéficier d'une large liberté d'expression afin de tenter de convaincre leurs électeurs, en cas de discours raciste ou xénophobe, un tel contexte contribue à attiser la haine et l'intolérance car, par la force des choses, les positions des candidats à l'élection tendent à devenir plus figées et les slogans ou formules stéréotypées en viennent à prendre le dessus sur les arguments raisonnables" et que l'impact "d'un discours raciste et xénophobe devient alors plus grand et plus dommageable". Elle ajoute que "le discours politique exige un degré élevé de protection, ce qui est reconnu dans le droit interne de plusieurs Etats, dont la Belgique, par le jeu de l'immunité parlementaire et de l'interdiction des poursuites pour des opinions exprimées dans l'enceinte du Parlement" et qu'elle "ne conteste pas que les partis politiques ont le droit de défendre leurs opinions en public, même si certaines d'entre elles heurtent, choquent ou inquiètent une partie de la population". Ils peuvent "donc prôner des solutions aux problèmes liés à l'immigration" mais "ils doivent éviter de le faire en préconisant la discrimination raciale et en recourant à des propos ou des attitudes vexatoires ou humiliantes, car un tel comportement risque de susciter parmi le public des réactions incompatibles avec un climat social serein et de saper la confiance dans les institutions démocratiques". L'arrêt Féret c. Belgique concerne un tract. Il n'est pas question dans ce cas d'application de l'article 58 de la Constitution, et l'enseignement de l'arrêt de Madame A n'est donc pas remise en cause. Tout au plus est-il permis de se demander si, en s'inspirant de l'enseignement de l'arrêt Féret, la Cour ne pourra pas à l'avenir infléchir sa jurisprudence en matière d'irresponsabilité parlementaire. (p.306 - leçon 10)
(29) CC 56/96, du 15 octobre 1996 - location voiture avec chauffeur
Il faut se garder de croire que la question des critères de rattachement ne se pose que dans le champ des compétences communautaires. En effet, la Cour constitutionnelle considère que la Région de Bruxelles-Capitale a valablement pu régler l'activité de location des voitures avec chauffeur en prenant en considération le point de départ de la prestation de service. Elle estime qu'il s'agit là d'un "critère de rattachement pertinent permettant de localiser la matière à régler exclusivement dans la sphère de compétences territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale", alors que, précisément, le critère choisir permet de réglementer des prestations qui s'effectuent, partiellement, en dehors du territoire de la Région. Il est manifeste que même si le critère de rattachement choisi n'est pas en soi déraisonnable, le fait qu'il ait été validé par la Cour constitutionnelle a pour effet de contraindre les autres législateurs régionaux à s'aligner sur la position prise par la Région de Bruxelles-Capitale en la matière. En effet, le choix d'un autre critère tout aussi raisonnable (tel par exemple que le siège d'exploitation de la société de location de voitures) aurait pour effet d'engendrer des situations de conflits qui ne permettraient plus de localiser chaque situation concrète dans l'aire de compétence d'un seul législateur. La Région wallonne a adopté un décret visant à régler les émissions de gaz à effet de serre provenant des aéronefs. Elle estime pouvoir réglementer ces émissions pour chaque exploitant d'aéronef qui décolle d'un aérodrome wallon ou qui y atterrit en provenance d'un aéroport établit en dehors de l'Union européenne. La Cour constitutionnelle constate notamment que tombent ainsi sous le coup de la réglementation wallonne des émissions de gaz à effet de serre qui se produisent en réalité en dehors de l'espace aérien wallon, voire dans l'espace aérien d'autre États de l'Union européenne, voir encore en dehors de l'espace aérien de l'Union. Elle relève également que des émissions de gaz à effet de serre qui affectent l'espace aérien wallon ne sont pas réglées par le décret. Tel est notamment le cas des avons qui survolent l'espaces aérien de la Région sans y atterrir. En conséquence, elle annule les critères de rattachement définis par la Région wallonne. Mieux, elle constate que, en vertu du droit européen, il ne peut exister qu'une seule autorité responsable par exploitant d'aéronef. Elle en déduit qu'une coopération est dès lors indispensable en cette matière. Cette décision est singulière car, dans cette matière, le législateur spécial n'a pas imposé d'accord de coopération obligatoire. La Cour en convient mais indique néanmoins que "les compétences de l'État fédéral et des régions sont devenues à ce point imbriquées, par suite, d'une part, de la nécessité en droit européen de n'avoir qu'une seule autorité responsable par exploitant d'aéronef et, d'autre part, la nature principalement transrégionale des émissions causée pendant l'intégralité de leur vol par des aéronefs qui atterrissent dans une région ou qui en décollent, qu'elles ne peuvent plus être exercées que dans le cadre d'une coopération". Dès lors, elle se substitue, en quelque sorte au législateur spécial en exigeant la passation d'un accord de coopération, à défaut duquel elle n'hésitera pas à annuler les critères de rattachement fixés unilatéralement par l'un des législateurs régionaux. (p.954 - leçon 29)
(4) CC 130/2010, du 18 novembre 2010 - CREG + CC 62/2016, du 28 avril 2016 - Traité de stabilité
Il s'indique, en effet, que la Cour ait égard au contenu du traité pour vérifier si les diverses règles de droit interne relatives à la répartition de compétences (tant internes qu'internationales) entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés sont respectées. Il est également admis que la Cour annule la norme législative d'assentiment si une disposition du traité méconnaît les autres articles dont la Cour assure le contrôle. Ce faisant, elle ne méconnaît pas le principe de la primauté du droit international qui a des effets direct dans l'ordre juridique interne sur l'ensemble des normes de droit interne. A ce stade, il ne peut y avoir qu'une contradiction entre les effets d'une norme législative d'assentiment et la Constitution. La norme de droit international n'a pas encore d'effet direct dans l'ordre juridique interne parce que, en toute logique, elle n'a pas encore été ratifiée par l'exécutif compétent. En effet, les recours en annulation dirigés contre les normes portant assentiment à un traité doivent être introduits, dans les 60 jours de leur publication au Moniteur belge. L'exécutif doit s'abstenir de ratifier le traité avant l'expiration de ce délai et doit attendre, si un recours en annulation a été introduit, que la Cour constitutionnelle se soit prononcée à son propos. L'interdiction faite au pouvoir exécutif de ratifier le traité avant l'expiration du délai de recours devant la Cour constitutionnelle ou avant que la Cour ne se soit prononcée si un recours est introduit s'analyse comme une COUTUME CONSTITUTIONNELLE. En effet, cette interdiction ne figure dans aucun texte, mais est le complément nécessaire de la règle selon laquelle les recours en annulation contre les normes d'assentiment aux traités doivent être introduits dans les 60 jours de leur publication au Moniteur. Cette interdiction vise à donner un effet utile au recours qui serait ainsi formé. En revanche, il est plus délicat d'affirmer, comme le fait la Cour, que son contrôle peut également s'exercer à l'occasion d'une question préjudicielle. En effet, le conflit entre la norme législative d'assentiment et une norme supérieur de droit interne implique cette fois un traité ratifié qui a effet directe dans l'ordre juridique interne et qui, en principe, prime toutes les dispositions internes, en ce compris constitutionnelles. Cette primauté est méconnue si, même à l'occasion d'un litige particulier, l'arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour a pour effet de rendre inopérante une disposition qui se situe au faîte de la hiérarchie des normes. Autrement dit, l'arrêt de la Cour contraint le juge qui l'a interrogée à titre préjudiciel à rendre une décision qui méconnaît les obligations internationales de la Belgique. Une telle jurisprudence entre en contradiction avec la position développée par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mai 1971 et par le Conseil d'Etat, dans ses arrêts du 05 novembre 1996. Nous inclinons, cependant, à approuver cette jurisprudence parce qu'elle garantit le respect du principe démocratique. En effet, l'affirmation de la primauté du droit international ayant effet direct dans l'ordre juridique interne sur la Constitution favorise des modifications implicites, discrètes, voire inconscientes du texte constitutionnel. La procédure imposée par l'article 195 de la Constitution garantit, lors de l'établissement de la déclaration de révision, un large débat sur le principe de celle-ci, impose une discussion de chaque article modifié et prévoit, en outre, la réunion des majorités renforcées. En revanche, le vote d'une loi d'assentiment (loi formelle qui ne comprend qu'un article) n'autorise aucun débat sur le principe de la révision, n'implique pas de débat sur chacune des dispositions du traité et, enfin, est acquise à la majorité ordinaire. Il serait dès lors singulier et démocratiquement contestable d'admettre qu'une norme législative d'assentiment puisse, par son seul effet, mettre en échec une disposition constitutionnelle. En vertu du même raisonnement, les lois spéciales et les décrets spéciaux devraient prévaloir sur le droit international qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne. En effet, il est peu cohérent d'admettre qu'une norme d'assentiment votée à la majorité ordinaire ait pour effet de paralyser l'application d'une règle qui trouve son fondement dans une norme votée à une majorité renforcée. Plus fondamentalement, la Cour constitutionnelle, à l'inverse du Conseil d'Etat, semble refuser de hiérarchiser entre elles les dispositions constitutionnelles. Les transferts de souveraineté opérés sur la base de l'article 34 de la Constitution ne peuvent avoir pour effet de méconnaître, ou même de modifier implicitement les autres articles de la Constitution. Il est, cependant, permis de se demander si elle n'a pas infléchi sa jurisprudence. Des directives européennes organisent la libéralisation du marché de l'électricité et, à ce titre, exigent des Etats qu'ils créent une autorité nationale de régulation qui a notamment pour mission d'exercer un contrôle sur les gestionnaires de réseau et sur leurs tarifs et qui peut aussi être chargée du contrôle de leur comptabilité. En Belgique, ce rôle est notamment assumé par la CREG, laquelle affirme la Cour, "dispose d'une large autonomie qui n'est pas compatible avec la soumission de cette autorité à un contrôle hiérarchique ou à une tutelle administrative" et "est instituée dans le but d'accomplir certaines missions que le législateur souhaitait soustraire à l'autorité du Gouvernement fédéral". Pour autant que la CREG soit soumise à un contrôle juridictionnel et à un contrôle parlementaire (ce qui est le ca), l'article 37 de la Constitution qui réserve au Roi l'exercice du pouvoir exécutif n'est pas, à l'estime de la Cour, méconnu. En effet, rien ne s'oppose en pareilles circonstances, à ce que "le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome". La Cour ajoute, cependant, que dans "la mesure où ce qui précède ne suffirait pas pour justifier que les personnes qui font l'objet d'une décision de la CREG 'ne jouissent pas de la garantie de voir la décision prise par une autorité administrative dont la direction est assurée directement par le pouvoir exécutif', cette situation est justifiée, en vertu de l'article 34 de la Constitution, par les exigences découlant du droit de l'Union européenne". Dans d'autres arrêts concernant la CREG, la Cour a développé une argumentation analogue. Cet argument laisse perplexe, car il s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat selon laquelle l'article 34 de la Constitution primerait les autres dispositions constitutionnelles. Or, c'est précisément cette conception que la Cour constitutionnelle entendait contrecarrer dans les arrêts rendus en 1991 et en 1994. En l'espèce, à l'inverse, elle admet que le droit européen dérivé, qui trouve son fondement dans les lois d'assentiment aux traités adoptées à la majorité ordinaire, prime, en se fondant sur l'article 34 de la Constitution, d'autres dispositions constitutionnelles. Fallait-il voir dans ces arrêts un revirement de jurisprudence et l'affirmation par la Cour constitutionnelle que l'article 34 de la Constitution autorise le législateur à adopter des lois d'assentiment à des traités qui méconnaissent la Constitution ? Un début de réponse est apporté par un arrêt 62/2016 du 28 avril 2016. A cette occasion, dans une affaire relative au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, conclu dans le cadre de la stabilisation de l'euro, la Cour s'exprime ainsi : "le Traité sur la stabilité ne prévoit pas seulement un cadre budgétaire rigide ; il confie également certaines compétences aux institutions de l'Union européenne, notamment à la Commission européenne et à la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsque le législateur donne assentiment à un traité qui a une telle portée, il doit respecter l'article 34 de la Constitution. En vertu de cette disposition, l'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public. Il est vrai que ces institutions peuvent ensuite décider de manière autonome comment elles exercent les pouvoirs qui leurs sont attribués, mais l'article 34 de la Constitution ne peut être réputé conférer un blanc-seing généralisé, ni au législateur, lorsqu'il donne son assentiment au traité, ni aux institutions concernées, lorsqu'elles exercent les compétences qui leur ont été attribuées. L'article 34 de la Constitution n'autorise en aucun cas qu'il soit porté une atteinte discriminatoire à l'identité nationale inhérente aux structures fondamentales, politiques et constitutionnelles ou aux valeurs fondamentales de la protection que la Constitution confère aux sujets de droit". Il est en tout cas permis d'en déduire que, si une hiérarchisation n'est pas exclue entre les différentes dispositions constitutionnelles, il en convient d'identifier celles qui sont inhérentes aux structures fondamentales, politiques et constitutionnelles ou aux valeurs fondamentales de la protection que la Constitution confère aux sujets de droit, l'article 34 de la Constitution, à l'estime de la Cour, ne permet pas par principe au législateur d'adopter des lois d'assentiment à des traités qui méconnaissent la Constitution. (p.139 - leçon 4)
(12) CC 3/2013, du 07 janvier 2013 - position de principe en matière de rétroactivité de la loi + CC 25/90, du 05 juillet 1990 - pilotage + CEDH, du 20 novembre 1995 - pilotage
La Cour constitutionnelle établit les limites dans lesquelles la rétroactivité d'une norme législative peut-être admise. Ainsi a-t-elle relevé que "la non-rétroactivité des lois est une garantie qui a pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte est accompli. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général. S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but ou pour conséquence d'influencer dans un sens déterminé l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire ou empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifie l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous". Dans cet arrêt, rendu à titre préjudiciel, la Cour constate que la rétroactivité du décret en cause n'a pour effet que de toucher un nombre de situations, à ce point limité que la politique ainsi mise en oeuvre "ne constitue ni un motif impérieux d'ordre général, ni une circonstance à ce point exceptionnelle qui puissent justifier une telle intervention rétroactive dans des litiges pendants". La jurisprudence de la Cour en la matière n'en est pas moins empreinte de pragmatisme. Elle a, par exemple, été appelée à connaître de cette question dans un arrêt relatif au SERVICE DE PILOTAGE. La loi du 30 août 1988 vise à consacrer un régime spécial de la responsabilité civile en matière de réparation de dommages causés par des fautes commises dans le fonctionnement ce service. Il s'agit plus particulièrement d'exonérer, sous certaines conditions, l'Etat de la responsabilité du dommage causé au moment où le navire est véhiculé par un membre du service public de pilotage. Par ailleurs, il est prévu que ce régime de responsabilité rétroagit 30 ans avant l'entrée en vigueur de la loi. Le législateur adopte cette loi parce qu'à la suite d'un revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation intervenu en 1983, l'Etat a vu sa responsabilité engagée pour les fautes commises par les services publics de pilotage et risquait de devoir acquitter des sommes considérables. La Cour constitutionnelle adopte une position nuancée. Elle affirme que "l'élément rétroactif que comporte le régime de responsabilité instauré en matière de pilotage porte atteinte au principe fondamental de la sécurité juridique, selon lequel le contenu du droit doit, en principe, être prévisible et accessible de sorte que le sujet de droit puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise. Cependant, cette atteinte au principe n'est pas, dans les circonstances en l'espèce, disproportionné par rapport à l'objectif général visé par la législation attaquée. Le législateur a entendu maintenir (...) le système de responsabilité qu'il n'avait pas voulu modifier en 1967 et que la jurisprudence antérieure à 1983 ainsi que la doctrine déduisaient de l'article 5 de la loi de 1967 sur le pilotage ainsi que des articles 64 et 251 de la loi maritime (...) ; de plus, il a pris en compte les conséquences budgétaires importantes découlant de façon imprévue pour les pouvoirs publics concernés de la modification de la jurisprudence". En d'autres termes, la Cour constitutionnelle affirme simultanément LA CONTRADICTION EXISTANT ENTRE LE PRINCIPE DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE ET LA RÉTROACTIVITÉ DE LA NORME LÉGISLATIVE ET LE FAIT QUE, DANS DES CIRCONSTANCES TRÈS PARTICULIÈRES, UNE NORME RÉTROACTIVE PEUT ÊTRE ADMISSIBLE. En l'espèce, ces circonstances sont d'une triple nature. Tout d'abord, LE DROIT ÉTAIT INCERTAIN, notamment en raison d'un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui compromettait, déjà, dans une certaine mesure la sécurité juridique. Ensuite, LA LOI, RÉTROAGISSANT DE 30 ANS, FRAPPAIT TOUS LES CAS D'INDEMNISATION ENCORE PENDANTS, ce qui évitait d'appliquer un droit différent à des affaires encore en cours. Enfin, la Cour, à l'évidence, a été sensible à L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ÉTAT, lequel, en cas d'annulation, aurait été amené à débourser des sommes considérables, et ce, au bénéfice d'importants amateurs, étrangers de surcroît. Cette affaire a été portée devant LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. Celle-ci, dans un arrêt du 20 novembre 1995, estime que la loi du 30 août 1988 viole l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit de propriété. Des considérations financières et le souci de l'État belge d'harmoniser le droit belge avec celui des pays voisins peuvent, à son sens, justifier pour l'avenir une législation dérogeant en cette matière au droit commun de la responsabilité. Mais ceci ne peut cependant légitimer une rétroactivité dont le but et l'effet étaient de priver les requérants de leurs créances en indemnisation. Une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés ne respecte pas, si l'on en croit la Cour, un juste équilibre entre les intérêts en présence. (p.381 - leçon 12)
(21) Cour d'appel de Bruxelles, du 28 juin 2005 - Eglise du Royaume universel de Dieu + Cass., du 01 juin 2006 - Eglise du Royaume universel de Dieu
La Cour d'appel de Bruxelles rend le 28 juin 2005 un arrêt condamnant l'Etat belge, représenté par le Président de la Chambre des représentants pour des affirmations contenues dans le rapport d'une commission parlementaire d'enquête sur les sectes. Plus précisément, il est reproché à l'Etat belge d'avoir, sans réserves, qualifié l'Eglise universelle du Royaume de Dieu "d'association criminelle dont le seul but est l'enrichissement" et d'avoir affirmé "qu'elle n'était en réalité qu'une vaste entreprise d'escroquerie". En conséquence, l'Etat a été contraint à publier dans deux quotidiens des extraits de l'arrêt le condamnant. Cette décision a déjà été critiquée en ce qu'elle porte atteinte à la protection absolue des parlementaires et au droit d'enquête des Parlements. Elle droit, cependant, être également analysé sous l'angle de la responsabilité des pouvoirs publics. Pour faire bref, la cour d'appel justifie sa position en reprenant quasi mot pour mot les termes de l'arrêt Anca en les appliquant aux organes parlementaires. Si elle s'était contentée de cette affirmation en ce qu'elle concerne l'exercice de la fonction législative, nul n'aurait pu lui adresser le moindre reproche. Cependant, elle opère, dans son raisonnement, un subtil glissement qui la conduit non plus A AFFIRMER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT dans l'exercice de cette fonction, mais bien pour les actes accomplis par le Parlement DANS L'EXERCICE DE SA MISSION DE CONTRÔLE. En effet, l'enquête parlementaire est étrangère à l'exercice de la fonction législative. Il s'agit d'un instrument de contrôle conféré aux assemblées parlementaires qui les autorise à s'intéresser à toute question généralement quelconque et à contrôler tout pouvoir, en ce compris le pouvoir judiciaire. Il ne suffisait donc pas ici de faire une application automatique, sinon obtuse des principes contenus dans les arrêts La Flandria et Anca, et de constater que le droit par hypothèse lésé de l'Eglise universelle du Royaume de Dieu étant un droit civil, l'Etat pouvait être rendu responsable d'une faute éventuellement commise par la Chambre des représentants exerçant son pouvoir d'enquête. En effet, en amont de ce constat se posait une question fondamentale à laquelle la cour d'appel ne libre aucune réponse convaincante. Où s'arrêtent les limites du pouvoir des juridictions ? La séparation des pouvoirs peut-elle s'accommoder d'une situation où des juridictions (dont les membres peuvent le cas échéant être appelés à rendre compte de leur action devant une commission d'enquête parlementaire) s'autorisent à juger le contenu des conclusions d'une enquête parlementaire ? La cour d'appel ne pouvait faire l'économie d'une réflexion sur son droit d'engager la responsabilité de l'Etat pour une faute commise par le Parlement dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, voire par un parlementaire considéré isolément. La Cour de cassation, dans son arrêt du 01 juin 2006, tranche la controverse. L'article 58 de la Constitution interdit d'engager la responsabilité de l'Etat pour des propos tenus oralement ou par écrit par des parlementaires et "la protection offerte par l'article 144 de la Constitution n'autorise pas le juge à contrôler, directement ou indirectement, la manière dont le parlement exerce le droit d'enquête ou aboutit à ses conclusions, ni partant, la manière dont les Chambres expriment leur opinion". Toutefois, "les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir législatif et des parlementaires n'impliquent pas que l'Etat serait exonéré en général de son obligation de réparer le dommage causé à un tiers par une faute du parlement. En confiant exclusivement aux cours et tribunaux la connaissance des contestations qui ont pour objet des droits civils, l'article 144 de la Constitution place tous les droits civils sous la protection du pouvoir judiciaire. Afin de réaliser cette protection, le constituant n'a pas tenu compte de la qualité des parties litantes, ni de la nature des actes portant atteinte à ce droit, mais exclusivement de la nature du droit faisant l'objet du litige. Comme tous les citoyens, l'Etat est soumis à des règles de droit, dont celles relatives à la réparation du dommage résultant de fautes portant atteinte aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes". La Cour de cassation trace donc une frontière. LE NOYAU DUR DE L'ACTION PARLEMENTAIRE EST PRESERVE DE TOUTE IMMIXTION DU POUVOIR JUDICIAIRE, mais les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir législatif et des parlementaires n'impliquent PAS UNE EXONERATION GENERALE de responsabilité de l'Etat pour les FAUTES COMMISES PAR LE PARLEMENT. (p.700 - leçon 21)
(16) CEDH, du 22 juin 2000 - Inusop + CEDH, du 02 juin 2005 - Agusta-Dassault
La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 22 juin 2000, a sévèrement sanctionné la Belgique pour la manière dont a été mené le procès Inusop. Deux griefs sont retenus par la Cour. Le premier concerne Guy Coëme. Elle estime qu'il y a eu VIOLATION DE L'ARTICLE 6.1 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE (lequel consacre le droit à un procès équitable) EN RAISON DE L'ABSENCE DE LOI D'APPLICATION RÉGISSANT LA PROCÉDURE D'EXAMEN DU BIEN-FONDÉ DES POURSUITES DIRIGÉES CONTRE LES MINISTRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 103 DE LA CONSTITUTION. Guy Coëme, assisté de ses avocats, ne se trouvait pas dans une situation d'ignorance absolue des règles de procédure qui trouverait application dans ce procès. Il ne pouvait ignorer que la procédure correctionnelle ordinaire serait probablement suivie. Cependant, cette procédure n'a pas été suivie telle quelle par la Cour de cassation qui, dans son arrêt interlocutoire du 12 février 1996, estima que les règles régissant la procédure correctionnelle ordinaire ne seraient appliquées que pour autant qu'elles soient compatibles "avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant chambres réunies". Il en résulte que les PARTIES N'ONT PAS PU CONNAÎTRE À L'AVANCE TOUTES LES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE QUI SERAIENT SUIVIES. La tâche de la défense devenait singulièrement difficile faute de savoir, au préalable, si une règle donnée allait ou non trouver application dans le cours du procès. Pareille incertitude plaçait Guy Coëme dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public, ce qui l'a PRIVÉ UN PROCÈS ÉQUITABLE au sens de l'article 6.1 de la Convention. En ce qui concerne MM. Jean-Louis Mazy, Jean-Louis Stalport, Merry Hermanus et Camille Javeau, Elle estime qu'il y a violation de l'article 6, §1 dans la mesure où la Cour de cassation n'est pas un tribunal "établi par la loi" au sens de l'article 6 pour examiner les poursuites mues à leur encontre. La Cour relève QU'AUCUNE DISPOSITION NE PRÉVOYAIT LA POSSIBILITÉ D'ÉTENDRE LA JURIDICTION DE LA COUR DE CASSATION À DES INCULPÉS AUTRES QUE DES MINISTRES POUR DES INFRACTIONS CONNEXES À CELLES POUR LESQUELLES LES MINISTRES ÉTAIENT POURSUIVIS. La connexité pouvait être envisagée eu égard aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, mais ces indications ne permettent pas de considérer que la connexité était "prévue par la loi", d'autant que la Cour de cassation a elle-même décidé que le fait d'inviter à comparaître devant elle des personnes qui n'avaient jamais exercé de fonctions ministérielles résultait de l'article 103 de la constitution plutôt que des dispositions du CIC ou du code judiciaire. Or, l'article 103 est muet sur cette question. La Cour européenne réaffirme, à quelques nuances près, ces principes à l'occasion de l'affaire Agusta-Dassault. En effet, d'une part, elle confirme que la Cour de Cassation n'a pas pu valablement faire application de la CONNEXITÉ pour attraire devant elle des prévenus qui n'étaient pas ministres. D'autre part, Elle constate que les ministres Coëme et Claes ne peuvent se prévaloir de l'absence de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles quand à la procédure dès lors que l'arrêt rendu dans l'affaire Inusop constituait un PRÉCÉDANT JUDICIAIRE et qu'ils avaient donc pu, à tout le moins par l'intermédiaire de leurs avocats ou grâce à leurs conseils éclairés, profiter des clarifications jurisprudentielles réalisées tout au long de ce premier procès. (p.498 - leçon 16)
(15) Démission avortée de Jambon-Geens, 2016
La question de la démission des ministres s'est posée de manière contrastée sous le gouvernement Michel-Jambon. Jacqueline Galant, ministre de la mobilité, démissionne en avril 2016, après s'être vu reprocher d'avoir dissimulé les conclusions d'un rapport relatif à la sécurité des aéroports. Déjà très critiquée quelques semaines plus tôt pour avoir confié une mission importante à un cabinet d'avocats sans avoir respecté la législation sur les marchés publics, la ministre a, de toute évidence, perdu la confiance du gouvernement, de son propre parti et du Premier ministre. Elle démissionne spontanément afin d'éviter de voir sa responsabilité engagée devant la Chambre des représentants. On doit également évoquer les démissions avortées des ministres de la Justice d'une part, et de la Sécurité et de l'Intérieur, d'autre part, Koen Gens et Jan Jambon, au lendemain des attentats à Zaventem et Maelbeek du 22 mars 2016. Un grave dysfonctionnement des services placés sous leurs autorités survient. L'un des kamikazes, Ibrahim El Bakraoui, avait été condamné en Belgique à 10 ans de prison. Il avait été libéré conditionnellement et n'avait pas respecté les conditions de sa libération conditionnelle. Il s'était rendu en Syrie et avait été arrêté en Turquie. Les autorités turques l'avaient expulsé vers les Pays-Bas en attirant l'attention de leurs homologues néerlandais et belge sur cette expulsion et sur la dangerosité de l'individu. A son retour en Belgique, cependant, l'intéressé n'est pas arrêté ce qui lui permet de perpétrer les attentats de Bruxelles. Cette situation est dénoncée, certes de manière approximative, par le Président turc, Recep Tayyip Erdogan. Les ministres annoncent tout à la fois leur intention de démissionner et le fait qu'à la demande du Premier ministre ils renoncent à s'engager dans cette voie. Chacun appréciera la sincérité de ce processus et d'aucuns pourront se demander s'il ne s'agit pas, dans le chef des intéressés, d'une mise en scène concertée visant précisément, après la survenance d'un fait d'une extrême gravité, à éviter de devoir abandonner leurs fonctions. Si l'on compare la situation des ministres Jambon et Geens, d'une part, et Galant, d'autre part, on constate que ce n'est pas la gravité des manquements en jeu qui conditionne la démission, mais le poids politique personnel de celui qui est mis en cause. La démission de Galant n'a pas soulevé de problème politique majeur et elle a aussitôt été remplacée par un membre de son parti. En revanche, la démission de deux poids lourds du gouvernement représentant les deux partis flamands les plus importants aurait plus que probablement provoqué une crise gouvernementale et la chute du gouvernement. Tel est plus que sans doute la raison pour laquelle au niveau supérieur de celui-ci, par réflexe de survie, tout a été mis en œuvre pour éviter que leurs responsabilités individuelles ne soient engagées. (p.471 - leçon 15)
(5) Cass., du 03 mai 1974 - Le Compte
Le 03 mai 1974, la Cour de cassation rend, en la matière, un arrêt de principe. Il faut rappeler les faits de la cause. Un médecin, le docteur Le Compte, s'est vu infliger une sanction disciplinaire de la part du conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'ordre des médecins. Il se pourvoit en cassation contre cette décision. Dans un moyen, il soutient que le Roi, en abrogeant par un arrêté, pris en vertu d'une loi de pouvoirs spéciaux, la loi du 25 juillet 1938 créant l'Ordre des médecins, viole non seulement cette loi, mais également l'article 108 de la Constitution aux termes duquel le Roi "fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution". L'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 dispose, en son article 32, alinéa 1er : "le Roi fixe la date de l'abrogation de la loi du 25 juillet 1938 créant l'ordre des médecins et celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté". Conformément à cette disposition est pris l'arrêté royal du 25 mars 1969 qui fixe au 01 avril 1969 l'abrogation de la loi de 1938 et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n°79, lequel a été appliqué au docteur Le Compte et a fondé la sanction disciplinaire contestée. Dans ses conclusions, le procureur général Walter-Jean Ganshof Van der Meesch défend la thèse selon laquelle les juridictions de l'ordre judiciaire ont qualité pour contrôler la constitutionnalité des lois. L'arrêt rejette le moyen soulevé par le demandeur au motif que la loi du 31 mars 1967, sur la base de laquelle est pris l'arrêté royal n°79, est une loi de pouvoirs spéciaux et qu'elle habilite le Roi, en vertu de l'article 105 de la Constitution, à réviser et à adapter la législation relative à l'art de guérir. Autrement dit, la Cour constate que LA LOI DE POUVOIRS SPECIAUX TROUVE SON FONDEMENT DANS LA CONSTITUTION. Les termes utilisés par la Cour de cassation ne sont pas dépourvus d'ambiguïté. La Cour n'affirme plus, comme par le passé, que les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas qualité pour contrôler la constitutionnalité des lois. Cependant, elle ne se rallie pas non plus, explicitement du moins, aux conclusions de son procureur général. Une lecture attentive de cette décision révèle que la Cour affirme que la loi de pouvoirs spéciaux du 31 mars 1967 ne viole pas l'article 105 de la Constitution, et par là même opère, certes IMPLICITEMENT, UN CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE CETTE NORME LEGISLATIVE. Cet arrêt provoque une réaction vive au Parlement. Le 26 juin 1975, le Sénat adopte une proposition de loi déposée par Marc-Antoine Pierson dont l'article unique vise à interdire aux cours et tribunaux de juger la constitutionnalité des lois et des décrets. Selon le Sénat, un tel contrôle "serait contraire à l'esprit de la Constitution et à la séparation des pouvoirs telle que l'a réalisée la Constitution, contraire à la volonté des Chambres constituantes, nuisible à l'ordre dans l'Etat et à la sécurité juridique, et dangereuse pour les intérêts de la Nation". Le projet est transmis à la Chambre des représentants, laquelle n'y donne aucune suite. Force cependant est de constater qu'après la réaction du Sénat, la Cour de cassation ne n'est pas engagée plus avant dans la voie que semblait lui ouvrir son arrêt du 03 mai 1974. (p.173 - leçon 5)
(25) CE 22.690, du 26 novembre 1982 - Schiltz + Avis SLCE - 138C, compétences régionales
Le Conseil d'Etat a, de manière constante, INTERDIT AUX INSTITUTIONS FLAMANDES DE REGLER DANS UN SEUL ACTES DES MATIERES REGIONALES ET COMMUNAUTAIRES. Cette thèse a été affirmée à plusieurs reprises par la section de législation et a également été développée dans un arrêt de la section du contentieux administratif. Le Conseil d'Etat relève, tout d'abord, que du point de vue constitutionnel, la SEPARATION INSTITUTIONNELLE ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA REGION EST LA REGLE et que la liaison institutionnelle, dans les limites autorisées par la Constitution, apparaît comme une dérogation à celle-ci. Il s'ensuit que toute forme de liaison, et certainement toute forme de liaison obligatoire, doit être fondée sur une disposition légale expresse. Autrement dit, il estime qu'il n'est pas possible de régler dans un même acte (arrêté ou décret) des matières régionales et communautaires. Ceci se justifie d'autant plus que la SPHERE DE COMPETENCE TERRITORIALE de ces actes est plus large pour la Communauté que pour la Région puisqu'elle englobe Bruxelles. De même, la COMPOSITION DU PARLEMENT FLAMAND est affectée par la distinction entre Région et Communauté. En effet, les membres bruxellois de cette assemblée prennent part au vote lorsqu'ils délibèrent sur des matières communautaires, ce qui n'est pas le cas lorsque des matières régionales sont en jeu. La Cour constitutionnelle n'a pas, jusqu'ici adopté une position aussi tranchée que la section de législation du Conseil d'Etat. Cependant, elle a également affirmé qu'il n'existait pas de confusion entre les compétences de la Communauté flamande et celles de la Région flamande. En effet, en une occasion, elle a estimé qu'il n'était pas disproportionné dans le chef de la Région flamande d'empiéter sur les compétences de la Communauté pour autant qu'elle ne rende pas l'exercice de celles-ci impossible ou exagérément difficile. En une autre occasion, elle a admis que la Région flamande se fondait sur la théorie des pouvoirs implicites pour régler une compétence communautaire. Si elle avait estimé que les matières régionales et communautaires pouvaient être réglées dans un seul décret, elle se serait épargnée de justifier les raisons pour lesquelles elle admettait l'existence d'un empiétement du législateur régional dans le champ des compétences communautaires. La section de législation du Conseil d'Etat adopte une POSITION SIMILAIRE EN CE QUI CONCERNE les compétences communautaires dont l'exercice est transféré en application de L'ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION à la Région wallonne. Elle estime, en effet, que la Constitution et les autres dispositions de réformes institutionnelles établissent une NETTE DISTINCTION ENTRE LES MATIERES COMMUNAUTAIRES ET LES MATIERES REGIONALES. Ces matières SONT DEVOLUES A DES PERSONNES MORALES DISTINCTES, dotées d'organes qui leur sont propres. La circonstance que la Région wallonne exerce certaines compétences de la Communauté française sur le territoire de la région de langue française ne porte pas, à son estime, atteinte à LA SEPARATION DES DEUX SPHERES DE COMPETENCES, NI AUX MISSIONS DISTINCTES DEVOLUES RESPECTIVEMENT AUX AUTORITES REGIONALES ET AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES. Il n'y a pas, dans le domaine d'application des compétences communautaires exercées par la Région wallonne, la moindre fusion entre celle-ci et la Communauté française. Le deuxième argument avancé par la section de législation se fonde sur une analyse des COMPETENCES TERRITORIALES des différentes entités fédérées. Elle relève, en effet, que le champ d'application des dispositions arrêtées par la Région wallonne n'est pas le même selon que celle-ci règle une matière régionale ou exerce des compétences de la Communauté française. En effet, dans le premier cas, les dispositions s'appliquent sur tout le territoire de la Région wallonne alors que dans le second cas, elles s'appliquent uniquement sur le territoire de la région de langue française, à l'exclusion de celui de la région de langue allemande. Enfin, elle avance un troisième argument qui se fonde sur la COMPOSITION DU PARLEMENT WALLON selon qu'il intervient dans des matières régionales ou communautaires. Elle rappelle qu'en ce qui concerne les décrets, les membres de cette assemblée qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand ne peuvent participer aux votes au sein du Parlement sur les matières relevant de la Communauté française. Cette thèse mérite d'être nuancée. Tout d'abord, l'argument fondée sur L'ETANCHEITE DES COMPETENCES REGIONALES ET COMMUNAUTAIRES ne résiste pas à l'analyse dès lors que c'est le constituant lui-même qui a investi la Région wallonne du pouvoir d'exercer des compétences communautaires. Ensuite, l'argument fondé sur l'absence de fusion des institutions régionales et communautaires et sur l'existence de PERSONNALITES JURIDIQUES DISTINCTES n'est pas conforme au prescrit constitutionnel dès lors que, à aucun moment, contrairement à ce qui a été fait pour les institutions flamandes, il n'est affirmé que la Région wallonne posséderait deux personnalités juridiques distinctes, selon qu'elle exerce des compétences régionales ou des compétences communautaires. En ce qui concerne LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL des normes uniques qui seraient adoptées, une solution pratique peut être envisagée dès lors qu'il est possible de prévoir, dans le décret ou dans l'arrêté, les modalités de sa mise en oeuvre sur le plan territorial. Enfin, le seul argument qui semble résister à l'analyse (mais qui ne vaut que pour l'exercice du pouvoir décrétal) tient dans le fait que LE PARLEMENT WALLON N'EST PAS COMPOSE DE LA MÊME MANIERE SELON QU'IL EXERCE DES COMPETENCES REGIONALES OU DES COMPETENCES DONT L'EXERCICE EST TRANSFERE EN VERTU DE L'ARTICLE 138 DE LA CONSTITUTION. Cet obstacle pourrait éventuellement être pallié par l'adoption de deux décrets identiques, votés par le Parlement, l'un dans sa composition régionale, l'autre dans sa composition communautaire ou encore soumettre chacune des dispositions du décret à une procédure de vote conditionnée par son contenu régional ou communautaire. Il est également possible de recourir au vote de décrets conjoints pour pallier l'impossibilité constatée par le Conseil d'Etat (p.839 - leçon 25)
(13) CE 27.619, du 04 mars 1987 - Ylieff, vérification des pouvoirs + CEDH du 02 mars 2010 - Grosaru c. Roumanie, vérification des pouvoirs
Les assemblées composées de membres qui ne sont pas élus directement en cette qualité procèdent également à une vérification des pouvoirs de ceux-ci. Dans ce cas, elles ne vérifient pas la régularité de l'élection directe, mais simplement si les conditions posées par la Constitution ou par la loi à propos de leur propre composition sont bien réunies. C'est au moment de la vérification des pouvoirs de leurs membres que les assemblées parlementaires de la Communauté française et de la Région wallonne ont, en 1985, évincé irrégulièrement de leur sein le sénateur de la Volksunie (parti nationaliste flamand), Toon van Overstraeten, pourtant élu régulièrement dans la circonscription de Nivelles. En effet, à l'époque, les règles d'apparentement s'appliquaient à l'ensemble de la province de Brabant et faisaient qu'un candidat dans une circonscription francophone pouvait bénéficier pour être élu des surplus de voix obtenues dans les autres circonscriptions de la même province. L'application du principe du double mandat avait aussi pour conséquence que tous les sénateurs élus directement dans une circonscription francophone faisaient de droit partie du groupe linguistique français du Sénat, et partant du Conseil régional wallon et du Conseil de la Communauté française. Ces assemblées, de manière totalement illégale, ont refusé de vérifier les pouvoirs de l'élu de la Volksunie, lui interdisant par là même de siéger et de prêter serment. Or, à la Région wallonne, la coalition libérale/sociale-chrétienne ne disposait que d'une voix de majorité et aurait perdu celle-ci si Toon van Overstraeten avait fait partie de l'assemblée. A la suite de ce coup de force, un parlementaire de l'opposition saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre la désignation du Ministre-Président par les membres de l'exécutif régional wallon. Il estime que les membres de cet organe étaient incompétents pour ce faire parce qu'ils avaient eux-mêmes été désignés par une assemblée irrégulièrement composée. Autrement dit, dès lors que l'assemblée est irrégulièrement composée, elle n'a pu valablement élire les membres de l'exécutif qui n'ont pu valablement élire leur président. Le Conseil d'Etat rejette le recours en indiquant "que tous les moyens se donnent comme fondement l'illégalité du refus de valider les pouvoirs du sénateur Van Overstraeten et de l'élection des membres de l'exécutif ; que ces actes, quoique ne procédant pas à la fonction décrétale du conseil régional wallon, émanent d'une autorité qui n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, mais une autorité parlementaire élue et souveraine dans la sphère de ses compétences et à laquelle il appartient exclusivement d'admettre un appréciation sur la légalité de tels actes à défaut de contrôle juridictionnel organisé par la Constitution ou par la loi ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la légalité des actes d'une telle autorité et, par conséquent, pour connaître de moyens d'annulation pris de leur illégalité". Cette question trouve une actualité toute particulière à la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme , Grosaru c. Roumanie, dans lequel elle constate que le bureau électoral central et la commission de validation de la Chambre des députés, qui ont rejeté la contestation du requérant, sont composés d'un grand nombre de partis politiques. À son estime, le requérant avait des raisons légitimes de penser que ces derniers pouvaient avoir des intérêts aux siens. Elle en déduit que ces organes ne paraissent donc pas fournir de gages suffisants d'impartialité. Elle note, en outre, qu'aucun tribunal national ne s'est prononcé sur l'interprétation de la disposition légale litigieuse, ce qui eut pourtant été important, tel que cela ressort non seulement de sa jurisprudence, mais aussi des travaux de la Commission de Venise et d'une analyse de droit comparé. Autrement dit, la Cour européenne estime que LE CONTRÔLE DES ÉLECTIONS DOIT ÊTRE RÉSERVÉE À UN ORGANE JURIDICTIONNEL INDÉPENDANT ET IMPARTIAL ET NE PEUT ÊTRE LAISSÉ À LA DISCRÉTION DES ÉLUS DE LA NATION. La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Grosaru, a évoqué incidemment la situation de la Belgique. Elle relève que "trois pays (Belgique, Italie, Luxembourg) présentent les particularités de ne pas prévoir d'autre recours postélectoral que la validation par le Parlement, les décisions des bureaux électoraux étant considérées comme définitives. Cela étant, ces trois pays jouissent d'une longue tradition démocratique qui tend à dissiper les doutes éventuels quant à la légitimité d'une telle pratique. La Commission de Venise se montre toutefois réservée de manière générale quant à l'effectivité de ce type de recours, l'impartialité de tels organes paraissant sujette à caution". La Commission de Venise, quant à elle, estime qu'il "est néanmoins sortable, à titre de précaution, de mettre en place une forme de contrôle juridictionnel. Dès lors, le premier degré de recours sera la commission électorale supérieure, et le deuxième le tribunal compétent" et que le "recours devant le Parlement, comme juge de sa propre élection, est parfois prévu, mais risque d'entraîner des décisions politiques. Il est admissible en première instance là où il est connu de longue date, mais un recours judiciaire doit alors être possible". Le constituant belge ne pourra donc pas faire l'économie d'une réforme relative au contrôle de la validité des élections. Il faudra trouver la juridiction capable d'opérer le contrôle exigé dans l'arrêt Grosaru. La sixième réforme de l'Etat était évidemment le moment idéal pour envisager cette réforme ou, à tout le moins, pour créer les conditions de sa réalisation ultérieure. Il en va d'autant plus ainsi que l'article 142 de la Constitution a été modifié pour confier à la Cour constitutionnelle le soin de connaître de recours dans le domaine des dépenses électorales. Pour ce faire, le constituant s'est référé au modèle allemand : "le choix de la Cour constitutionnelle comme instance de recours s'inspires de la solution retenue dans d'autres pays voisins. Ainsi, en Allemagne, la Loi fondamentale réserve au Bundestag le soin de contrôler les élections tout en ouvrant un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale contre les décisions de ce dernier". Il est donc peu cohérent de ne pas avoir prolongé cette réforme et de ne pas avoir investi la Cour constitutionnelle du pouvoir de connaître de tous les recours formés contre les décisions de la Chambre, voire de l'ensemble des assemblées parlementaires relatives à la vérification des pouvoirs de leurs membres. En effet, en Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale connaît des recours formés contre les décisions du Bundestag en matière de contrôle des élections. L'application de cette jurisprudence européenne à la Belgique sera assurément au coeur des débats dans les années qui viennent. (p.401 + 404 - leçon 13)
(20) CE 175.208, du 02 octobre 2007 - Bosseaux, motivation formelle
Les moyens qui ont trait à LA LEGALITE INTERNE renvoient au contrôle de la LEGALITE DES MOTIFS de l'acte administratif. Un acte est entaché d'une illégalité interne lorsque l'administration, intervenant dans une matière dans laquelle elle est a priori compétente et dans le respect des formes qui régissent son action, viole une norme de droit supérieure ou fait une fausse application de celle-ci. Par norme de droit supérieure, il faut entendre les traités internationaux directement applicables en droit belge, la Constitution, les lois, les décrets et les ordonnances, ainsi que les normes réglementaires prises par le pouvoir exécutif au sens large. Le contrôle exercé par le Conseil d'État sur ce point porte sur les motifs de droit et les motifs de fait qui ont servi de fondement à l'acte attaqué. En d'autres termes, une erreur dans l'appréciation matérielle des faits à la base d'un acte administratif peut fonder son annulation. Le Conseil d'État accepte aujourd'hui d'exercer un CONTRÔLE MARGINAL DE L'OPPORTUNITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS (voie que condamne en principe la règle de la séparation des pouvoirs) EN SANCTIONNANT LES ERREURS MANIFESTES D'APPRÉCIATION COMMISES PAR L'ADMINISTRATION. Cependant, depuis l'adoption de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, sous le couvert d'un examen tatillon de la forme de la motivation, le Conseil d'État effectue un contrôle invasif de l'action de l'administration qui aboutit à la sanctionner bien au-delà de l'erreur manifeste d'appréciation. À titre d'exemple, un conducteur de train, par ailleurs délégué syndical, écrit à ses supérieurs un courrier contenant les propos suivants : "concerne l'absence du 16 novembre 2000 de 22h00 à 0h30, il s'agit d'une vengeance du convoyeur Daniel (...) ; ce type passe ses nuits à regarder des films érotiques sur canal+ puis disparaît 15 minutes dans les WC provoquant des sorties tardives, il se permet de sonner au répartiteur de Namur pour faire garer des trains de manière à éviter les rentrées avant l'heure prévue se vengeant du mépris de certains conducteurs". L'auteur de ces propos est sanctionné disciplinairement pour avoir tenu des propos diffamatoires transmis par lettre. La lettre est connue de l'agent. Il en est l'auteur. Elle figure au dossier administratif. Tout d'abord, le Conseil d'État affirme que l'autorité n'a pas commis une erreur manifeste en qualifiant les propos de l'agent de diffamants. Il annule, cependant, la sanction pour violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il indique que "même si le requérant pouvait se faire une idée plus précise des faits viser par le grief de 'propos diffamants' l'autorité devait préciser dans le texte même de la décision attaquée ce qu'elle entendait par là". Que déduire de cet arrêt ? Le Conseil d'État constate que l'autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et, ce faisant, il démontre qu'il a parfaitement compris pourquoi l'agent a été sanctionné. S'il a compris, il devait en aller de même pour l'agent. L'annulation ne s'explique que parce que, dans sa motivation formelle, l'autorité n'a pas ajouté une ligne expliquant ce qui ressort de l'évidence, à savoir qu'il est diffamant d'affirmer sans preuve qu'un collègue visionne des films érotiques pendant ses heures de service. (p.651 - leçon 20)
(1) CE 80.787, du 09 juin 1999 - Bastien, tribunes électorales + CE 171.094, du 11 mai 2007 - Robert, tribunes électorales
Lors de la campagne électorale précédant les élections du 13 décembre 1999, la haute juridiction administrative, dans un arrêt Bastien, donne raison à la RTBF qui a refusé d'offrir une tribune électorale à un parti d'extrême droite, le Front nouveau de Belgique. Le Conseil d'Etat précise qu'une institution de service public peut REFUSER DE DIFFUSER UNE TRIBUNE ELECTORALE d'une FORMATION QUI NE RESPECTERAIT PAS LES PRINCIPES ET LES REGLES DE LA DEMOCRATIE, et cela, même lorsqu'elle ne comporte que des propos anodins. Il fonde notamment sa décision sur l'article 3 de la loi du 16 juillet 1972 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (dite loi sur le Pacte culturel) qui oppose à un organisme comme la RTBF "d'associer à la politique culturelle toutes les tendances idéologiques" pour autant qu'elles "acceptent les principes et les règles de la démocratie et s'y conforment". De même, en 2007, dans un arrêt Robert relatif au Front nouveau de Belgique, le Conseil d'Etat considère qu'en décidant de ne pas diffuser les tribunes ou débats électoraux d'une liste ou d'un candidat émanant d'un parti, d'une formation, d'une association, d'un mouvement ou d'une tendance ne respectant pas les principes démocratiques, le dispositif électoral de la RTBF ne viole ni l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 19 de la Constitution, lesquels consacrent la liberté d'expression et d'association. Le Conseil d'Etat va plus loin encore en affirmant que même si la RTBF était tenue, en vert d'un décision judiciaire, de diffuser une tribune électorale d'un tel parti, elle pourrait néanmoins REFUSER DE DIFFUSER LES TRIBUNES DONT LE CONTENU SERAIT CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE LA DEMOCRATIE. Force est d'ailleurs de relever qu'en vertu de l'article 7 §1 du décret du 14 juillet 1997, la RTBF "ne peut produire ou diffuser des émissions contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, et notamment contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ou tout autre forme de génocide". En vue d'appliquer notamment les dispositions évoquées ci-dessus, ajoute le Conseil d'Etat, la RTBF est fondée à exiger que le parti souhaitant accéder à La Tribune électorale lui fournisse notamment son programme complet, ainsi que la liste de ses candidats et de ses dirigeants nationaux et régionaux. (p.39 - leçon 1)
(30) Conflits d'intérêts, normes de bruit, sanctions applicables aux compagnies aériennes
Lorsque la procédure trouve à s'appliquer à des CONFLITS ENTRE AUTORITES GOUVERNEMENTALES, le comité de concertation est saisi directement par l'organe exécutif ou l'un de ses membres qui s'estime lésé par une décision ou une absence de décision d'un autre organe exécutif. Le comité de concertation est ici aussi appelé à prendre une décision dans le respect de la procédure du consensus et, à défaut, l'autorité exécutive retrouve sa pleine liberté pour agir ou ne pas agir. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à propos d'une même décision ou d'une même absence de décision. Le 6 février 2014, peu avant la dissolution des chambres préalables aux élections du 25 mai 2014, le secrétaire d'État fédéral à la Mobilité, Melchior Wathelet Jr, exécute un accord passé antérieurement au sein du gouvernement fédéral sur le survol de Bruxelles par les avions qui utilisent l'aéroport de Bruxelles-National. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté un certain nombre de mesures d'accompagnement imposées par cet accord et d'avoir ainsi avalisé le survol de zones densément peuplées. Confronté, pendant la campagne électorale, à la colère des habitants de plusieurs communes bruxelloises, il envisage de revoir le plan de survol, avec pour conséquence de déplacer une partie des nuisances au-dessus du Brabant flamand. Avant même que cette question ne soit évoquée au sein du gouvernement fédéral, manifestement divisé sur la question, le gouvernement flamand engage, la procédure en conflits d'intérêts. La solution envisagée par le secrétaire d'État ne peut donc pas fait l'objet d'une décision gouvernementale pendant au moins soixante jours et le débat est reporté au-delà de l'échéance électorale. A l'issue du délai de 60 jours, il est apparu que le comité de concertation ne s'était pas réuni et qu'aucune solution n'avait donc pu être dégagée en son sein. Le gouvernement fédéral retrouvait ainsi sa capacité de prendre une décision. Cependant, les ministres fédéraux francophones et néerlandophones se sont avérés incapables de s'accorder sur la solution sur la solution envisagée par le secrétaire d'État de telle manière que le plan de survol du 06 février 2014 est demeuré d'application. Cet épisode a permis de mettre en lumière que même si un gouvernement (qu'il s'agisse d'un gouvernement fédéral ou de celui d'une entité fédérée) est démissionnaire, la mise en œuvre de la procédure en conflit d'intérêts n'a d'effets paralysants que pendant 60 jours. La situation est différente lorsque la procédure de la sonnette d'alarme est mise en œuvre. En effet, dans ce cas, le processus d'adoption de la norme législative est suspendu tant que le conseil des ministres n'a pas émis d'avis. Or, étant démissionnaire, celui-ci est incapable de le faire. Mérite également l'attention le conflit d'intérêts concernant la décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'appliquer effectivement les sanctions applicables aux compagnies aériennes qui méconnaissent les normes de bruit régionales. Une première procédure en conflit d'intérêts avait été mise en œuvre, en décembre 2016, par le Gouvernement flamand, agissant dans l'exercice de ses compétences régionales. Confronté à la détermination du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'infliger des amendes à la suite du survol du territoire régional par des avions utilisant l'aéroport de Bruxelles-National, le Gouvernement flamand, agissant cette fois dans l'exercice de ses compétences communautaires, a engagé, en février 2017, une seconde procédure en conflit d'intérêts. Compte tenu de la séparation institutionnelle existant entre les sphères de compétences régionale et communautaire, cette initiative n'était pas, sous cet angle, critiquable. Par contre, l'article 32, §1er, de la loi ordinaire du 09 août 1980 est clair : "cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'une même décision ou d'un même projet de décision", et cela sans qu'il soit fait référence à l'organe gouvernemental qui met la procédure en œuvre. On notera la différence entre les procédures relatives aux conflits d'intérêts entre assemblées et entre organes gouvernementaux. Dans le premier cas, la procédure ne peut être engagée qu'une seule dois par chaque assemblée alors que, dans le second cas, elle ne peut l'être QU'UNE SEULE FOIS, peu importe l'organe gouvernemental qui la met en œuvre. Il en résulte que la deuxième procédure en conflit d'intérêts mise en œuvre par le Gouvernement flamand était irrecevable. (p.965 - leçon 30)
(17) CE 211.502, du 24 février 2011 - ASBL Théâtre Jacques Gueux, titulaires du pouvoir réglementaire
On a pu s'interroger sur la constitutionnalité des arrêtés et règlements pris par des ministres ou des secrétaires d'Etat fédéraux. En effet, ces actes révèlent l'existence d'une délégation dans l'exercice du pouvoir réglementaire, laquelle n'est pas consacrée par la Constitution. Cette controverse appartient au passé, personne ne condamnant plus le principe de la délégation de pouvoirs du Roi à ses ministres. La section de législation du Conseil d'Etat indique, à ce propos que "si la Constitution, notamment par ses articles 37, 105 et 108 ne reconnaît expressément un pouvoir réglementaire qu'au Roi, une délégation de ce pouvoir à un ministre est admissible, en raison notamment de la responsabilité politique assumée par celui-ci devant la Chambre des représentants". Encore faut-il qu'elle "NE PORTE PAS SUR L'ESSENCE MÊME DU POUVOIR ATTRIBUE OU RECONNU AU ROI ET QU'ELLE NE CONCERNE QUE DES ASPECTS ACCESSOIRES OU SECONDAIRES OU ENCORE DES MESURES D'EXECUTION DE PRINCIPES FIXES PAR LE ROI". Cette habilitation doit, de surcroît, être expresse. Par contre, UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE NE PEUT, EN PRINCIPE, ÊTRE CONFIÉ À UN AGENT DE L'ADMINISTRATION, lequel, par définition, n'engage pas sa responsabilité devant le Parlement. Tout au plus peut-on concevoir qu'il se voit reconnaître le pouvoir de prendre des décisions individuelles pour autant que le ministre dont il est le subordonné conserve le pouvoir de les réformer. Dans le même ordre d'idée, aucune délégation ne peut être accordée à un membre d'un cabinet ministériel. Il a été jugé que "la décision attaquée de la ministre de la culture de la Communauté française de ne pas accorder une convention au théâtre requérant, signée par le directeur de cabinet de la ministre de la culture et de l'audiovisuel, a été prise par une autorité incompétente". En effet, "les membres des cabinets ministériels sont des collaborateurs personnels des ministres qui n'ont pas la qualité pour se substituer à eux aux fins de prendre des décisions relevant de la compétence du ministre" et ils "ne peuvent pas d'avantage se substituer à l'administration, en telle sorte qu'une délégation de compétence ne peut valablement leur être consentie". Il en va a fortiori de même d'un pouvoir réglementaire qui serait délégué à une autorité étrangère au pouvoir exécutif fédéral, régional ou communautaire. Le juge judiciaire ou administratif dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans chaque cas, si la délégation porte sur l'essence du pouvoir réglementaire ou sur des questions d'importance secondaire. De plus, le principe de la délégation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le principe de la solidarité gouvernementale. En cas de différend avec l'un de ses collègues, un ministre ne peut se prévaloir d'une délégation pour imposer ses vues. S'il y a dissension, on en revient à la procédure normale de consensus, et ce, par la mise en oeuvre d'un processus d'évocation. (p.522 - leçon 17)
(7) Problématique de l'arrêt Inusop sur l'exercice des fonctions parlementaires
A la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 05 avril 1996, dans l'affaire Inusop, la question s'est posée de savoir si LA PERTE D'UNE CONDITION D'ELIGIBILITE EN COURS DE MANDAT A POUR EFFET DE RENDRE IMPOSSIBLE LA POURSUITE DE CELUI-CI. La question concerne non seulement Guy Coëme, qui est à la fois membre de la Chambre des représentants et bourgmestre de la commune de Waremme, mais également Merry Hermanus, qui est membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Tous les deux ont été condamnés et déchus de leurs droits civils et politiques. Pouvaient-ils conserver leur mandat jusqu'à son expiration ou perdaient-ils immédiatement le droit de l'exercer ? La réponse à cette question doit être nuancée. En effet, la solution qui doit être retenue varie selon l'assemblée en cause. En ce qui concernent le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone, les dispositions légales sont explicites. Un membre de l'assemblée doit POUR ENTRER EN FONCTION ET POUR EXERCER CELLE-CI réunir les conditions d'éligibilité. Le droit communal retient la même solution. La situation est quelque peu différente en ce qui concerne les chambres fédérales ou les autres assemblées régionales et communautaires. En effet, les articles 64 et 69 de la Constitution en 24bis de la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles prévoient qu'il faut jour de ses droits civils et politiques pour ÊTRE ELU dans l'une des assemblées considérées. S'agissant en l'espèce d'un DROIT POLITIQUE (celui d'exercer une fonction élective), toute restriction à ce droit doit résulter d'un texte exprès et clair et en cas de doute dans l'interprétation de ces dispositions, il faut opter pour la conception qui préserve l'exercice du droit plutôt que pour celle qui aboutit à le restreindre. Dès lors, à défaut d'un texte exprès, Guy Coëme aurait pu, à notre sens, exercer son mandat jusqu'à son terme, étant entendu qu'il ne pouvait plus par la suite, et pendant le temps de l'interdiction, se présenter à de nouvelles élections. En pratique, la pression politique exercée sur l'intéressé fut telle qu'il démissionna de son mandat de député. Par contre, la perte de la condition de la nationalité entraînée ipso facto la perte du mandat dès lors qu'une disposition expresse (l'article 8 de la Constitution) prévoit que seuls les Belges peuvent exercer des droits politiques. Il serait souhaitable, pour couper court à toute controverse, que les textes envisagés prévoient expressis verbis que les conditions d'éligibilité doivent être réunies durant tout le mandat. (p.213 - leçon 7)
(7) CC 169/2015, du 26 novembre 2015 - circonscriptions électorales
Alors qu'au niveau fédéral, il a été opté pour des circonscriptions provinciales, il avait été décidé, en Région wallonne, de conserver les anciens arrondissements électoraux. Il en résulte que le plus petit d'entre eux comptait seulement 2 élus (Neufchâteau-Virton) alors que le plus grand (Liège) en comptait 13. Dans son arrêt n°169/2015 du 26 novembre 2015, la Cour constitutionnelle affirme que cette disparité viole le principe d'égalité. Elle note que "des écarts importants entre les seuils électoraux naturels à atteindre ne peuvent manquer d'apparaître lorsque le nombre de sièges à pourvoir par circonscription varie de 2 à 13". Il est donc bien plus malaisé de se faire élire dans une circonscription ne comptant qu'un nombre très réduit d'élus. Elle en conclut que, si elle a jugé dans un arrêt précèdent qu'il "peut être admis qu'une circonscription électorale où quatre mandats sont à répartir est compatible avec le système de la représentation proportionnelle, tel n'est pas le cas pour les circonscriptions où seuls 2 ou 3 mandats sont à répartir et où le seuil électoral est, pour cette raison, déraisonnablement élevé". En conséquence, le législateur wallon est tenu de revoir sa carte électorale afin d'éviter qu'il n'existe aucune circonscription dont le nombre d'élus est inférieur à 4. La Cour ne semble pas avoir égard, afin de déterminer si le principe d'égalité est respecté, au différentiel entre la plus grande et la plus petite circonscription. Elle se contente d'affirmer que ce principe exige qu'il ne peut exister de circonscription dans laquelle il serait procédé à l'élection de moins de 4 parlementaires. (p.222 - leçon 7)
(5) Cour Suprême des Etats-Unis - Marbury c. Madison
Aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, toutes les juridictions sont habilitées à contrôler, par voie d'exception, la constitutionnalité des lois. Ce principe a été fixé aux Etats-Unis à l'occasion de l'arrêt Marbury vs Madison (1803). Le 2ème Président des Etats-Unis, John Adams avait procédé dans les heures qui précédaient son remplacement par Thomas Jefferson à diverses nominations. Il avait notamment nommé Willian Marbury en qualité de juge de paix. Il appartenait au secrétaire d'Etat de notifier cette décision au bénéficiaire de la nomination. Compte tenu du manque de temps dont il disposait, le secrétaire d'Etat de John Adams, John Marshall, n'eut pas matériellement la possibilité de notifier sa nomination à William Marbury. Le nouveau secrétaire d'Etat, James Madison, décida de ne pas notifier cette décision à l'intéressé. William Marbury saisit la Cour Suprême, présidée désormais par John Marshall, afin qu'il soit donné injonction à James Madison de notifier la décision en cause. Son action était fondée sur le Judiciary Act qui fondait la compétence de la Cour Suprême de connaître, en premier et dernier ressort, d'un tel recours. La Cour Suprême, cependant, écarta l'application du Judiciary Act au motif qu'il entrait en contradiction avec une disposition constitutionnelle qui, pour des nominations à ce niveau de pouvoir, conférait à la Cour Suprême un pouvoir d'appel contre la décision prise par une juridiction de premier degré, mais qui ne lui accordait pas le droit de connaître directement du litige. Le Président de la Cour Suprême, le juge John Marshall, souligne avec force que "l'on ne peut présumer qu'il se trouve dans la Constitution des causes qui soient sans effet". Il pose deux principes fondamentaux. Tout d'abord, la supériorité de la Constitution sur la loi n'est pas qu'une considération théorique, mais doit être mise en pratique, avec pour conséquence la nullité des actes qui lui sont claires. Ensuite, il appartient au pouvoir judiciaire d'interpréter la Constitution, et donc d'apprécier la conformité des lois. Il est donc clairement affirmé que le contrôle de constitutionnalité (le judicial review) est une conséquence du pouvoir de juger. Le juge (qu'il s'agisse de la Cour Suprême ou des juridictions des différents Etats) n'a pas simplement le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, il en a le devoir. A cette fin, il doit assurer le respect de la hiérarchie des normes qu'elles soient fédérales ou étatiques. Ce contrôle s'opère par voie d'exception. Il peut cependant avoir les mêmes effets qu'un contrôle par voie d'action puisque la règle du précédent (le stare decisis) veut que les tribunaux se conforment aux solutions précédemment dégagées par des juridictions supérieures. Il suffit donc que la Cour Suprême déclare une loi inconstitutionnelle pour qu'aucune juridique ne puisse plus en faire application. La Cour Suprême, cependant, ne s'estime pas liée par ses propres précédents. (p.166 - leçon 5)
(13) Chambre des mises en accusation de Bruxelles, du 10 décembre 1987 - de Bonvoisin
Ces principes (séparation des pouvoirs) trouvent à s'appliquer lorsque le pouvoir judiciaire entend contraindre des membres d'une commission parlementaire d'enquête à s'expliquer sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission. Dans un arrêt du 10 décembre 1987, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles invite un juge d'instruction à procéder à de nouvelles investigations dans le cadre d'une plainte déposée par le baron de Bonvoisin contre deux agents de la sûreté de l'État à la suite de déclarations qu'ils ont faites devant une commission parlementaire d'enquête. Le juge d'instruction est notamment chargé d'enregistrer les témoignages effectués par les intéressés devant la commission sénatoriale d'enquête, dite commission Wijninckx est de faire transcrire ces témoignages sur procès-verbal. Il est également invité à interroger l'ex-président Wijninckx et l'ex-vice président Moureaux de la commission d'enquête du Sénat des éléments de faits relatifs à cette affaire. Si cette décision est analysée au regard de l'article 10 de la loi du 03 mai 1880, la commission d'enquête se devait d'informer le parquet des infractions dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Comme elle est abstenue de prendre cette initiative, elle est présumée n'avoir pas découvert d'infractions au cours de ses travaux. Cette présomption revêt d'ailleurs un caractère irréfragable dans la mesure où la commission a cessé d'exister. Le système mis en oeuvre par l'article 10 de la loi du 03 mai 1880 suppose donc que la démarche initiale (la transmission d'un procès-verbal constatant une infraction) soit prise par la commission parlementaire d'enquête. Il est remarquable que le législateur impose la transmission du seul procès-verbal. La commission peut également communiquer les pièces sur lesquelles se fonde ce procès-verbal, mais le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'elle y soit contrainte. Elle DÉTERMINE SOUVERAINEMENT CE QU'IL DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE TRANSMISSION AU PARQUET. Un juge d'instruction ne peut donc exiger d'une assemblée qu'elle lui fournisse les enregistrements réalisés lors des travaux d'une commission parlementaires d'enquête. Mutatis mutandis, ces principes s'appliquent également aux témoignages des membres d'une commission parlementaire. Ils ne peuvent être contraints de divulgués à un juge d'instruction des informations portées à leur connaissance en raison des fonctions qu'ils ont exercées en vertu de l'article 56 de la Constitution. En l'espèce, le Sénat, d'une part, les sénateurs Nos Wijninckx et Serge Moureaux, d'autre part, pouvaient décider spontanément de déférer à l'invitation qui leur était faite par le juge d'instruction. S'il existe, en raison de la séparation des pouvoirs, un droit au silence, celui-ci ne doit pas se muer en une interdiction de parler. Dans les faits, il semble que les intéressés se soient refusés à témoigner. (p.414 - leçon 13)
(5) CE 215.144, du 14 septembre 2011 - Wysocki, avis SLCE
Dans l'affaire Wysocki, la requérante poursuit l'annulation de la décision d'un jury de lui refuser un brevet d'inspecteur dans l'enseignement secondaire. Le Conseil d'Etat constate que ce jury a été constitué en exécution d'un arrêté du gouvernement de la Communauté française. Au moment de son adoption, le gouvernement, invoquant l'urgence, avait demandé que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat soit rendu dans un délai réduit. Le Conseil d'Etat constate que cette urgence est démentie lorsque "trois mois et demi séparent l'adoption d'un arrêté du moment où il a été publié au Moniteur belge, que la demande visant à faire traduire en néerlandais ce règlement n'a pas été adressé au service compétent immédiatement, mais seulement un mois et demi plus tard, à un moment où les vacances d'été risquaient de ralentir la réalisation de ce travail de traduction, et que, par la suite, un mois et 5 jours ont encore été nécessaires afin de traduire un texte qui occupe à peine plus de 2 pages dans le Moniteur belge". En conséquence, il estime que le jury a été constitué en exécution d'un acte réglementaire irrégulier et qu'il était donc incompétente pour prendre des décisions. (p.157 - leçon 5)
(17) CC 65/93, du 15 juillet 1993 - pacte culturel
Dans le cadre de leurs compétences d'exécution par voie d'actes à portée individuelle, une compétence des exécutifs retient particulièrement l'attention. Il s'agit DU POUVOIR DE NOMINATION AUX EMPLOIS DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. Les nominations aux fonctions supérieures de l'administration ont longtemps fait l'objet d'un partage entre les partis de la coalition gouvernementale. Cette politisation de la fonction publique est contraire aux principes fondamentaux inscrits dans notre charte fondamentale, et particulièrement aux principes de l'égale admission aux emplois publics, consacré par l'article 10 de la Constitution. La Cour constitutionnelle l'a rappelé fermement à propos de l'article 20 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, dite loi du Pacte culturel. Cette disposition a pour but garantir le pluralisme dans les institutions publiques qui relèvent du secteur culturel, tel par exemple la RTBF et la VRT. Elle prévoit que, de tels organismes, les emplois doivent être répartis de manière équilibrée entre toutes les tendances représentatives afin que chacune d'elle bénéficie d'une présence minimale et qu'aucune d'entre elles ne bénéfice d'un monopole ou d'une prédominance injustifiée. La Cour constitutionnelle a jugé cet article et le système qu'il organise contraires à l'article 10 de la Constitution, notamment au motif que "s'il est légitime de veiller à des équilibres, LE LÉGISLATEUR MANQUE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ EN RECOURANT, POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, À UN SYSTÈME QUI EN IMPOSE À L'AUTORITÉ DE DÉROGER AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ EN CONSIDÉRATION DES CONVICTIONS PERSONNELLES. Il en est d'autant plus ainsi que le système impose, sur le plan des principes, un sacrifice certain pour un avantage qui reste conjectural. Ce n'est pas encourager chaque agent à exercer ses fonctions avec impartialité que de rendre officielle la tendance qu'il est incité à déclarer et d'attacher à celle ci des conséquences sur le plan de la carrière". (p.535 - leçon 17)
(28) CC 119/2004, du 30 juin 2004 - égalité des belges et répartition des compétences
Dans plusieurs arrêts, la Cour constitutionnelle affirme que l'autonomie des entités fédérées les autorise à adopter des politiques qui leur sont propres et qui, par essence, se distinguent de celles retenues par d'autres législateurs dans le même domaine. Ainsi, une agence de voyage flamande poursuit l'annulation d'un décret de la Commission communautaire française aux motifs que "les agences de voyage qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française peuvent désormais vendre sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale des voyages dans les foires et salons de tourisme, alors que les agences de voyage qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande et les agences de voyages bicommunautaires n'ont pas cette possibilité". La Cour rejette ce recours : "une différence de traitement dans des matières ou les Communautés et Régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci ; une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les diverses Communautés et Régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution". Il s'agit là de L'AFFIRMATION DU FAIT FÉDÉRAL. Les citoyens belges ne peuvent se plaindre d'une différence de traitement (et partant d'une violation du principe d'égalité des Belges devant la loi) qui trouveraient sa source exclusive dans le fait que les règles de droit diffèrent dans les ordres juridiques de chacune des entités fédérées". (p.912 - leçon 28)
(21) Cass., du 23 avril 1971 - carence règlementaire
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait déjà affirmé que l'autorité engageait sa responsabilité dans l'exercice actif de son pouvoir réglementaire. Un arrêt du 23 avril 1971 va plus loin en consacrant sa responsabilité du fait d'une ABSTENTION DE PRENDRE UN RÈGLEMENT, même si aucun délai ne lui est imparti par la loi. S'abstenir d'agir pendant un DÉLAI RAISONNABLE peut constituer une CARENCE FAUTIVE de la part de l'autorité donnant lieu, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, à réparation du dommage qui en est résulté. En l'occurrence, un arrêté du Régent du 30 novembre 1950 accorde le bénéfice du logement gratuit à certains agents de l'État dans les fonctions réclament la présence permanente sur les lieux du travail. Le Roi est chargé de déterminer pour chaque ministère les fonctions qui permettent de bénéficier de ce droit. Or, 8 ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Régent, cette liste n'a toujours pas été établie. Le demandeur, Monsieur Goffin, percepteur des postes et, à ce titre, tenu d'habiter dans un bâtiment appartenant à l'État, engage ainsi, avec succès, une action en vue de percevoir des dommages et intérêts correspondant à la diminution de son traitement opérée afin de couvrir les frais de logement qui n'aurait pas dû engager si le Roi ne s'était pas rendu coupable de carence réglementaire. (p.688 - leçon 21)
(10) CEDH - Cordova I & II c. Italie
Dans ses arrêts rendus dans les affaires Cordova I et II contre Italie, la Cour européenne doit déterminer si l'immunité parlementaire couvre des propos tenus dans des courriers et lors de réunions électorales. Dans la première affaire, l'ancien Président de la République, Francesco Cossiga, qui, en vertu de la Constitution italienne, est sénateur à vie, s'en prend à un procureur qui enquête sur un membre de son entourage. Il lui adresse des courriers blessants, lui annonçant notamment l'envoi d'un petit cheval de bois et d'un tricycle "pour les divertissements auxquels vous avez, je crois, le droit de vous livrer". Les jouets annoncés, accompagnés d'un jeu de détective dénommé Super Cluedo, sont envoyés à leur destinataire avec un petit mot ainsi libellé : "amusez-vous, Cher Procureur, Cordialement". Dans la seconde affaire, un parlementaire tient, lors d'une réunion électorale, des propos particulièrement insultants à l'égard du même procureur. Dans les deux cas, la Cour européenne considère que les opinions exprimées ne l'ont pas été dans le cadre des "fonctions parlementaires stricto sensu" et qu'elles "paraissaient plutôt s'inscrire dans le cadre d'une querelle entre particuliers". En conséquence, elle estime QU'ELLES NE SONT PAS COUVERTES PAS L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE et que celui qui estime avoir subi un dommage du fait de leur expression doit pouvoir faire valoir ses droits devant une juridiction. (p.304 - leçon 10)
(13) CE 233.678, du 01 février 2016 - Thibaut et consorts, vérification des pouvoirs
Dans son arrêt 169/2015 du 26 novembre 2015, la Cour constitutionnelle constate qu'il est inconstitutionnel d'organiser, en Région wallonne, des élections dans le cadre de circonscription dans lesquelles il n'y a que 2 ou 3 candidats élus. En conséquence, le Conseil d'Etat annule l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28/02/2013 portant répartitions des membres du Parlement wallon entre circonscriptions électorales. La Cour constitutionnelle s'est manifestement interrogée sur les conséquences d'une éventuelle annulation de cet arrêté sur la validité de la composition du Parlement wallon issu des élections de 2014. Elle indique, en effet, que "la Région wallonne demande à la Cour, à titre subsidiaire, de maintenir les effets des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel et n'est ordonné que lorsque la Cour juge que le constat d'inconstitutionnalité implique pour l'ordre juridique une perturbation disproportionnée. En l'espèce, l'éventuelle perturbation serait la conséquence de l'annulation de l'acte attaqué devant le Conseil d'État. Il appartiendra à celui-ci de juger si, le cas échéant, l'annulation de l'acte attaqué devant lui entraîne une telle perturbation et si ses effets doivent être maintenu". Le Conseil d'État répond "qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de porter atteinte au principe de la légalité et de limiter les effets de l'annulation ; qu'en effet, l'annulation rétroactive de l'acte attaqué ne peut aboutir à remettre en cause la composition du Parlement wallon ; que celle-ci a été arrêtée définitivement par ce dernier lorsqu'il a validé le résultat des élections régionales du 25 mai 2014, par une décision de nature juridictionnelle échappant à la compétence du Conseil d'État ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande". Autrement dit, la vérification des pouvoirs a pour effet de valider le mandat des membres du parlement quand bien même il apparaît par la suite que les élections ont été organisées sur des bases inconstitutionnelles. Les plus hautes juridictions belges ont donc affirmé à la fois le caractère juridictionnel de la vérification des pouvoirs et que les assemblées sont souveraines à ce propos, non pas en raison de la séparation des pouvoirs, mais parce que la Constitution n'a organisé aucun recours contre leurs décisions. Ceci a d'ailleurs été réaffirmé par le Conseil d'État lorsqu'il a été saisi en 2010 d'un recours contre l'arrêté royal convoquant les élections du 13 juin 2010. (p.402 - leçon 13)
(4) Cass., du 27 mai 1971 - Fromagerie Franco-suisse Le Ski
Dans son arrêt Fromagerie franco-suisse Le Ski du 27 mai 1971, la Cour de cassation affirme que lorsqu'un traité contient des règles de droit directement applicables dans l'ordre interne, celles-ci ont une force juridique supérieure à celle d'une loi. La Cour indique que "même lorsque l'assentiment à un traité exigé par l'article 68, alinéa 2 (ancien), de la Constitution est donné dans la forme d'une loi, le pouvoir législatif, en accomplissant cet acte, n'exerce pas une fonction normative". Elle ajoute que "le conflit qui existe par une loi postérieure, n'est pas un conflit entre deux lois" et que "lorsque le conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international QUI A DES EFFETS DIRECTS DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE, la règle établie par le traité doit prévaloir (...), la prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit international conventionnel". Enfin, il résulte, à son estime, "des considérations qui précèdent que le juge avait le devoir d'écarter l'application des dispositions de droit interne qui sont contraires à cette disposition du traité". (p.131 - leçon 4) Les termes de l'arrêt Le Ski ne permettent pas d'établir de distinction entre la Constitution et les autres normes de droit interne. La primauté du droit international vise, semble-t-il, l'ensemble des normes internes, sans qu'un traitement différencié soit réservé à la Constitution. (p.134 - leçon 4)
(28) CC 65, du 30 juin 1988 - en matière de protection de la jeunesse + CC 66, du 09 novembre 1988 - en matière de protection de la jeunesse + CC 32/92, du 23 avril 1992 - ARGO
Dans son arrêt n° 65 du 1988, elle constate que l'article 24 du décret de la Communauté flamande 27 juin 1985 qui impose aux juges de la jeunesse de RÉDIGER UN RAPPORT pour toute demande d'agrément d'institutions accueillant ou assistant des mineurs TOUCHE À UNE MATIÈRE RELEVANT DU DROIT JUDICIAIRE qui appartient à la compétence du législateur fédéra. De même, dans son arrêt n° 66 du 09 novembre 1988, elle estime que la disposition du décret de la Communauté française du 14 mai 1987 qui prévoit la PARTICIPATION DE MAGISTRATS À UNE COMMISSION D'AGRÉMENT des services de protection de la jeunesse TOUCHE également À UNE MATIÈRE RELEVANT DU DROIT JUDICIAIRE qui, en vertu de l'article 5, §1, II, 6, ancien de la loi du 08 août ressortit aux compétences du législateur fédéral. Toutefois, dans ces deux cas, la Cour considère que les conditions d'application de l'article 10 sont réunies. Elle constate, en effet, que la matière réservée au législateur fédéral se prête à un RÈGLEMENT DIFFÉRENTIÉ, que l'incidence de l'intervention des Communautés sur cette matière revêt un CARACTÈRE MARGINAL et, enfin, que les dispositions décrétales en cause sont indispensables à la mise en œuvre des compétences communautaires. De même, elle estime, en se fondant sur l'article 10 de la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles, que LE LÉGISLATEUR FLAMAND PEUT RÉGLER LA MATIÈRE DES MARCHÉS PUBLICS, RÉSERVÉE PAR LA LOI SPÉCIALE À L'AUTORITÉ FÉDÉRALE. En l'espèce, une disposition décrétale prévoyait que l'A.R.G.O (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) et les pouvoirs organisateurs étaient tenus de conclure les marchés publics de travaux, de fourniture et de services selon les procédures et les conditions applicables à l'État, mais pouvaient déroger aux règles relatives au choix de l'entrepreneur en cas d'adjudication publique ou restreinte si le ministre communautaire compétent pour l'enseignement ne s'y opposait pas dans les 30 jours de la demande. Il s'agit là, selon la Cour, d'un empiètement admissible sur les compétences fédérales. En effet, la mesure est NÉCESSAIRE à l'exercice des compétences communautaires (sa nécessité avait déjà été établie au niveau fédéral avant la communautarisation de l'enseignement) et revêt un caractère MARGINAL par rapport aux compétences générales de l'autorité générale en matière de marchés publics. Ceci résulte notamment du fait qu'un pouvoir de dernier mot est réservé au ministre. (p.928 - leçon 28)
(26) CC 35/2003, du 25 mars 2003 - élections régionales, accord du Lombard
Dans son arrêt n°35/2003 du 25 mars 2003, la Cour connait, en effet, de plusieurs recours introduits contre les lois du 13 juillet 2001 qui traduisent dans le droit positif les accords du Lombard. Il est piquant de constater que ces recours étaient introduits tout à la fois pour des représentants du Vlaams Blok, de représentants du CD&V et de défenseurs des intérêts des francophones de la périphérie bruxelloise, dont la commune de Wezembeek-Oppem. LES ACCORDS DU LOMBARD ont également consacré une RESTRUCTURATION du PARLEMENT RÉGIONAL. En effet, le nombre de ses membres a été porté de 75 à 89. Alors qu'auparavant, ceux-ci se répartissaient entre les groupes linguistiques en fonction des résultats électoraux, l'article 20, §2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 consacre désormais LE PRINCIPE DE LA REPRÉSENTATION GARANTIE au bénéfice de la Communauté flamande de Bruxelles. Il est prévu en effet, qu'indépendamment du nombre de voix qui se porte sur les listes francophones, d'une part, et sur les listes flamandes, d'autre part, les francophones bénéficient de 72 élus alors que les flamands en comporteront 17. Il s'agit donc d'un mécanisme de protection de la minorité flamande de Bruxelles. Celui-ci a suscité de vives réactions, notamment de la part de la section de législation du Conseil d'Etat, dès lors qu'il aboutissait à créer une distorsion entre le nombre de voix nécessaire pour être élu en qualité de parlementaire francophone, d'une part, et en qualité de parlementaire néerlandophone d'autre part. Autrement dit, c'est le principe même de la représentation proportionnelle qui est ainsi remis en cause. La Cour constitutionnelle, saisie d'un recours à ce propos, était ainsi confrontée à un problème délicat. En effet, en d'autres occasions, elle n'a pas manqué de sanctionner une norme qui remettait en cause le principe même de la représentation proportionnelle. La Cour, non sans subtilité, écarte l'objection fondée sur le principe de la représentation proportionnelle. Elle met en évidence que, à "la différence de ce qui est le cas pour les élections de la Chambre des représentants et du Sénat (...) et les élections du Parlement flamand et du Parlement wallon (...), il n'est pas précisé pour les élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale qu'elles se déroulent selon le système de la représentation proportionnelle. Pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'article 3 du Premier Protocole additionnelle à la Convention européenne des droits de l'homme, les élections peuvent être organisées aussi bien selon le système de la représentation proportionnelle que selon le système majoritaire. De même que l'article 3 précité n'implique pas que la dévolution des sièges soit le reflet exact du nombre des suffrages, rien ne s'oppose en principe à ce qu'une représentation fixe soit prévue pour une minorité numérique". Elle relève, en outre, que "la disposition attaquée s'inscrit dans le système institutionnel général de l'Etat belge qui vise à réaliser un équilibre entre les diverses Communautés et Régions du Royaume. Au sein de ce système institutionnel général, la Région de Bruxelles-Capitale est la seule entité fédérée bilingue, ce qui justifie qu'elle soit dotée d'organes et de mécanismes institutionnels propres". La Cour constate également que l'objectif poursuivi par le législateur est légitime. Elle indique, à ce propos que, dans "un tel système, la règle attaquée vise en particulier à apporter une solution au problème de la représentation des néerlandophones au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, lesquels avaient 'démontré, de manière convaincante, qu'ils éprouvaient de grandes difficultés à s'acquitter démocratiquement de leur travail au parlement bruxellois' (...). Les membres néerlandophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale font aussi partie de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande et de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. En outre, les six premiers membres élus siégeaient également au Parlement flamand. S'il est avéré qu'une partie des élus du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent, pour des motifs institutionnels, exercer pleinement les mandats qui leur reviennent, le fonctionnement démocratique des institutions concernées risque d'être mis en péril". Enfin, après avoir examiné les résultats lors des élections régionales qui ont précédé son arrêt, la Cour considère que le mécanisme mis en œuvre n'est pas disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. Dans son arrêt n° 35/2003 de 2003, la Cour constitutionnelle a également affirmé la validité du mécanisme consacré par l'article 16bis, §2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, qui permet à différentes listes de faire une déclaration de groupement vue de la répartition des sièges entre les différentes listes. Ce système permet aux partis démocratiques flamands de se grouper et partant de bénéficier des résidus de voix, et ce, au détriment des Vlaams Belang. (p.850 - leçon 26)
(8) CC 90/94, du 22 décembre 1994 - BHV, avant la réforme électorale
Dans son arrêt n°90/94 du 22 décembre 1994, lequel concernait les réformes de 1993, la Cour constitutionnelle avait affirmé que l'existence de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde était constitutionnellement admissible. Elle avait, en effet, indiqué que "le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection des Chambres fédérales et du Parlement européen procède d'un choix dicté par le SOUCI D'UN COMPRIS GLOBAL DANS LE CADRE DUQUEL L'INDISPENSABLE EQUILIBRE A ETE RECHERCHE ENTRE LES INTERÊTS DES DIFFERENTES COMMUNAUTES ET REGIONS AU SEIN DE L'ETAT BELGE. Cet objectif peut justifier la distinction opérée par les dispositions attaquées entre les électeurs et les candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et ceux des autres circonscriptions pourvu que les mesures prises puissent être raisonnablement considérées comme n'étant pas disproportionnées. Elles le seraient notamment si une telle solution était recherchée au prix d'une méconnaissance de libertés et de droit fondamentaux". (p.239 - leçon 8)
(21) CC 99/2014, du 30 juin 2014 - responsabilité de l'Etat du pouvoir judiciaire
Dans son arrêt n°99/2014 du 30 juin 2014, la Cour constitutionnelle remet en cause la condition selon laquelle la responsabilité de l'Etat dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle ne peut être engagée que pour autant que l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée. Elle estime que la responsabilité de l'Etat doit pouvoir être engagée pour une faute commise par une juridiction statuant en dernier ressort. Elle considère, en effet, "qu'empêcher, tant que la décision litigieuse n'a pas été effacée, que la victime d'une faute commise par une juridiction de dernier ressort, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, puisse mettre en cause la responsabilité de l'Etat, est susceptible d'emporter des effets disproportionnés par rapport à l'objectif poursuivi". En conséquence, elle estime que "la nécessité de préserver un équilibre entre le principe de sécurité juridique, d'une part, et le droit d'accès au juge, d'autre part, exige cependant que la responsabilité de l'Etat ne puisse être engagée que si la juridiction de dernier ressort commet, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables" et que "l'impossibilité d'obtenir, à charge de l'Etat, la réparation d'une faute plus légère commise par une juridiction de dernier ressort, tant que la décision en cause n'a pas été effacée, n'emporte pas d'atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, tel qu'il est garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme". Il s'en déduit que, si l'Etat n'engage pas sa responsabilité civile pour une faute légère commise par une juridiction de dernier ressort, il peut être contraint à indemniser la victime d'une violation suffisamment caractérisée du droit commise par une telle juridiction. (p.698 - leçon 21)
(4) CC 12/94, du 03 février 1994 - écoles européennes
Dans un arrêt concernant les Ecoles européennes, elle précise sa position. Elle indique que LE CONSTITUANT INTERDIT AU LEGISLATEUR D'ADOPTER DES NORMES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION (et plus particulièrement aux dispositions dont elle garantit le respect) que ce soit directement, ou indirectement par le biais de l'assentiment donné à un traité international. De même, AUCUNE NORME DE DROIT INTERNATIONAL NE DONNE AUX ETATS LE POUVOIR DE FAIRE DES TRAITES CONTRAIRES A LEUR CONSTITUTION. Dans le cas qui lui était soumis, la Cour estime, cependant, que le minerval exigé des étudiants inscrit dans les Ecoles européennes n'est pas contraire à l'article 24 §3, alinéa 1er de la Constitution car cette disposition, en ce qu'elle impose la gratuité de l'enseignement, ne s'applique pas à des établissements qui ne sont pas subventionnés par les pouvoirs publics. Or, les Ecoles européennes sont financées principalement par des contributions versées par les parties contractantes. Par cette jurisprudence, LA COUR CONSTITUTIONNELLE affirme implicitement la PRIMAUTE, dans l'ordre juridique interne, DE LA CONSTITUTION SUR LE DROIT INTERNATIONAL qui a des effets directs dans celui-ci. (p.138 - leçon 4)
(21) Cass., du 07 avril 2011 - devoir de renseignements
Dans un arrêt du 07 avril 2011, la Cour de cassation rejette un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Mons qui avait estimé que l'administration fiscale a commis une faute en omettant de prendre une mesure d'information générale qui aurait permis à des contribuables d'obtenir, en temps utile, le remboursement d'une taxe dont il résultat d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel qu'elle avait été payée indûment. La Cour d'appel avait, en effet, admis que l'administration fiscale n'était pas tenue d'informer individuellement chaque contribuable ou de procéder pour chacun d'eux à un dégrèvement d'office. Cependant, elle se devait, même si aucun texte légal ou réglementaire ne lui imposait, de lancer une information générale ou de prendre une quelconque mesure (tels l'envoi d'une notice explicative annexée à la déclaration fiscale ou une annonce par voie de presse) qui aurait permis aux personnes concernées d'obtenir le remboursement auquel elles avaient droit. (p.689 - leçon 21)
(21) Cass., du 25 octobre 2004 - illégalité = faute + Cass., du 08 février 2008 - illégalité = faute
Dans un arrêt du 25 octobre 2004, la Cour de cassation précise sa jurisprudence en affirmant qu'UN ERREUR DE DROIT commise par l'ONSS NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR UNE FAUTE dans son chef. Elle considère, en effet que la décision de l'ONSS ne pouvait être considérée comme fautive que "si elle consistait en un comportement qui s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité administrative normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions". Autrement dit, une autorité ne commet pas forcément une faute, lorsqu'elle fait une application du droit, dans un domaine controversé, et qu'in fine, la solution qu'elle a retenue n'a pas été validée par les tribunaux. Ainsi que le note, judicieusement, Michel Leroy, "quand une question est controversée, 'l'erreur' c'est la thèse que la jurisprudence ne consacrera pas. avant que les tribunaux n'aient parlé, plusieurs thèses peuvent être raisonnablement défendables. Pencher pour celle qui sera écartée, ce n'est pas se tromper en droit, c'est se tromper dans la prédiction de l'avenir. Une telle erreur n'est pas une faute". Dans un arrêt du 08 février 2008, la Cour de cassation précise que "l'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, être considérée par un juge comme étant invisible à la condition que de ces circonstances, il puisse se déduire que l'autorité administrative a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente". Ainsi que le relève encore Michel Leroy, "le recours implicite au critère du 'bon père de famille", soit en l'espèce, le fonctionnaire normalement diligent et prudent, élargit à ce point le domaine de l'erreur invincible que celle-ci s'en trouve dénaturée". L'autorité administrative, ajoute-t-il, "est, comme tout un chacun, responsable quand elle agit imprudemment ; elle ne l'est pas d'office dès qu'elle commet une illégalité". Il est permis d'en conclure que les autorités exécutives et administratives sont simplement tenues à une OBLIGATION DE MOYEN de faire une application correcte du droit. (p.691 - leçon 21)
(28) CC 25, du 26 juin 1986 - théorie de la répartition des compétences
Dans un arrêt du 26 juin 1986, la Cour constitutionnelle exprime, en termes généraux, sa conception de la réforme de l'Etat. "La réforme institutionnelle intervenue en 1980", affirme-t-elle, "a incontestablement approfondi l'autonomie des communautés et appliqué le principe de l'autonome pour la Région wallonne et la Région flamande. Il faut considérer que le constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disent pas autrement, ont attribué aux Communautés et aux Régions toute la compétence d'édicter les règles aux matières qui leur ont été transférées". Par la suite, la Cour a réaffirmé sa position initiale. Ainsi indique-t-elle que "le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont transféré un ensemble homogène de compétences" aux entités fédérées et que le transfert porte sur "l'ensemble de la politique relative aux matières transférées". Guidée par ce principe, la Cour donne une INTERPRETATION LARGE DES COMPETENCES REGIONALES ET COMMUNAUTAIRES, et, par voie de conséquence, une interprétation stricte des compétences fédérales. Par cette double attitude, elle s'efforce de donner un EFFET UTILE aux compétences dévolues aux Communautés et aux Régions. (p.909 - leçon 28)
(15) CE 197.522, du 30 octobre 2009 - ligue des droits de l'homme + CE 211.590, du 28 février 2011 - transervices
Dans un arrêt du 30 octobre 2009, le Conseil d'Etat suspend une licence d'exportation d'armes vers la Lybie, délivrée par le Ministre-Président wallon, LE LENDEMAIN DES ÉLECTIONS, soit une date où le gouvernement n'est pas encore démissionnaire, mais n'est plus contrôlé par le parlement. Le Conseil d'Etat indique "que les décisions attaquées font suie à la demande introduite 11 mois plus tôt, et ont été prises au terme d'une procédure qui a requis de multiples consultations" et "qu'en particulier, la commission d'avis sur les licences d'exportation a été saisie 3 fois du dossier et a fini par se partager par moitié, sans devoir donner d'avis". Il relève "que la partie adverse reconnaît à l'audience que les décisions du type de celles qui sont attaquées posent des questions d'appréciation politiques délicates" et "que c'est précisément à cause de ce genre de décisions que le contrôle politique a le plus de raisons d'être". En effet, "les décisions attaquées apparaissent non seulement comme des affaires d'intérêts plus qu'ordinaire, mais aussi comme des 'affaires de gouvernement' dans lesquelles le pouvoir politique est amené à trancher entre des intérêts économiques considérables d'une part et des principes éthiques d'autre part". Il s'en déduit "qu'en l'absence d'une urgence particulière, les décisions qui tranchent un tel débat ne peuvent être regardées comme relevant des affaires courantes et à ce titre susceptibles d'être valablement adoptées par un gouvernement en l'absence de contrôle parlementaire". Enfin, dans un arrêt du 28 février 2011, le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation dirigé contre un arrêté du gouvernement wallon du 03 juin 2009 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeurs. Cet arrêté a été pris 4 jours avant les élections, et alors que le Parlement wallonne s'et plus réuni après le 15 mai 2009, date à laquelle le Président a déclaré que ses travaux étaient clos. La société requérante estime que le gouvernement n'était plus contrôlé par le Parlement et ne pouvait prendre l'arrêté en cause. Le Conseil d'Etat rappelle que "si le Gouvernement wallon n'a démissionné que le 23 juin 2009 et si sa compétence n'a été que formellement limitée aux affaires courantes que ce jour-là, en application de l'article 73, il n'en reste pas moins qu'aucun contrôle parlementaire ne pouvait s'exercer sur son activité pendant la période où le parlement n'était pas ne mesure de se réunir", que "s'il n'existe pas d'acte formel de dissolution du Parlement dans le droit des Communautés et des Régions, il est hors de doute qu'une assemblée ne peut plus se réunir après qu'ont eut lieu les élections destinées à la renouveler" et que "le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses pouvoirs pendant la période au cours de laquelle il est privé de sa base parlementaire et échappe au contrôle de l'assemblée élue ; que ce gouvernement, à l'instar d'un gouvernement démissionnaire, peut uniquement expédier les affaires courantes". Cependant, la situation du gouvernement après les élections ne peut, selon le Conseil d'Etat, être assimilée à celle qui était la sienne avant celle-ci, et cela, même si dans les faits le parlement ne se réunit plus. En effet, "à défaut de dispositions contraires et en l'absence de décisions déclarant close la session 2008-2009 du Parlement wallon, rien ne permet de considérer que pendant cette période, le Parlement n'aurait pas été en droit de se réunir et d'exercer son contrôle sur l'activité du Gouvernement". Il relève "qu'en vertu de l'article 32, §3 de la loi spéciale du 8 aout 1989 de réformes inconstitutionnelles, c'est au gouvernement qu'il incombe de prononcer la clôture d'une session parlementaire" et "que celui-ci n'a pas exercé sa compétence en ce qui concerne la session 2008-2009 du parlement wallon, cette session ayant été close par l'arrivée du terme de la législature". Il constate que le Parlement a simplement ajourné ses travaux et "que l'ajournement des travaux, qui n'équivaut pas à une clôture de la session, n'empêchait pas le parlement de se réunir et de censurer l'action du gouvernement, en dépit de la proximité du jour des élections". Le gouvernement jouissait donc au moment de l'adoption de l'acte attaqué, de la plénitude de ses compétences. (p.483 - leçon 15)
(28) CC 7/85, du 20 décembre 1985 - arrêt de principe en matière de pouvoirs implicites
Dès 1985, la Cour constitutionnelle a jeté les bases de son interprétation de l'article 10 de la loi spéciale. Elle était amenée à connaitre d'un recours en annulation introduit contre un décret du Conseil de la Communauté française du 08 décembre 1981 fixant les conditions de reconnaissance des radios locales et interdisant, à ce titre, la publicité commerciale. Or, sous l'emprise de l'article 4, 6° ancien de la loi spéciale du 08 aout 1980, les Communautés étaient compétentes pour régler la radiodiffusion et la télévision, à l'exclusion de "la publicité commerciale et des communications gouvernementales". En conséquence (et tel était précisément l'argument de la Communauté française) seul l'article 10 de la loi spéciale était susceptible de justifier ce dérobement de compétences. La Cour constate, tout d'abord, que même si toute exception doit s'interpréter restrictivement, la décision de permettre l'introduction de la publicité commerciale constitue "l'essence même de la compétence maintenue à l'État par l'article 4, 6° de la loi spéciale", et cela quel que soit le mode de radiodiffusion. Elle relève, ensuite, que l'article 10 crée UNE COMPÉTENCE ACCESSOIRE au profit des Communautés. Celle-ci peuvent, en effet, régler les matières pour lesquelles l'État est, en principe, compétent (que ce soit en vertu d'une reconnaissance expresse de la loi ou en vertu de sa compétence résiduelle) pour autant que deux exigences soient rencontrées. D'autre part, l'article 10 ne peut être isolé du système de répartition des compétences exclusives. Pour être compatible avec celui-ci, le recours à l'article 10 n'est, à l'estime de la Cour, admissible qu'à la double condition que la matière réservée se prête à un RÈGLEMENT DIFFÉRENCIÉ et que L'IMPACT sur la matière réservée ne soit que MARGINAL. D'autre part, un lien très étroit doit exister entre la compétence principale et sa compétence accessoire. En d'autres termes, le recours à l'article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles doit être indispensable (depuis 1988, le critère de NÉCESSITÉ suffit) à l'exercice d'une compétence principale. Elle en conclut que ces conditions n'étaient pas réunies dans l'espèce qui lui était soumise. (p.927 - leçon 28)
(15) CE 47.689, du 31 mai 1994 - Leclercq + Avis SLCE - A.R.P.G.
En 1977, un collège de juristes rend un avis qui vise à déterminer quels sont les pouvoirs D'UN GOUVERNEMENT QUI N'A PAS DÉMISSIONNÉ MAIS QUI N'EST PLUS CONTRÔLÉ PAR LA CHAMBRE du fait de sa dissolution. Aux yeux de ce collèges, le gouvernement qui ne démissionnerait pas pourrait continuer à exercer la plénitude de ses attributions tout en manifestant une certaine prudence eu égard en l'absence de contrôle parlementaire, d'où l'expression affaires prudentes. Le Conseil d'Etat ne partage pas cette opinion. Il assimile implicitement la situation d'un gouvernement démissionnaire à elle d'un cabinet qui n'a pas démissionné alors que les chambres sont dissoutes. Ainsi, en 1991, la section législation émet des doutes sur le pouvoir du gouvernement d'adopter l'A.R.P.G. alors que le contrôle parlementaire ne peut plus trouver à s'appliquer. Elle indique que cet avis est sollicité dans une période où le gouvernement fédéral est privé de sa base parlementaire, échappe au contrôle de l'assemblée élue et ne dispose plus de la plénitude de ses attributions. DANS UNE TELLE PÉRIODE, LE GOUVERNEMENT DOIT RÉDUIRE SES ACTIVITÉS À CE QUE REQUIERT LA CONTINUITÉ DES AFFAIRES PUBLIQUES. Dans un arrêt du 31 mai 1994, la section contentieux administratif du Conseil d'Etat annule l'arrêt litigieux en réaffirmant que dans une période où un gouvernement "est, du fait de sa dissolutions privé de sa base parlementaire et échappe au contrôle des assemblées élues, il ne dispose plus de la plénitude de ses attributions". Le Conseil d'Etat, plutôt que de se fonder sur le critère purement formel de la légitimité que puise le gouvernement dans la nomination de ses membres par le Roi, SE RÉFÈRE À LA DYNAMIQUE DES RAPPORTS QUI SE NOUENT ENTRE LES POUVOIRS. Pour déterminer si le gouvernement fédéral doit limiter son action à l'expédition des affaires courantes, il suffit d'avoir égard À L'EXISTENCE DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE. Si celui-ci est rendu impossible du fait de la démission du gouvernement ou de la dissolution de l'assemblée, le gouvernement limite son action à l'expédition des affaires courantes. Dans une telle perspective, il n'y a pas de distinction à opérer entre le gouvernement démissionnaire confronté à une assemblée en activité et celui qui, sans être démissionnaire, ne peut plus être contrôlé du fait de la dissolution de l'assemblée. Une telle analyse conforte l'opinion qui est la nôtre quant aux limites des affaires courantes. UN GOUVERNEMENT N'EST SOUMIS A UNE TELLE LIMITATION QUE POUR LES ACTES QU'IL ACCOMPLIT SEUL, A L'EXCLUSION DE CEUX QUI SONT COMMIS DE CONCERT AVEC LES ASSEMBLEES. Lorsque le Roi agit en sa qualité de troisième branche du pouvoir législatif ou du pouvoir constituant, le contrôle parlementaire n'a guère de sens dès lors que l'action de l'exécutif se limite à donner effet à la volonté exprimée dans un vote par l'assemblée parlementaire concernée. (p.481 - leçon 15)
(16) Cass., du 07 mai 2014 - Vancauwenberghe + Cass., du 12 février 1996 - Inusop + CC 60/96, du 07 novembre 1996 - privilège de juridiction
En 1982, un premier pas est franchi afin de faciliter la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des ministres. Dans un arrêt du 07 mai 2014, la Cour de cassation précise encore sa position. L'ancien Ministre-Président de la Région wallonne, Jean-Claude Vancauwenberghe, est poursuivi pour faux et détournement commis dans le cadre de l'attribution d'un marché public par la Ville de Charleroi dont l'intéressé était également conseillé communal. Les faits s'étant produits à un moment où il était ministre, il estime devoir bénéficier du régime d'exception. Il soutient que l'activité d'un ministre s'étend au delà de sa seule fonction réglementaire ou législative et qu'elle comprend notamment une mission de représentation et de gestion, voire de décisions purement politiques. A son estime, le ministre doit aussi bénéficier du régime spécifique de responsabilité pénale chaque fois qu'il intervient dans la gestion et administration de la chose publique. La Cour de cassation refuse de s'engager dans cette voie. Elle affirme que "le constituant et le législateur n'ont pas voulu protéger la personne du ministre mais la fonction ministérielle elle-même et au delà de la fonction, le gouvernement tout entier en tant qu'institution. La mise en cause de la responsabilité ministérielle est soumise à des conditions directement liées à cet objectif. Comme celles de tout régime dérogeant au droit commun, ces conditions sont de strictes interprétation". La Cour considère alors que c'est à bon droit que l'intéressé (qui sera d'ailleurs acquitté) est poursuivi devant les juridictions ordinaires : "en adoptant les motifs du réquisitoire, la Cour d'appel s'est encore référée à l'intervention du demandeur qui, s'il était parfois désigné comme Ministre-Président, soit le titre de sa plus haute fonction, était également à l'époque le mandataire communal et le président d'une association politique de la ville concernée. Les juges d'appel ont enfin constaté, à la suite du ministère public, que ni la Région wallonne ni le Gouvernement wallon ne sont intervenus à propos du dossier litigieux. Ayant ainsi considéré que les faits incriminés, à les supposer établis, ressortissent à l'exercice du mandat communal exercé accessoirement par le demandeur, la chambre des mises en accusation a pu légalement justifier sa décision qu'en la cause, celui-ci n'a jamais été suspecté d'avoir commis un fait culpeux quelconque en qualité de ministre et que dès lors, l'instruction le concernant était régulière". Cependant, au début des années 90, la prolifération d'affaires relatives au financement occulte des partis politiques consacre la fin du régime d'impunité de fait dont bénéficient les ministres. En 1996, la Cour de cassation juge le ministre Coëme dans l'affaire Inusop. Contrairement à ce qu'il s'était passé dans l'affaire Chazal, le législateur n'estime pas utile d'adopter une loi pour fixer la procédure. La Cour de cassation est dès lors appelée à trancher, dans un arrêt du 12 février 1996, un certains nombres de questions existentielles. Tout d'abord, la Cour de cassation détermine les règles de procédure qui trouvent à s'appliquer. Soucieuse de respecter le principe selon lequel la procédure pénale doit être légale, prévisible et accessible, elle veille à appliquer le droit existant, dans le respect de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte sur les droits civils et politiques. Dans cette perspective, elle fait application des dispositions du Code d'instruction criminelle qui s'imposent aux tribunaux correctionnels "dans la mesure où elles sont compatibles avec celles qui règlent la procédure devant la Cour de cassation, siégeant en chambres réunies". Ainsi affirme-t-elle, elle "ne fait pas œuvre du législateur". Elle est également appelée à se prononcer sur la manière dont la chambre a mis en accusation le ministre Coëme. Il est fait grief à cette assemblée d'avoir eu peu d'égard au respect des droits de la défense lors de l'examen du dossier devant la commission constitué en son sein à cette fin. La Cour de cassation rappelle que la Chambre des représentants disposait d'un pouvoir discrétionnaire d'accuser les ministres et de les traduire devant elle. A son estime, la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'elle s'érige en juge de la régularité du mode de procéder de la Chambre des représentants. Curieusement, après avoir posé ce principe, la Cour y apporte un démenti en constatant qu'à supposer les griefs invoqués par Guy Coëme fondés, "ils ne vicieraient pas la procédure de manière irréparable entrainant l'irrecevabilité des poursuites". Cette argumentation n'échappe pas à la critique. Tout d'abord, le pouvoir discrétionnaire de la Chambre de la dispense pas de respecter les droits de la défense consacrés par des dispositions de droit international qui ont des effets directs dans l'ordre juridique interne. La Cour s'est d'ailleurs fait application à elle-même de ces principes, en établissant dans le même arrêt, la procédure qu'il convenait de suivre pour juger les ministres. Ensuite, en d'autres occasions, elle a considéré que nonobstant le principe de la séparation des pouvoirs, il appartenait aux juridictions judiciaires de vérifier si dans la phase parlementaire d'une procédure, les droits de la défense n'ont pas été méconnus au point de rendre nulles les poursuites. Enfin elle affirme péremptoirement, mais sans donner d'explications, que la manière dont la Chambre a exercé ses compétences n'est pas de nature à vicier les poursuites. En outre, et sans doute est-ce là que l'arrêt du 12 février 1996 est le plus choquant, la Cour de cassation refuse d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur la compatibilité de certaines dispositions du Code d'instruction criminelle relative à la connexité ont fait que toutes les personnalités impliquées dans l'affaire Inusop ont "bénéficié" du privilège de juridiction applicable au ministre Coëme et ont ainsi perdu leurs DROIT À UN DOUBLE DEGRÉ DE JURIDICTION. La Cour de cassation indique à ce propos, à supposer que la privation d'un double degré de juridiction constitue une discrimination, celle-ci trouve sa source dans l'article 103 de la Constitution, et non dans une norme législative dont la Cour constitutionnelle assure le contrôle. En conséquence, en violation manifeste de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, elle refuse d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel. Il s'agit là d'une construction juridique pour le moins hasardeuse. En effet, ce n'est pas en application de l'article 103 de la Constitution que des personnalités qui n'étaient pas ministres ont été renvoyées devant la Cour de cassation, mais parce que la Cour de cassation a fait application des dispositions législatives (qui peuvent être soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle) figurant dans le Code d'instruction criminelle, mais qui a priori ne concernait pas la procédure mue devant elle. Les raisons véritables de la position prise par la Cour de cassation doivent sans doute être trouvées ailleurs. En effet, celle-ci entendait plus que probablement éviter qu'un détour préjudiciel par la Cour constitutionnelle ait pour conséquence de provoquer la prescription d'un certains nombres d'infractions. Il n'est pas inconcevable non plus qu'elle ait souhaité conserver seule la mainmise sur la procédure de mise en accusation des ministres. Ceci est d'autant plus regrettable que la Cour constitutionnelle aurait probablement rendu une décision qui n'aurait pas compromis la bonne fin de la procédure. En effet, celle-ci estime que DES PERSONNES PEUVENT ÊTRE PRIVÉES D'UN DEGRÉ DE JURIDICTION EN RAISON DU FAIT QU'ELLES SONT IMPLIQUÉES DANS UNE AFFAIRE AUX CÔTÉS D'UN BÉNÉFICIAIRE D'UN PRIVILÈGE DE JURIDICTION. En l'occurrence, diverses personnes, dont un juge suppléant soumis au privilège de juridiction, avaient engagé un garde-chasse sans respecter l'ensemble des exigences de la législation en matière de sécurité sociale. La présence d'un magistrat suppléant parmi les prévenus à pour conséquence de leurs faire perdre à tout le droit à un double degré de juridiction. La Cour considère que l'article 479 du Code d'instruction criminelle relatif à la connexité ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle indique que "la nécessité d'une bonne administration de la justice justifie l'organisation d'un procès unique et complet, qui assure une cohérence dans l'appréciation des faits et des responsabilités", qu'il "est conforme au principe fondamental de la contradiction des débats de permettre à plusieurs personnes poursuivies à propos des mêmes faits de comparaître devant la même juridiction" et qu'à "défaut, la multiplicité des instructions, puis des débats, serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité judiciaire, notamment quant à détermination du rôle respectif des différentes personnes poursuivies". Elle ajoute que "les droits de la défense tant des personnes mentionnées à l'article 479 que des autres personnes poursuivies pour les mêmes faits pourraient être méconnus si des prévenus devaient se défendre devant une juridiction alors qu'une autre juridiction aurait déjà statué sur la réalité, l'imputabilité et la qualification pénale des faits qui leur sont reprochés". (p.494 - leçon 16)
(21) Tribunal civil de Bruxelles, du 06 novembre 2001 - affaire Ferrara Jung + Cour d'appel de Bruxelles, du 04 juillet 2002 - affaire Ferrara Jung + Cass., du 28 septembre 2006 - affaire Ferrara Jung
En 1987, Maria Laetizia Ferrara Jung engage une action en responsabilité contre son chirurgien auquel elle reproche une erreur médicale. En 2001, l'affaire est encore pendante devant la cour d'appel et rien ne laisse présager une issue rapide de l'affaire. L'intéressée engage la responsabilité de l'Etat à qui il est fait grief de ne pas avoir pris les mesures destinées à prévenir l'arriéré judiciaire au sein des juridictions bruxelloises. Le Tribunal civil de Bruxelles, dans un jugement du 06 novembre 2001, fait droit à la demande. Il estime, en effet, qu'en "démocratie, le droit des citoyens de bénéficier du bon fonctionnement des pouvoirs de l'Etat et notamment d'une bonne organisation judiciaire ne peut être supprimé, ou limité, par les difficultés du législateur et/ou du pouvoir exécutif à obtenir en leur sein l'accord politique nécessaire à l'adoption des mesures qui s'imposent". Il relève encore que "tant qu'il n'y a pas d'accord politique, les mesures ne peuvent être adoptées, mais que tout citoyen lésé par l'arriéré judiciaire, a droit à la réparation du dommage qu'il subit". L'affaire est portée devant la Cour d'appel de Bruxelles. Celle-ci, dans un arrêt du 04 juillet 2002, note tout d'abord, que "l'Etat ne peut invoquer sa propre impuissance (ou plutôt le défaut de consensus entre les communautés) pour justifier sa carence à organiser de manière efficace le service public de la justice à Bruxelles comme il en a l'obligation". Elle se défend, ensuite, d'opérer un contrôle de constitutionnalité de la loi, lequel relève, un vertu de l'article 142 de la Constitution, de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Enfin, elle précise que "la faute reprochée au législateur en l'espèce n'est pas d'avoir élaboré des textes légaux qui seraient contraires à des dispositions constitutionnelles, mais d'avoir omis de légiférer afin de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour lui permettre d'assurer efficacement le service public de la justice, dans le respect notamment de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Or, à son estime, "cette disposition impose notamment aux Etats signataires l'obligation d'organiser les cours et tribunaux de leur ordre judiciaire de façon à ce que les causes qui leur sont soumises soient entendues dans des délais raisonnables". En conséquences, elle confirme la décision du premier juge. Pourvoi est aussitôt formé contre son arrêt devant la Cour de cassation. Dans un arrêt du 28 septembre 2006, LA COUR DE CASSATION constate tout d'abord que, de manière générale, L'ARTICLE 144 DE LA CONSTITUTION MET SOUS LA PROTECTION DU POUVOIR JUDICIAIRE TOUS LES DROITS CIVILS, SANS QU'IL FAILLE AVOIR EGARD NI A LA QUALITE DES PARTIES, NI A LA NATURE DES ACTES QUI AURAIENT CAUSE UNE LESION DE DROIT, MAIS UNIQUEMENT A LA NATURE DU DROIT FAISANT L'OBJET DE LA CONTESTATION. Le principe de la séparation des pouvoirs n'implique pas, à son estime, que l'Etat belge, serait, de manière générale, soustrait à l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l'exercice de la fonction législative. Il en résulte que ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni les articles 33, 36 ET 42 DE LA CONSTITUTION NE S'OPPOSENT A CE QU'UN TRIBUNAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE CONSTATE PAREILLE FAUTE POUR CONDAMNER L'ETAT A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI EN RESULTENT. Elle affirme, ensuite, qu'un TRIBUNAL de l'ordre judiciaire A LE POUVOIR DE CONTROLER SI LE POUVOIR LEGISLATIF A LEGIFERE DE MANIERE ADEQUATE OU SUFFISANTE pour permettre à l'Etat de respecter une norme supérieur lui imposant une obligation, en l'occurence l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la Cour indique, eu égard aux faits de la cause, qu'une FAUTE pouvait être IMPUTEE AU LEGISLATEUR pour AVOIR OMIS DE LEGIFERER afin de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour lui permettre d'assurer efficacement le service public de la justice dans le respect de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (p.702 - leçon 21)
(18) CC 35/36, du 10 mai 1994 - Cerexhe
En 1994 la Cour, saisie par des particuliers d'un recours en annulation contre la loi ordinaire de réformes institutionnelle du 16 juillet 1993, se prononce à nouveau sur cette délicate question. Elle est, en effet, appelée à statuer sur des requêtes en récusation du juge Etienne Cerexhe. Celui-ci était sénateurs lors de l'élaboration et de l'adoption des dispositions attaquées. A cette occasion, il a voté le rejet de différents amendements dont la justification correspondait, à l'estime des requérants, aux développements des moyens articulés devant la Cour. Celle-ci rappelle, tout d'abord, qu'en sa qualité d'organe juridictionnel, elle est soumise au principe général de droit relatif à l'impartialité du juge, et qu'en application de l'article 101, alinéa 2 de la loi spéciale du 06 janvier 1989, le fait que l'un de ses membres ait participé à l'élaboration d'une norme législative NE CONSTITUE PAS EN SOI UNE CAUSE DE RÉCUSATION. Elle en déduit que la participation à l'élaboration d'une loi par un membre du Parlement ne suffit pas à remettre en cause son impartialité en tant que juge de la Cour appelé à connaître de la constitutionnalité de cette loi. En effet, indique-t-elle "le point de vue auquel s'est placé un représentant de la nation pour prendre position à l'égard d'une politique et des actes législatifs par lesquels celle-ci se réalise n'est pas comparable avec celui du juge spécialisé dans l'appréciation juridique de la constitutionnalité de tels actes". Elle interprète, ensuite, l'article 101 de la loi spéciale du 06 janvier 1989 au regard des exigences posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et affirme qu' "en l'espèce, la participation du sénateur Cerexhe à l'élaboration de la loi critiquée a consisté à émettre avec la majorité dont son groupe faisait partie un vote positif en ce qui concerne la loi et un vote négatif à l'égard d'amendements déposés par l'opposition. Une telle participation ne suffit pas à justifier objectivement les appréhensions des requérantes quant à l'aptitude du juge Cerexhe à contrôler avec impartialité la constitutionnalité de la loi critiquée". En conséquence, elle rejette la requête en récusation. D'une part, il est permis de se réjouir du fait que la Cour ait suivi le législateur spécial en considérant que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lui est applicable, et ce, qu'elle soit saisie d'un recours en annulation ou d'une question préjudicielle. D'autre part, la solution retenue consacre une CONCEPTION POUR LE MOINS ASSOUPLIE DE LA NOTION D'IMPARTIALITÉ OBJECTIVE. La Cour laisse, en tout cas, entendre que la solution pourrait être autre en cas de participation plus engagée d'un mandataire politique à l'élaboration d'une norme dont elle est appelée à assurer le contrôle. (p.552 - leçon 18)
(29) CC 72/95, du 09 novembre 1995 - annonces d'emploi
En 1995, la Cour constitutionnelle est appelée à préciser sa jurisprudence dans le domaine de l'emploi des langues dans les relations sociales. Le législateur flamand, usant de cette compétence, impose l'usage exclusif du néerlandais dans les annonces d'emploi et dans les pourparlers préalables à l'embauche dans toutes les entreprises dont le siège d'exploitation est établi en région de langue néerlandaise. La Cour estime que les offres d'emploi ne peuvent être considérées comme relevant des relations sociales. Il s'agit de simples annonces unilatérales et aucun lien individualisé n'existe encore à ce stade entre l'employeur et ceux qui sont susceptibles d'y répondre. En revanche, elle intègre, dans les relations de travail, toute forme de relations précontractuelles entre un employeur et des personnes qui par définition ne font pas encore partie de son personnel puisqu'on se situe au stade de l'embauche. Autrement dit, elle admet que soit imposée une langue déterminée pour les examens préalables à l'embauche, et ce, dans une conception particulièrement extensives du concept de relations sociales. (p.949 - leçon 29)
(1) CEDH, du 13 février 2003 - Refah Partisti c. Turquie
En 2003, la Cour européenne, siégeant en grande chambre, a affiné encore la jurisprudence en la matière. La Cour constitutionnelle turque avait prononcé la dissolution du Parti de la Prospérité (un parti islamiste dénommé Refah Partisti) parce qu'il était devenu "un centre d'activités contraire au principe de laïcité". Devant la Cour européenne, ce parti invoque notamment la violation des articles 9 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacrent la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression ainsi que la liberté de réunion et d'association. La Cour réaffirme l'existence d'une RELATION ETROITE ENTRE LA DEMOCRATIE ET LA CONVENTION, et rappelle le RÔLE PRIMORDIAL QUE JOUENT LES PARTIS POLITIQUES DANS UN REGIME DEMOCRATIQUE en bénéficiant des droits et libertés reconnus par les articles 10 et 11 de la Convention. Toutefois, les libertés garanties par la Convention ne sauraient priver les autorités d'un Etat, dont une association, par ses activités, met en danger les institutions, du droit de protéger celles-ci. Elle estime qu'un parti politique peut promouvoir un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'Etat à deux conditions. Tout d'abord, les MOYENS UTILISES A CET EFFET DOIVENT ÊTRE LEGAUX ET DEMOCRATIQUES. Ensuite, le CHANGEMENT PROPOSE DOIT LUI-MÊME ÊTRE COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DEMOCRATIQUES FONDAMENTAUX. Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs. La Cour de Strasbourg rappelle cependant que les exceptions visées à l'article 11 appellent, à l'égard des partis politiques, UNE INTERPRETATION STRICTE, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté d'association. Pourvu qu'il remplisse les conditions mentionnées ci-dessus, un parti politique qui s'inspire des valeurs morales imposées par une religion ne saurait être considéré d'emblée comme une formation enfreignant les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu'ils ressortent de la Convention. La Cour estime également que les statuts et le programme d'un parti politique ne peuvent être pris en compte comme seul critère afin de déterminer ses objectifs et intentions. L'expérience a montré que, par le passé, les partis politiques ayant des buts contraires aux principes fondamentaux de la démocratie ne les ont pas dévoilés dans des textes officiels jusqu'à ce qu'ils s'approprient le pouvoir. On ne peut donc exclure que le programme politique d'un parti cache des objectifs et intentions différents de ceux qu'il affiche publiquement. Pour s'en assurer, il faut comparer le contenu de ce programme avec les actes et prises de position des membres et dirigeants du parti en cause. En l'espèce, elle admet le bien-fondé de la position prise par la Cour constitutionnelle turque au motif que les actes et discours des membres et dirigeants du Parti de la Prospérité invoqués dans son arrêt étaient imputables à l'ensemble du parti. Elle constate que ces actes et discours révélaient un projet politique à long terme visant à instaurer un régime fondé sur la charia dans le cadre d'un système multi-juridique et que ce parti n'excluait pas le recours à la force afin de réaliser son projet et de maintenir en place le système qu'il prévoyait. (p.29 - leçon 1)
(18) CC 157/2009, du 13 octobre 2009 - ASBL Vrijheidsonfs et Vlaamse Concentratie + CE 169.314, du 22 mars 2007 - ASBL Vrijheidsonfs et Vlaamse Concentratie
En 2009, la Cour connaît des demandes de récusations de plusieurs de ses membres introduites par des responsables du Vlaams Belang dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 15ter de la loi du 04 juillet 1989. Ils font notamment griefs à ces juges d'être respectivement membres du Centre de droit public de l'ULB qui a comme thème de recherche "la lutte contre l'extrême droite", d'être membre de la commission du Parc naturel "plaines de l'Escaut" et de faire partie du "Dialogue euro-arabe", d'être proche du parti sp.a et d'avoir publié des articles dans une revue connue pour son hostilité au Vlaams Belang, d'être un collègue universitaire de l'un des avocats du conseil des ministres dans la même affaire ou d'être membre d'une loge maçonnique. La Cour rejette cette requête. Après avoir rappelé la portée de l'impartialité subjective et objective, elle indique que les particularités d'une Cour constitutionnelle impliquent, dans sa composition, UN ÉQUILIBRE SUR LES PLANS LINGUISTIQUE, POLITIQUE ET PROFESSIONNEL. Elle en déduit que "l'application des causes de récusation ne peut avoir pour effet que la Cour (...) ne puisse plus délibérer". Pour ce qui concerne L'APPARTENANCE À UN CENTRE UNIVERSITAIRE, elle relève que "l'université est un lieu privilégié de la liberté académique, qui traduit le principe selon lequel les enseignants et les chercheurs doivent jouir, dans l'intérêt même du développement du savoir et du pluralisme des opinions, d'une très grande liberté pour mener des recherches et exprimer leur opinion dans l'exercice de leurs fonctions". Pour ce qui concerne LES SYMPATHIES POLITIQUES DES JUGES, elle relève, se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, "qu'une sympathie politique dans le chef d'un magistrat ne suffit pas en soi pour susciter des appréhensions justifiées de partialité" et qu'il n'en irait autrement que si "l'intéressé a reçu du parti politique qui est censé être le sien des instructions concernant le litige". Enfin, elle rappelle que la Cour européenne a déjà considéré que LA SIMPLE CIRCONSTANCE QU'UN JUGE SOIT FRANC-MAÇON NE DONNE PAS LIEU À RÉCUSATION. Constatant que les requérants ne "font pas valoir d'éléments concrets de nature à compromettre l'impartialité subjective des juges", elle rejette la requête. On notera que, dans la même affaire, le Conseil d'Etat a adopté une attitude beaucoup moins tranchée. Il a fait droit à une demande de récusation des conseillers d'Etat Michel Leroy et Philippe Quertainmont au motif que des "éléments (incontestés) peuvent faire problème du point de vue de l'impartialité objective requise". En effet, ils font partie du Centre de droit public de l'ULB "qui entent rassembler autant des théoriciens que des praticiens du droit public, centre au sein duquel ils rencontrent entre autre sa directrice, Annemie Schaus, que ce centre a entre autre pour objectif la recherche (pas seulement concernant l'extrême droite) mais concernant la lutte contre l'extrême droite, et que c'est précisément Annemie Schaus qui assiste et représente les parties requérantes originaires en sa qualité d'avocate dans la procédure qu'elles ont intentée pour demander la suppression de la dotation accordée au Vlaams Belang". (p.553 - leçon 18)
(10) Refus de levée de l'immunité parlementaire d'Alain Mathot
En 2013, la Chambre des représentants refuse de délivrer l'autorisation visant au renvoi d'une parlementaire devant une juridiction de jugement au motif qu'elle avait été sollicitée à contretemps et, curieusement, à la veille du scrutin communal, et en refusant le renvoi d'un autre parlementaire au motif que l'accusation de trafic d'influence portée à son égard revêtait à son estime un caractère ténu et que, de surcroît, les faits reprochés au parlementaire "pourraient à première vue découler de l'exercice normal d'un mandat politique". En 2016, la Chambre refuse d'autoriser les poursuites à l'encontre d'Alain Mathot notamment au motif que "le déroulement chronologique de l'instruction, dont on peut relever la longueur, pose certaines questions concernant en particulier le fait que des devoirs et phases importants de cette instruction coïncident avec des moments revêtant un certain intérêt politique : une perquisition au domicile de M. Mathot pendant une période de dissolution parlementaire, et, dès lors, pendant l'établissement des listes électorales pour les élections fédérales de 2010, l'inculpation de M. Mathot au moment de la formation du gouvernement en 2011 et la rédaction du réquisitoire contre M. Mathot au moment de l'établissement des listes électorales pour les élections fédérales de 2014" et que "ces phases importantes de l'instruction ont souvent coïncidé avec des fuites dans la presse, ce qui a incité M. Mathot à déposer plusieurs plaintes avec constitution de partie civile du chef de violation du secret de l'instruction et du secret professionnel, plaintes qui sont d'ailleurs, jusqu'à présent, restées sans suite". (p.327 - leçon 10)
(1) Arrivée au pouvoir des partis fasciste (Mussolini) et nazi (Hitler) en Italie et en Allemagne
En Italie, la loi électorale de 1923 prévoyait que la liste ayant obtenu 25% au moins des voix serait assurée des deux tiers des sièges, le tiers restant étant réparti à la proportionnelle entre les autres listes. Lors des élections du 06 avril 1924, se tenant dans un climat de violence et d'intimidation, Il Listone, une liste regroupant les candidats du parti fasciste et des partis alliés (les populaires, les libéraux et les démocrates sociaux) obtient 60,1% de suffrages exprimés. Cette liste obtient ainsi les 356 députés prévus par la loi électorale, rejoints par 19 députés, élus sur des listes dissidentes. Parmi ceux-ci, 275 appartiennent au Parti fasciste qui dispose donc de la majorité à lui seul. L'opposition ne compte donc que 151 sièges répartis à la proportionnelle entre les différentes formations politiques la composant. On notera, cependant, que le taux de participation à ces élections n'était que de 63,8% et qu'Il Lestone n'a obtenu que 41% des voix des électeurs inscrits. L'opposition ne désarmant pas, le 10 juin 1924, l'un de ses principaux leaders, le socialiste Giacomo Matteotti est assassiné. L'opposition parlementaire réagit en refusant de prendre part aux travaux des assemblées tant qu'elles n'auront pas été dissoutes et que de nouvelles élections n'auront pas été organisées. Il n'est donné aucune suite à cette revendication et le Parlement vote, en 1925 et en 1926, diverses lois (dites "fascitissimes") portant notamment atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'association et qui créent les conditions d'instauration de la dictature. En novembre 1932, en Allemagne, le parti nazi obtient 33% des voix, ce qui permettra à Hitler d'accéder à la Chancellerie. En mars 1933, de nouvelles élections sont organisées dans un climat de terreur et de persécution des partis hostiles aux nazis. Le parti nazi obtient désormais 44% des voix, auxquelles il faut ajouter les 8% obtenus par les nationalistes. Hitler est donc soutenu par une majorité absolue sans que son parti, à lui seul, détienne celle-ci. Immédiatement après les élections, le Reichstaf vote un acte d'habilitation qui retire au Parlement le vote des lois et des budgets et qui confie, pour une période de 4 ans, ces pouvoirs au gouvernement. Celui-ci peut, en outre, "dévier la Constitution". C'en est donc fini de la démocratie allemande. (p.27 - leçon 1)
(15) Démission de Leterme-Vandeurzen, 2008
En décembre 2008, un séisme secoue la politique belge. Lors de la crise financière, l'État a racheté la banque Fortis. La solution retenue sauve les épargnants, mais préjudicie les actionnaires. Des procédures judiciaires sont engagées par ces derniers. Des rumeurs circulent : le premier ministre Yves Leterme, sans se concerter avec ses vices premiers ministres, fait distribuer au parlement une note qu'il a adressée au ministre de la justice dans laquelle il fait état de contacts entre son cabinet et des représentants de l'ordre judiciaire. Le 18 décembre, le Premier président de la Cour de cassation écrit au président de la chambre, Herman Van Rompuy, un courrier dans lequel il écrit : "il y a inévitablement des indications qui apparaissent comme quoi tout a été mis en œuvre pour faire en sorte que l'arrêt de la 18ème chambre de la Cour d'appel ne soit pas prononcé comme prévu et que l'on a tenté de faire traiter l'affaire par un autre siège, vraisemblablement dans l'espoir d'aboutir à un autre résultat". Le lendemain, il complète sa note en affirmant l'existence de lourds indices d'intervention du pouvoir exécutif dans le processus judiciaire. Ceci entraîne la démission du premier ministre (et son remplacement par monsieur Van Rompuy) ainsi que celle du ministre de la justice Jo Vandeurzen. Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Fortis ont simplement révélé un contact entre un magistrat détaché au cabinet du premier ministre et le représentant du ministère public chargé de donner un avis à l'audience. Il n'y avait là rien de choquant des lors que le ministère public est censé exprimer la position de l'exécutif dans le débat judiciaire, il ne s'agissait d'ailleurs que les délivrer un simple avis et que l'enquête parlementaire n'a révélé aucune pression sur le parquet, mais simplement une divergence de vues sur une question juridique. Par contre sont particulièrement choquantes les accusations sans preuve porté au premier président de la Cour de cassation, lequel a de toutes évidence violé la séparation des pouvoirs. (470 - leçon 15)
(10) Affaire Wesphael, la notion de flagrant délit, Cass. 03 décembre 2013
En novembre 2013 éclate l'affaire Wesphael, du nom d'un parlementaire wallon, accusé d'avoir assassiné son épouse dans un hôtel ostendais. Dans les faits, l'intéressé a fait appel à la réception de l'hôtel, laquelle a immédiatement saisi les services de police qui, arrivés sur-le-champ, ont constaté le décès de la victime. Il nie avoir assassiné son épouse. Les autorités judiciaires, et notamment le Parquet général de Gand, estiment qu'il y a FLAGRANT DELIT et s'abstiennent de solliciter l'autorisation du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté française avant d'arrêter l'intéressé et de le placer en détention préventive. Cette interprétation du flagrant délit est validée par la Chambre des mises en accusation du Gand et par la Cour de cassation. le champ d'application de la notion de flagrant délit au sens constitutionnel du terme a été débattu devant les chambres au moment de l'adoption du Code pénal de 1867, et plus particulièrement de son article 158 ("seront punis d'une amende de 200€ à 2000€ et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers, du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêt soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit"). A cette occasion, le débat à porté sur la question de savoir si la notion de flagrant délit au sens de l'article 59 de la Constitution devait être assimilée non seulement au flagrant délit proprement dit, mais également aux cas réputés flagrants par le Code d'instruction criminelle (article 41 : "dans tous les cas de flagrant délit ou réputés tels, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement des actes relevant de la compétence du procureur du Roi"). Devant la commission de la Justice, le baron d'Anethan a indiqué : "votre commission partage l'opinion exprimée dans l'exposé des motifs que cette expression ne comprend que le flagrant délit proprement dit". Des considérations d'ordre public, ajoute-t-il, "ont pu engager les auteurs de la Constitution à déroger au principe de l'inviolabilité du député, en cas de flagrant délit, parce que, dans ce cas, une autorisation préalable est impossible à obtenir ; mais il N'EN EST PAS DE MÊME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE ARRESTATION OPEREE PAR SUITE D'INDICES RECUEILLIS APRES LE FAIT CONSOMME. Ces indices ont bien pu être assimilés par le Code d'instruction criminelle au flagrant délit, pour faciliter les poursuites dans les cas ordinaires ; mais CES INDICES, QUI N'ONT JAMAIS L'EVIDENCE DU FLAGRANT DELIT, ET QUI, S'ETANT PRODUITS PLUS TARD, ONT LAISSE LE PLUS SOUVENT LE TEMPS DE DEMANDER L'AUTORISATION VOULUE, CES INDICES, DISONS-NOUS, NE PEUVENT PAS FAIRE FLECHIR LE GRAND PRINCIPE DE L'INVIOLABILITE PARLEMENTAIRE". De même, le procureur général à la Cour de cassation, Raoul Hayoit de Termicourt a indiqué que le flagrant délit ne se concevait que si le fait est vu ou entendu par un témoin, ou constaté immédiatement par un agent de police judiciaire". Un autre ancien procureur général près de cette Cour, Jean du Jardin, écrit : "flagrant délit au sens de l'article 45 de la Constitution doit donc s'entendre au seul sens strict de l'article 41, aliéna 1, du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'exception ne s'appliquera pas au délit réputé flagrant, au sens de l'alinéa 2 de l'article 41. LES CARACTERES D'EVIDENCE JUSTIFIANT L'IMMEDIATETE DES POURSUITES N'EXISTENT PAS LORSQUE L'ON DOIT SE BASER SUR DES INDICES RECUEILLIES ULTERIEUREMENT". Le même auteur ajoute : "si le ministère public devait estimer que des recherches d'indices ou d'éléments d'imputabilité sont indispensables à l'exercice de son action, l'absence de solution de continuité dans la procédure des poursuites qui pourrait en résulter aurait pour conséquence d'ôter à l'exception de flagrance, et sa justification, et ses effets ; la règle de l'immunité de procédure devrait alors reprendre vigueur". En l'espèce, les faits se sont déroulés dans un lieu clos où seuls étaient présents les protagonistes de l'affaire. Il n'y a donc eu aucun témoin visuel des faits. Quant aux éventuels témoins auditifs, il paraît peu probable qu'ils aient pu rapporter des éléments de preuve démontrant irréfutablement la culpabilité de l'intéressé. Enfin, une autopsie, des examens toxicologiques, une reconstitution ont été prescrits dans le cadre de l'instruction, preuve s'il en est que l'infraction "ne se présente pas avec tous les caractères de l'évidence". On comprend donc mal que la Cour de cassation, dans son arrêt du 03 décembre 2013, ait couvert la manière dont l'instruction a été conduite. En effet, la définition qu'elle livre du flagrant délit est en totale contradiction avec la manière dont la notion est présentée, notamment par ses anciens procureurs généraux. Pour qu'il y ait un flagrant délit, affirme-t-elle, il suffit que des éléments précis permettent de déduire objectivement qu'un crime est commis ou vient d'être commis. Il n'est pas requis, à son estime, que le crime soit perçu par un témoin ou immédiatement constaté par un agent de police judiciaire, ni qu'il soit évident et déterminé dans tous ses aspects qu'aucune enquête plus approfondie n'est nécessaire. Il est donc permis d'en déduire que le caractère exceptionnel des faits, la circonstance qu'il relevaient de la vie privée de l'intéressé et la crainte d'une réaction courroucée de l'opinion face aux "privilèges" consentis par la Constitution aux parlementaires ont conduit les autorités judiciaires, suivies en cela par le Parlement concernés, à prendre des libertés avec l protection constitutionnelle consacrée par l'article 59 de la Constitution. De toute évidence, les autorités judiciaires n'ont pas ici médité le sage conseil de Raoul Hayoit de Termicourt qui écrivait : "existe-t-il un doute sur le point de savoir si, dans une cause déterminée, le délit est encore flagrant : la sagesse commande au ministère public d'adresser une demande d'autorisation à la chambre compétente". Dès lors que Bernard Wesphael a finalement été acquitté des faits mis à sa charge, il est démontré irréfutablement qu'il n'y avait pas flagrant délit, que les autorités judiciaires et, au premier titre, la Cour de cassation se sont gravement et lourdement méprises et que ce parlementaire a été injustement privé de la protection constitutionnelle à laquelle il avait droit. Il est intéressant de reprendre ici les éléments avancés par la Cour de cassation pour fonder la prétendue existence d'un flagrant délit : " - que le demandeur a été trouvé immédiatement après la commission du crime pour lequel il y avait de fortes indications ; - que le 31 octobre 2013 à 22 :55, le demandeur a rapporté au réceptionniste de l'hôtel où il résidait avec la victime, que cette dernière s'était probablement suicidée ; - que le réceptionniste a téléphoné à la police et les premiers verbalisants sont arrivés dans la chambre d'hôtel environ 10 minutes plus tard ; - que ces verbalisants ont trouvé, dans la salle de bain de la chambre, la victime récemment décédée, le corps à demi nu et avec la zone pubienne complètement nue, avec à droite de la tête en sac en plastique ; - qu'ils ont vu le demandeur, avec ses vêtements en désordre, bouger de manière étrange et qu'ils ont remarqué qu'il avait une éraflure récente au poignet gauche ; -que le demandeur a dit plusieurs fois en français que la victime s'était suicidée à l'aide d'un sac en plastique ; -que les officiers de la police judiciaire ont procédé à l'arrestation du demandeur à 23 :05 ou un peu plus tard". On n'aperçoit pas en quoi ces différents éléments démontrent la flagrance. Outre qu'ils n'aient été constatés au moment de leur commission ni par un témoin ni par un officier de police judiciaire et qu'il s'agit d'indices recueillis après les faits, ils doivent, en outre, être corroborés par des devoirs d'instruction ultérieurs, tels une autopsie ou des examens toxicologiques. La position prise ici par la Cour de Cassation laisse d'autant plus perplexe que dans son arrêt du 11 juin 2013, cette juridiction livre une interprétation stricte de la notion de flagrant délit. Elle juge que : "le délai ainsi écoulé de plus de trois mois entre le dernier acte d'instruction constaté par le jugement attaqué effectué juste après la découverte de l'infraction et la citation directe n'est pas compatible avec la condition qu'au moment des poursuites, l'infraction faisant l'objet d'un flagrant délit puisse être encore actuelle. Le jugement attaqué ne pouvait davantage déduire des faits qu'il constate que le ministère public a procédé sans délai à la citation du demandeur". Ces conditions ne sont pas réunies quand instruction n'est pas diligentée, mais aussi quand elle est complexe et longue. Si le flagrant délit est une exception au régime de droit commun, c'est aussi parce que la procédure répressive est rapide. Dans l'affaire Wesphael, l'instruction prend de longs mois de telle manière qu'il est hasardeux d'affirmer que l'infraction puisse encore être actuelle. De même, le ministère public n'a pas pu, du fait de l'instruction qui se prolonge, prendre sans délai des réquisitions de renvoi devant une juridiction de jugement. Ces considérations confirment notre constat selon lequel la Cour de cassation n'a pas fait, en l'espèce, une application correcte de la notion de flagrant délit. N'est-il pas étonnant, sinon regrettable, que cette juridiction fasse dans une affaire ordinaire une application rigoureuse de cette notion et en développe une conception plus lâche dans une hypothèse où elle se devait précisément de garantir la protection reconnue à un parlementaire par la Constitution? (p.318 - leçon 10)
(14) CE 219.380, du 16 mai 2012 - XXX, pouvoirs d'un secrétaire d'Etat fédéral
En principe, DANS LA LIMITE DE LEURS ATTRIBUTIONS, LES SECRÉTAIRES D'ETAT ONT TOUS LES POUVOIRS D'UN MINISTRE. Ainsi, dans un litige ressortissant au droit des étrangers, un requérant fait grief au secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile d'avoir délégué des pouvoirs à l'Office des étrangers. Il soutient que le pouvoir de délégation n'appartient qu'au ministre. Le Conseil d'État indique, par exemple, qu' "en vertu de l'article 104 de la Constitution, les secrétaires d'Etat fédéraux, s'ils ne font pas partie du conseil des ministres, font partie du Gouvernement fédéral et leurs attributions et les limites dans lesquels ils peuvent recevoir le contreseing sont déterminés par le Roi. En l'application de cette disposition, L'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d'Etat énonce que sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4 de cet arrêté royal, le secrétaire d'Etat a, dans les matières qui lui sont confiées, tous les pouvoirs d'un ministre. Les pouvoirs dont disposent les secrétaires d'Etat fédéraux sont ainsi prévus par un arrêté royal pris directement en vertu la Constitution et sont les mêmes que ceux du ministre auquel ils sont adjoints. Il en ressort que le secrétaires d'Etat à la Politique de foula migration et d'asile, régulièrement nommé en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 17 juillet 2009 'gouvernement - démissions - nominations - modifications', dispose des mêmes attributions et du même pouvoirs de tutelle notamment 'sur l'Office des étrangers', que ceux du ministre auquel il est adjoint. Les pouvoirs dont de délégation est donné à des agents de l'Office des étrangers pour l'application de certaines dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sont ceux dont, et le ministre, et le secrétaire d'Etat, disposent dans le cadre de la politique et les versions et d'asile qui leur a, à tous deux, été confiée par les articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 17 juillet 2009. Il en résulte que lorsque l'agent délégué prendre une décision 'pour le secrétaire d'Etat', Il agit dans le cadre des délégations de pouvoir prévues par l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences". (p. 451 - leçon 14)
(18) CC 116/2002, du 26 juin 2002 - suspension, arrêt de principe + CC 143/2013, du 30 octobre 2013 - procédure en suspension, fouille au corps
En principe, le recours en annulation N'EST PAS SUSPENSIF. Toutefois, la partie qui saisit la Cour d'une requête en annulation peut solliciter la suspension de la norme incriminée dans les 3 mois de sa publication. La Cour est tenue de statuer sans délai sur la demande en suspension. Tout d'abord, la Cour peut ordonner la suspension d'une norme si le recours se fonde sur des MOYENS SÉRIEUX (qui ne doivent pas être confondus avec des moyens fondés) et que la norme querellée crée, dans le chef du requérant, UN RISQUE DE PRÉJUDICE GRAVE ET DIFFICILEMENT RÉPARABLE. Ces deux conditions revêtent un caractère CUMULATIF. Encore faut-il relever que même si ces deux conditions sont réunies, la Cour se réserve la faculté de ne pas user de son pouvoir de suspension. A son estime, il résulte que "de l'emploi du mot 'peut' de l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 de la Cour constitutionnelle que la Cour, même si elle juge qu'il est satisfait aux deux de fonds de l'article 20, 1°, pour pouvoir procéder à la suspension, n'est pas tenue de suspendre. La Cour examine donc s'il se justifie de procéder à la suspension du décret attaqué, en faisant la balance des avantages qu'une suspension procurerait aux parties requérantes et des inconvénients qu'une telle suspension entrainerait pour l'intérêt général". Faisant donc application du principe de LA BALANCE DES INTÉRÊTS, elle constate que "le décret attaqué poursuit des objectifs à ce point importants pour la collectivité qu'une suspension de ce décret risquerait de causer à l'intérêt général et à l'intérêt de tiers un préjudice plus grave et plus difficilement réparable que celui de son exécution immédiate pourrait causer aux parties requérantes". En l'occurrence, elle avait constaté que les parties pouvaient se prévaloir d'un risque de préjudice difficilement réparable ainsi écrit : "les parties font valoir d'un deuxième lieu comme préjudice grave difficilement réparable que l'adaptation des plans d'exécutions spatiaux prescrite d'urgence par les articles 2 et 8 du décret attaqué a pour effets que les propriétaires deviennent non conformes à la destination de la zone dans laquelle elles sont situées et qu'elles ne pourront plus exécuter de nouveaux travaux soumis à l'octroi d'un permis. Les bailleurs et les preneurs de terre agricole sont également directement touchés par le décret attaqué. Les terres risquent d'être rehaussées par des boues de dragage et d'être rendues pour longtemps, ainsi définitivement inutilisables pour l'agriculture. La perte de plusieurs années d'exercice d'une profession indépendante doit être considérée, selon les parties requérantes, comme un préjudice grave difficilement réparable. Les parties requérantes soulignent en troisième lieu l'atteinte à leurs conditions de logement, à leur santé, à leur sécurité et à leur environnement : un tel dommage dépasse largement le simple dommage moral que ferait disparaître une annulation". Les arrêts de suspension sont rares, et cela notamment parce que la Cour se montre sévère lorsqu'il s'agit d'admettre l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable. Elle considère, par exemple, qu'un préjudice financier ne justifie pas une suspension sauf lorsque, en raison des circonstances de la cause, celui-ci ne pourrait plus être réparé à la suite d'un éventuel arrêt d'annulation. Il en va notamment ainsi lorsqu'une norme a pour effet de bouleverser les conditions de fonctionnement d'un secteur d'activités. La Cour estime également que la condition du préjudice est remplie lorsque le requérant est privé d'une garantie juridictionnelle essentielle et que, compte tenu de son âge, il ne pourrait plus, à l'issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle, utilement faire valoir ses droits devant le Conseil d'Etat. Il en va de même lorsqu'il subit un préjudice moral lié à une mise à la refaire anticipée ou encore lorsque, compte tenu de son âge (59 ans), il perdrait, à défaut de suspension de la norme en cause, la dernière possibilité de nomination à la fin de sa carrière et après avoir déjà menée de nombreuses procédures. Il en est de même lorsque le préjudice consiste en la perte d'une année scolaire ou dans l'exclusion de l'accès à des études de dentisterie ou de médecine. Elle considère aussi que la condition du préjudice est réalisée lorsque l'exécution immédiate d'une norme a pour effet de dissuader un nombre important d'étudiants étrangers de s'inscrire dans une école artistique et de provoquer un afflux d'étudiants qui n'ont pas fait la preuve de leur aptitude à en suivre les cours par la réussite d'une épreuve artistique. La Cour n'hésite pas non plus à suspendre une loi électorale afin d'éviter que celle-ci ne trouve à s'appliquer lors des élections législatives du 18 mai 2003. Elle considère, en effet, que "le préjudice qui naîtrait d'élections organisées sur une base inconstitutionnelle serait nécessairement grave puisqu'il s'agirait d'une atteinte à la substance du droit, essentiel à l'existence même d'une démocratie représentative, d'élire et d'être élu". Elle use également de son pouvoir de suspension afin de préserver des libertés publiques essentielles. Ainsi est partiellement suspendu un décret flamand du 27 mars 1991 au motif qu'il impliquait la diffusion sur un site officiel de la Communauté flamande de l'identité des sportifs (en l'occurence d'un coureur cycliste amateur) qui font l'objet d'une suspension disciplinaire. Une telle publication viole le droit à la vie privée des intéressés et peut être utilisée à d'autres fins que celles poursuivies par le législateur, causant ainsi un préjudicie irréparable à leur réputation. Elle suspend aussi une disposition de la loi de principe du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détentions, relative à la fouille au corps des détenus, tel que modifié par la loi du 1er juillet 2013. Cette disposition consacrait : "l'obligation (...) faite au détenu de se déshabiller avant d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps". Auparavant, cette mesure "n'était pas possible que si des indices individuels laissaient supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffisait pas à atteindre l'objectif précité et nécessitait une décision particulière du directeur". Le législateur a rendu cette fouille systématique lors de leur entrée en prison des détenus, préalablement à leur placement dans une cellule sécurisée ou à leur enfermement dans une cellule de punition ou après des visites lorsqu'elles n'ont pas lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui les sépare des visiteurs. Après avoir considéré qu'en "prévoyant une fouille au corps systématique sans justification précise tenant au comportement du détenu, la disposition attaquée semble porter une atteinte discriminatoire à l'interdiction de traitement dégradant", la Cour estime que la condition du préjudice est remplie parce que les "fouilles corporelles portent une atteinte sérieuse à l'intégrité physique" et que "la nature de la mesure a en outre pour effet que cette atteinte ne peut être réparée". De plus, la Cour fait pleinement application de la notion de risque de préjudice car le requérant été libéré au moment où elle a rendu son arrêt mais, mais n'ayant pas purgé l'intégralité de sa peine, il pouvait "à tout moment être convoqué pour purger le reste de sa peine privative de liberté". (p.577 - leçon 18)
(13) Cour d'appel de Bruxelles, du 08 mai 1998 - Doutrèwe, secret
En raison du principe de publicité des séances de la commission, la décision de se réunir à huis clos doit être motivée. Elle emporte une obligation de secret pour tous ceux qui ont assisté aux réunions de la commission. POUR LES NON-PARLEMENTAIRES, la violation de cette obligation constitue une VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL et partant peut impliquer des sanctions pénales en vertu de l'article 458 du Code pénal. Ces principes ont été rappelés avec force par la Cour d'appel de Bruxelles dans une affaire opposant la juge d'instruction Martine Doutrèwe contre Ciné-télé-revue. Cet hebdomadaire avait publié les notes personnelles du magistrat qui avait été saisies par le président de la commission et qui pouvait être consultées par les commissaires dans les locaux de la Chambre, sans qu'ils soient autorisés à en prendre copie. La Cour d'appel estime que la publication de documents examinés par la commission lors d'une réunion à huis clos et à propos desquels elle n'a pas levé le secret "présente, dans le chef de l'auteur de l'article incriminé, Une apparence de faute tant pénale (aux regards des articles 458, 66 et/ou 67 du Code pénal) que civile, l'article incriminé paraissant nuire à l'intégrité est au respect de la vie privée de madame Martine Doutrèwe et violer le respect dû aux droits de la défense". La Cour d'appel estime donc que le journaliste qui publie des éléments couverts par l'obligation de secret au sens la loi sur les enquêtes parlementaires se rend coupable, comme auteur, coauteur ou complice, d'une infraction pénale. (p.411 - leçon 13)
(15) Démission avortée du gouvernement Eyskens, 1960 + "Démission" des ministres RW, 1977
En vertu des articles 96 et 104, LE ROI PEUT REVOQUER LES MINISTRES ET LES SECRETAIRES D'ETAT. Le chef de l'Etat a rarement fait usage de ce pouvoir qu'il doit exercer avec le contreseing d'un ministre. À ce propos, une attention toute particulière mérite d'être à portée est ce qui a dû être la DERNIÈRE TENTATIVE DU ROI D'EXERCER UN POUVOIR PERSONNEL DANS LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES. En 1960, lors des cérémonies consacrant l'indépendance du Congo, Baudoin Ier prononce un discours pour le moins paternaliste dans lequel il fait notamment l'éloge de la colonisation et de Léopold II. Patrice Lumumba, Premier ministre du nouvel État, lui répond en des termes particulièrement vifs. Le Roi en rend responsable le gouvernement belge qui n'a pas pris les dispositions qui auraient permis d'éviter l'humiliation qu'il a ressentie à l'écoute des propos de Lumumba. Il reproche, en outre, au gouvernement présidé par Gaston Eyskens ses atermoiements dans la politique menée à la suite de l'indépendance du Congo. Le souhait du Roi est de désigner un nouveau gouvernement Van Zeeland-Spaak, composé pour le surplus de ministres extérieurs au monde politique. Le premier ministre, Gaston Eyskens, refuse cependant de démissionner et déclare au roi : "sire, vous avez le droit de nous renvoyer, révoquez-nous". Parallèlement, le président du parti social chrétien (et futur premier ministre) Théo Lefèvre, qui fut pourtant un fervent défenseur de Léopold III, écrit au roi que la pire des choses serait qui existe, à nouveau en Belgique deux politiques, celle du palais et celle du gouvernement. Incantatoire, il écrit : "puis-je supplier le roi de se faire dire comment la crise de la monarchie qui s'est terminée aussi douloureusement en 1950 a débuté dans les années 1930". Le roi renonce alors ses projets, admettant aussi implicitement mais certainement qu'il ne lui appartient pas de dessiner les concours de la politique du pays, ce pouvoir ressortant à la compétence exclusive du gouvernement sous le contrôle du Parlement. En 1977, il est fait un véritable usage du droit de révocation. Sa mise en œuvre, cependant, ne résulte pas de la volonté personnelle du Roi. Le 04 mars, LES MINISTRES APPARTENANT AU RASSEMBLEMENT WALLON (RW), Robert Moreaux et Pierre Bertrand, SONT RÉVOQUÉS après que les députés de leurs partis se soient abstenus lors du vote d'un budget important. Le Premier ministre Léo Tindemans, en déduit que son gouvernement a perdu le soutien du RW et propose le roi la révocation des ministres appartenant à ce parti. Le terme "révocation" n'est cependant pas utilisé dans l'arrêté royal du 04 mars 1977, qui dispose que les deux ministres RW sont DÉCHARGÉS DE LEURS FONCTIONS. En outre, c'est arrêté est publié au MB sous le titre "gouvernement - démission" alors que, à l'évidence, les intéressés n'avait eu aucune intention de démissionner. Ce déguisement terminologique s'explique sans doute par la connotation péjorative du terme "révocation". En droit administratif, en effet, il s'agit d'une peine disciplinaire sanctionnant une faute grave. En droit constitutionnel, par contre, ce concept est étranger à la notion de faute. Il vise simplement à consacrer le fait que l'action d'un ministre ne se résout pas à présenter sa démission ne se concilie plus avec la politique générale du gouvernement. Il est permis, en outre, de s'interroger sur le rôle joué par le Premier ministre. Celui-ci, sans en avoir conféré au préalable avec les deux ministres concernés, les somme, en public et sans aucune explication, de démissionner. Une telle démarche n'est pas sans risque car, si les intéressés refusent de céder, elle ne peut plus se traduire que par leur révocation ou par la démission de l'ensemble du gouvernement. Par ailleurs, elle méconnaît la règle selon laquelle un différend entre ministres doit faire l'objet d'un débat au sein du conseil des ministres, dans le respect de la procédure du consensus. Enfin, il est significatif que les deux ministres soient sanctionnés alors que, respectueux de la solidarité gouvernementale, Ils ont, à l'inverse des parlementaires de leur parti, voté le budget qui était à l'origine de l'incident. Ce précédent témoigne de l'impact des partis politiques dans la vie et la fin des gouvernements. A aucun moment, le Premier ministre ne se demande si les ministres intéressés partagent l'opinion exprimée par leur parti à la Chambre. Dans l'esprit du Premier ministre, la défection des députés RW implique d'emblée que les ministres de ce parti doivent quitter le gouvernement, sans être en droit ni de manifester leur solidarité avec le gouvernement, ni même de s'expliquer. (p.464 - leçon 15)
(30) CE 133.797, du 12 juillet 2004 - concertation
Encore faut-il que les partenaires appelés à participer à une concertation fassent preuve D'UN MINIMUM DE BONNE VOLONTE. On ne pourra reprocher à une autorité d'avoir effectivement exercé ses compétences nonobstant la circonstance qu'une entité avec laquelle il devait y avoir concertation s'est refusée de participer à celle-ci. Le Conseil d'État l'a clairement affirmé dans un arrêt du 12 juillet 2004. Dans cette affaire, la Région wallonne faisait grief à l'autorité fédérale d'avoir adopté un arrêté royal relatif à la navigation aérienne sans s'être effectivement concertée avec elle et d'avoir ainsi manqué à la loyauté fédérale. Or, il apparaissait que le gouvernement wallon avait été invité à se prononcer sur le texte en projet et s'était contenté de contester la compétence de l'autorité fédérale pour intervenir en la matière. Le Conseil d'État a, tout d'abord, constaté que les deux autres Régions avaient fait valoir leurs observations sur le projet de texte fédérale et que seule la Région wallonne avait adopté une position de principe fondée sur la contestation de la compétence fédéral en la matière. En adoptant cette attitude de principe radicale, indique le Conseil d'État, "le Gouvernement wallon s'est lui-même exclu d'une procédure devant aboutir à l'adoption d'un texte satisfaisant pour les différentes entités". Il ajoute qu'une "éventuelle violation du principe de loyauté fédérale n'est pas sanctionnée juridiquement", tout en ayant en pratique fait application dudit principe. (p.971 - leçon 30)
(1) Civ. Bruxelles, du 29 juin 2001 - Vlaams Blok + Cass., du 18 novembre 2003 - Vlaams Blok, notion de délit politique
Grâce à cette modification constitutionnelle, des poursuites sont engagées, à l'initiative du Centre pour l'égalité des chances et de la Ligue des droits de l'homme, contre trois associations sans but lucratif dont l'objet social est de participer au fonctionnement du Vlaams Blok, devenue depuis lors le Vlaams Belang. Dans un jugement du 29 juin 2001 et dans un arrêt du 26 février 2003, le Tribunal de première instance de Bruxelles et la Cour d'appel de Bruxelles se déclarent successivement incompétents pour connaître de ces poursuites. Le premier juge estime que prôner la discrimination ou la ségrégation de façon aussi manifeste et répétée est un délit qui va à l'encontre de la conception actuelle de la démocratie et porte ainsi atteinte aux institutions politiques du pays. Il ajoute que la perpétration de ce délit est une atteinte à l'ordre interne de l'Etat et a pour objectif de faire évoluer ou de changer l'ordre politique établi. Il en déduit qu'il s'agit là d'un DELIT POLITIQUE qui, en vertu de l'article 150 de la Constitution, relève de la compétence exclusive de la Cour d'assises. La Cour d'appel, à son tour, considère que "le fait reproché constitue un délit politique parce qu'il consiste (pour autant évidemment qu'il soit prouvé) dans la commission de l'infraction dans l'intention (...) de faire exister et perdurer un parti politique, en l'espèce le Vlaams Blok, et d'accorder à ce parti une aide substantielle (...)". Autrement dit, elle estime que l'on est en présence d'un DELIT POLITIQUE car l'infraction en cause est une manière pour le Vlaams Blok d'exister et partant de faire connaître son programme. L'interprétation ainsi donnée du délit politique entre cependant en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Celle-ci, dans un arrêt du 18 novembre rappelle, en effet, que DEUX CONDITIONS doivent être réunies pour qu'un délit soit qualifié de politique. Il faut, tout d'abord, pour qu'une infraction de droit commun (en l'occurrence une violation de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie) soit considérée comme politique, que L'AUTEUR DE CELLE-CI AIT ENTEDU AGIR AVEC L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE à L'ORDRE POLITIQUE. Il faut ensuite, que LES FAITS AIENT ETE COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES TELLES QU'ILS SONT DE NATURE A AVOIR L'EFFET RECHERCHE, SOIT PORTER DIRECTEMENT ATTEINTE AUX INSTITUTIONS POLITIQUES. Elle en conclut que la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas motivé de manière adéquate les raisons qui l'ont conduite à considérer qu'il s'agissait bien, en l'espèce, d'un délit politique. Plus particulièrement, elle estime que le simple fait que le parti politique ne peut exister que par la perpétration du délit ne suffit pas à conférer à celui-ci la qualification de politique. A la suite de cette arrêt, l'affairait est renvoyée devant la Cour d'appel de Gand qui, dans un arrêt du 21 avril 2004, condamne sévèrement les trois associations satellites du Vlaams Blok pour violation de l'article 3 de la loi précitée du 30 juillet 1981. La Cour de cassation rejette, le 09 novembre 2004, le pourvoi formé contre cet arrêt. Elle constate que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 transpose en droit belge l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et que cette disposition légale ne souffre aucune exception. Autrement dit, LES PARTIS POLITIQUE NE PEUVENT, PAS PLUS QUE QUICONQUE, SE RENDRE COUPABLES DE DISCRIMINATIONS RACIALES. La Cour relève, en outre, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales admet que des limites soient apportées à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Il en résulte que le Vlaams Blok ne peut se prévaloir de ces libertés pour donner un fondement à un comportement discriminatoire contraire à la loi du 30 juillet 1981. Tirant les conclusions de cet arrêt, les responsables du Vlaams Blok ont "nuancé" certains aspects de leur programme et modifié la dénomination de leur parti qui se présente aujourd'hui sous l'appellation Vlaams Belang. (p.37 - leçon 1)
(10) CC 130/2006, du 28 juillet 2006 - inéligibilité applicable aux conseillers provinciaux
Il a déjà été relevé plus haut qu'en exécution de la sixième réforme de l'Etat, et en vue d'assurer l'EFFET UTILE DU VOTE, il est désormais interdit de se présenter simultanément à des élections qui se tiennent le même jour et que le membre d'une assemblée parlementaire qui se présente à une élection dans une autre assemblée, s'il est élu, est tenu d'abandonner son ancien mandat au bénéfice de celui qui vient de lui être confié par les électeurs. L'article L4155-1, alinéa 2, 6° du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation pose une règle plus radicale encore pour ce qui concerne les élections provinciales. Il prévoit que les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européenne, d'un Parlement régional ou communautaire sont inéligibles au conseil provincial. Autrement dit, cette disposition instaure une CONDITION D'ELIGIBILITE, et non une incompatibilité. La conséquence est qu'un parlementaire fédéral, régional, communautaire ou européen qui veut se présenter aux élections provinciales doit d'abord démissionner de son mandat précédent. Cette mesure est plus exigeante que l'incompatibilité car elle implique le risque pour le candidat de ne pas être élu et de perdre tous ses mandats. Deux parlementaires saisissent la Cour constitutionnelle d'un recours en annulation. Ils justifient leur position par le fait qu'ils ne seraient prêts à renoncer à leur mandat parlementaire qu'à la condition de faire partie de l'exécutif provincial. Or, il leur est impossible, avant les élections, d'avoir la garantie que leur formation politique fera partie de la majorité provinciale et qu'ils pourront ainsi exercer le mandat convoité. La Cour constitutionnelle leur donne tort en réaffirmant le principe du droit du citoyen au CARACTERE UTILE DE SON VOTE. Elle relève que "le législateur décrétal wallon poursuit un objectif légitime, à savoir garantir l'effet utile du vote des électeurs. La Cour doit encore examiner si la mesure entreprise est raisonnablement justifiée eu égard à cet objectif. Les conditions auxquelles est subordonné le droit de se porter candidat doivent refléter le souci de maintenir l'intégrité et l'effectivité d'une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l'intermédiaire du suffrage universel. L'éligibilité est un droit fondamental ayant pour objet de pouvoir se porter candidat à un mandat de représentant du peuple. Il s'ensuit que ce droit peut être encadré par des exigences plus strictes que le droit de vote, spécialement lorsque ces exigences ont pour but de garantir l'effet utile du vote de l'électeur. La mesure entreprise n'est pas une atteinte disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi : la restriction au droit d'éligibilité ne constitue pas un empêchement absolu de se porter candidat aux élections provinciales ; la personne concernée peut y remédier en démissionnant des mandats politiques visés par la disposition attaquée". (p.295 - leçon 10)
(17) CE 94.345, du 27 mars 2001 - circulaire Peeters et Martens, recours CF-RW + CC 201/2004 - circulaire Peeters et Martens, recours CF-RW
Il arrive que des ministres adoptent des circulaires qui ONT POUR EFFET, SOUS LE PRÉTEXTE DE DONNER UNE INTERPRÉTATION DU DROIT EXISTANT, D'EN DÉNATURER OU D'EN MODIFIER LA PORTÉE. Il a été jugé que "quel que soit leur intitulé, ce sont des actes de portée réglementaire et, partant, sont de nature à faire grief, les circulaires signées par un ministre qui ajoutent des règles nouvelles à celles qui sont en vigueur, qui sont rédigées en termes impératifs, que leur auteur a entendu rendre obligatoire et au respect desquelles il peut contraindre les destinataires". Dans ce cas, il s'agit d'un règlement attaquable devant le Conseil d'État qui, s'il émane du pouvoir exécutif de l'autorité fédérale ou d'une entité fédérée, peut être censuré si il n'a pas été soumis à l'avis préalable de la section de législation. Tel était a priori le cas des circulaires adoptées par les ministres du gouvernement flamands, Peeters, Martens et Van Den Brande. L'objectif poursuivi est de contraindre les francophones établis dans des communes à statut linguistiques spécial à solliciter, pour chaque document administratif émanant de la commune ou du CPAS, qu'il leur soit adressé en français alors qu'auparavant, la législation linguistique était interprétée de telles manière qu'une demande unique suffisait pour qu'ils reçoivent l'ensemble des documents administratifs dans leur langue. Ces circulaires paraissaient manifestement irrégulières. Tout d'abord, LA LÉGISLATION SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE L'AUTORITÉ FÉDÉRALE et les institutions flamandes ne peuvent régler en se prévalant de leurs compétences dans le domaine de la tutelle sur les communes et la CPAS. Ensuite, elles ont pour effet de modifier la portée du droit existant et de restreindre une liberté dont bénéficient des citoyens. Elles ont donc UNE PORTÉE RÉGLEMENTAIRE, ce qui implique notamment qu'il fallait se soumettre à l'avis préalable de la section de législation du Conseil d'État. Celui-ci, au contentieux de la suspension, en a d'ailleurs implicitement convenu. En effet, il a rejeté les demandes introduites devant lui en raison d'une absence de risque de préjudice grave difficilement réparable. S'il s'était agi de véritables circulaires, il n'aurait pas examiné si il existait un risque de préjudice grave difficilement réparable. Il se serait contenté de constater que les actes en cause n'avaient pas de contenu normatif, ne pouvait pas faire grief aux requérants et, en conséquence, se serait déclaré incompétent pour connaître des recours. Cependant, le militantisme des chambres flamandes du Conseil d'État est apparu au grand jour dans la manière dont le recours en annulation concernant la circulaire Peeters a été traité. L'opération qui tient du CRIME JUDICIAIRE PARFAIT s'est déroulée en deux temps. Alors que cette question n'avait pas été évoquée dans le cadre de la procédure en suspension, les chambres bilingues du Conseil d'État ont, dans un premier temps, rejeté le recours en ce qu'il était mis en œuvre par la Communauté française et la Région wallonne. Elles ont estimé que celles-ci n'avaient pas intérêt à poursuivre l'annulation d'une règle qui s'applique sur un territoire où elle n'exerce aucune compétence et qu'ils n'ont pas plus un intérêt direct à défendre l'intérêt de tiers. Comme la troisième requérante, bien que francophone, était domiciliée dans la Région de langue flamande, l'affaire a été renvoyé à une chambre flamande du Conseil d'État. Le 23 décembre 2004, contre l'avis de l'auditeur général néerlandophone du Conseil d'Etat, cette chambre rejette les recours en annulation dirigés contre la circulaire Peeters. Il est, tout d'abord, constaté que la situation de fait qui prévalait avant l'adoption de la circulaire n'était pas conforme aux articles 25, 26 et 28 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Plus particulièrement, la haute juridiction administrative estime que la pratique antérieure conduisait, en fait, à un système de bilinguisme par lequel la préférence linguistique des personnes est instituée en régime ou en principe. Or, à l'estime des magistrats flamands du Conseil d'État, une telle interprétation des textes est contraire à la législation linguistique et à la Constitution telle qu'elle a notamment été interprétée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 26/98 du 10 mars 1998. Après avoir invalidé la pratique administrative qui prévalait jusqu'à l'adoption de la circulaire, le conseil d'État conclut à l'illégitimité de l'intérêt de la requérante en ce que celui-ci s'appuie, en réalité, sur une interprétation de la législation linguistique incompatible avec la Constitution. Cet arrêt est une décision de combat au service de la cause flamande la plus agressive. En effet, le Conseil d'État développe une argumentation pour le moins artificielle et alambiquée qui le conduit à constater que la requérante ne disposait pas d'un intérêt légitime à agir. Elle peut dès lors rejeter son recours et éluder les questions fondamentales du caractère réglementaire de la circulaire et de la compétence du gouvernement flamand pour interpréter les lois linguistiques fédérales. La matière de l'emploi des langues est par excellence un champ de division entre les juridictions francophones et néerlandophones. Les arrêts de rejet du Conseil d'État n'ont pas autorité de choses jugée. La Cour de cassation "a ainsi décidé que l'arrêt par lequel le Conseil d'État rejette un recours en annulation contre un arrêté réglementaire n'a pas autorité de chose jugée erga omnes et ne sauraient porter atteinte ni au devoir de contrôle de légalité des tribunaux, ni à celui de la Cour de cassation de contrôler la légalité du même arrêté lorsqu'elle est saisie d'un pouvoir, celui-ci fût-il fondé sur le grief d'illégalité rejeté par le Conseil d'État". Les arrêts précités du Conseil d'État n'ont donc pas pu délivrer un certificat de validité juridique aux circulaires Peeters, Martens et Van Den Brande. (p.526 - leçon 17)
(18) CC 68/2005, du 13 avril 2005 - affaire Total + Cass., du 29 juin 2005 - affaire Total
Il existe néanmoins des cas où la juridiction qui a posé la question préjudicielle se refuse d'admettre la primauté de la Cour constitutionnelle. A titre d'exemple, on peut évoquer l'affaire Total. Un réfugié politique birman dépose plainte sur la base de la loi du 05 aout 2003, relative aux violations graves du droit international humanitaire, dite loi de compétence universelle contre Total. Cependant, au regard du texte de celle-ci, les juridictions belges doivent se dessaisir de l'affaire si la plainte n'a pas été déposée par un ressortissant belge. Par un arrêt du 05 mai 2004, la Cour de cassation interroge la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur la discrimination qui frapperait ainsi les réfugiés politiques. Dans son arrêt n°68/2005 du 13 avril 2005, la Cour constitutionnelle constate que cette loi est entachée d'inconstitutionnalité EN CE QU'ELLE NE TRAITE PAS ÉGALEMENT LES PLAIGNANTS BELGES ET LES RÉFUGIÉS POLITIQUES ÉTABLIS EN BELGIQUE. Plus précisément, elle indique que l'article 16.2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, disposition directement applicable au droit interne, confère au réfugié reconnu, dan l'Etat où il a sa résidence habituelle, l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne le droit d'accès au tribunaux. Dans un arrêt du 29 juin 2005, la Cour de cassation refuse de tirer les conséquences de cet arrêt et prononce le dessaisissement des juridictions belges. Son raisonnement se fonde sur le constat que, MÊME INCONSTITUTIONNELLE SUR CE POINT, LA LOI SUR LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE NE PERMET PAS AUX JURIDICTIONS BELGES DE CONNAÎTRE D'UNE PLAINTE D'UN RÉFUGIÉ POLITIQUE ET QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS DE PALLIER UNE CARENCE LÉGISLATIVE. Le plaignant avait pourtant demandé que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : "l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage viole t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il serait interprété de telle manière que le juge qui a interrogé la Cour constitutionnelle pourrai appliquer une disposition législative dans une interprétation jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle, assimilant ainsi un constat d'inconstitutionnalité, de surcroit exprimé au conditionnel, à une carence législative ?". La Cour de cassation refuse de poser cette question préjudicielle en affirmant qu'elle repose sur une prémisse inexacte en ce qu'il ressort de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle "que le constat d'inconstitutionnalité ne repose pas sur une interprétation de la règle existante mais sur la constatation d'une lacune dont celle-ci est entachée". La Cour de cassation était confrontée à une alternative claire. Elle pouvait donner de la loi sur la compétence universelle une interprétation conciliante conforme tout à la fois à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel et au droit international directement applicable et, dans ce cas, refuser que les juridictions belges soient dessaisies. Elle pouvait également, et c'est ce qu'elle a fait, ordonner le dessaisissement en considérant qu'il y avait une lacune législative et qu'il convenait dès lors d'appliquer un droit jugé inconstitutionnel et, de surcroît, manifestement contraire à une disposition de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne. Ce faisant, la Cour de cassation neutralise la réponse à la question qu'elle a elle-même posée et rend le mécanisme préjudiciel parfaitement inutile. (p.589 - leçon 18)
(4) Avis SLCE, des 8 et 14 janvier 2013 - accord de coopération sur les conventions des droits de l'enfant
Il existe également des ACCORDS DE COOPERATION, conclus entre les différents partenaires de la Belgique fédérale. Ils revêtent, selon les cas, une valeur législative ou réglementaire. Ils doivent, à notre sens, trouver leur place dans la hiérarchie des normes. A l'instar des normes de droit international, il convient de les situer au-dessus des normes internes de chaque ordre juridique. La section de législation du Conseil d'Etat a relevé qu'il "peut se déduire du principe général de droit pacta sunt servanda qui, par analogie au droit international, doit également être considéré comme applicable aux accords de coopération, que les autorités qui ont conclu un accord de coopération entre elles doivent le respecter et ne peuvent pas édicter unilatéralement des règles de droit portant atteinte au contenu de l'accord de coopération". Il en découle que les accords de coopération législatifs se situent, dans la hiérarchie des normes, au-dessus des normes législatives prises unilatéralement par les partenaires, parties à l'accord. Il en va de même des décrets conjoints tant qu'ils n'ont pas été abrogés unilatéralement par l'un des législateurs concernés. Enfin, les accords de coopération législatifs priment les accords de coopération d'exécution. Quant aux accords strictement réglementaires, ils priment les actes réglementaires pris unilatéralement par chaque partenaire. (p.146 - leçon 4)
(10) CEDH - Madame A c. Royaume-Uni
L'IRRESPONSABILITE (ou L'IMMUNITE ABSOLUE) du parlementaire l'exonère, de façon absolue, de toute forme de responsabilité (qu'elle soit pénale, civile, voire disciplinaire) pour les attitudes prises et les opinions étendues dans le cadre de l'exercice du mandat parlementaire. Pour mieux en cerner la portée, il faut se livrer à un bref examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci se prononce sur cette question dans un arrêt A c. Royaume-Uni. Un député conservateur, s'exprimant à La Tribune de la Chambre des Communes, cite le nom et l'adresse de Madame A et tient à son égard des propos scandaleux qui sont répercutés par la presse, provoquant pour l'intéressée et sa famille des dommages irréparables. En raison de l'immunité parlementaire dont bénéficie le député, Madame A ne peut saisir une juridiction interne afin d'obtenir réparation du dommage subi. Elle saisit la Cour des droits de l'homme D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 6 §1 DE LA CONVENTION QUI GARANTIT A QUICONQUE LE DROIT D'ACCES A UN TRIBUNAL INDEPENDANT ET IMPARTIAL. La Cour, cependant, ne fait pas droit à sa demande et développe une conception globalisante de l'immunité parlementaire. Elle indique, en effet "que L'APPLICATION D'UNE REGLE CONSACRANT UNE IMMUNITE PARLEMENTAIRE ABSOLUE NE SAURAIT ÊTRE CONSIDEREE COMME EXCEDANT LA MARGE D'APPRECIATION DONT JOUISSENT LES ETATS POUR LIMITER LE DROIT D'ACCES D'UNE PERSONNE A UN TRIBUNAL". Elle souscrit, affirme-t-elle, "aux arguments de la requérante selon lesquels les allégations formulées à son sujet dans le discours du député étaient extrêmement graves et de toute évident inutiles dans le contexte d'un débat sur la politique municipale du logement". Il est, en effet, "particulièrement regrettable que le député ait cité à plusieurs reprises le nom et l'adresse de l'intéressée". Ces considérations "ne sauraient toutefois modifier sa conclusion quant à la proportionnalité de l'immunité parlementaire en cause, car la création d'exceptions à cette immunité, dont l'application serait alors fonction des faits particuliers de chaque espèce, aurait pour effet de saper sérieusement les buts légitimes poursuivis". (p.303 - leçon 10)
(10) Affaire Wesphael, le rôle de l'assemblée ainsi que la notion de bon fonctionnement de l'assemblée, position du Parlement wallon
L'affaire Wesphael a été l'occasion de s'interroger sur le rôle des assemblées en la matière. Initialement, la commission des poursuites du Parlement wallon constate que n'étant saisie d'aucune demande émanant soit du ministère public, soit de la défense, il ne lui appartient pas de prendre une quelconque initiative. Cette démarche contredit les termes mêmes de l'article 59, alinéa 6 de la Constitution. Cette disposition, en effet, ne subordonne pas (même si elle ne s'exclut pas) l'intervention de l'assemblée à une quelconque demande du parlementaire mis en cause. Ensuite, saisis par Bernard Wesphael, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté française refusent de solliciter la levée de sa détention. Certains auteurs estiment que ces assemblées ne pouvaient agir autrement, car cela les aurait amenées à s'immiscer dans l'exercice de la fonction judiciaire. L'argument n'est pas sérieux. L'article 59, alinéa 6, n'a de sens que s'il permet à l'assemblée parlementaire de faire échec à des décisions du pouvoir judiciaire qu'elle estime arbitraires. Il s'agit d'une disposition qui garantit la séparation des pouvoirs et qui permet de faire obstacle au pouvoir judiciaire s'il a méconnu les limites constitutionnelles de son action. Autrement dit, sauf à vider de toute pertinence cette disposition constitutionnelle, l'assemblée parlementaire a le devoir de solliciter la suspension de l'arrestation d'un parlementaire si elle estime que le pouvoir judiciaire a outrepassé les limites des pouvoirs que lui consent la Constitution, notamment en donnant une définition élargie ou inadéquate de la notion de flagrant délit. Il a été relevé que l'article 59 de la Constitution vise à garantir LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE, et non à accorder une impunité quelconque au parlement poursuivi. Encore faut-il définir les critères permettant d'apprécier ce qui est requis par le bon fonctionnement du Parlement. A cet égard, une distinction doit être faite entre les poursuites et la détention. Un parlementaire faisant l'objet de poursuites subit sans doute quelque gêne dans l'exercice de son mandat, mais rien ne lui interdit d'exercer néanmoins celui-ci. Il en va tout autrement s'il est incarcéré et, partant, incapable de prendre part à l'activité quotidienne de l'assemblée. Il est possible de soutenir que l'absence durable de l'un de ses membres ne nuit en rien au fonctionnement du Parlement dès lors qu'aucun problème de quorum ou de majorité ne se pose. Cette thèse a minima semble avoir inspiré la commission des poursuites du Parlement wallon dans l'affaire Wesphael. En effet, elle estime ne pas devoir s'opposer à la détention de l'intéressé, notamment parce que celui-ci "peut continuer à déposer des propositions de décret ou de résolution et des questions écrites". Or dans un régime démocratique, le bon fonctionnement de l'assemblée exige que les électeurs soient effectivement et pleinement représentés par le parlementaire à qui ils ont donné leur voix. Les 3.688 électeurs qui ont exprimé un vote de préférence à l'égard de Bernard Wesphael n'ont pas bénéficié de cette garantie pendant sa détention. André Mast écrivait d'ailleurs à ce propos : "les poursuites intentées contre un membre du Parlement peuvent troubler l'ordre régulier des travaux parlementaires, puisque ces poursuites requièrent généralement la présence de l'inculpé. Elles peuvent avoir pour conséquence de priver une fraction du corps électoral de sa représentation à la Chambre ou au Sénat" (p.323 +328 - leçon 10)
(18) CC 184/2011, du 08 décembre 2011 - effets des arrêts, budgets bruxellois
L'annulation d'une norme peut être soit PURE ET SIMPLE, soit ATTENUEE. Les arrêts par lesquels la Cour prononce l'annulation totale ou partielle d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ont, en vertu de l'article 9 §1 de la loi spéciale du 06 janvier 1989, "autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge". Une telle formulation est inadéquate car l'annulation est un effet de droit qui dépasse celui de l'autorité de la chose jugée. En réalité, L'ANNULATION OPERE, EN PRINCIPE, DE MANIERE ABSOLUE. En effet, les dispositions annulées n'existent plus et, de surcroît, sont censées n'avoir jamais existé. Toutefois, en raison des difficultés insurmontables qui peuvent être engendrées par l'annulation d'une norme qui a parfois fait l'objet de nombreuses applications, le législateur a prévu que la COUR PEUT INDIQUER, par voie de disposition générale, CEUX DES EFFETS DE L'ACTE ANNULE QUI DOIVENT ÊTRE CONSIDERES COMME DEFINITIFS OU MAINTENUS PROVISOIREMENT POUR LE DELAI QU'ELLE DETERMINE. Elle est donc habilitée soit à limiter la portée rétroactive de ses arrêts, soit à prévoir le moment auquel son arrêt commencera à produire ses effets. Cette faculté constitue, en quelque sorte, le corollaire des règles relatives à la suspension des lois, décrets ou ordonnances. Dans les deux cas, en effet, IL S'AGIT D'EVITER QU'UNE ANNULATION AIT POUR EFFET DE COMPROMETTRE GRAVEMENT LA SECURITE JURIDIQUE. Il arrive donc que la décision de la Cour n'ait d'effet que pour l'avenir. Ainsi a-t-elle annulé des dispositions budgétaires de la Région de Bruxelles-Capitale visant à financer des crèches sur le territoire bruxellois. Elle a, cependant, maintenu les effets de la norme annulée en précisant que cette "annulation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le financement alloué sur la base de cette disposition doive être remboursé". Elle indique que plusieurs projets d'infrastructures qui ont été financés sont déjà réalisés, que d'autres sont en cours d'exécution et qu'une "annulation rétroactive aurait pour effet que plusieurs acteurs qui ont pu invoquer de bonne foi une disposition budgétaire et une décision des pouvoirs publics fondée sur cette disposition pourrait rencontrer des problèmes financiers". Pour autant que le budget ait été épuisé, une telle décision est donc dépourvu d'effet utile, si ce n'est pour le principe qu'elle pose et l'indication faite au législateur du comportement qui doit être le sien à l'avenir. La Cour, en certaines circonstances, use de cette faculté pour laisser le temps au législateur de remédier au vice qu'il a détecté. Ainsi, il lui arrive de maintenir les effets d'une législation pour l'avenir et pour une période qu'elle détermine. Elle se fonde à cet égard sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci estime "qu'au regard du principe de la sécurité juridique, une cour constitutionnelle peut laisser un délai au législateur pour légiférer à nouveau, ce qui a pour conséquence qu'une norme inconstitutionnelle reste applicable pendant une période transitoire". (p.580 - leçon 18)
(5) Cass., du 13 avril 1989 - Debled c. Odre des médecins, avis SLCE
L'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 1989 mérite d'être invoqué ici. Le docteur Debled est sanctionné par l'Ordre des médecins parce qu'il pratiquait des honoraires excessifs. L'intéressé conteste cette sanction parce que la procédure mise en oeuvre à son encontre se fonde sur des arrêtés qu'il estime irréguliers. Il indique, en effet, que les arrêtés royaux 78 et 79, relatifs à l'art de guérir et à l'Ordre des médecins pris en vertu d'une loi d'habilitation du 31 mars 1967 (et qui organisent la procédure disciplinaire) ont été délibérés en conseil des ministres avant que soit communiqué à celui-ci l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Cet argument est invoqué dans le cadre d'un pourvoi formé devant la Cour de cassation. Celle-ci le rejette, en se fondant sur une analyse par trop formelle de l'article 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Elle estime que "l'existence de ces 2 avis (celui du Conseil d'Etat et des ministres qui délibèrent en conseil) est la seule condition formelle fixée par la loi qui n'indique pas l'ordre dans lequel ils doivent être données". Cet arrêt est contestable. En toute logique, la consultation de la section de législation doit intervenir AVANT que le texte définitif de l'arrêté soit délibéré au sein de l'organe exécutif. Il s'agit là, selon nous, d'une condition essentielle à L'EFFET UTILE de l'obligation de consultation de la section de législation. Enfin, l'absence de consultation de la section de législation à propos d'un acte réglementaire est de nature à fragiliser irrémédiablement celui-ci. En effet, en tout temps, les juridictions devant lesquelles sont application est invoquée pourront l'écarter sur la base de ce simple motif. (p.158 - leçon 5)
(5) CE 185.266, du 09 juillet 2008 - Claudic, article 159
L'article 159 crée une obligation dans le chef du juge, et non dans celui de l'autorité administrative. Dès lors, estime le Conseil d'Etat, "que l'auteur de l'acte attaqué est un organe de l'administration active, il est tenu d'appliquer les dispositions réglementaires et n'a pas le pouvoir d'écarter celle qu'il estimerait illégale". En revanche, ajoute-t-il, "comme toute juridiction, le Conseil d'Etat est tenu de refuser d'appliquer toute disposition réglementaire qu'il juge illégale". L'autorité administrative est donc tenu d'appliquer un règlement illégale, mais est confrontée à un jeu de dupes puisque l'acte qu'elle prend sera annulé par le Conseil d'Etat ou verra son application écartée par le juge judiciaire, précisément en raison de irrégularité. Dans une affaire Claudic, le Conseil d'Etat fournit une piste permettant à l'autorité administrative d'échapper à cette situation inextricable. En l'espèce, l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances, n'avait pas nommé la requérante en qualité de concierge. Il avait, à cette occasion, refusé de faire application d'une instruction administrative (un règlement d'ordre intérieur) organisant la procédure de recrutement des concierges qui avait été déclarée irrégulière, en la même cause, par un arrêt antérieur de la haute juridiction administrative. La requérante estimait que "la partie adverse, en tant qu'autorité administrative, ne pouvait, sur la base de l'article 159 de la Constitution et du principe général du parallélisme des procédures et des compétences, refuser l'application de cette instruction, quand bien même celle-ci paraîtrait illégale". Le Conseil d'Etat refuse de censurer la décision attaquée en décidant que "la requérante n'a pas intérêt au moyen dès lors que l'instruction ministérielle du 10 août 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur des concierges est un acte réglementaire irrégulièrement adopté". Les circonstances dans lesquelles l'arrêt Claudic a été rendu étaient évidemment particulières. En effet, la partie adverse était l'auteur du règlement litigieux et son irrégularité avait non seulement été préalablement constatée par le Conseil d'Etat, mais l'avait été dans le cadre de la même affaire. Il n'en demeure pas moins que la piste ainsi indiquée par la haute juridiction administrative paraît satisfaisante en toutes circonstances. Sans doute l'autorité prend-elle un risque, que ce soit en appliquant ou en refusant d'appliquer un règlement illégal, mais il paraît saugrenu, et contraire au principe de légalité, de la sanctionner pour avoir, en refuser d'appliquer un règlement irrégulier, fait une application correcte du droit. Corrélativement, il serait déraisonnable de reconnaître à une partie un intérêt à une application incorrecte de celui-ci. Autrement dit, il n'est pas déraisonnable pour l'autorité administrative, agissant avec prudence et circonspection, de faire application, en certaines circonstances et à ses risques et périls, sinon de l'article 159 de la Constitution qui ne concerne que les juridictions, mais à tout le moins de la technique de raisonnement qu'il consacre. (p.169 - leçon 5)
(1) CC 10/2001, du 07 février 2001 - 15ter
L'article 15ter (parti politique hostile à la Convention européenne des droits de l'homme), dans sa formulation de 1999, a fait l'objet d'un recours en annulation de la part du Vlaams Blok devant la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt du 07 février 2001, elle rejette celui-ci en assortissant sa décision de différentes réserves qui ont malheureusement conservé leur pertinence par rapport au nouveau texte de cette disposition. Tout d'abord, elle estime que cette disposition doit S'INTERPRETER STRICTEMENT. Elle considère, en effet, que le terme "hostilité" est peu précis. Il convient, dès lors, compte tenu de l'objectif du législateur (à savoir défendre la démocratie et ne pas permettre que des libertés politiques soient utilisées afin de la détruire), de l'interpréter comme la manifestation d'une "incitation à violer la norme juridique en vigueur",et notamment "une incitation à commettre des violences et à s'opposer à ces règles". Ainsi affirme-t-elle que fait partie du débat démocratique légitime le fait pour un parti de proposer que l'une ou l'autre règle figurant dans la Convention européenne des droits de l'homme ou dans un de ses protocoles reçoive une interprétation nouvelle ou soit révisée. De même, il doit être possible pour un parti d'émettre "des critiques sur les présupposés philosophiques ou idéologiques de ces instruments internationaux". La Cour en déduit que la sanction ne pourra être prise que dans le cas d'une hostilité manifestée à l'égard d'un "principe essentiel au caractère démocratique du régime" politique. Elle souligne expressément que la condamnation du racisme et de la xénophobie constitue incontestablement l'un de ces principes fondamentaux "car de telles tendances, si elles étaient tolérées, présenteraient, entre autres dangers, celui de conduire à discriminer certaines catégories de citoyens sous le rapport de leurs droits, y compris de leurs droits politiques, en fonction de leurs origines". La réserve émise par la Cour revient, dès lors, à limiter le champ d'application de l'article 15ter de la loi du 04 juillet 1989 précité aux incitations à violer les principes essentiels d'un régime démocratique, en ce compris les principes légalité et de non-discrimination. Une deuxième réserve émise par la Cour est liée à L'IMMUNITE PARLEMENTAIRE dont peuvent bénéficier les membres des partis politiques concernés. La Cour estime, en effet, qu'une opinion ou un vote émis dans l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut donner lieu à l'application de la procédure prévue par l'article 15ter de la loi du 04 juillet 1989, et ce, en raison de l'immunité parlementaire garantie par l'article 58 de la Constitution. Cette réserve n'est pas déraisonnable, de prime abord. Néanmoins, il eût été possible de défendre une conception différente de l'irresponsabilité du parlementaire consacrée par l'article 58 de la Constitution, et de considérer que ce dernier ne peut être personnellement rendu responsable de ses opinions et votes. Ceux-ci peuvent néanmoins avoir des effets en droit, dès lors qu'ils concernent des tiers (en l'occurrence sa formation politique). Il aurait alors été possible de garantir le nécessaire respect de l'article 58 de la Constitution tout en permettant que des sanctions soient prises à l'égard des partis liberticides, et ce, même pour des propos tenus dans une enceinte parlementaire. Enfin, la Cour émet une troisième réserve. Elle estime que le parti QUI A CLAIREMENT ET PUBLIQUEMENT DESAVOUE le membre qui aurait manifesté son hostilité à l'égard des principes démocratiques ne peut être sanctionné. On peut regretter sa frilosité. En effet, il est fréquent que, pour la forme, une formation politique liberticide se désolidarise des propos inqualifiables tenus par l'un de ses membres, mais ne prenne aucune sanction à son égard et, pire, continue à lui faire confiance et bénéficie, lors des élections suivantes, des suffrages qu'il peut recueillir. L'exonération de responsabilité ainsi consacrée n'aurait de sens que dans l'hypothèse où le parti concerné ne se contenterait pas de désavouer le membre en cause, mais le sanctionnerait, par une exclusion ou à tout le moins par une interdiction de figurer à l'avenir sur ses listes électorales. Force est de constater que la Cour constitutionnelle, généralement plus pragmatique, prive ainsi l'article 15ter d'un part de son effet utile. (p.32 - leçon 1)
(12) CE 217/199, du 12 janvier 2012 - Hazette et consorts
L'article 32 du règlement du Parlement de la Communauté française établit que l'exercice d'un mandat politique électif est incompatible avec la qualité d'agent du Parlement et que "l'acceptation d'un tel mandat entraîne la démission d'office à la date d'installation dans les fonctions". Cette nouvelle disposition, adoptée en décembre 2011, a pour effet d'empêcher des agents du Parlement de se présenter aux élections communales ou provinciales d'octobre 2012 s'ils entendent conserver leur emploi. Ils saisissent le Conseil d'État d'une demande en suspension d'extrême urgence, lequel fait droit à leur requête. Il relève que "l'éligibilité est un droit fondamental dans une société démocratique", que "si le régime d'incompatibilités attaqué n'a pas pour objet les conditions d'exercice d'un mandat politique, il a cependant pour conséquence qu'il n'est pas possible d'exercer, en même temps qu'un mandat politique électif, les fonctions qu'il vise, sous peine de démission d'office, ce qui peut dissuader les titulaires de ces fonctions de postuler un mandat politique puisque l'exercice de ce mandat entrainerait la perte de leur emploi". Il en conclu "qu'il résulte des articles 8, alinéa 12, et 162, alinéa 1er, de la Constitution qu'il appartient au législateur seul de régler les conditions nécessaires pour exercer les droits politiques, et, partant, les incompatibilités qui empêchent l'exercice d'un mandat électif communal, notamment". Dans cette affaire, la partie adverse conteste l'extrême urgence. Elle relève que la procédure est engagée en janvier et que les élections se tiennent au mois d'octobre suivant. Une requête en suspension simple permettrait, à sons sens, aux requérants d'obtenir un arrêt avant les élections. Le Conseil d'État, avec pragmatisme écarte cet argument : "considérant qu'il ressort notamment des pièces annexées au recours que si les élections communales auront lieu en octobre 2012, le processus de constitution des listes est d'ores et déjà en cours au sein de chaque parti ; que la préparation sereine d'élections démocratiques ne s'accommode pas de pis-aller, tel qu'en l'espèce, l'incertitude que créé le règlement attaqué dans le chef des requérants quant à la possibilité de pouvoir non seulement se porter candidats auxdites élections mais aussi garantir aux électeurs qui leur auront fait confiance et à leur colistiers, l'exercice effectif du mandat pour lequel ils se seront engagés ; que même si les listes ne sont officiellement arrêtées que quelques semaines avant la tenue du scrutin et que la question de l'incompatibilité entre la fonction d'agent et le mandat électif ne se posera que si ils sont effectivement élus, les requérants soutiennent légitimement que dans les faits, par égard pour les électeurs et les partis, c'est en réalité maintenant que le choix s'impose ; que l'imminence de ce choix justifie qu'ils aient eu recours à la procédure d'extrême urgence". (p.360 - leçon 12)
(13) Cour d'appel d'Anvers, du 30 janvier 1992 - Transnuklear, enquêtes parlementaires + CE 86.728, du 07 avril 2000 - enquêtes parlementaires
L'essentiel du travail des commissions d'enquête consiste dans L'AUDITION D'EXPERTS ET DES TÉMOINS. Ceci peut, cependant, être à l'origine de réelles difficultés lorsqu'il y a interaction entre une enquête parlementaire et une enquête judiciaire en cours ou à venir. Ainsi, dans une affaire Transnuklear, la Cour d'appel d'Anvers décide de prononcer la nullité des poursuites à charge de deux prévenus condamnés en première instance par le Tribunal correctionnel de Turnhout à 5 ans de prison. La Cour a constaté que les déclarations faites par les intéressés dans le cadre de leur audition sous serment par une commission parlementaire ont été utilisées lors de la procédure en première instance. Elle relève qu'ils n'ont pas été en mesure d'organiser leur défense comme ils l'entendaient puisqu'ils ont du faire sous serment des déclarations compromettantes pour eux-mêmes. Elle y voit une violation flagrante des droits de la défense et de l'article 14, §3, g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que NUL NE PEUT ÊTRE TENU DE TÉMOIGNER CONTRE SOI-MÊME. La Cour de cassation, dans un arrêt du 06 mai 1993, rejette le pourvoi dirigé par le ministère public contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers. Le législateur a tiré les enseignements de cet arrêt et a posé le principe selon lequel : "tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner". Ces garanties permettent normalement à l'enquête parlementaire et à la procédure judiciaire de se compléter harmonieusement. Les personnes entendues par la commission d'enquête le sont à titre de témoins et si une infraction est relevée, un procès-verbal est dressé et communiqué aux autorités judiciaires compétentes. La procédure judiciaire peut alors commencer, avec comme corollaire la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense. La commission parlementaire, dont les pouvoirs sont quasi illimités lorsqu'il s'agit de procéder aux investigations, ne peut, en aucun cas, se substituer, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, aux organes du pouvoir judiciaire dans la mise en oeuvre des poursuites. Le procès-verbal qui est dressé par ses soins doit avoir pour seule conséquence de permettre au parquet d'entamer des poursuites. La commission doit veiller en l'établissant à ne rien y faire figurer qui entre en contradiction avec le principe du respect du droit de la défense. Les mêmes principes doivent l'animer lorsqu'elle rédige son rapport. Un souci identique doit la guider lorsqu'il peut exister une interaction entre une procédure disciplinaire et une enquête parlementaire. La commission ne peut, comme l'a fait la commission sur les disparitions d'enfants, se substituer à l'autorité disciplinaire. Elle doit limiter son action à établir des faits. En imputant personnellement des fautes à des témoins entendus au cours de ses travaux, elle prend le risque de compromettre la validité d'une sanction disciplinaire prononcée ultérieurement. Cette question a été traitée dans l'affaire Michaux, du nom du gendarme à qui il était reproché, dans le cadre de l'affaire Dutroux, de ne pas avoir découvert, lors d'une perquisition, la cache dans laquelle étaient séquestrées deux enfants. À cette occasion, le Conseil d'État indique "que la seule question que pose le moyen elle celle de savoir si la médiatisation des travaux de la commission d'enquête parlementaire est le rapport établi par cette commission ont entamé l'impartialité de l'autorité disciplinaire ou on peut donner l'apparence de l'entamer". En l'espèce, le Conseil d'État a répondu par la négative à la question parce que "les faits reprochés au requérant ont fait l'objet d'une enquête minutieuse et autonome au sein de la gendarmerie et que ce sont le contenu et les conclusions de cette enquête là qui ont servi de fondement à la proposition de sanction". Il souligne également que le ministre lui-même a dénoncé la médiatisation à outrance de cette affaire, s'il en est qu'il était capable de se dégager de cette influence. La commission par contre, est parfaitement LIBRE D'INCRIMINER LES MINISTRES parce que, dans ce cas, il n'est pas question d'engager à leur égard une éventuelle procédure disciplinaire et que l'enquête parlementaire est précisément UN MOYEN permettant de METTRE EN OEUVRE LEUR RESPONSABILITE POLITIQUE. (p.415 - leçon 13)
(29) CC 124/2010, du 28 octobre 2010 - inspection scolaire
L'exercice extraterritorial des compétences communautaires était également au cœur du débat relatif à L'INSPECTION DES ECOLES FRANCOPHONES SITUEES DANS LES COMMUNES A STATUT LINGUISTIQUE SPECIAL DE LA PERIPHERIE BRUXELLOISE. Avant la communautarisation de l'enseignement, les ministres de l'Éducation nationale francophone et flamand avaient conclu un protocole d'accord aux termes duquel les services d'inspection francophones contrôleraient ces écoles francophones situées en région de langue néerlandaise. Une loi spéciale du 21 juillet 1971 a maintenu les "mesures d'exécution pratiques en matière d'enseignement" en vigueur au moment de la communautarisation de l'enseignement au profit des habitants des communes à facilités et a prévu que celles-ci ne peuvent être modifiées que du commun accord des Communautés. En vertu de ces principes, les services de la Communauté française ont continué à assumer la mission d'inspection à l'égard de ces écoles. Par son décret du 23 octobre 2009, la Communauté flamande a remis en cause cette formule et a investi ses services de la mission d'inspecter ces écoles. D'une part, la Cour constitutionnelle affirme clairement que le principe du standstill consacré par l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 impose que la garantie d'une inspection de ces écoles par les services de la Communauté française soit préservée. D'autre part, elle réaffirme clairement que la Communauté flamande est la seule compétente pour "fixer les objectifs de développement et les objectif finaux, les prescriptions en matière d'encadrement des élèves" et pour "approuver les programmes d'études pour l'enseignement dans la région de langue néerlandaise, à laquelle appartiennent également les écoles précitées". S'il est possible d'apporter des dérogations à ces règles, eu égard à la spécificité de ces écoles et à la circonstance que nombre des élèves qui les fréquentent poursuivent leur scolarité dans des écoles de la Communauté française, seule la Communauté flamande, dans le respect de la loyauté fédérale, est habilitée à les accorder. Autrement dit, elle admet que les services d'inspection de la Communauté française exercent des compétences de manière extraterritoriale, mais au seul motif qu'il s'agit d'une garantie accordée antérieures à la réforme de l'État et délibérément maintenue par les auteurs de celle-ci. Cette garantie est d'ailleurs limitée puisque les inspecteurs doivent transmettre leurs rapports et une traduction de ceux-ci à l'administration flamande. Pour le reste, la Communauté française n'a aucune vocation à exercer ses compétences à l'égard d'écoles situées en dehors de son territoire. Cet arrêt, tout en préservant les garanties existantes au bénéfice des francophone, réaffirme donc le CARACTERE EXCLUSIF des compétences territoriales et L'ETANCHEITE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE en ce qu'il concerne les régions linguistiques unilingues. La Cour ne remet en cause ce principe que quand, par nature, une compétence ne se prête pas à un exercice strictement territorial. A propos d'un décret de la Communauté française qui fixe le cadastre des fréquences qui peuvent être attribuées à des opérateurs sur la bande FM, elle affirme qu'il résulte "de la nature même de la matière de la radiodiffusion qu'une réglementation dans ce domaine peut avoir des effets extraterritoriaux". Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle présente dans le domaine des compétences territoriales un CARACTERE EMINEMMENT SUBJECTIF. En matière de protection de la jeunesse, elle a considéré, par exemple, que sont admissibles, à titre de critère de rattachement, "la résidence familiale du mineur", ou à défaut "le lieu où il est éduqué ou entretenu". En revanche, "le lieu où il se trouve" paraît trop indéterminé et ne peut être retenu qu'à titre "très subsidiaire". (p.952 - leçon 29)
(17) CE 82.791, du 08 octobre 1999 - Ceder
L'exécutif fédéral tire son pouvoir réglementaire d'exécution de l'article 108 de la Constitution. Celui-ci dispose que "le Roi fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution". En vertu des lois de réformes institutionnelles, les mêmes principes s'appliquent, mutatis mutandis, aux gouvernements régionaux et communautaires. La Cour de cassation en trace ainsi les contours : "si le pouvoir exécutif, dans l'accomplissement de la mission que lui confère l'article 108 de la Constitution ne peut étendre pas plus qu'il ne peut restreindre la portée de la loi, il lui appartient de dégager du principe de celle-ci et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit". Les règles figurant dans un arrêté d'exécution doivent donc se trouver AU MOINS EN GERME dans la norme législative, étant entendu que l'exécutif ne peut étendre la portée de la loi, combler ses lacunes ou la modifier. Les juridictions disposent d'une marge d'interprétation assez large pour déterminer si le germe figurant dans la norme législative est suffisant pour fonder l'exercice du pouvoir réglementaire de l'organe exécutif. En septembre 1999, le gouvernement entend réaliser une vaste opération de régularisation des sans-papiers établis sur le territoire belge. Il fixe une procédure par arrêté royal. Celui-ci est présenté comme une mesure d'exécution de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 qui autorise le Roi à délivrer un permis de séjour à des étrangers établis sur le territoire national lorsqu'ils peuvent se prévaloir de circonstances exceptionnelles. L'arrêté litigieux détermine ces circonstances exceptionnelles, mais, ce faisant, à la suite d'une maladresse de plume, peut être interprété de manière telle que les étrangers concernés serai dispensés de faire valoir des circonstances exceptionnelles s'ils entrent dans un des cas visés par cet acte réglementaire. Saisie d'une demande en suspension introduite par des représentants du Vlaams Blok, une chambre flamande du Conseil d'État, dans son arrêt Ceder, suspend l'arrêté au motif qu'il n'exécute pas l'article 9 précité, mais qu'il en modifie la portée. Le gouvernement est dès lors contraint de renoncer à l'adoption d'un arrêté d'exécution et fait voter une loi pour donner un fondement à l'opération de régularisation des sans-papiers. (p.520 - leçon 17)
(22) Cour Suprême du Canada, du 20 août 1998 - renvoi relatif à la sécession du Québec
L'unité de l'Etat fédéral implique qu'en règle, la sécession d'une composante n'est pas constitutionnellement prévue. Or, il arrive (tel est le cas, par exemple, en Catalogne, au Québec, voire en Flandre) qu'il existe au sein d'un Etat fédéral des revendications indépendantistes. La Cour suprême du Canada a fixé, dans une décision du 20 août 1998 dénommée "renvoi relatif à la sécession du Québec", des principes clairs en la matière. Elle précise, tout d'abord, que "nos institutions démocratique permettent nécessairement un processus continu de discussion et d'évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l'initiative de modifications constitutionnelles. Ce droit emporte l'obligation réciproque des autres participants d'engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l'ordre constitutionnel. Un vote qui aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l'obligation de reconnaître". Ensuite, elle indique que "le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à l'autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions d'un projet de sécession. Le vote démocratique, quelle que soit l'ampleur de la majorité, n'aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme et de la primauté du droit, les droits de la personnes et des minorités, non plus que le fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l'ensemble du Canada. Les droits démocratiques fondés sur la Constitution ne peuvent être dissociés des obligations constitutionnelles". Mais elle ajoute que "la proposition inverse n'est pas acceptable non plus : l'ordre constitutionnel canadien existant ne pourrait pas demeurer indifférent devant l'expression claire, par une majorité claire de Québécois, de leur volonté de ne plus faire partie du Canada. Les autres provinces et le gouvernement fédéral n'auraient aucune raison valable de nier au gouvernement du Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la populaire du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette poursuite, le Québec respecterait les droits des autres. Les négociations qui suivraient un tel vote porteraient sur l'acte potentiel de sécession et sur ses conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée". Elle en conclut qu'il "n'y aurait aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit. Les négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement fédéral, du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à l'intérieur et à l'extérieur du Québec, et plus particulièrement des droits des minorités". et que "le processus de négociation exigerait la conciliation de divers droits et obligations par voie de négociation entre deux majorités légitimes, soit la majorité de la population du Québec et celle de l'ensemble du Canada. Une majorité politique, à l'un ou l'autre niveau, qui n'agirait pas en accord avec les principes sous-jacents de la Constitution mettrait en péril la légitimité de l'exercice de ses droits et ultimement l'acceptation du résultat par la communauté internationale". Autrement dit, dans un régime démocratique fédéral, lorsqu'il existe une volonté sécessionniste claire d'une composante fédérée, il faut aménager le droit constitutionnel afin qu'elle puisse s'exprimer, tout en veillant en toutes circonstances à garantir la protection des minorités. (p.717 - leçon 22)
(17) CC 97/2011, du 31 mai 2011 - CREG + CC 117/2013, du 07 août 2013 - CREG
LES ORGANES EXÉCUTIFS DE L'AUTORITÉ FÉDÉRALE, DES RÉGIONS ET DES COMMUNAUTÉS NE DISPOSENT PAS DU MONOPOLE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE. Celui-ci appartient également à d'autres autorités, comme les assemblées législatives, les provinces, les communes, les commissions communautaires agissant dans le cadre de leurs compétences des pouvoirs organisateurs, certains organismes d'intérêt public ou les ordres professionnels. Un pouvoir réglementaire appartient également à des AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES, tels les régulateurs régionaux en matière d'énergie. Ceux-ci interviennent notamment, en vertu d'une directive européenne, dans la fixation des tarifs en matière de distribution d'électricité sans qu'aucun organe exécutif, fédéral ou régional, puisse interférer dans l'exercice de leurs missions. Avant que cette matière soit transférée aux Régions, la Cour constitutionnelle n'a pas hésité à annuler une loi qui validait des arrêtés royaux fixant des tarifs de distribution s'écartant de la proposition de l'organe de régulation (en l'occurrence la CREG) alors qu'en vertu de la deuxième directive électricité, il appartenait à celui-ci de les établir, sans que le pouvoir exécutif puisse réformer ses décisions. La Cour constitutionnelle relève que la "confirmation législative d'un arrêté royal contraire au droit de l'Union européenne ne couvre pas l'irrégularité de cette réglementation". Cet arrêt laisse perplexe. En effet, la Cour considère qu'une loi ne peut méconnaître les termes d'une directive européenne. Envisagée de la sorte, cette interprétation ne souffre aucune critique. Cependant, cette directive a pour effet de priver le pouvoir exécutif fédéral de la faculté d'exercer sa compétence réglementaire, et partant entre en contradiction avec les articles 37 et 108 de la Constitution. La Cour semble donc adopter une position inverse à celle qui a été la sienne dans des arrêts rendus entre 1991 et 1994, et faire ici primer le droit européen dérivé sur la Constitution. Dans un arrêt de 2013, elle connaît d'un recours introduit par la CREG contre la loi de transposition de la troisième directive électricité. Celle ci entend faire respecter les prérogatives qu'elle tire du droit européen et fait grief au législateur d'autoriser certaines interventions du ministre, du Parlement ou des gestionnaires de réseau dans l'exercice de ses pouvoirs. La Cour se contente de vérifier la validité de la loi par rapport à la directive européenne sans plus même je s'interroger de façon explicite sur la question de savoir si la fonction exécutive peut être exercée par une autorité administrative indépendante. (p.516 - leçon 17)
(26) CC 35/2003, du 25 mars 2003 - COCOM, accords du Lombard
La COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE dispose d'organes propres qui sont issus d'un dédoublement fonctionnel des organes régionaux, adapté à ses spécificités. Son organe législatif, L'ASSEMBLÉE RÉUNIE, adopte, en principe, toutes ses résolutions à la MAJORITÉ ABSOLUE DE SES MEMBRES, et à la MAJORITÉ DE CHAQUE GROUPE LINGUISTIQUE. Cette formule peut provoquer une paralysie des institutions de la Commission communautaire commune. Telle est la raison pour laquelle les accords du Lombard ont consacré un NOUVEAU MODE DE DÉLIBÉRATION de cette assemblée. Il est prévu, en effet, que si une résolution n'est pas votée à la majorité absolue des membres de l'assemblée et la majorité de chaque groupe linguistique, UN DEUXIÈME VOTE EST ORGANISÉ. La résolution est adoptée à LA MAJORITÉ DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE ET POUR AUTANT QU'UN TIERS DES MEMBRES DE CHAQUE GROUPE LINGUISTIQUE SE SOIT PRONONCÉ EN SA FAVEUR. S'il s'agit du vote d'une ordonnance, ce vote doit intervenir au plus tôt un mois après le premier vote. Cette disposition a été critiquée devant la Cour constitutionnelle au motif qu'une distorsion est ainsi établie entre les partenaires de la Belgique fédérale. Plus particulièrement, il est reproché au législateur spécial d'avoir privé la minorité flamande d'une mesure de protection, sans que corrélativement une mesure analogue n'ait été adoptée à l'égard des francophones dans l'organisation l'Etat fédéral. La Cour écarte cet argument. Elle indique, en effet, que "l'organisation des institutions bruxelloises présente un certain parallélisme avec l'organisation des institutions fédérales en ce qui concerne la protection du groupe linguistique le moins nombreux, mais on ne saurait déduire des articles 10 et 11 de la Constitution que le législateur devrait nécessairement organiser les institutions bruxelloises de la même manière que celle qui est prévue, pour les instituions fédérales, à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution". Elle considère de surcroît que ce système de vote ne joue qu'à titre subsidiaire et qu'il peut se déduire des travaux préparatoires qu'il tend "à créer un équilibre entre l'exigence d'une protection suffisante du groupe linguistique le moins nombreux et la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'assemblée concernée". (p.861 - leçon 26)
(28) CC 145/2004, du 15 septembre 2004 - conventions collectives de travail
La Cour Constitutionnelle a affirmé que le gouvernement flamand n'avait pas vocation à donner force obligatoire aux CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL dans les matières qui relèvent de la Région et de la Communauté flamande. Cette matière concerne, en effet, le droit du travail, lequel relève de la compétence énumérée de l'autorité fédérale telle qu'elle ressort de la répartition des compétences dans le domaine de l'économie. La Cour indique que rien, ni dans la loi spéciale, "ni dans ses travaux préparatoires, n'indique que le législateur spécial ait dissocié le régime juridique des conventions collectives en fonction de l'objet traité par celles-ci, alors qu'une même convention collective peut contenir des dispositions qui portent sur plusieurs objets et qui sont liées dans l'intention des négociateurs, voire dans la logique de cette convention. Un telle dissociation aurait pu compromettre la cohérence du droit conventionnel du travail et perturber les équilibres voulus par la concertation sociale, dès lors que le législateur spécial ne prévoyait pas de mécanisme permettant de prévenir ce risque". Autrement dit, elle affirme la prédominance de l'exception à la compétence régionale de l'économie sur l'ensemble des compétences matérielles de la Région et de la Communauté. (p.927 - leçon 28)
(28) CC 25/40, du 26 juin 1986 - accès à la profession + CC 36/87, du 10 juin 1987 - accès à la profession
La Cour Constitutionnelle donne généralement une interprétation restrictive des matières expressément réservées à l'autorité fédérale, comprises dans un bloc de compétences attribué, en principe, à une Communauté ou à une Région. On a cru pouvoir en déduire que, dans la logique commandée par une telle interprétation restrictive, elle refuserait de FAIRE UNE APPLICATION DANS UNE POLITIQUE DONNÉE D'UNE EXCEPTION À LA COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ OU DE LA RÉGION, CONSACRÉE EXPRESSÉMENT À PROPOS D'UNE AUTRE POLITIQUE. Cette affirmation trouve son fondement dans un arrêt par lequel elle avait refusé de faire application à propos du décret flamand portant statut des entreprises d'hébergement, de l'article 6, §1, VI, dernier alinéa, 6°, ancien de la loi spéciale du 08 aout 1980 qui réservait à l'autorité fédérale, dans le cadre de la politique économique, le soin exclusif de fixer les conditions d'accès à la profession. En d'autres termes, elle avait estimé que le droit pour l'autorité fédérale de régler l'accès à la profession n'existait que dans le cadre de la politique de l'économie, et l'on avait cru pouvoir en déduire qu'en dehors de cette politique, les Communautés et les Régions étaient habilitées à régler cette matière. Or la Cour est bien vite revenue sur cette affirmation. En effet, elle indique que la Communauté flamande est incompétence pour régler les conditions d'accès à la profession des agents de voyage. Elle pose ainsi le principe selon lequel les réserves de compétences au profit de l'autorité fédérale revêtent un CARACTERE TRANSVERSAL. (p.925 - leçon 28)
(28) CC 35/2003, du 25 mars 2003 - 162C
La Cour constitutionnelle a été saisie d'un recours en annulation contre les dispositions de la loi spéciale régionalisant la matière des pouvoirs subordonnés. Il lui appartenant de trancher entre deux thèses contradictoires. La première, se fondant notamment sur l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, appuyée par une partie de la doctrine, reposait sur l'idée selon laquelle, à plusieurs reprises, le constituant et le préconstituant avaient indiqué qu'une révision constitutionnelle était requise pour régionaliser la matière. Ceci ressortait notamment du fait que l'article 162 avait déjà été modifié pour conférer des compétences aux Régions notamment dans le domaine des intercommunales et du fait que, consciemment, le préconstituant avait refusé d'inclure l'article 162 dans les dispositions soumises à révision. Les tenants d'une deuxième thèse soutenaient que l'article 39 de la Constitution conférant au législateur spécial un pouvoir souverain pour définir les compétences régionales pour autant qu'il n'empiète pas sur les compétences des Communautés. Il en résultait, à leur sens, qu'il y avait plusieurs manières de régionaliser la matière : une révision constitutionnelle en était une, la modification de l'article 19, §1 de la loi spéciale du 08 août 1980, une autre. La Cour constitutionnelle a résolument opté pour cette seconde option. Elle s'est, en effet exprimée ainsi : "le contenu de l'article 162, alinéa 1er, de la Constitution (...) est demeuré inchangé depuis 1831 (...). L'utilisation des termes 'par la loi' (...) dans cette disposition ne permet pas de déduire que le Constituant ait voulu ainsi réserver une matière au législateur fédéral puisque ce n'est que par la modification constitutionnelle du 24 décembre 1970 qu'il a procédé à la création des Communautés et des Régions (...). En utilisant les termes 'par la loi', le Constituant a uniquement voulu exclure cette matière de la compétence du pouvoir exécutif, de sorte que le législateur spécial peut confier aux Régions la compétence de régler cette matière à condition que cette attribution soit expresse et précise". Elle ajoute qu'une "modification de la portée de l'article 162, alinéa 1er, ne peut être déduite de ce que l'alinéa 3, inséré ultérieurement, permet que la réglementation de l'organisation et de l'exercice de la tutelle administrative soit confiée, en exécution d'une loi adoptée à la majorité spéciale, aux Conseils de communauté ou de région et de ce que l'alinéa 4 permet de manière identique de régler, par décret ou par la règle visée à l'article 134 de la Constitution, les conditions et le mode suivant lequel plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer". Enfin, elle indique que "les dispositions précitées n'empêchent donc pas que, par application de l'article 39 de la Constitution, le législateur spécial rende les régions compétentes pour régler, par décret ou par ordonnance, la composition, l'élection, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, dans le respect des principes contenus dans les articles 41 et 162 de la Constitution". La lecture de l'arrêt n°35/2003 fait apparaitre que pour la Cour constitutionnelle, la DATE DE BASCULEMENT POUR CE QUI CONCERNE LES MATIÈRES RÉSERVÉES EST BIEN 1970, et non 1980. Judicieusement, Hendrick Vuye, Charline Desmecht et Katrin Stangherlin Relèvent que le mot "loi" utilisé avant 1970 exclut l'intervention du d'un organe exécutif, mais non d'un Parlement régional ou communautaire, que son utilisation après 1980 impose l'intervention du législateur fédéral, et ce, par application tant de la Constitution que de l'article 19, §1 de la loi spéciale du 08 aout 1980, et que son utilisation entre 1970 et 1980 crée une matière réservée au bénéfice du législateur fédéral, mais en vertu de la seule Constitution. De là à considérer que l'article 19, §1 est devenu une disposition dépourvue d'utilité, il n'y a qu'un pas qu'il est aisé à franchir. Cette disposition peut d'ailleurs être encore à l'origine d'effets pervers. Tel est le cas lorsque le législateur spécial confie à une entité fédérée une compétence visée par une disposition constitutionnelle adoptée après 1970 et dans laquelle un pouvoir est confié à la loi. Dans ce cas, cette entité fédérée sera gênée, sinon paralysée, par ce résidu de compétence dévolu à l'autorité fédérale et ne pourra, en principe, intervenir dans le champ constitutionnellement réservé au législateur fédéral. Il ne lui reste d'autre possibilité pour exercer pleinement sa compétence que d'invoquer le bénéfice des pouvoirs implicites. (p.922 - leçon 28)
(19) CC 63/2002, du 28 mars 2002 - vice présidents de tribunaux
La Cour constitutionnelle considère d'ailleurs que la DÉSIGNATION D'UN VICE-PRÉSIDENT DE TRIBUNAL, soit d'un mandat adjoint, ÉCHAPPE À TOUS CONTRÔLE JURIDICTIONNEL puisque les titulaires d'une telle fonction doivent "être considérés comme des collaborateurs étroits d'un chef de corps qu'ils assistent dans l'accomplissement de sa mission", ce qui implique que, "dans sa présentation, le chef de corps ne tiendra pas uniquement compte des capacités de personnes concernées mais aussi des éléments tels que les possibilités de collaboration et l'opinion du magistrat concerné au sujet des problèmes auxquels est confrontée la juridiction". (p.601 - leçon 19)
(28) CC 40/87, du 15 octobre 1987 - pouvoirs impliqués, politique de sécurité + CC 41/87, du 15 octobre 1987 - pouvoirs impliqués, politique de sécurité + CC 49/88, du 10 mars 1988 - pouvoirs impliqués, politique de sécurité
La Cour constitutionnelle crée des ZONES DE COMPETENCES PARTAGEES entre l'autorité fédérale, d'une part, et les Communautés ou les Régions, d'autre part, alors qu'elles ne sont pas prévues dans les règles relatives à la répartition des compétences. Paul Martens, ancien président de la Cour constitutionnelle, explique que cette jurisprudence se fonde sur le principe selon lequel le constituant et le législateur spécial ont attribué aux Communautés et aux Régions "toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées". Il en résulte que des compétences qui, sur le papier, ne leur appartient pas sont IMPLIQUEES par les compétences qui sont les leurs. La Cour constitutionnelle reconnait aux Communautés et aux Régions la compétence d'édicter des normes relatives à la PROTECTION CONTRE L'INCENDIE dans les STRUCTURES DESTINÉES AUX PERSONNES ÂGÉES et dans les IMMEUBLES DESTINÉS AU LOGEMENT alors que la sécurité relève, en principe, de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale. Dès 1987, elle souligne que "la politique en matière de sécurité dans les structures destinées aux personnes âgées, et plus particulièrement la protection contre l'incendie, n'est pas demeurée une matière purement nationale". Elle fixe, cependant, les limites de cette compétence en précisant que si l'autorité fédérale "est compétente pour édicter des normes de base, à savoir des normes qui sont communes à une catégorie de construction sans que soit prise en compte leur destination, les communautés sont compétentes pour régler les aspects de sécurité qui sont spécifiques aux établissements destinés aux personnes âgées, c'est-à-dire pour adapter et compléter les normes nationales de base, sans mettre celles-ci en péril". Elle développe une argumentation identique pour fonder la compétence des Régions, sur la base de leurs compétences en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et de logement, "pour régler les aspects de la protection contre l'incendie qui sont spécifiques aux immeubles destinés en ordre principal à l'habitation". De façon purement prétorienne, la Cour constitutionnelle opère donc, dans une matière (la sécurité) relevant en principe de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale, une distinction entre les "normes fédérales de base" et les "normes spécifiques aux matières qui relèvent des compétences des Communautés ou des Régions". Ce faisant, elle admet qu'il existe dans le domaine de la sécurité, COMPETENCE RESIDUELLE de l'autorité fédérale, une ZONE DE COMPETENCE CONCURRENTE. La REGLE DE CONFLIT permettant de distinguer les attributions respectives de l'autorité fédérale et des entités fédérées réside dans la distinction entre les normes de base et les normes spécifiques qui ne mettent pas en péril les normes de base. (p.913 - leçon 28)
(18) CC 56/93, du 08 juillet 1993 - maintien des effets des arrêts préjudiciels, statut ouvrier-employé + CC 125/2011, du 07 juillet 2011 - maintien des effets des arrêts préjudiciels, statut ouvrier-employé
La Cour constitutionnelle s'autorise à MAINTENIR LES EFFETS D'UNE NORME dont elle a constaté l'inconstitutionnalité à l'occasion d'un arrêt rendu au CONTENTIEUX PRÉJUDICIEL. Cette question a été posée dans le cadre du contentieux relatif aux statuts respectifs des ouvriers et des employés. Ceux-ci diffèrent sur de nombreux plans, et notamment en ce qui concerne la durée du préavis. Les employés bénéficient à cet égard dans un régime nettement plus favorable. Interrogée un titre préjudiciel, en 1993, la Cour avait relevé qu'en "fondant la distinction entre les ouvriers et employés sur la nature principalement manuelle ou intellectuelle de leur travail, le législateur a établi une différence de traitement en fonction d'un critère qu'il pourrait difficilement justifier de manière objective et raisonnable qu'elle fut instaurée aujourd'hui". Constatant que cette différence de traitement existait depuis le début du 20ème siècle et que le législateur a entrepris progressivement de rapprocher ces statuts, "préférant une harmonisation progressive de ceux-ci à une brusque suppression de la distinction de ces catégories professionnelles, spécialement dans une matière où les normes peuvent évoluer grâce à une négociation collective", elle avait admis que "le processus d'effacement de l'inégalité dénoncée, entamée depuis des décennies ne pouvait être que progressif". Comme cet objectif de rapprochement des statuts ne pouvait être atteint que par étapes successives, elle avait refusé alors de voir dans cette situation une violation de la Constitution. Saisie 20 ans plus tard de la même question, elle constate que la distinction entre le travail manuel et intellectuel, retenue notamment pour établir la durée d'un préavis, déjà dénoncé en 1993, revêt un caractère discriminatoire. Elle s'empresse, cependant, d'examiner les conséquences de ce constat opéré à titre préjudiciel. Elle indique qu'un "arrêt préjudiciel, tout en ne faisant pas disparaître la disposition inconstitutionnelle de l'ordre juridique, a un effet qui dépasse le seul litige pendant devant le juge qui a posé la question préjudicielle" et que notamment il s'étend "à d'autres affaires, lorsque, à la suite d'un tel arrêt de la Cour, les juridictions sont dispensées de l'obligation de poser une question préjudicielle ayant le même objet". En l'espèce, "le constat, non modulé, d'inconstitutionnalité entrainerait dans de nombreuses affaires pendantes et future une insécurité juridique considérable et pourrait engendrer des difficultés financières graves pour un grand nombre d'employeurs". La cour maintient donc les effets de la norme déclarée inconstitutionnelle jusqu'à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions et au plus tard jusqu'au 8 juillet 2013, soit pendant 2 ans. L'originalité de cet arrêt réside dans le fait que le législateur spécial n'avait pas autorisé la Cour à moduler les effets de ses arrêts rendus au contentieux préjudiciel. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour estime que les principes de SECURITE JURIDIQUE et de CONFIANCE LEGITIME justifient qu'elle déroge ainsi, de manière prétorienne, au caractère déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel. Elle doit, en effet, vérifier que "l'avantage tiré de l'effet du constat d'inconstitutionnalité non modulé n'est pas disproportionné par rapport à la perturbation qu'il impliquerait pour l'ordre juridique". Le législateur spécial a tiré les conséquences de cet arrêt. Désormais, l'article 28, alinéa 2, de la loi spéciale du 06 janvier 1989 prévoit que "si la Cour l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions ayant fait l'objet d'un constat d'inconstitutionnalité qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine". (p.590 - leçon 18)
(28) CC 8/2011, du 27 janvier 2011 - juridiction administrative flamande
La Cour constitutionnelle valide, sur la base de l'article 10 de la loi, la création par le législateur flamand d'un Conseil pour les contestations d'autorisation, soit d'une juridiction administrative, intervenant dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, dont les décisions font l'objet d'un recours en cassation administrative devant le Conseil d'État. Il s'agit donc en réalité d'une juridiction administrative de premier degré. Ce faisant, le législateur flamand règle des matières que la Constitution réserve à la loi, à savoir la compétence du Conseil d'État (article 160) et la création de juridictions administratives (article 161). La Cour, tout d'abord, constate que la création de cette juridiction était nécessaire à l'exercice des compétences régionales : "il ressort des travaux préparatoires précités que le législateur décrétale a jugé nécessaire de créer une juridiction administrative, d'une part, afin de remplacer le recours devant le Gouvernement flamand par une procédure de recours devant une instance impartiale et indépendante qui dispose de l'expertise suffisante pour pouvoir juger si des décisions relatives à des autorisations sont conformes au bon aménagement du territoire et, d'autre part, afin de pouvoir garantir un examen rapide de ce recours. Il n'apparait pas que cette appréciation soit erronée". Ensuite, elle indique que la "matière de la procédure de recours contre une décision administrative par laquelle un permis est délivré ou refusé, une attestation as-built est délivrée ou refusée ou une construction est inscrite ou non dans le registre des permis se prête à un régime différencié, étant donné qu'il existe aussi, au niveau fédéral, des exceptions à la compétence générale du Conseil d'Etat et que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat statue sur les recours en annulation des actes et règlements mentionnés à l'article 14, §1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour autant seulement qu'il ne soit pas prévu de recours auprès d'une autre juridiction administrative". Enfin, elle considère que la condition de l'impact marginal est remplie parce que le Conseil d'Etat connaît, dans le cadre du contentieux de la cassation administrative, des recours formés contre les décisions de cette juridiction administrative. Il s'en déduit que le décret attaqué ne limite "pas exagérément les compétences du Conseil d'Etat, de sorte que le législateur décrétale n'a empiété que marginalement sur la compétence réservée en l'espèce au législateur fédéral". (p.930 - leçon 28)
(20) CC 36.2011, du 10 mars 2011 - mesure d'ordre à l'égard d'un auditeur
La Cour constitutionnelle, dans la droit ligne de sa jurisprudence relative aux fonctions parlementaires, a, par la suite, détecté d'autres inconstitutionnalité ou lacunes législatives. Ensuite, elle est amenée à se prononcer sur la décision de l'auditeur général du Conseil d'Etat de prendre à l'égard d'un auditeur une mesure d'ordre suspendant pour une année judiciaire sa possibilité de travailler à domicile. L'intéressé saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre ce qu'il considère comme une sanction disciplinaire déguisée. La haute juridiction administrative constate que lorsque l'article 14, §1 des lois coordonnées ouvre un recours au "personnel" du Conseil d'Etat, il ne vise pas les magistrats eux-mêmes, tels que les auditeurs, mais le personnel administratif. Elle estime donc ne pas être compétente pour connaître d'un recours en annulation d'une décision d'un organe du Conseil d'Etat qui impose à un magistrat une mesure d'ordre pouvant s'analyser comme une sanction disciplinaire déguisée. En conséquence, elle interroge la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de cette situation. La Cour constate que "l'absence de tout recours contre une décision d'un organe du Conseil d'Etat qui impose aux membres de l'auditorat une mesure d'ordre qui pourrait être une sanction disciplinaire déguisée n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution". S'inspirant de sa jurisprudence relative aux fonctionnaires parlementaires, elle affirme que cette discrimination ne réside pas dans l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, mais dans une lacune législative. À son estime, il appartient au législateur de déterminer quel type de recours doit être mis en œuvre en l'espèce, en tenant mon compte du fait que les membres de l'auditorat doivent pouvoir rédiger "leurs rapports et leurs avis en toute indépendance". (p.645 - leçon 20)
(5) Cass., du 20 avril 1950 - Waleffe
La Cour de cassation a affirmé que "le Pouvoir législatif souverain dans son domaine, apprécie seul la constitutionnalité des lois" et qu'il "n'appartient donc pas au pouvoir judiciaire de recherche si une loi est ou non conforme à la Constitution". Cette jurisprudence a, cependant, connu des dérives subtiles, et notamment lorsqu'il s'agissait de déterminer si un règlement était conforme à une Constitution. On peut mentionner un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 1950 rendu dans l'affaire Waleffe. Une loi de pouvoirs spéciaux habilite le Roi à "modifier ou compléter la législation relative aux rétributions, subventions, indemnités et allocations de toute nature qui sont à la charge de l'Etat". Sur cette base, un arrêté royal porte atteinte au régime de pension des magistrats émérites. L'un d'entre eux engage une action fondée sur l'article 152 de la Constitution qui réserve au seul législateur, et ce, à l'exclusion du Roi, le soin de régler la pension des magistrats. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, inaugure une jurisprudence fondée sur le postulat selon lequel le législateur ne veut rien qui soit contraire à la Constitution et qu'il ne peut autoriser une autorité à édicter un règlement qui soit contraire à celle-ci. En d'autres termes, SI UN REGLEMENT EST INCONSTITUTIONNEL, CE N'EST PAS PARCE QUE LA LOI QU'IL RESPECTE EN APPARENCE CONTREDIT LA CONSTITUTION, MAIS BIEN AU CONTRAIRE PARCE QU'IL MÉCONNAÎT CETTE LOI QUI, PAR HYPOTHESE, EST CONFORME A LA NORME SUPERIEUR. Il est alors possible d'écarter l'application du règlement réputé illégal, au nom d'une fiction juridique. Une telle démarche permet à la Cour de concilier deux objectifs, en apparence, contradictoires : respecter en apparence sa jurisprudence traditionnelle et contrôler en fait la constitutionnalité de la loi. En réinterprétant celle-ci et en sanctionnant l'illégalité d'un acte réglementaire, elle opère, en effet, un contrôle implicite de constitutionnalité qui a la particularité de garantir, en toutes circonstances, la conformité de la loi à la Constitution. (p.172 - leçon 5)
(4) Cass., du 09 novembre 2004 - primauté de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur la Constitution + Cass., du 16 novembre 2004 - primauté de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur la Constitution
La Cour de cassation, dans son arrêt du 09 novembre 2004, rendu dans l'affaire Vlaams Belang, affirme que la CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES PRIME LA CONSTITUTION. Elle motive, en effet, ainsi son refus de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle : "attendu que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prime la Constitution ; qu'en l'espèce, la Constitution ne soumet pas la restriction de l'exercice des libertés d'expression, de réunion et d'association à des conditions plus sévères que celles autorisées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient en premier lieu au juge d'interpréter et d'appliquer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". Dans un arrêt du 16 novembre 2004, elle précise que lorsqu'il s'indique de contrôler la conformité d'une disposition légale par rapport à la Constitution ainsi que par rapport à une disposition de droit international qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, le juge doit opérer par priorité le contrôle par rapport à la disposition de droit international. s'il apparaît que l'article de la Constitution en cause ne comprend pas d'exigences supplémentaires par rapport à la norme de droit international, il ne s'indique pas d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel quand bien même une partie en aurait fait la demande. Ce faisant, la Cour de cassation affirme la primauté du droit international sur la Constitution. Cependant, le législateur spécial a réagi à cette position en complétant et modifiant à 2 reprises, en 2009 et en 2014, l'article 26 de la loi spéciale du 06 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Il est désormais précisé que "lorsqu'est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, d'un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d'abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu'est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d'office, si le titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Ce principe connaît cependant certaines exceptions. (p.136 - leçon 4)
(12) Cass., du 04 novembre 1996 + conclusions Leclercq
La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 novembre 1996, rappelle que le pouvoir d'interpréter les normes législatives par voie d'autorité doit s'exercer avec la plus grande circonspection. Il s'indique, en particulier, de veiller à respecter les normes hiérarchiquement supérieures. Dans ses conclusions précédant cet arrêt, l'avocat général Jean-François Leclercq, a clairement fixé les principes applicables à la matière : "le pouvoir interpréter authentiquement un acte est un pouvoir d'une importance extrême dont l'usage peut se révéler particulièrement dangereux pour les administrés ; il est nécessaire que le pouvoir de donner une interprétation authentique aux normes ne puisse être utilisé qu'avec bonne foi et qu'il ne puisse pas ouvrir la voie, sous prétexte d'interprétation, à une véritable modification des normes interprétées (...). Je pense (...) qu'il convient en tout cas d'admettre que le juge ne s'estimera lié par une loi d'interprétation authentique que si le législateur fédéral a exercer ce pouvoir dans le respect des normes hiérarchiquement supérieures à la loi ; le législateur fédéral ne pourrait ainsi méconnaître les règles prescrites par ou en vertu de la Constitution ou encore porter atteinte aux droits fondamentaux des individus garantis par la Constitution ou par des Conventions internationales". Dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt du 4 novembre 1996, la Cour de cassation a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne afin d'apprécier si la loi qui établit une différence de traitement entre hommes et femmes quant à l'âge de la pension respectait une directive européenne. Il s'agit là d'une démarche heureuse car on ne pourrait suivre l'avocat général Jean-François Leclercq si son raisonnement devait aboutir à permettre à la Cour de cassation d'opérer directement un contrôle de la norme législative interprétative par rapport à des normes hiérarchiquement supérieures dans des hypothèses où elle ne dispose pas de cette faculté. Autrement dit, on ne peut admettre, par exemple, que la Cour de cassation écarte directement l'application d'une loi interprétative parce qu'elle serait contraire à une disposition constitutionnelle. Dans ce cas, deux hypothèses peuvent être envisagées. Soit la disposition constitutionnelle en cause est contrôlée par la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation doit interroger cette dernière à titre préjudiciel avant de prendre attitude à l'égard de la loi interprétative. Soit il s'agit d'une disposition constitutionnelle qui n'est pas contrôlée par la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation doit appliquer la loi interprétative. (p.379 - leçon 12)
(18) CC 65/86, du 15 juin 1986 - expropriations
La Cour n'hésite pas à affirmer sa compétence pour contrôler, sous l'angle de la répartition des compétences, LA VALIDITÉ DES LOIS ADOPTÉES AVANT L'AMORCE DU PROCESSUS DE RÉFORME DE L'ETAT dans la mesure où, à la suite des transferts de compétences, elles ont acquis FORCE DE DÉCRETS. Cette question s'est posée avec une acuité particulière à propos de l'interprétation qu'il convenait de donner à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans un arrêt du 20 février 1986, la Cour de cassation avait affirmé un pouvoir exclusif du Roi d'autoriser de telles expropriations. La Cour constitutionnelle, saisie à titre préjudiciel, affirme sa compétence pour connaître de la conformité d'une loi antérieure à la réforme de l'Etat à la loi spéciale du 08 aout 1980 et réinterprète, plutôt que sanctionne la loi de 1962, en affirmant que LES POUVOIRS ATTRIBUÉS AU ROI RELÈVENT EXCLUSIVEMENT DES GOUVERNEMENTS RÉGIONAUX ET COMMUNAUTAIRES DANS LES MATIÈRES TRANSFÉRÉES AUX ENTITÉS FÉDÉRÉES. N'étant pas habilitée à opérer un contrôle global de constitutionnalité, elle aurait normalement dû se déclarer incompétente au motif qu'elle n'avait pas, en l'espèce, à constater une violation des règles relatives à la répartition des compétences. Elle s'autorise, cependant, à donner une interprétation conciliante d'une norme adoptée avant l'amorce du processus de réforme de l'Etat. Il faut voir, dans le choix ainsi opéré, la volonté de la Cour (qui sera réaffirmée en d'autres occasions) DE S'ÉRIGER EN GARANTE DE L'ORDRE CONSTITUTIONNEL, quitte, pour ce faire, à INTERPRÉTER EXTENSIVEMENT SES PROPRES COMPÉTENCES. Elle offre ainsi au juge qui l'a interrogé une solution concrète à appliquer et qui aura autorité sur la position prise par ailleurs par la Cour de cassation. Cette jurisprudence ne doit cependant pas être exagérée. En effet, même si la Cour admet, dans le contentieux de la répartition des compétences, le principe du contrôle d'une norme antérieure à la réforme de l'État, ELLE APPRÉCIE LA CONFORMITÉ D'UNE NORME SOUMISE À SON CONTRÔLE AU REGARD DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN VIGUEUR AU MOMENT OÙ C'EST NORME A ÉTÉ ADOPTÉE. Autrement dit, elle annule une norme entachée d'excès de compétence, et cela, même si entre l'adoption de cette dernière et le moment où elle rend son arrêt, le législateur concerné s'est vu attribuer la compétence pour prendre la norme en cause. Dans la même logique, elle annule des dispositions qui ont déjà été abrogées ou qui, à la suite d'une modification de l'ordonnancement juridique, ont cessé d'être inconstitutionnelles. Dans ce cas, cependant, elle limite l'annulation à la période pendant laquelle ces normes revêtaient un caractère irrégulier. Une telle jurisprudence permet à un législateur d'anticiper certaines réformes. En effet, lorsqu'il sait qu'il va recevoir une compétence, il peut déjà adopter des normes dans une matière où il n'est pas encore compétent tout en sachant que la censure éventuelle de la Cour ne portera que sur la période au cours de laquelle il n'avait pas encore vocation à intervenir. (p.558 - leçon 18)
(28) CC 101/2008, du 10 juillet 2008 - Wooncode, pouvoirs impliqués
La Cour ne se limite pas, cependant, à créer des zones de compétences concurrentes dans le champ des compétences résiduelles de l'autorité fédérale et dans celui des compétences accessoires. Elle applique le même mode de raisonnement afin de permettre des immixtions dans le champ des compétences réservées de l'autorité fédérale, dans celui des compétences réservées des entités fédérées, et que cela soit au profit de l'autorité fédérale ou d'une entité fédérée. La Cour constitutionnelle admet QU'UNE RÉGION PUISSE EMPIÉTER SUR LES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES. Elle affirme, en effet, dans son arrêt relatif au Wooncode que "la circonstance qu'une norme décrétale, adoptée par le législateur régional dans l'exercice de ses compétences, peut avoir pour effet de contribuer à la réalisation d'un objectif par ailleurs poursuivi par le législateur communautaire dans l'exercice de ses compétences propres ne peut entrainer, à elle seule, une violation des règles répartitrices de compétence par le législateur régional. Il en irait toutefois autrement si, en adoptant une telle mesure, le législateur régional rendait impossible ou exagérément difficile l'exercice, par le législateur communautaire, de ses compétences". Ainsi, admet-elle que le législateur flamand exige des candidats locataires à un logement social qu'ils fassent la preuve de leur volonté d'apprendre le néerlandais. Outre le fait que cette exigence est de nature à faciliter les relations entre le bailleur et e locataire, elle pourra également avoir un effet positif sur les possibilités d'intégration sociale et professionnelle des personnes concernées, et par conséquent sur les objectifs poursuivis par la Communauté flamande en matière d'intégration des personnes immigrées. Ceci, affirme-t-elle "ne saurait faire obstacle à l'exercice, par la Région, de sa compétence en matière de logement". (p.915 - leçon 28)
(28) CC 110/99, du 14 octobre 1999 - décret Suykerbuyk + CC 33/2001, du 13 mars 2001 - compétences en matière de sécurité sociale, assurance soins
La Cour s'est prononcée, en 1999, sur le décret Suykerbuyk de sinistre mémoire par lequel la Communauté flamande entendait, au titre de l'aide sociale procurer une aide matérielle aux victimes de la guerre, sans qu'aucune distinction ne soit faite entre les résistants et les collaborateurs, "victimes" de la politique d'épuration consécutive à la Seconde Guerre mondiale. De multiples recours ont été introduits contre ce décret, se fondant non seulement sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, mais également sur la violation des règles de répartition de compétences. Dans de telles circonstances, la Cour examine toujours prioritairement la compétence de l'auteur de l'acte. La section de législation du Conseil d'Etat avait estimé que les Communautés "peuvent, en ce qui concerne l'aide aux personnes, soit mener une politique d'aide sociale 'catégorielle' mais alors exclusivement pour les familles, immigrés, handicapés, personnes âgées, jeune et détenus, mentionnés expressément dans la loi du 08 aout 1980, soit mener une politique d'aide 'générale', mais alors nécessairement pour tous les nécessiteux sans distinction, donc sans que l'on puisse tenir compte des causes spécifiques qui ont conduit à la situation de nécessité". La Cour constitutionnelle développe, au contraire, une CONCEPTION EXTENSIVE DES COMPETENCES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE D'AIDE SOCIALE. Elle affirme que "la politique dont il est question dans cette disposition vise spécifiquement à fournir une assistance aux personnes qui se trouvent dans le besoin" et que "la nature et l'origine du besoin ne jouent en principe aucun rôle pour cet aspect de l'aide aux personnes". Il s'en déduit que "l'aide que les Communautés peuvent prévoir en vertu de cette disposition n'est donc pas limitée aux diverses catégories de personnes mentionnées dans les autres subdivisions de l'article 5, §1, II, de la loi spéciale du 08 août 1980, ni à l'octroi d'une aide non différenciée". Dès lors, les Communautés peuvent accorder une aide indifférenciée à l'ensemble de la population, une aide aux catégories de personnes visées explicitement dans la loi spéciale et une aide à toute autre catégorie de personnes qui se trouvent dans le besoin. Cependant, et heureusement, elle annule le décret Suykerbuyk, au motif que la réglementation flamande "est à ce point liée à la répression et à l'épuration qu'elle doit être considérée comme faisant partie de la répression et de l'épuration en général, réglementation qui continue de relever de la compétence résiduelle de l'autorité fédérale". Cette arrêt jette les bases de la jurisprudence ultérieure de la Cour dans la définition des limites de l'aide sociale. Dans son arrêt relatif au décret du 30 mars 1999 portant organisation du service d'assurance soins, elle délimite clairement les compétences respectives de l'autorité fédérale et des Communautés dans ce domaine. Rappelons que ce décret vise à accorder une aide non-médicale 'l'aide médicale est prise en charge par la sécurité sociale) aux "personnes qui sont dans une capacité réduite d'autonomie dans un cadre résidentiel, semi-présidentiel ou ambulatoire". La Cour indique qu'en "réservant la matière de la sécurité sociale à l'autorité fédérale, le législateur spécial a entendu interdire que les Communautés et les Régions puissent s'immiscer dans la réglementaire établie par l'autorité fédérale". Toutefois, ajoute-t-elle, "en ce qu'il a attribué aux Communautés la compétence de prendre des mesures d'aide en faveur des catégories des personnes mentionnées en B.3.3, il a nécessairement admis que puissent bénéficier, par ailleurs, du système de sécurité sociale". En conséquence, estime-t-elle, ces "deux attributions de compétence doivent s'interpréter de la manière qui les rend compatibles" et on "ne peut en effet présumer que ne pourraient être aidées par les communautés que les personnes qui n'en ont pas besoin". Elle constate que "le législateur décrétale a par ailleurs exclu tout empiétement en prévoyant, à l'article 6, §2, du décret, que les prises en charge seront refusées si l'usager a le droit à la couverture des mêmes frais en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires". En conséquence, devraient "être considérées comme excédant la compétence d'une communauté les mesures par lesquelles elle prétendrait modifier une règle de sécurité sociale, la remplacer y déroger ou l'abroger". Mais "une communauté n'excède pas ses compétences si, dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en matière d'aide sociale, elle accorde à certains d'entre elles une aide particulière, distincte de celles qui sont accordées par le régime de sécurité sociale organisé par l'autorité fédérale, et sans toucher à une matière réservée à celle-ci". Cette arrêt confirme l'analyse livrée plus haut selon laquelle la sécurité sociale est une matière RESERVEE à l'autorité fédérale et, non comme d'aucuns l'ont soutenu, une compétence résiduelle de celle-ci. Les conséquences sur le plan de la répartition des compétences en découlent naturellement. Pour autant que la matière traitée par un législateur communautaire n'ait pas pour implication de "modifier une règle de sécurité sociale, la remplacer, y déroger ou l'abroger", elle relève de l'aide sociale, soit une politique communautaire qui, ainsi que la Cour l'avait déjà relevé dans son arrêt sur le décret Suykerbuyk, doit recevoir une interprétation extensive. Afin de déterminer quels sont les contours de la matière réservée à l'autorité fédérale, il faut se reporter, ainsi que cela a été indiqué plus haut, à l'état de la législation sur la sécurité sociale au moment où celle-ci a été érigée en borne des compétences fédérales, soit lors de l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 08 août 1980. Rien n'interdit, cependant, à des mêmes personnes, se trouvant par exemple dans une situation de dépendance, de bénéficier de certains services en application du régime de sécurité sociale et d'autres services trouvant leur fondement dans les compétences d'aide aux personnes des Communautés. La Cour, interprétant justement la frontière de compétences entre la sécurité sociale et l'aide aux personnes, indique implicitement et certainement qu'eu égard à la définition large des compétences en matière d'aide aux personnes, il n'y a pas d'espace entre cette matière et celle de la sécurité sociale pour une zone de compétence résiduelle de l'autorité fédérale. (p.909 - leçon 28)
(18) CC 8/90, du 07 février 1990 - lois spéciales
La Cour se déclare aussi compétente pour contrôler LA CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS SPÉCIALES. Ce contrôle peut être opéré tant par rapport aux dispositions constitutionnelles qui régissent les compétences de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés que par rapport aux autres dispositions constitutionnelles dont elle assure le contrôle. En adoptant cette position, elle s'est résolument affirmée en tant que juridiction constitutionnelle. En effet, elle s'érige EN JUGE DU PARTAGE DES COMPÉTENCES et NON SIMPLEMENT EN GARDIENNE DE CELUI-CI. Il peut difficilement être nié que la loi spéciale est, dans la hiérarchie des normes, située à un rang inférieur par rapport à la Constitution. En conséquence sur un plan strictement juridique, la solution dégagée dans l'arrêt du 07 février 1990 échappe à la critique. Toutefois, au regard de la problématique générale de la réforme des institutions, il n'est pas certain qu'il faille se féliciter d'une solution de voir la Cour constitutionnelle, à l'instar de la Cour de cassation, mettre fin, juridiquement, au MYTHE DU BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ. Alors qu'elle doit sa création à la nécessité absolue de faire respecter les règles relatives À la répartition des compétences et que, en 1988, l'extension de son pouvoir de contrôle à 3 articles nouveaux s'explique comme une mesure d'encadrement de la communautarisation de l'enseignement, LA COUR N'A PAS HÉSITÉ À CONTRÔLER DES NORMES DE CONTRÔLE, soit des normes qui intéressent L'ÉTAT GLOBAL. Elle estime donc que le principe de la hiérarchie des normes lui PERMET DE FAIRE PRÉVALOIR LE TEXTE CONSTITUTIONNEL SUR DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES À LA MAJORITÉ SPÉCIALE, et cela bien qu'il apparaisse que, dans la configuration actuelle du pouvoir constituant et du pouvoir législatif, il est plus difficile d'adopter une loi spéciale que de modifier une disposition constitutionnelle. Ce faisant, elle recourt à une interprétation rigide de la hiérarchie des normes et se reconnaît un POUVOIR D'INGÉRENCE DANS LE PROCESSUS NORMATIF COMPLEXE QUI PRÉSIDE À L'ÉLABORATION DES NORMES FONDATRICES DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT. En opérant une dissociation, juridiquement fondée, entre la Constitution et les lois spéciales qui la mettent en œuvre, elle établit une distinction dans un ensemble normatif qui fait l'objet d'une négociation politique globale et préalable au dépôt des textes devant les chambres, qu'elles soient constituantes ou législatives. Si l'existence d'une hiérarchie entre la Constitution et la loi spéciale repose sur un évident fondement juridique, elle n'a pas la même réalité dans le processus concret d'élaboration des normes, du moins pour tout ce qui concerne le processus de fédéralisation de l'Etat. (p.560 - leçon 18)
(4) CC 26/91, du 16 octobre 1991 - sur la primauté du droit international
La Cour, dans cette matière, développe une conception extensive de ses compétences, et plus particulièrement en ce qui concerne ses attributions dans le cadre du contentieux préjudiciel. Dans un arrêt du 16 octobre 1991, elle affirme tout d'abord que son contrôle implique l'examen du contenu des dispositions du Traité, sous réserve que "la Cour devra exercer son contrôle en tenant compte de ce qu'il s'agit non d'un acte de souveraineté unilatéral mais d'une norme conventionnelle produisant également des effets de droit en dehors de l'ordre juridique interne". De plus, elle estime qu'elle peut connaître de ces questions non seulement dans le délai réduit fixé par le législateur spécial (soit 60 jours) pour l'introduction d'un recours en annulation, mais également par la voie préjudicielle. Elle relève, en effet que "par elle-même une décision préjudicielle par laquelle elle constate une violation n'est pas applicable erga omnes, et ne fait pas disparaître de l'ordre juridique belge la règle de droit qui en fait l'objet". Autrement dit, la Cour s'autorise à constater l'invalidité d'un traité international qui est déjà directement applicable dans l'ordre juridique interne. Par cette jurisprudence, LA COUR CONSTITUTIONNELLE affirme implicitement la PRIMAUTE, dans l'ordre juridique interne, DE LA CONSTITUTION SUR LE DROIT INTERNATIONAL qui a des effets directs dans celui-ci. (p.138 - leçon 4)
(29) CC 184/2011, du 08 décembre 2011 - budgets bruxellois + CC 67/2012, du 24 mai 2012 - budgets bruxellois
La complexité de la mise en œuvre des compétences territoriales sur le territoire bruxellois s'est doublée de défaillances dans le chef des autorités effectivement compétentes. Ainsi, l'autorité fédérale avait tendance à délaisser complètement l'exercice de sa compétence dans les matières culturelles autres que les grandes institutions biculturelles. Tel était le cas, par exemple, en ce qui concerne les infrastructures sportives. De même, les deux grandes Communautés investissaient insuffisamment dans des secteurs comme l'enseignement ou l'accueil de la petite enfance. La Région de Bruxelles-Capitale a entendu pallier ces carences en inscrivant à son budget des moyens lui permettant d'intervenir dans des domaines où elle n'était a priori pas compétente, tels le financement d'infrastructures sportives, la formation professionnelle ou le tourisme. Elle a également programmé le financement de crèches et d'écoles par le biais de budgets complémentaires alloués aux communes. Cette démarche n'a suscité aucune protestation de la part des Communautés jusqu'à ce que des ASBL flamandes, suivies par le gouvernement flamand, introduisent des recours en annulation devant la Cour constitutionnelle en dénonçant des excès de compétence dans le chef de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans un premier arrêt, la Cour annule une partie du budget 2010 de la Région. Elle constate que celui-ci comprend des allocations budgétaires destinées aux communes afin de créer des places supplémentaires dans des crèches. Il s'agit de matières relevant de la politique familiale, soit une matière personnalisable. Elle estime que la Région de Bruxelles-Capitale ne peut intervenir dans le financement de cette politique communautaire au titre de sa compétence en matière de financement des missions à remplir par les communes. En effet, le "financement général des communes" concerne les "modes de financement généralement quelconques en vertu desquels les communes (...) sont financées, suivant les critères qui ne sont pas directement liés à une mission ou tâche spécifique". Or, précisément, à son estime, l'accueil de la petite enfance est une mission spécifique. Elle indique néanmoins que le législateur régional aurait pu atteindre cet objectif en finançant, en vertu de l'article 178 de la Constitution, la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande qui peuvent, quant à elles, intervenir dans le champ des compétences communautaires. Dans un second arrêt, la Cour annule une partie du budget 2011. Elle reproduit exactement le même raisonnement que dans son arrêt antérieur pour ce qui concerne les crèches et développe une argumentation identique pour annuler des crédits destinés à permettre aux communes de financer des infrastructures scolaires. Cette problématique a été évoquée dans l'accord institutionnel du 11 octobre 2011. Celui-ci consacre un certain nombre de principes nouveaux. Les auteurs de l'accord constatent que, mis à part "la gestion des institutions culturelles d'envergure nationale ou internationale (La Monnaie, Palais des Beaux-Arts, etc.), le niveau fédéral n'exerce pas sa compétence relative aux matières biculturelles à Bruxelles" et qu'il est donc opportun "de transférer la compétence relative aux matières biculturelles d'intérêt régional à la Région de Bruxelles-Capitale à l'exclusion des institutions culturelles fédérales". Pour ce qui concerne les matières personnalisables, et notamment la communautarisation des allocations familiales, il est décidé que dans la "mesure où les compétences impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou une allocation, ou lorsqu'il s'agit d'institution bicommunautaires, l'autorité compétente en Région de Bruxelles-Capitale sera la Commission communautaire commune". Enfin, il est décidé de permettre à la Région d'intervenir dans le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales et dans la formation professionnelle, matières demeurant communautaires, et de régionaliser le tourisme. (p.940 - leçon 29)
(29) Cass., du 11 juin 1979 - affaire Vandenplas
La délicate question des CONFLITS DE NORMES SANS EXCÈS DE COMPÉTENCE a été soulevée, pour la première fois, dans un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1979. La Cour est saisie d'un litige à l'occasion duquel elle est apparemment tenue D'APPLIQUER SIMULTANÉMENT les dispositions du décret de la Communauté culturelle néerlandaise du 19 juillet 1973 (mieux connu sous la dénomination de DÉCRET DE SEPTEMBRE) et l'article 52, §1, de LA LOI SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE. Le décret (qui impose l'usage du néerlandais dans les relations sociales) s'applique à toutes les entreprises dont tous les travailleurs occupés dans cette région. La loi sur l'emploi des langues en matière administrative ne retient, quant à elle, que le seul critère du siège de l'exploitation de l'entreprise. Dans l'espèce portée à la connaissance de la Cour de cassation, M. Vandenplas était représentant de commerce et l'essentiel de son activité se déroulant dans la région de langue néerlandaise. La société qui l'employait (établie dans la région liégeoise) lui avait envoyé une lettre de licenciement en français. La loi sur l'emploi des langues en matière administrative était donc respectée, mais les disposition du décret de septembre étaient méconnues. La Cour de cassation constate la contradiction et affirme que celle-ci ne résulte pas d'un excès de compétence. La loi et le décret, écrit l'avocat général Lenaerts, "ont chacun un champ d'application bien précis et aucun des deux n'a empiété sur le domaine de l'autre. Le conflit est dû au seul fait que le champ d'application du décret, contrairement à celui de la loi n'a pas été exclusivement déterminé par le siège de l'exploitation de l'entreprise. Mais, en retenant également le lieu de travail comme critère pour définir le champ d'application, le Conseil culturel n'a pas outrepassé les limites de sa compétence". Cette jurisprudence de la Cour de cassation a placé dans l'embarras le législateur appelé à fixer les attributions de la Cour constitutionnelle. Fallait-il admettre l'existence de conflit de normes sans excès de compétence ? Si cette existence est reconnue, fallait-il autoriser la Cour à connaître de pareilles contradictions ? Fallait-il, enfin, dans l'affirmative, lui conférer un pouvoir d'annulation ? Le législateur OPTE POUR UNE VOIE MÉDIANE. La Cour constitutionnelle, précise-t-il tout d'abord, ne peut annuler d'autres normes que celles qui sont entachées d'excès de compétence. Toutefois, lorsqu'elle doit simplement répondre à une question préjudicielle, elle peut non seulement statuer sur des excès de compétences, mais également sur tout conflit entre décrets communautaires ou entre décrets régionaux émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif. En d'autres termes, il admet l'existence de conflit de normes émanant de législateurs de même nature. La Cour ne peut annuler l'un de ces normes, mais doit indiquer à la juridiction qui l'a saisie la manière de trancher le contradiction. La règle selon laquelle le conflit de normes sans excès de compétences ne peut exister qu'entre normes émanant de législateurs de même nature n'échappe pas à la critique. En effet, le conflit de référence en la matière concernait des normes émanant de législateurs de nature différente, à savoir le législateur fédéral, d'une part, le législateur communautaire, d'autre part. Par ailleurs, compte tenu de l'atypisme qui caractérise aujourd'hui notre système institutionnel, des législateurs de nature différente exercent des compétences de nature identique. Ainsi, en vertu de l'article 138 de la Constitution, les législateurs de la Région wallonne et de la Commission communautaire française exercent des compétences communautaires. De même, en application de l'article 139 de la Constitution, le législateur de la Communauté germanophone est appelé à exercer certaines compétences régionales. (p.944 - leçon 29)
(21) Cass., du 16 décembre 1965 - droit politique
La jurisprudence de la Cour de cassation relative à la responsabilité des autorités publiques, s'est développée dans un sens toujours plus extensif. Dans un arrêt du 16 décembre 1965, la Cour admet expressément le principe de la compétence des cours et tribunaux pour connaître de l'action en responsabilité sur LA LÉSION FAUTIVE PAR L'AUTORITÉ D'UN DROIT POLITIQUE. Un agent la Société nationale du logement a été licencié à la suite d'une réorganisation du service. Le statut des agents de l'État prévoit en cas de suppression d'un emploi, le licenciement de l'agent de grade égal ayant le moins d'ancienneté et son inscription en première place de la réserve de recrutement. Au mépris du statut, la Société recrute un agent licencié comme le demandeur, mais d'une ancienneté moins importante que la sienne. Il y a donc violation par l'autorité publique d'un droit de priorité, droit politique au sens de l'article 145 de la Constitution. La compétence des cours et tribunaux pour connaître de la demande en réparation de la lésion de ce droit est contestée car l'annulation de la décision illégale n'a pas été demandée au Conseil d'État. À cet argument, la Cour répond qu'une "contestation qui a pour objet la réparation pécuniaire d'un droit, fut-il politique, relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux ; que ni l'appréciation de la faute ni celle du préjudice causé par celle ci n'échappent à la compétence du pouvoir judiciaire au cas ou la lésion du droit venté pourrait trouver sa source dans l'excès de pouvoir d'une autorité administrative et donner lieu à l'annulation de l'acte accompli par cette autorité si une requête à cette fin était introduite devant le Conseil d'État". Cette décision démontre que c'est LA NATURE DU DROIT QUE L'ON INVOQUE DEVANT LES TRIBUNAUX QUI DETERMINE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. L'action en réparation du préjudice causé fautivement à un droit politique est, en réalité, de nature civile, parce qu'elle se fonde sur les articles 1382 et suivants du Code civil, aux termes desquels il y a lieu à réparation lorsqu'il y a un faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Il s'ensuite que, à l'estime de la Cour, le législateur ne peut pas investir une juridiction administrative du pouvoir de trancher les contestations qui ont pour objet la réparation pécuniaire d'un droit politique. Cette jurisprudence est aujourd'hui dépassée à la suite de la révision de l'article 144 de la Constitution et à l'adoption de l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. (p.687 - leçon 21)
(7 + 8) CC 73/2003, du 26 mai 2003 - seuil d'éligibilité
La loi du 13 décembre 2002 a également consacré pour les élections législatives fédérales l'introduction dans le droit constitutionnel belge du SEUIL D'ELIGIBILITE. Pour qu'une liste puisse bénéficier d'un élu, elle doit avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Cette mesure a été critiquée devant la Cour constitutionnelle. Celle-ci dans son arrêt n°73/2003 a relevé que "pour satisfaire aux exigences de l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les élections peuvent être organisées aussi bien selon le système de la représentation proportionnelle que selon un système majoritaire. Même si les élections ont lieu suivant un système de représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le phénomène des 'voix perdues'. De même que l'article 3 n'implique pas que la dévolution des sièges doive être le reflet exact du nombre des suffrages, il ne fait pas obstacle en principe à ce qu'un seuil électoral soit instauré en vue de limiter la fragmentation de l'organe représentatif". Elle ajoute qu'en vertu "des articles 62 et 68 de la Constitution, les élections de la Chambre des représentants et du Sénat se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine. Ces dispositions empêchent certes de procéder à des élections selon un système majoritaire, mais elles n'interdisent pas au législateur d'apporter au système de la représentation proportionnelle des limitations raisonnables en vue d'assurer le fonctionnement des institutions démocratiques". Enfin, elle rappelle que "l'instauration d'un seuil électoral ne peut pas être considérée en faisant abstraction d'une autre modification, déjà mentionnée, de la législation électorale. En étendant les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants de manière à les faire coïncider en principe avec les provinces, le législateur a pris une mesure qui facilite l'obtention d'un siège par les partis plus petits". En conséquence, elle estime que l'introduction du seuil d'éligibilité ne méconnaît pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour avait, par contre, successivement suspendu et annulé les règles spécifiques applicables aux circonscriptions du Brabant wallon, de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain qui constituaient le complément indissociable de dispositions jugées inconstitutionnelles par ailleurs. En effet, le seuil de 5% était calculé pour les listes néerlandophones en additionnant les voix exprimées dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde à celles exprimées dans celle de Louvain. La démarche de la Cour était logique dès lors qu'elle avait entendu rétablir sur le territoire de l'ancienne province de Brabant la législation électorale telle qu'elle s'appliquait avant la réforme de décembre 2002. Il n'en demeurait pas moins que l'intervention de la Cour constitutionnelle était à l'origine d'une différence de traitement puisque le seuil électoral s'appliquait dans tout le Royaume, à l'exclusion du territoire de l'ancienne province de Brabant. Un requérant y a vu une nouvelle discrimination, les petits partis étant mieux traités sur le territoire de l'ancienne province de Brabant qu'ils ne le sont dans le reste du pays. Avant les élections du 18 mai 2003, il a saisi la Cour constitutionnelle d'une nouvelle demande en suspension dans laquelle il s'est plaint de cette situation. La Cour a sèchement rejeté ce recours dans son arrêt n°48/2003 du 10 avril 2003. Elle a estimé, en effet, que "les griefs du requérant visent en apparence une disposition de la loi attaquée mais portent, en réalité, sur certains effets de l'arrêt n°30/2003 du 26 février 2003. Ils tendent ainsi à demander à la Cour de revenir sur les effets d'un arrêt statuant sur une demande de suspension, dans l'attente de l'arrêt qui sera prononcé sur le recours en annulation dans la même affaire. La loi spéciale du 06 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne prévoit pas une telle possibilité". Depuis l'adoption de la loi du 19 juillet 2012, cette question ne se pose plus, le seuil de 5% étant d'application dans les 11 circonscriptions pour les élections de la Chambre des représentants. (p.222 - leçon 7) + (voir p.241 - leçon 8)
(1) Commission européenne des droits de l'homme, du 20 juillet 1957 - KPD
La loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne est exemplaire à cet égard. En son article 21.2, elle établie que "les partis qui, d'après leurs buts ou d'après l'attitude de leurs adhérents cherchent à porter atteinte à l'ordre fondamental libre et démocratique, à le renverser ou à compromettre l'existence de la République fédérale d'Allemagne sont anticonstitutionnels. Le tribunal constitutionnel fédéral statue sur la question de l'anticonstitutionnalité". En application de cette disposition, le Tribunal constitutionnel fédéral a interdit, en 1953, le Parti socialiste du Reich (SRP), un parti d'extrême droite et, en 1956, le Parti communiste allemand (KPD). Saisie de cette dernière affaire, la Commission européenne des droits de l'homme affirme que lorsque le régime prôné par un parti est incompatible avec la Convention et vise à la destruction de certains droits fondamentaux qu'elle consacre, son interdiction se justifie au regard de L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION, selon lequel "aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples que ces droits et libertés que celle prévues à ladite Convention". Ainsi, la Commission indique que "compte tenu du lien très clair entre la Convention et la démocratie, nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir les idéaux et valeurs d'une société démocratique". En conséquence, elle estime que les liens qu'entretenait le KPD avec son parti frère d'Allemagne de l'Est et le fait qu'il prônait la "dictature du prolétariat", soit une philosophie contraire aux valeurs de la Convention, justifiaient son interdiction. (p.28 - leçon 1)
(17) Cass., du 21 avril 2011 - Gérardrie Immo c. Ville de Liège, hiérarchie des normes
La loi spéciale du 08 août 1980 attribut le pouvoir réglementaire aux gouvernements des entités fédérées, mais, contrairement à la Constitution, les autorise à déléguer leur pouvoir à leurs membres. Il en résulte que cette délégation doit être décidée par les organes exécutifs eux-mêmes et que les décrets ou les ordonnances qui attribuent directement des compétences à un ministre sont donc contraires à la loi spéciale. Ce principe est affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 avril 2011 dans l'affaire Gérardrie Immo c. Ville de Liège. A cette occasion, elle pose le principe selon lequel "il ressort des articles 68 et 69 de la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles qu'il n'appartient pas au législateur décrétal d'attribuer directement une délégation de compétence du gouvernement à l'un de ses membres". Le droit positif ne garantit, cependant, pas le respect de l'interdiction faite au législateur de confier directement des pouvoirs à un ministre. En effet, cette interdiction trouve son fondement dans l'article 33 de la Constitution (lequel figue dans son Titre III) et dans une disposition de la loi spéciale du 08 août 1980 qui n'opère pas une répartition des compétences entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés. Il s'en déduit que la Cour constitutionnelle, sous réserve d'une définition extensive de ses compétences, ce qui est toujours imaginable, n'a pas vocation à annuler une norme législative qui conférerait directement un pouvoir à un ministre. Il n'est dérogé à ce principe que pour les ordonnances de la Région de Bruxelles capitale et de la Commission communautaire commune. Les juridictions peuvent en écarter l'application si elles méconnaissent la Constitution ou la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Par conséquent, une juridiction pourrait refuser d'appliquer un règlement pris par un membre du gouvernement bruxellois qui se serait vu confier directement ce pouvoir par le législateur régional. L'arrêt précité de la Cour de cassation du 21 avril 2011 s'inscrit, cependant, à contre courant de cette manière d'appréhender la question. En effet, la Cour de cassation affirme que "en vertu du principe général du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes, dont l'article 159 de la Constitution constitue une expression particulière, les cours et tribunaux sont tenus d'écarter l'application des articles 471 à 474 du code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en tant qu'ils confient, en violation des articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence en la matière de revitalisation urbaine au ministre de la Région wallonne qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions". Elle s'autorise donc à écarter l'application d'une norme législative ordinaire parce que contraire à une loi spéciale. A l'instar de la Cour constitutionnelle, elle fait une application stricte du principe de la hiérarchie des normes, n'ayant aucun égard au mythe du bloc de constitutionnalité. (p.524 - leçon 17)
(30) CC 17/94, du 03 mars 1994 - établissement
La pratique institutionnelle, depuis 1988-1990, a relevé que de nombreux accords facultatifs ont été conclus (sans création simultanée de juridictions de coopération) et ont touché des domaines particulièrement variés. Tel est par exemple le cas de l'accord conclu, en novembre 1990, entre la Région wallonne et la Communauté française permettant l'exercice commun de certaines compétences, et surtout le financement de celles-ci (à savoir des compétences communautaires pour l'essentiel) par la Région wallonne. On peut se demander si cet accord de coopération qui créait un ETABLISSEMENT COMMUN AUX DEUX ENTITES n'impliquait pas en réalité un TRANSFERT DE COMPETENCE qui ne peut être organisé dans notre système institutionnel que par ou en vertu de la Constitution. La Cour constitutionnelle en a, cependant, décidé autrement. Elle a considéré que le système de financement des communes et des C.P.A.S. montre combien ces deux institutions sont solidaires : il a été conçu pour permettre aux premières de faire face à leurs responsabilités à l'égard des seconds. Elle a relevé que les moyens attribués aux Régions doivent leur permettre de disposer des ressources nécessaires pour assurer le financement des mussions relevant des instituions communales, en ce compris celles relevant des C.P.A.S. Une telle situation a pu justifier, aux yeux de la Cour, que bien que la matière relève des Communautés, la Communauté française accepte d'associer la Région wallonne à la tutelle sur les C.P.A.S. puisque cette tutelle s'exerce sur des actes qui ont une influence sur les finances des communes, soit une matière relevant des compétences régionales. Vu l'interdépendance de ces matières, elle a estimé que l'accord en cause était conforme aux exigences de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980. Autrement dit, c'est en raison de l'imbrication des compétences qu'il n'y aurait pas eu ici abandon de compétence dans le chef de la Communauté. La section législation du Conseil d'État, examinant les accords en amont pas le biais des projets de normes d'assentiment, critique régulièrement la matière originale par laquelle les partenaires articulent l'exercice de leurs compétences respectives. Cette attitude méticuleuse offre un contraste frappant avec l'approche plus pragmatique de la Cour constitutionnelle qui, agissant en aval, une fois la procédure de coopération bien en place, fait montre de tolérance face aux arrangement interfédéraux. (p.974 - leçon 30)
(4) Avis SLCE - Statut de Rome
La section de législation du Conseil d'Etat a relevé que le projet de loi portant assentiment au STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE, fait à Rome le 17 juillet 1998, entrait en contradiction avec nombre de dispositions constitutionnelles, et plus particulièrement les articles 88, 58, 59 et 103 de la Constitution qui consacrent l'inviolabilité du Roi, la protection absolue des parlementaires pour leurs opinions et votes, la protection relative dont bénéficient les parlementaires en cas de poursuites pénales et le régime spécifique de responsabilité pénale des ministres. Elle observe, en effet, que "le Statut de Rome de la Cour pénale internationale auquel la loi en projet entend procurer assentiment contient un ensemble de dispositions qui ne se concilient pas avec les prescriptions de la Constitution", qu'il "ne revient ni aux auteurs du Statut, ni à ceux de la loi d'assentiment de procéder à une révision, fût-elle implicite, de la Constitution et de modifier de la sorte le statut des pouvoirs publics que cette dernière établit" et que si "la Belgique entend ratifier un tel traité et si le pouvoir législatif entend l'approuver, il convient que des modifications soient apportées, selon la procédure inscrite à l'article 195 de la Constitution, à plusieurs dispositions constitutionnelles". Cependant, à l'inverse de ce qui s'est produit pour le Traité de Maastricht, la loi d'assentiment du 25 mai 2000 a été adoptée sans que par la suite la Constitution ne soit modifiée. La Belgique a donc consciemment adoptée une convention internationale qui méconnaît plusieurs dispositions de sa Constitution. (p.133 - leçon 4)
(29) CC 9/86, du 30 janvier 1986 - emploi des langues dans les relations sociales + CC 10/86, du 30 janvier 1986 - emploi des langues dans les relations sociales
Le 30 janvier 1986, la Cour rend deux arrêts de principe à l'occasion de recours introduits respectivement contre le décret de septembre et un décret de la Communauté française qui avait le même objet, mais qui ajoutait en outre un critère de rattachement visant les entreprises occupant ou employant des travailleurs d'expression française. Dans ces arrêts, la Cour se démarque nettement de la position que le législateur avait reconnue en 1983. En effet, elle affirme, d'emblée, le principe selon lequel les dispositions constitutionnelles relatives à l'emploi des langues opèrent une répartition exclusive de compétences territoriales, ce qui a pour conséquence que "toute norme adoptée par un législateur communautaire puisse être localisée dans le territoire de sa compétence". Elle ajoute, ensuite, que cette localisation implique que "toute relations ou situations concrètes soient réglées par un seul législateur". Enfin, elle précise que (dans le respect des règles constitutionnelles) chaque législateur est libre de choisir les critères qui permettent de rattacher les normes qu'il édicte à son aire de compétence. Toutefois, ce choix est soumis à un contrôle de constitutionnalité, effectué par la Cour. Celle-ci, en effet, doit veiller à ce qu'aucun législateur n'excède ses compétences matérielles ou territoriales. La validité de ces critères doit être appréciée au regard de la nature de l'objet et éventuellement du bute de la compétence matérielle, sur base de laquelle la norme incriminée a été prise. En application de ces principes, elle annule le décret de la Communauté française en ce qu'il tendait à s'appliquer "aux entreprises occupant ou employant des travailleurs d'expression française", ce critère ne permettant pas de localiser les relations sociales entre travailleurs et employeurs. Elle annule, en outre, dans le décret de la Communauté flamande, et ultérieurement dans le décret de la Communauté française, les dispositions qui faisaient appel au critère de l'occupation du travailleur dans une région linguistique. Elle estime que ce facteur de rattachement ne situe dans l'aire de compétence de la Communauté qu'une "seule des parties aux relations sociales à savoir le personnel, et non comme le prévoit la Constitution, les relations sociales entre employeurs et leur personnel". En conséquence, le seul facteur de rattachement qui a grâce à ses yeux est celui du SIÈGE D'EXPLOITATION. C'est, en effet, en cet endroit "qu'on eu lieu en principe les relations sociales entre les deux parties" et que "les missions et les instructions sont données aux membres du personnel, que lui sont faites les communications et qu'il s'adresse à son employeur". Cette jurisprudence appelle un certain nombre de commentaires. Tout d'abord, la Cour n'a pas eu égard à l'argument de la Communauté française selon lequel une Communauté est compétente "pour un ensemble de personnes qui parlent la même langue et non pour un territoire déterminé". A son estime, les normes adoptées par les diverses entités doivent pouvoir être LOCALISÉES sur le territoire qui constitue leur aire de compétence. Elle affirme donc nettement l'existence d'un TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE. Ensuite, en posant nettement le caractère exclusif des compétences territoriales des Communautés et des Régions, elle écarte toute forme de situation mixte. Le choix discrétionnaire par chaque législateur des facteurs de rattachement ne peut déboucher sur des normes également valides, mais dont la mise en œuvre s'avère contradictoire. Il ne peut être question, dans son esprit, contrairement à la position défendue par la Cour de cassation et par le législateur, de régler de telles situations mixtes par application d'un droit interrégional privé. En effet, à ses yeux, TOUTE CONTRADICTION EXISTANT ENTRE DES NORMES ADOPTÉES PAR DES LÉGISLATEURS DIFFÉRENTS IMPLIQUE FORCÉMENT QUE L'UN D'ENTRE EUX A EXCÉDÉ SES COMPÉTENCES. Enfin, il est permis de s'interroger sur la nature de la liberté que la Cour reconnaît aux différents législateurs dans le choix des facteurs de rattachement à leur aire de compétence. Cette liberté, en effet, risque de s'avérer illusoire. Il suffit, pour s'en rendre compte, de se reporter aux décrets relatifs à l'emploi des langues dans les relations sociales. En choisissant le critère de l'occupation, les législateurs décrétaux ont interprété largement le concept de relations sociales. Ce dernier, à leur sens, comprenait non seulement les relations impliquant a présence physique du travailleur et de son employeur, mais également l'ensemble de la relation de travail, en ce compris les prestations professionnelles du travailleur. Dans cet esprit, le critère de l'occupation paraissait pertinent. Il permet une localisation territoriale de la compétence, au sens exigé par la Cour, et il participait pleinement de l'objet, de la nature et du but de la compétence matérielle en cause. Si, en l'espèce, le siège d'exploitation a été retenu comme seul facteur de rattachement valide, c'est, semble-t-il, parce que cette solution, à l'inverse de toutes les autres, offrait une solution pratique, conforme au principe selon lequel tout conflit de normes traduit un excès de compétence. Néanmoins, on n'aperçoit pas comment, en prenant les décrets litigieux, les législateurs décrétaux auraient pu anticiper la décision de la Cour et choisir le facteur de rattachement adéquat. Cette jurisprudence est donc de nature à limiter l'autonomie des entités fédérées. En effet, les normes qui règlent une même matière dans les aires de compétences distinctes devront faire appel à des facteurs de rattachement compatibles. De plus, l'utilisation de plusieurs de ces facteurs dans une seule norme (du moins s'ils sont alternatifs) paraît de nature à augmenter le risque de conflits avec les normes adoptées par d'autres législateurs. Les législateurs sont, dès lors, invités par la Cour à faire preuve de prudence dans le choix des facteurs de rattachement et à éviter spontanément les situations mixtes. Pour réaliser cet objectif, plusieurs techniques sont concevables. Tout d'abord, ils peuvent se concerter avant de choisir leurs facteurs de rattachement à leur aire de compétence respective. Ils peuvent également conclure des accords de coopération afin de fixer les règles de conflits permettant de rendre conciliables leurs facteurs de rattachement respectifs. En l'absence d'une telle concertation, le législateur qui intervient en second ou en troisième lieur n'a d'autre choix que de calquer ses facteurs de rattachement sur ceux qui ont été retenus par les législateurs qui ont déjà préalablement réglé la même matière. Enfin, ils peuvent simplement s'abstenir de fixer le moindre facteur de rattachement législative pourrait être à l'origine d'un excès de compétence. En effet, dans pareille hypothèse, la Cour constitutionnelle affirme : "étant donné que le décret lui-même ne formule pas de critères de localisation, sa sphère d'application territoriale est régie par l'article 127, §2, de la Constitution lui-même et le décret ne saurait donc violer cette disposition constitutionnelle". Toute imprudence des législateurs risque donc d'être à l'origine de CONFLITS INCONSCIENTS. Dans une telle hypothèse, la Cour, afin de consacrer le principe de l'exclusivité des compétences territoriales, est contrainte de trancher des conflits dans lesquels l'excès de compétence peut ne pas être apparent. Elle peut donc être amenée à découvrir, coûte que coûte, des excès de compétences là où ils n'existent peut-être pas. Par conséquent, si, dans le domaine de compétences matérielles, la Cour constitutionnelle a remis en cause le mythe des compétences exclusives, elle est restée délibérément attachée à celui-ci dans celui des compétences spatiales. Or, l'exclusivité des compétences qui constituait, en apparence, une garantie d'autonomie pour les entités régionales et communautaires semble, in fine, s'analyser comme un facteur de paralysie tant des entités elles-mêmes que l'autorité fédérale. (p.946 - leçon 29)
(21) Cass., du 05 novembre 1920 - La Flandria
Le 5 novembre 1920 dans UN ARRÊT LA FLANDRIA, la Cour de cassation opère un revirement fondamental de jurisprudence. L'enjeu du litige est minime. Ses données illustre bien l'absurdité que pouvait parfois revêtir, en pratique, la distinction entre l'autorité agissant comme personne publique et l'autorité agissant comme personnes privée. Un arbre planté au bord d'une route appartenant à la ville de Bruges avait été mal entretenu et s'était abattu sur une exploitation horticole riveraine, causant de menus dégâts aux plantations. Les juges du fond fondent le droit de l'intéressé à obtenir réparation sur base du dommage causé sur l'article 1382 du Code civil, au motif que l'arbre se trouvait sur le DOMAINE PRIVÉ de la Ville et que, partant, la faute commise par celle-ci l'avait été en tant que personne privée. Suivant les conclusions du Procureur général, Paul Leclercq, la Cour de cassation rejette le pourvoi, mais développe une conception nouvelle de la responsabilité de l'Etat. Les cours et tribunaux, affirme-t-elle, sont compétents pour connaître d'un pareil litige : il y a lieu d'abandonner la distinction entre l'activité publique et privée de l'autorité et de considérer que l'article 144 de la Constitution attribue une compétence aux tribunaux judiciaires dès le moment où l'enjeu de la contestation est un DROIT CIVIL. Il en résulte que la "Constitution n'a égard ni à la qualité des parties, ni à la nature des actes qui aurait causé une lésion de droit mais uniquement à la nature du droit lésé". En l'occurrence, le droit lésé consiste dans le droit de propriété de l'horticulteur sur ses plantations. En conséquence, la connaissance du litige relatif à ce droit incombe constitutionnellement aux seuls tribunaux de leur ordre judiciaire. Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime utile de donner sa propre définition de la SÉPARATION DES POUVOIRS. Elle indique que la Constitution a consacré une "théorie de la 'séparation des pouvoirs' qui voit une condition de la liberté politique dans la répartition des fonctions publiques en trois groupes distincts et indépendant les uns des autres" et qu'en vertu "de cette règle de partage des attributions, il est interdit aux cours et tribunaux de faire des actes d'administration publique et de réformer ou d'annuler les actes des autorités administratives, comme il est interdit à l'administration de juger les contestations qui ont pour objet des droits civils". Elle relève, cependant, "que la même expression 'séparation des pouvoirs' sert aussi à désigner une règle très ancienne du droit public français, admise déjà au temps de l'absolutisme monarchique et qui a trouvé son expression dans l'édit de Saint-Germain du 06 février 1641 est plus tard dans les lois du 16 et 24 août 1790 (article 13 du titre II) et du 16 fructidor an III", et qu'au "vœu de cette règle il est interdit dit au corps judiciaire de juger les contestation où l'Etat et les autres personnes du droit public sont intéressées, la compétence judiciaire en matière civile étant réduite à la connaissance des litiges entre particuliers". Cette conception de la séparation des pouvoirs, "née d'un sentiment de méfiance et des défaveurs à l'égard des corps judiciaires, et qui permettait à l'administration de disposer souverainement et sans recours de la personne et des biens des citoyens, n'a pas été consacré dans la Constitution belge" et que "tout au contraire, le régime que celui-ci a organisé est inspiré d'un sentiment de méfiance à l'égard des pratiques administratives des régimes antérieurs et qu'il vise à mettre les droits privés à l'abris des atteintes de l'administration et sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire". Selon la Cour de cassation, dans le système constitutionnel belge, les "gouvernants ne peuvent rien que ce qui sont chargés de faire et sont, comme les gouvernés, soumis à la loi". Ils "sont limités dans leurs activités par les loi est notamment par celles qui organisent les droits civils" et "s'ils lèsent l'un de ses droits, le pouvoir judiciaire peut déclarer que leurs actes a été accompli sans pouvoir, qu'il est donc illégal et constitutif de fautes et accorder la réparation du préjudice ainsi causé". L'arrêt La Flandria inaugure une nouvelle conception de l'État de droit dans laquelle le juge constitue pour le citoyen un rempart efficace contre l'arbitraire du pouvoir. Le principe ainsi posé par la Cour de cassation sera décliné dans les décennies qui suivent afin de toujours renforcer cette protection du citoyen tant contre le pouvoir exécutif que contre le pouvoir législatif ou judiciaire lui même. (p.682 - leçon 21)
(2) CE 117.851, du 01 avril 2003 - Van Cauter, tribune électorale BUB
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours mis en oeuvre par le président du parti BUB (Belgische Unie - Union belge) contre la décision de la RTBF de ne pas accorder à son parti, pendant la campagne électorale, un temps d'antenne égal ou quasiment égal à celui consenti aux grands partis. Ce recours se fondait notamment sur le principe d'égal accès aux médias publics. Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord les principes fondateurs en matière d'égalité : "les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination N'EXCLUENT PAS QU'UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT SOIT ETABLIE ENTRE DES CATEGORIES DE PERSONNES, POUR AUTANT QU'ELLE REPOSE SUR UN CRITERE OBJECTIF ET QU'ELLE SOIT RAISONNABLEMENT JUSTIFIEE ; que l'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du BUT ET DES EFFETS DE LA MESURE CRITIQUEE AINSI QUE DE LA NATURE DES PRINCIPES EN CAUSE ; que le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de RAPPORT RAISONNABLE DE PROPORTIONNALITE ENTRE LES MOYENS EMPLOYES ET LE BUT VISE". Appliquant ce principe au cas d'espèce, il rejette le recours en relevant que "compte tenu de la rareté du temps d'antenne, des exigences de lisibilité des débats diffusés à la radio et à la télévision et de la pléthore de listes qui présentent des candidats à chaque élection, la partie adverse a légitimement pu établir des critères de différenciation fondés sur l'importance relative des différents partis candidats aux élections, et traiter de manière différente les partis qui avaient obtenu une représentation parlementaire lors des élections précédents et les autres parties". Il ajoute que "cette disposition repose sur un critère objectif ; qu'en raison du caractère généralement modeste des déplacements de voix observés d'une élection à l'autre, qui emporte comme conséquence qu'il est vraisemblable que les partis représentés au parlement continueront à attirer les voix d'un nombre important d'électeurs, et donc que les émissions électorales où ces partis sont présents soient plus suivies que celles où n'apparaîtraient que des représentants de partis non encore représentés, dont il est vraisemblable qu'ils attireront un nombre de voix plus modeste, et dont l'apparition dans les émissions électorales suscite un intérêt moindre, les mesures contenues dans le "dispositif électoral" de la partie adverse apparaissent proportionnées à leur objectif". (p.60 - leçon 2)
(2) CE 93.468, du 21 février 2001 - Taymans, privilège du préalable + CE 215.538, du 04 octobre 2011 - XXX, enseignante voilée
Le Conseil d'Etat a, à plusieurs reprises, relevé que LE PRIVILEGE DU PREALABLE IMPOSE A L'ADMINISTRE DE SE SOUMETTRE A UNE DECISION ADMINISTRATIVE, FÛT-ELLE ILLEGALE, et cela tant qu'elle n'a pas été suspendue ou annulée par la haute juridiction administrative. Dans l'affaire Taymans, le requérant, agent à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), a obtenu un congé pour mission qui lui permet de travailler au sein de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne. Il se voit refuser une prolongation de ce congé. L'intéressé, considérant que cette décision est illégale, en poursuite l'annulation devant le Conseil d'Etat et ne réintègre par ses fonctions au sein de l'IBPT à la date prévue. Il est alors démis d'office, et ce, sans préavis. Le Conseil d'Etat donne raison à l'IBPT au motif "qu'en vertu du privilège du préalable, le requérant avait à s'incliner devant ladite décision, fût-elle illégale (et) que la seule conviction que celle-ci n'était pas justifiée ne (le) dispensait pas de s'y plier". Une autre affaire mérite d'être invoquée. Une enseignante musulmane exerçant ses fonctions dans une école de la Ville de Charleroi refuse d'ôter son voile pour dispenser un cours de mathématiques. Ce faisant, elle méconnait un règlement d'ordre intérieur de la Ville qui interdit aux enseignants le port de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions. L'intéressée, invoquant une violation de la liberté religieuse, attaque ce règlement devant le Conseil d'Etat et justifie ainsi sa décision de ne plus dispenser son enseignement. Elle est alors licenciée par la Ville de Charleroi, en raison de la méconnaissance du privilège du préalable, résumant de son refus de se conformer à l'ordre de dispenser son enseignement non voilée. Le Conseil d'Etat rejette la demande en suspension introduite par ses soins contre la décision de la licencier. Il estime que la "décision attaquée est fondée sur un motif suffisant à lui seul à fonder son adoption", à savoir la violation du privilège du préalable. Le Conseil d'Etat précise que "selon (ce motif), la partie adverse a entendu sanctionner la requérante en raison de son refus de respecter l'ordre qui lui était adressé d'enseigner sans porter de signes ostentatoires attestant ses convictions religieuses. Ce motif justifie valablement la décision entreprise. Un enseignant a en effet l'obligation d'obéir aux ordres qui lui sont adressés par l'autorité hiérarchique, sauf lorsqu'ils sont manifestement illégaux. En l'espèce, le règlement prescrivant le devoir méconnu par la requérante n'est pas entaché de manière manifeste par les illégalités qu'elle dénonce dans les deux moyens. En effet, les violations de normes alléguées par la requérante n'apparaissent nullement évidentes". L'enseignante est d'autant moins fondée à invoquer l'irrégularité du règlement lui interdisant le port du voile que le Conseil d'Etat réuni en assemblée générale, a rejeté la demande en suspension qu'elle avait dirigée contre celui-ci. Autrement dit, le Conseil d'Etat admet qu'il soit dérogé au privilège du préalable lorsque l'administré doit se soumettre à une décision MANIFESTEMENT ILLEGALE de l'administration. Cependant, au moment de prendre attitude, celui-ci n'a pas l'assurance que la juridiction qui aura à connaître du litige considérera, comme lui, que l'illégalité en cause est manifeste. C'est donc toujours à ses risques et périls qu'il décidera de ne pas se soumettre à la décision de l'autorité. (p.62 - leçon 2)
(26) CE 51.585, du 08 février 1995 - Goethals et Vanderstichelen, ordonnances
Le Conseil d'Etat n'a pas hésité à opérer un contrôle par voie d'exception d'une ordonnance bruxelloise. Il considère en effet que le mode de publication du projet de Plan régional de développement imposé par l'ordonnance du 29 août 1991 n'est pas compatible avec l'article 39 de la LOI SPÉCIALE DU 12 JANVIER 1989 qui prévoit que les arrêtés de l'exécutif doivent être publiés au Moniteur belge. En l'espèce, les prescriptions littérales du plan ont été publiées au Moniteur belge, mais tel n'avait pas été le cas de ses prescriptions graphique. En conséquence, il a refusé d'avoir égard à ce projet de plan. (p.852 - leçon 26)
(20) CE 43.717, du 05 juillet 1993 - Bossart
Le Conseil d'Etat statue EN EQUITE, tant pour apprécier si les conditions constitutives d'un dommage exceptionnel sont remplies que pour fixer le montant de l'indemnité à accorder. Il en résulte que celle-ci ne devrait pas forcément équivaloir à une répartition intégrale du dommage subi. Telle n'est cependant pas l'option retenue par le Conseil d'Etat selon qui "il s'indique de prendre en considération le montant qui serait octroyé, pour un dommage identique, par les juridictions judiciaires". Dans un arrêt Bossart, il accorde une indemnité de 4 millions d'anciens francs à un agent qui a subi le préjudice de ne pas avoir été nommé à titre définitif aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement spécial, alors qu'il attendait l'extension du cadre et sa nomination depuis 10 ans. A l'occasion de cette procédure, le requérant, qui avait exercé la fonction d'inspecteur des cours d'éducation musicale pendant plus de 13 ans en vertu de titre précaires, a pu convaincre le Conseil d'Etat qu'en raison de son profil, il était le mieux placé pour exercer cette mission et qu'il eut été peu cohérent de choisir quelqu'un d'autre pour occuper l'emploi dans les conditions statuaires normales. Le Conseil d'Etat indique en outre, que "le dommage allégué ne résulte pas de l'application d'une mesure générale qui s'applique à un grand nombre de personnes, mais de l'omission de l'adapter un cadre qui était reconnu insuffisant pour couvrir les besoins de l'administration" et que "le dossier nous révèle pas que d'autres agents se retrouveraient dans une situation analogue". Curieusement, dans ces affaires, les parties adverses se sont abstenues de contester le montant du préjudice allégué par les requérants qui ont, chaque fois, obtenu l'intégralité de ce qu'ils réclamaient. Alors qu'en principe, le Conseil d'Etat fixe l'indemnité en équité (ce qui laisse supposer qu'elle peut être inférieure à l'équation exacte du dommage), l'indemnisation des requérants peut s'avérer supérieure à celle accordée par les juridictions ordinaires en cas de faute de l'administration. Ceci est d'ailleurs confié dans un autre arrêt dans lequel le Conseil d'Etat a désigné un expert pour connaître la réalité du dommage subi, ce qui signifie qu'il ne se contente pas de définit ce qu'est l'équité ou qu'à tout le moins, il estime indispensable de connaître la réalité précise du dommage pour établir les limites de ce qu'est une réparation équitable. Il précise d'ailleurs sa position en affirmant à la fois "qu'il s'indique de prendre en considération le montant qui serait octroyé, pour un dommage identique, par les juridictions judiciaires" et que "l'indemnité accordée par le Conseil d'Etat ne peut, en principe, être supérieure à celle réclamée dans la requête préalable". (p.643 - leçon 20)
(4) CE 62.921, du 05 octobre 1996 - Goosse + CE 62.922, du 05 octobre 1996 - Orfinger
Le Conseil d'Etat, dans ses arrêts Goosse, Orfinger, De Baenst et Gerfa, se prononce explicitement dans le sens ainsi indiqué. Il est saisi d'une recours en annulation dirigé contre une disposition de l'arrêté royal fixant les principes généraux (ARPG) du 26 septembre 1994 qui ouvre en partie la fonction publique régionale et communautaire à des ressortissants de l'Union européenne. Le requérant relève que même si cette disposition respecte l'article 48 du Traité de Rome, elle méconnaît l'article 8 ancien de la Constitution qui réservait l'accès à la fonction publique aux seuls Belges. Le Conseil d'Etat affirme que "lorsqu'un conflit existe ente une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir". Cette interprétation trouve son fondement dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne aux termes de laquelle "le recours à des dispositions de l'ordre juridique interne afin de limiter la portée des dispositions du droit communautaire aurait pour conséquence de porter atteinte à l'unité et à l'efficacité de ce droit et ne saurait dès lors être admis, même si les dispositions de droit interne sont celles de la Constitution". La haute juridiction administrative conclu en relevant que "du point de vue du droit constitutionnel belge, l'autorité de l'interprétation donnée au Traité de Rome par la Cour de justice repose sur l'article 34 de la Constitution, quand bien même cette interprétation aboutirait à arrêter les effets d'une partie des articles 8 et 10 de la Constitution". Le Conseil d'Etat hiérarchie ainsi les dispositions constitutionnelles donnant à l'article 34 une valeur supérieure à celle reconnue à l'ensemble des autres dispositions constitutionnelles. Cette jurisprudence s'inscrit dans la droite ligne des principes posés par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai 1971, mais, pour la première fois, une haute juridiction belge affirme péremptoirement que LE PRINCIPE DE LA PRIMAUTE DU DROIT INTERNATIONAL QUI A DES EFFETS DIRECTS DANS L'ORDRE INTERNE SUR LE DROIT INTERNE S'APPLIQUE A TOUS LES ECHELONS DE LA HIERARCHIE DES NORMES. (p.135 - leçon 4)
(14) Avis SLCE - parité en conseil des ministres
Le Conseil d'État, dans ses avis du 24 janvier 1978 et 03 avril 1980, précise la portée exacte de l'article 99 de la Constitution. Il en résulte que l'absence fortuite d'un ministre "n'a pas de répercussions sur la composition paritaire du conseil des ministres et est étrangère à la règle de droit inscrite à l'article 99 (composition du conseil des ministres)". En cas de décès ou de démission d'un ministre, "la parité doit être rétablie le plus rapidement possible". Tant que celle-ci n'est pas rétablie, le conseil des ministres peut valablement délibérer conformément aux principes généraux qui régissent le fonctionnement des assemblées ou des collèges administratifs, mais la minorité du conseil des ministres et le Parlement peuvent juger de "l'admissibilité des décisions prises par le conseil des ministres non paritairement composé en rapport avec des matières engageant des intérêts auxquels le groupe minoritaire est spécialement chargé de veiller". (p. 444 - leçon 14)
(20) Cour d'appel de Bruxelles, du 05 octobre 2006 - nomination des conseillers d'Etat + CC 123/2011, du 07 juillet 2011 - nomination des conseillers d'Etat
Le candidat évincé lors d'un processus de désignation d'un conseiller d'Etat est singulièrement démuni. En effet, le seul recours qui lui permettrait de mettre à néant la désignation qu'il conteste doit être porté devant le Conseil d'Etat, soit la juridiction qui a précisément décidé de ne pas le présenter. Il peut raisonnablement considérer que cette juridiction n'adoptera pas une position schizophrénique et que partant son recours est voué à l'échec. Ainsi, un candidat, professeur d'université aux qualités unanimement reconnues, n'a eu d'autres choix que de saisir les juridictions civiles après que le Conseil d'Etat a refusé de présenter. La Cour d'appel de Bruxelles a condamné l'Etat belge, sur la base de l'article 1382 du Code civil, parce que l'examen des titres et mérites des candidats ne pouvait de toute façon pas aboutir à préférer l'autre candidat. La cour ne comprend pas comment l'assemblée générale du Conseil d'Etat a pu considérer que la candidat nommé "avait une meilleure pratique de la collégialité" que le candidat évincé, pourquoi elle a pu affirmer que le candidat nommé "était plus qualifié que la candidat évincé pour exercer la fonction de conseiller d'Etat à la section de législation" et pourquoi elle a estimé qu'il "n'y avait pas lieu de prendre en considération pour apprécier les titres et mérites respectifs au regard de la fonction à pourvoir les publications scientifiques" du candidat évincé. La décision judiciaire favorable dont le candidat évincé a bénéficié lui apporte une satisfaction morale, mais ne lui permet pas d'obtenir l'annulation de la décision administrative qui lui a fait grief. Devant porter son recours devant la juridiction qui a joué un rôle prédominant dans sa décision querellée, il a été privé de l'accès à un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, à notre sens de manière contestable, dans un arrêt n°123/2011 du 07 juillet 2011, la Cour constitutionnelle constate que cette situation tout à fait particulière ne méconnait pas le principe d'égalité combiné au principe d'impartialité objective des juridictions, dès lors que dans la pratique, "un certain nombre de conseillers d'Etat ne peuvent prendre part à l'assemblée générale en cas de délibération ou de vote sur la présentation de candidats à une fonction vacante de conseillers d'Etat et que, lorsqu'un recours est introduit contre l'arrêté de nomination d'un conseiller d'Etat qui fait suite à cette présentation, seuls les conseillers d'Etat qui n'ont pas pris part à l'assemblée générale peuvent connaître de ce recours". (p.639 - leçon 20)
(10) CC 81/2012, du 28 juin 2012 - SLCE décret social du 09 décembre 2010, incompatibilité + CC 78/2005, du 27 avril 2005 - taille des circonscriptions électorales
Le décret spécial wallon du 09 décembre 2010 limant le cumul des mandats dans le chef des députés du Parlement wallon crée une INCOMPATIBILITE RELATIVE ENTRE LA FONCTION DE PARLEMENTAIRE WALLON ET DE MEMBRE D'UN EXECUTIF LOCAL. Il participe de l'idée de préserver l'indépendance du parlementaire par rapport aux intérêts du pouvoir local dans lequel il exerce des responsabilités et sa disponibilité dans l'exercice de son mandat régional. Un système original permet à 25% DES MEMBRES DE CHAQUE GROUPE POLITIQUE REPRESENTE AU PARLEMENT DE CUMULER UN MANDAT PARLEMENTAIRE ET UN MANDAT EXECUTIF LOCAL. Le critère retenu pour déterminer quels parlementaires peuvent bénéficier de ce cumul est LE TAUX DE PENETRATION, soit le pourcentage de voix de préférence obtenu par un candidat par rapport à l'ensemble des suffrages qui se sont portés sur sa liste. La section de législation du Conseil d'Etat est critique à l'égard de ce projet. Elle estime que le législateur wallon ne peut l'instituer car il ne s'agit pas d'une incompatibilité. A son estime, une incompatibilité doit concerner l'ensemble des membres du Parlement. Comme tel n'est pas le cas en l'espèce, le législateur n'institue pas une incompatibilité, mais établit irrégulièrement une règle de composition du Parlement. Elle estime aussi que ce décret compromet l'effet utile du vote. Elle relève enfin une RUPTURE D'EGALITE entre les candidats selon la circonscription où ils se présentent. Il est, en effet, plus aisé d'obtenir un haut taux de pénétration dans une petite circonscription où se présentent peu de candidats que dans une circonscription où les candidats sont plus nombreux. La Cour constitutionnelle rejette le recours en annulation introduit contre ce décret. Elle considère, tout d'abord, que le législateur décrétal a bien institué une INCOMPATIBILITE. Elle affirme que "rien ne permet de considérer que le législateur spécial, lorsqu'il a octroyé aux Parlements wallon et flamand une autonomie constitutive leur permettant notamment d'ajouter des incompatibilités à celles qui existaient déjà, a entendu limiter cette possibilité à la création d'incompatibilités visant de la même manière tous les membres de l'assemblée concernée" et ajoute que la "circonstance que cette incompatibilité influence la composition globale du Parlement wallon ne la prive pas de sa qualification d'incompatibilité". Ensuite, elle estime que le décret spécial respecte le principe de L'EFFET UTILE DU VOTE. Elle relève que "l'électeur qui souhaite apporter sa voix à un candidat qui est déjà titulaire d'un mandat au sein d'un collège communal sait à l'avance qu'il y a un risque que ce candidat, s'il est élu, ne se trouve pas dans les conditions pour pouvoir cumuler les deux mandats, l'électeur votant dès lors en connaissance de cause". Il en résulte que le législateur décrétal n'a pas porté atteinte à l'effet utile du vote. Enfin, en ce qui concerne la VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE, la Cour ayant examiné concrètement les résultats d'une simulation de l'application du décret, constate que le "comportement des électeurs et les stratégies des partis politiques, notamment la concentration des voix de préférence sur un nombre réduit de candidats dans toutes les circonscriptions, sont à même d'influencer suffisamment les possibilités pour tous les candidats élus de se trouver dans les conditions du cumul, même lorsqu'ils se présentent dans les plus grandes circonscriptions". Autrement dit, elle constate que même lorsqu'il y a un nombre plus important de candidats qui se présentent, les voix de préférence se portent systématiquement sur un nombre plus réduit d'entre eux de telle manière que le principe d'égalité n'es pas violé. Sur ce dernier point, la Cour adopte une attitude prudente. En effet, si elle avait estimé qu'il existait une discrimination entre petites et grandes circonscriptions, elle aurait dû constater que celle-ci trouvait en réalité son origine dans la manière dont est dessinée la carte électorale. Or, en l'état actuel de sa jurisprudence, sous réserve des arrêts dans lesquels elle affirme qu'une circonscription doit compter au moins 4 élus, elle s'est refusée à considérer que les articles 10 et 11 de la Constitution étaient violés en raison de l'inexistence de circonscriptions électorales d'importance inégale. Antérieurement, la Cour constitutionnelle avait clairement affirmé la constitutionnalité de la disparité pouvait exister entre circonscriptions électorales. Elle avait relevé que "la détermination des circonscriptions électorales pour les élections du Parlement de la Région wallonne et du Parlement flamand relève, en vertu de l'article 26 §1 de la loi spéciale du 08 août 1980 de réformes institutionnelles, de leur autonomie constitutive". Elle ajoute qu'une "différence de traitement qui résulte de l'effet différencié du seuil électoral en fonction de la taille des circonscriptions ne trouve pas sa source dans l'instauration par le législateur fédéral d'un seuil électoral uniforme, mais dans l'exercice pour les régions de leur autonomie dans la détermination des circonstances électorales". Une décision en sens contraire aurait eu pour effet de remettre en cause la validité des élections fédérales et régionales qui toutes sont organisées sur la base de circonscriptions aux contours disparates. En l'état actuel du droit positif, aucune incompatibilité n'a été jusqu'ici établie au niveau fédéral, dans la Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale entre la fonction de parlementaire et celle de membre d'un exécutif local. (p.298 - leçon 10)
(5) CC 18/2012, du 09 février 2012 - article 14ter
Le législateur a introduit, par une loi du 04 août 1996, un article 14ter dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon lequel "si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d'actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine". Autrement dit, cette disposition permet au Conseil d'Etat de maintenir la validité de décisions individuelles prises en vertu d'un règlement irrégulier. Or, ceci entre totalement en contradiction avec l'interprétation globalisante que la Cour de cassation réserve à l'article 159 de la Constitution et au contrôle par voie d'exception. Au regard de cette interprétation, l'article 14ter violerait, de manière flagrante, l'article 159 de la Constitution. La Cour constitutionnelle, interrogée sur cette question à titre préjudiciel, à considéré, tout d'abord que "l'article 160 de la Constitution consacre l'existence du Conseil d'Etat. Il attribue au législateur le pouvoir de déterminer ses compétences et son mode de fonctionnement. Dans la mesure où le Constituant a entendu, de la sorte, consacrer le contrôle objectif de la légalité des actes administratifs, le contrôle juridictionnel de légalité, prévue à l'article 159 de la Constitution, doit raisonnablement tenir compte de l'effet utile des arrêts d'annulation du Conseil d'Etat et des modalités dont ils peuvent être assortis". Ensuite, elle indique que l'article 159 de la Constitution doit être interprétée en tenant compte du principe de sécurité juridique. Il s'ensuit, à son estime, que "si l'article 159 de la Constitution ne prévoit, explicitement, aucune restriction au mode de contrôle de légalité qu'il consacre, une telle restriction se justifie néanmoins si elle est nécessaire pour assurer le respect d'autres dispositions constitutionnelles ou de droits fondamentaux. Tenu de garantir notamment le principe de sécurité juridique, le législateur se doit de régler le mode de contrôle de l'action administrative, ce qui peut exiger des restrictions au contrôle juridictionnel incident de la légalité des actes réglementaires, pour autant que ces restrictions soient proportionnées au but légitime poursuivi". En se fondant sur l'article 160 de la Constitution, la Cour constitutionnelle fait primer ici les termes de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sur ceux de l'article 159 de la Constitution. Cette thèse audacieuse et qui malmène quelque peu la hiérarchie des normes se justifie, à son sens, par le principe de sécurité juridique "qui est inhérent à l'ordre juridique interne, ainsi qu'à l'ordre juridique de l'Union européenne et à la Convention européenne des droits de l'homme". (p.171 - leçon 5)
(12) Avis SLCE - article 9 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980
Le législateur ne peut se dépouiller de ses compétences dans les MATIERES RESERVEES par la Constitution à la loi, au décret ou à l'ordonnance. Des principes identiques s'appliquent aux Régions et aux Communautés. Ainsi, L'ARTICLE 9 DE LA LOI SPÉCIALE DU 8 AOÛT 1980 prévoit que le législateur régional ou communautaire règle "la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle" des établissements et des organismes qu'il crée. La section de législation dénie dès lors au gouvernement régional ou communautaire, et a fortiori aux organes de gestion de ces organismes, le soin de fixer le statut des agents qui y exercent leurs activités. Force est de constater, cependant, que dans la pratique, cette exigence est loin d'être toujours respectée. Ainsi par exemple, malgré la position prise par la section de législation du Conseil d'Etat, l'article 28 du décret du 14 juillet 1997 portant sur le statut de la RTBF prévoit que "sur proposition de son administrateur général, le conseil d'administration de la RTBF arrête le statut du personnel, le règlement de travail et le statut syndical". Dans les matières qui relèvent de la compétence résiduelle du législateur, des délégations sont concevables, mais elles ne peuvent être illimitées. La section de législation fixe en ce domaine les bornes de l'admissible : "pour concilier les principes constitutionnels régissant la répartition des compétences entre le législateur et le Gouvernement, LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA RÉGLEMENTATION DOIVENT FIGURER DANS LE TEXTE MÊME (DE LA NORME LÉGISLATIVE). LES LIMITES DE LA DÉLÉGATION CONSENTIES AU GOUVERNEMENT DOIVENT ÊTRE DÉFINIES PAR (LA NORME LÉGISLATIVE) AUSSI PRÉCISÉMENT QUE POSSIBLE, de préférence en indiquant de manière concrète, les circonstances dans lesquelles il peut être fait usage de cette délégation et en définissant à tout le moins dans leurs grandes lignes, les mesures à prendre". (p.386 - leçon 12)
(9) CE 156.078, du 08 mars 2006 - Brynaert + CE 157.044, du 28 mars 2006 - Van Bergen + CE 161.253, du 11 juillet 2006 - Van Bergen II + CE 214.529, du 11 juillet 2011 - Daerden
Le mécanisme de responsabilité politique des membres du collège devant le conseil communal (permettant le vote d'une motion de méfiance constructive, à la majorité absolue des membres du conseil), à l'inverse du régime instauré au niveau fédéral, régional et communautaire, a d'emblée été mis en oeuvre. Il a été à l'origine de vives controverses juridiques. En effet, deux échevins, les dénommés Jean-Marie Brynaert et Serge Van Bergen, impliqués dans des affaires pénales intéressant la gestion de sociétés de logements sociaux, ont fait, à La Louvière et à Charleroi, l'objet de motions de méfiance constructive. Ils ont saisi le Conseil d'Etat de demandes en suspension, et ce, dans le but d'être réintégrés dans leurs fonctions. La problématique que devait trancher le Conseil d'Etat se présentait en ces termes. Dans une PREMIER LOGIQUE, FONDEE sur des principes de DROIT CONSTITUTIONNEL et de droit parlementaire, l'adoption d'une motion de méfiance s'analyse comme un acte politique qui, sans devoir pour autant avoir recours à la doctrine abhorrée par le Conseil d'Etat de l'acte de gouvernement, échappe pour l'essentiel à son contrôle. Celui-ci contrôle donc simplement le respect des conditions formelles de mise en oeuvre de la procédure (le nombre de signatures au bas de la motion, le nombre de votants de la motion, le respect du délai qui doit s'écouler entre son dépôt et son vote, le caractère public de la séance et du vote) mais n'examine pas le contenu de la motion ou la manière dont celle-ci a été débattue. L'AUTRE LOGIQUE, FONDEE sur des mécanismes classiques de DROIT ADMINISTRATIF et du droit de la fonction publique, consiste à considérer que la délibération approuvant la motion de méfiance constructive est une mesure grave pris par une autorité administrative en raison du comportement de celui qui en fait l'objet. Une telle interprétation doit conduire la haute juridiction administrative à garantir le respect des droits de la défense, principe exprimé par l'adage audi alteram partem et à contrôler si les motifs de la délibération respectent bien le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Faut-il s'étonner que la haute juridiction administrative se soit engagée, fût-ce avec prudence, dans la 2ème voie ? Dans ses arrêts Brynaert et Vanbergen I, elle suspend, au bénéfice de l'extrême urgence, des délibérations qui adoptaient des motions de méfiance constructive, et ce parce que le principe audi alteram partem a été violé. Dans l'arrêt Brynaert, elle estime que L'INTERESSE N'A PAS DISPOSE D'UN TEMPS SUFFISANT POUR PREPARER SA DEFENSE, et cela, alors même que le délai de 3 jours (remplacé depuis lors par un délai de 7 jours francs) entre le dépôt de la motion et son vote avait été respecté. Dans l'arrêt Vanbergen, bien que l'échevin se soit expliqué devant le conseil communal, elle annule la délibération qui le concernait au motif QUE SON AVOCAT S'ETAIT VU REFUSER LE DROIT D'INTERVENIR DANS LE DEBAT. Afin d'obvier à cette situation, le législateur wallon adopte le 08 juin 2006, une proposition de décret qui vise à mettre les points sur les i. Il affirme dans la loi et dans les travaux préparatoires QUE LE CONSEIL COMMUNAL APPRECIE SOUVERAINEMENT LES MOTIFS DE LA MOTION DE MEFIANCE (ce qui rend impossible le contrôle des motifs de celle-ci) et organise la manière dont le membre du collège fait valoir sa position EN PERSONNE devant le conseil, ce qui a pour effet de limiter les effets du principe audi alteram partem. Il restait à examiner comment la haute juridiction administrative réagirait à cette initiative du législateur. La réponse vient dans l'arrêt Vanbergen II. Tout d'abord, le Conseil d'Etat maintient avec force que la délibération approuvant une motion de méfiance constructive peut être querellée devant lui. Il précise "qu'en alléguant que la motion de méfiance attaquée serait une décision essentiellement politique, la partie adverse n'établie pas, prima facie, que le contrôle de sa légalité devrait échapper au Conseil d'Etat ; qu'en effet, le vote d'une telle motion, par un conseil communal, qui n'est ni un organe du pouvoir législatif ni un organe du pouvoir judiciaire, apparaît comme un acte accompli par une autorité administrative, destiné à produire des effets de droit, faisant grief, acte qui, dès lors, est de nature à faire l'objet d'une requête en annulation et, partant, d'une demande de suspension, sur la base des articles 14 §1, et 17 §1, des lois sur le Conseil d'Etat, précitées ; qu'aucune disposition de nature constitutionnelle ou législative n'exclut pareille décision de la compétence du Conseil d'Etat". Ensuite, il précise que la décision d'adopter une motion de méfiance constructive est "un acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité" et qu'il "paraît devoir faire l'objet d'une motivation formelle". Plus précisément encore, il indique que l'ajout "des mots 'le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui les fondent' porte sur la motivation matérielle de l'adoption de la motion de méfiance, soit sur ses motifs, de sorte que cette modification décrétale n'exonère pas cette décision du conseil communal de l'exigence de motivation formelle". Il reconnaît, cependant, "que la rupture du lien de confiance entre le conseil communal et un membre du collège communal qui se manifeste par l'adoption d'une motion de méfiance n'est pas nécessairement fondée sur des faits précis et, par conséquent, peut être impossible à objectiver, ce qui réduit forcément la motivation formelle de l'acte mettant un terme au mandat d'un échevin à une formule stéréotypée". Tirant les conséquences de ce raisonnement, il opère un contrôle de la motivation de la motion de méfiance et affirme, en l'espèce, que les griefs contenus dans la motion de méfiance dirigée contre l'échevin Van Bergen (et notamment son implication dans le scandale dit de La Carolo) constituent une motivation suffisante et adéquate. Enfin, la haute juridiction administrative admet que le principe audi alteram partem ne trouve pas à s'appliquer pleinement en l'espèce dès lors que le législateur a décidé d'en modaliser l'application. Elle reconnaît donc que le seul droit dont dispose l'intéressé est d'être entendu personnellement par le conseil et que, par voie de conséquence, il ne peut, à cette occasion, se faire assister d'un conseil. Il en résulte que le seul contrôle que peut encore opérer le Conseil d'Etat est un contrôle des conditions de forme qui s'impose au vote d'une telle motion. Serge Van Bergen ne se décourage pas. Il saisit la Cour constitutionnelle d'un recours en annulation contre le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Il invoque deux moyens. Le premier est fondé sur le fait que la motion de méfiance n'était pas soumise à une obligation de motivation formelle et le second sur le fait que l'échevin mis en cause est privé de l'assistance d'un avocat. Dans un arrêt n°157/2007 du 19 décembre 2007, la Cour constitutionnelle rejette ce recours. Elle refuse, tout d'abord, de se prononcer sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître d'une motion de méfiance, preuve qu'elle ne considère pas cette compétence comme incontestable. Elle considère que le premier moyen n'est pas fondé puisque les dispositions attaquées n'interdissent pas au Conseil d'Etat de contrôler la motivation de la motion, et cela, même s'il admet qu'elle peut se limiter à une formule stéréotypée. Elle écarte également le deuxième moyen, en rappelant avec force la spécificité d'un mécanisme de responsabilité politique : "la motion de méfiance constructive réglée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est un instrument qui permet au conseil communal d'exercer SA COMPETENCE DE CONTRÔLE POLITIQUE à l'égard du collège communal ou à l'égard d'échevins à titre individuel. LE DEBAT QUI EST MENE A L'OCCASION D'UNE TELLE MOTION EST, DE PAR SA NATURE, AXE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ORGANE ELU DEMOCRATIQUEMENT ENTEND OU NON MAINTENIR SA CONFIANCE A L'ORGANE EXECUTIF OU A UN MEMBRE DE CET ORGANE et suppose que celui qui porte une responsabilité politique se justifie en personne devant l'organe élu démocratiquement, même lorsque la question de confiance est dictée par son comportement personnel. Le Conseil d'Etat, cependant, rechigne à se soumettre tant à la volonté claire du législateur wallon qu'à l'enseignement de la Cour constitutionnelle. Ainsi connaît-il d'un recours en annulation dirigé par Michel Daerden contre la motion de méfiance à la suite de laquelle il a été évincé en tant que bourgmestre faisant fonction de la commune d'Ans. Devant le Conseil d'Etat, il invoque un détournement de pouvoir, soit un moyen consistant à affirmer que l'auteur de l'acte a usé de ses compétences légales à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui ont été consenties. Plus particulièrement, il soutient "que le législateur wallon a conçu la motion de méfiance individuelle comme un moyen de sanctionner un bourgmestre ou un échevin qui fait preuve d'un comportement inadéquat à l'occasion de ses fonctions, et (...) que l'acte attaqué a été adopté aux fins d'écarter le requérant de ses fonctions de bourgmestre empêché, fonctions dès lors non exercées, alors même que les institutions communales fonctionnent parfaitement". Il en conclut "que la délibération attaquée a été adoptée dans l'intention de lui nuire ainsi qu'à son entourage politique ; qu'il relève que ce risque de détournement avait été évoqué au cours des travaux préparatoires, et souligne que les institutions communales d'Ans tout comme celles du CPAS ont toujours parfaitement fonctionné". Le Conseil d'Etat rejette ce moyen au motif "que l'appréciation que le requérant porte sur la qualité du fonctionnement des institutions locales n'est manifestement pas partagée par la majorité des membres du conseil communal, qui ont voté la motion". Il constate que le dossier "contient les procès-verbaux des réunions du conseil communal des 23 et 30 septembre 2010, où le conseil n'était pas en nombre" et "que cela ne témoigne pas d'un bon fonctionnement". De même, le dossier contient "surtout des extraits de prise, nombreux et concordants, qui témoignent de graves dissensions entre le requérant et certains membres de son parti". Le Conseil d'Etat en conclut que "s'il apparaît clairement du vote de la motion qu'une large majorité du conseil communal estimait opportun de remplacer le collège, aucun document n'établit que cette majorité aurait été animée de la volonté de nuire au requérant ; qu'à plus forte raison, il ne peut être tenu pour établi que le conseil communal aurait poursuivi un tel but à l'exclusion de tout but licite". Le Conseil d'Etat contrôle donc de manière quasi tatillonne la validité des motifs, fondant la motion de méfiance. Autrement dit, il porte un jugement de valeur sur les considérations qui conduisent un organe politique (le conseil communal) à retirer sa confiance à des membres de l'exécutif communal. Ce faisant, il s'obstine, comme il l'avait déjà fait dans sa jurisprudence antérieure, mais sans doute avec encore plus d'amplitude, à se faire juge du jeu politique local. Cet arrêt est profondément choquant car il marque une intrusion plus inadmissible encore du Conseil d'Etat dans le champ politique. En effet, à la suite de la jurisprudence Vanbergen et de l'arrêt n°156/2007 de la Cour constitutionnelle, une sorte de compromis implicite s'était dégagé. Il suffisait que le conseil communal motive la motion par une formule lapidaire, une clause de style entérinant la rupture de confiance pour éviter le contrôle invasive du Conseil d'Etat sur les motifs politiques réels de sa délibération. Ce compromis était évidemment déjà insatisfaisant puisque les électeurs n'étaient, de ce fait, pas informés de manière précise des raisons pour lesquelles le lien de confiance avait été rompu. En acceptant d'examiner un moyen tiré du détournement de pouvoir, et partant en s'autorisant à contrôler les motifs intrinsèques de la motion de méfiance, nonobstant le recours à une formule lapidaire pour la fonder, le Conseil d'Etat fait voler en éclats le compromis qui était le résultat de sa jurisprudence antérieure. Cette logique est de nature à le conduire à annuler la délibération approuvant une motion de méfiance à l'égard d'un membre d'un collège communal au seul motif qu'il estimerait que le conseil communal lui fait des reproches injustes, et cela même si les motifs réels de la rupture ne sont pas exprimés dans la motion de méfiance et que celle-ci, par son existence même, témoigne d'une rupture de confiance entre l'assemblée et l'intéressé. Cette jurisprudence, qui contredit les intentions univoques du législateur régional et la conception de la motion de méfiance livrée par la Cour constitutionnelle, conduit à transformer la troisième juridiction suprême du pays en acteur politique local. (p.279 - leçon 9)
(9) Motions de méfiance en République Fédérale Allemande, précédents de 1982 et 2005
Le parlementarisme rationalisé vise à pallier les effets négatifs de l'instabilité gouvernementale. Il trouve sa source dans la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, et plus particulièrement dans ses articles 67 et 68. La première de ces dispositions relative à la motion de méfiance constructive prévoit que le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier fédéral qu'en élisant un successeur à la majorité absolue et en invitant le Président de la République fédérale à le relever de ses fonctions. Celui-ci doit faire droit à cette demande et nommer la personnalité élue. Il est prévue, en outre, que le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures. Enfin, la stabilité garantie par la Loi fondamentale s'exprime encore dans le fait qu'une motion de méfiance non constructive n'est pas recevable. Il est donc impossible au Bundestag d'exprimer gratuitement sa méfiance à l'égard du chancelier, sans être capable, simultanément, de lui proposer un successeur. Par ailleurs, hormis l'hypothèse du rejet d'une question de confiance, il ne peut être question de dissolution que lorsqu'il est impossible au Bundestag de procéder à l'élection du chancelier. Dans ce cas, le Président doit dissoudre l'assemblée. Ces dispositions constituent un ensemble cohérent. Elles établissent un lien étroit entre le pouvoir de dissolution et le rejet d'une motion de confiance. La pratique institutionnelle l'a révélé. En effet, la majorité parlementaire, en refusant artificiellement la confiance au chancelier fédéral a permis, en 1982 et en 2005 de provoquer la dissolution du Bundestag que celui-ci appelait de ses voeux et qui, dans la conjoncture politique du moment, semble-t-il, s'imposait. Le système allemand vise donc à la stabilité gouvernementale et à favoriser des Parlements de législature. Après 70 ans d'application de ces mécanismes, il est permis d'en tirer un bilan. En 1972, une motion de méfiance constructive est soumise au vote du Bundestag, mais il manque 2 voix pour qu'elle soit adoptée. En 1982, par contre, à la suite d'un revirement des libéraux (FDP), une motion de méfiance constructive consacre le remplacement du Chancelier social-démocrate Helmut Schmidt (SPD) par un Chancelier chrétien-démocrate Helmut Kohl (CDU). Le nouveau chancelier, cependant, estime ne pas pouvoir gouverner sans avoir été porté à ces fonctions par un vote du peuple. Il invite donc son groupe politique à s'abstenir lorsqu'il pose la question de confiance. A la suite du rejet de celle-ci, l'assemblée est dissoute, des élections sont organisées, gagnées par la nouvelle majorité et Helmut Kohl est élu Chancelier. En 2005, le Chancelier Gerhard Schröder (SPD), affaibli politiquement, souhaite provoquer des élections législatives anticipées. Le système constitutionnel tel qu'il vient d'être décrit ne lui permet pas d'obtenir immédiatement la dissolution du Bundestag. En conséquence, il pose la question de confiance et invite les membres de son groupe politique à la lui refuser. Ceci est chose faite le 1er juin 2005. N'est-il pas paradoxal de voir un chef de gouvernement demander à l'assemblée en général, et à son parti en particulier, de le désavouer ? A l'évidence, la réponse est affirmative, mais cette anomalie trouve son explication exclusive dans la nécessité de contourner les mécanismes visant à créer, fût-ce artificiellement, une stabilité gouvernementale. Le 25 août, à la suite du rejet de la question de confiance posée par le Chancelier Schröder, le Tribunal constitutionnel fédéral, statuant à 7 voix contre une, rejette un recours contre la dissolution du Bundestag par le Président fédéral, introduit par un représentant écologiste, qui estimait que celle-ci avait été décidée en violation de l'esprit de la Constitution. Cette décision aboutit en fait à conférer au Président de la République un pouvoir de dissolution qui ne se distingue pas fondamentalement de celui qui appartient au chef de l'Etat, dans un régime parlementaire classique. Bref, le Tribunal constitutionnel fédéral avalise le constat d'échec du parlementarisme rationalisé à l'allemande. La "plus-value" du parlementarisme rationalisé en Allemagne est donc inexistante. Dans un régime de parlementarisme classique, la crise de 1982 se serait dénouée de manière identique. La défection des libéraux aurait entraîné la chute du gouvernement présidé par Helmut Schmidt et de nouvelles élections se seraient tenues, soit ce qui s'est précisément produit, après que, artificiellement, les parlementaires de la CDU se sont abstenus de manifester leur confiance à leur leader. De même, en 2005, dans un régime de parlementarisme classique, il eut suffit que le chancelier demande au Président de la République de dissoudre le Bundestag pour provoquer, comme il le souhaitait, des élections anticipées. Deux grandes conclusions s'imposent donc. Nonobstant l'instauration de mécanismes de parlementarisme rationalisé, sans doute au prix de jeux de rôle un peu ridicules, le système fonctionne toujours selon le mode du parlementarisme classique. Ensuite, et le précédent de 1982 est particulièrement significatif à cet égard, les mécanismes de parlementarisme rationalisé n'offrent pas un surcroît de stabilité, mais bien au contraire compromettent la lisibilité du fonctionnement institutionnel. En République fédérale d'Allemagne, le parlementarisme rationalisé est donc un leurre. (p.262 + 263 - leçon 9)
(12) CC 5/2005, du 02 février 2005 - lois interprétatives
Le pouvoir conféré au législateur d'interpréter authentiquement la norme législative doit évidemment être exercée avec circonspection. Il ne pourrait adopter une norme interprétative d'une disposition législative claire pour la seule raison qu'il estime inopportune la jurisprudence des cours et tribunaux relative à celle-ci. Il a, en effet, été précisé que l'interprétation authentique n'est pas possible si une norme est claire. En d'autres termes, il N'Y A LIEU D'INTERPRETER la loi par voie d'autorité que SI LE SENS DE LA NORME EST DOUTEUX, S'IL EST CONTREDIT PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES OU SI CEUX-CI SONT SILENCIEUX. Il a été précisé, en outre, que dans le doute, en raison du caractère rétroactif qui s'attache à la loi interprétative, il est préférable de modifier la norme plutôt que de l'interpréter. La Cour constitutionnelle a fait application de ces principes dans un arrêt relatif à un recours en annulation contre un décret modifiant le décret flamand sur l'électricité du 17 juillet 2000. Elle s'exprime ainsi : "la disposition attaquée interprète les termes 'sans préjudice' figurant à l'article 37, §2, du décret sur l'électricité dans le sens de 'à l'exclusion du'. Or, la véritable signification de 'sans préjudice de', commune aux textes juridiques, est 'sans porter atteinte à'. LE SENS D'UNE DISPOSITION LÉGISLATIVE NE PEUT ÊTRE INFLÉCHI EN FAISANT PRÉVALOIR SUR LE TEXTE CLAIR DE CETTE DISPOSITION DES DÉCLARATIONS QUI ONT PRÉCÉDÉ SON ADOPTION. La Cour ne peut que constater que la disposition entreprise donne à la disposition interprétée une portée qui implique le contraire de sa signification originaire, même si la nouvelle portée est conforme à l'intention originaire du législateur décrétal, intention qui n'avait toutefois pas été restituée dans le texte de l'article 37, §2, et qui était même en contradiction avec celui-ci. CETTE DISPOSITION NE PEUT RAISONNABLEMENT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE DISPOSITION INTERPRÉTATIVE. Il serait du reste surprenant que le même mot ait une signification différente au § 1 et au §2 du même article 37. (p.378 - leçon 12)
(19) Tribunal civil de Bruxelles, du 07 novembre 2000 - Nihoul
Le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice à l'égard du parquet ne se limite pas aux seules poursuites. En 2001, le ministre de la Justice donne une injonction au procureur général de faire procéder à l'arrestation de Michel Nihoul au motif que celui-ci n'aurait pas respecté les termes d'une décision de la commission de libération conditionnelle. Le tribunal de première instance de Bruxelles estime qu'aucun reproche ne peut être adressé au ministre de la Justice, notamment sur le plan de la séparation des pouvoirs, dès lors que ce ministre dispose d'un droit général d'impulsion vis-à-vis des membres du parquet, lequel peut trouver également à s'appliquer dans la mission d'exécution des décisions judiciaires. Cependant, depuis la création des tribunaux d'application des peines, le ministère public doit saisir le tribunal d'application des peines qui seul peut révoquer, suspendre ou revoir les conditions d'une liberté conditionnelle. C'est donc dans cette exacte limite (à savoir les réquisitions du ministère public devant le tribunal de l'application des peines) que peut intervenir l'injonction du ministre de la Justice. (p.607 - leçon 19)
(10) CC 74/92, du 18 novembre 1992 - incompatibilités, règle générale
Le système des incompatibilités se fonde en quelque sorte sur le principe de LA DOUBLE PORTE. Chaque législateur peut établir des incompatibilités applicables aux organes qui relèvent de sa compétence, et cela même si, ce faisant, il prend des mesures qui se répercutent sur des organes étrangers à son ordre juridique. La Cour constitutionnelle a ainsi affirmé que la législateur flamand étant compétent pour rendre incompatible la fonction d'inspecteur dans l'enseignement (matière communautaire) avec un mandat communal ou provincial (matière qui à l'époque relevait de l'autorité fédérale). Elle s'est exprimée comme suit : "les Parlements de Communauté ont (...) la plénitude de compétence pour régler l'enseignement dans la plus large acception du terme, sauf les exceptions qui y sont explicitement mentionnées. La disposition attaquée est comprise dans la réglementaire globale édictée par la Communauté flamande pour l'inspection et les services d'encadrement pédagogique de l'enseignement ; elle fait partie du chapitre (...) ayant pour objet les devoirs, les incompatibilités et le recrutement des membres de l'inspection (...). Il appartient au seul législateur décrétal de déterminer les garanties qu'il estime nécessaires au bon fonctionnement de l'inspection. Il lui est permis d'instaurer des incompatibilités qui empêchent l'intéressé d'assumer la fonction d'inspecteur s'il exerce un autre mandat ou une autre fonction. C'est dans ce sens que doit se lire la disposition attaquée ; en vertu de cette disposition, la fonction d'inspecteur est incompatible notamment avec un mandat politique ou un mandat auprès d'un pouvoir organisation. En instaurant une telle interdiction de cumul, le législateur décrétal règle la situation juridique des membres de l'inspection (...) ; il ne règle pas le fonctionnement des institutions provinciales ou communales et ne porte pas atteinte à la compétence réservée au législateur national par l'article 162 de la Constitution". Autrement dit, et là est la mise en oeuvre du "principe de la double porte", pour que deux fonctions puissent être exercées simultanément, il faut que chacun des législateurs compétents pour les organiser ait décidé de ne pas les rendre incompatibles. Dans le cas d'espèce, le législateur wallon a rendu incompatibles un mandat dans un collège communal et une fonction de direction attribuée par un mandat non électif au sein d'une administration publique fédérale, régionale ou communautaire ou d'un organisme public qui en dépend. Philippe Mettens, président du Service public fédéral de programmation de la Politique scientifique (SPP Politique scientifique) et bourgmestre de Flobecq attaque ce décret devant la Cour constitutionnelle. Il invoque notamment qu'en le contraignant à démissionner de son mandat dans l'administration fédérale s'il entend conserver son mandat de bourgmestre, il est porté atteinte aux compétences de l'autorité fédérale en matière de recherche scientifique. La Cour constitutionnelle lui donne tort : "il appartient au législateur décrétal de déterminer les garanties qu'il estime nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des institutions communales qui relèvent de sa compétence. Il lui est permis d'instaurer des incompatibilités qui empêchent un mandataire communal d'assurer une fonction au sein du collège communal s'il exerce simultanément un autre mandat ou une autre fonction. En instaurant une telle interdiction de cumul, le législateur décrétal règle la situation juridique des membres des collèges communaux et demeure donc dans la sphère de compétence et ne porte pas atteinte à l'article 6 §1, VIII, de la loi spéciale précitée. Il ne règle pas le fonctionnement des institutions fédérales, communautaires ou régionales qui ne relèvent pas de sa compétence et ne porte pas atteinte à l'article 162 de la Constitution (...) il ne peut être admis que le législateur décrétal aurait abandonné au profit des autres entités de l'Etat fédéral sa compétence de fixer une telle incompatibilité" et que "le législateur décrétal ne rend pas exagérément difficile l'exercice des compétences fédérales, et en l'occurence celles que l'Etat fédéral détient relativement à la politique scientifique (...) la disposition attaquée n'empêche nullement le requérant de continuer à exercer sa fonction de président du comité de direction du SPP Politique scientifique. Elle le contraint seulement, dans ce cas, à renoncer à exercer une fonction au sein du collège d'une commune wallonne". Le Conseil d'Etat a, cependant, estimé que l'incompatibilité portait exclusivement sur l'exercice de la fonction et que Philippe Mettens ne s'était pas rendu coupable de négligence grave en conservant son mandat fédéral, en prêtant serment comme bourgmestre mais en en déléguant les fonctions à d'autres membres du collège (CE 224.021, du 21 juin 2013 - Mettens). Il est loin d'être certain que l'interprétation ainsi livrée par le Conseil d'Etat soit conforme à l'intention du législateur, ni même à la conception que la Cour constitutionnelle se faisait de cette incompatibilité. La haute juridiction administrative fait, cependant, application du principe général selon lequel toute limitation d'un droit politique est d'interprétation restrictive. Si le législateur wallon entend privilégier une conception plus intense de l'incompatibilité, il lui appartient de le prévoir expressément dans le décret, fût-ce par l'adoption d'un décret interprétatif. (p.291 - leçon 10)
(6) CC 86/2012, du 28 juin 2012 - scrutin proportionnel
Le système proportionnel ne permet cependant pas de donner un poids strictement égal à chaque voix et connaît également (mais sans commune mesure avec le système majoritaire) le phénomène des voix perdues. La Cour constitutionnelle relève que "même si les élections ont lieu suivant un système de représentation strictement proportionnelle, on ne saurait éviter le phénomène des 'voix perdues'. Il s'ensuit que chaque suffrage n'a pas un poids égal dans l'attribution des sièges et que chaque candidat n'a pas les mêmes chances d'être élu". En outre, ajoute-t-elle, "aucune disposition de droit international ou de droit interne n'interdit au législateur qui a opté pour un système de représentation proportionnelle de prévoir des limitations raisonnables afin de garantir le bon fonctionnement des institutions démocratiques". Elle ajoute que "la volonté d'instaurer ou de maintenir un système démocratique de représentation proportionnelle n'empêche pas de tenir également compte des avantages d'une politique suffisamment stable et claire pendant la législature". Ainsi, dans "le cadre de son pouvoir d'appréciation étendu quant au mode d'organisation de la représentation proportionnelle, le législateur (...) peut prendre des mesures destinées à éviter un morcellement du paysage politique, en favorisant, au sein des organes représentatifs, la formation de groupes politiques suffisamment cohérents". Le législateur peut donc organiser le système électoral de telle manière qu'un parti doive obtenir un seuil minimal de voix pour être représenté au sein de l'assemblée. Il lui est loisible d'organiser un système de représentation proportionnelle qui avantage les grands partis au détriment des petits partis, la Cour observant d'ailleurs à cet égard que "ce sont les élections mêmes qui font apparaître les partis ou les listes qui sont 'plus grands' et que les rapports peuvent être modifiés à chaque nouvelle élection". (p.202 - leçon 6)
(13) Affaire Schlicker, enquêtes parlementaires
Le témoignage de magistrats devant les commissions d'enquête a été à l'origine de vives controverses. Le 08 décembre 1988, le juge Schlicker, entendu en séance publique de la commission d'enquête de la Chambre des représentants relative à la répression du banditisme et du terrorisme, est interrogé sur les pressions qu'il aurait subies lors de certaines instructions judiciaires. Le magistrat nivellois refuse de répondre à ces questions et déclare que lorsqu'il a reçu la convocation de la commission parlementaire d'enquête, "il a demandé à son président ce qu'il pouvait dire. Celui-ci a interrogé premier président de la Cour qui lui a fait parvenir une note de quatre pages". Cette note, qui n'est pas confidentielle, est publiée par le Journal des tribunaux, le 07 janvier 1989. Indépendamment du principe de séparation des pouvoirs, un magistrat peut être tenter de se prévaloir du DEVOIR DE RÉSERVE et du secret de l'instruction pour refuser du témoigner devant une commission d'enquête parlementaire. Cette question a fait couler beaucoup d'encre avant l'adoption de la loi du 30 juin 1996. Si le juge appelé à témoigner devant une commission parlementaire ne pouvait valablement invoquer le devoir de réserve, la situation était quelque peu différente s'il fondait sa démarche sur le SECRET DE L'INSTRUCTION. L'argumentation développée par le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles pour affirmer qu'un magistrat n'a pas à témoigner devant une commission d'enquête se fonde essentiellement sur deux principes ("le témoignage devant une commission parlementaire d'enquête ne peut être assimilé au témoignage en justice" et "la législation sur les enquêtes parlementaires n'est pas une loi qui impose la dénonciation de secrets") qui constituent autant de postulats erronés. Si la loi du 03 mai 1880 ne confère pas à la commission d'enquête la qualité de juge d'instruction, ses pouvoirs d'investigation n'en sont pas pour autant affectés. L'exercice du pouvoir judiciaire est réservé aux cours et tribunaux et l'article 56 de la Constitution ne déroge pas, à proprement parler, à ce principe. Toutefois, cette disposition constitutionnelle, complétée par la loi du 03 mai 1880, vise à donner aux assemblées, dans l'exercice de leur mission d'enquête, des moyens identiques à ceux dont disposent les juges d'instruction. Le renvoi opéré par l'article 4 de la loi du 03 mai 1880 au Code d'instruction criminelle faisait, dès avant la modification de la loi du 03 mai 1880 opérée en 1996, que cette différence n'a pas d'incidence sur le témoin lui-même. Celui-ci était soumis aux mêmes règles selon qu'il dépose devant la commission d'enquêtes ou devant un juge d'instruction. Une commission d'enquête pouvait donc, dans les mêmes conditions qu'un juge d'instruction, solliciter le témoignage d'un dépositaire d'un secret professionnel, au sens de l'article 458 du Code pénal. La situation d'un témoin qui dépose devant une commission d'enquête pouvait donc être totalement assimilée à celle qui est la sienne lorsqu'il témoigne en justice. Ce principe résultait clairement du renvoi, sans restrictions, opéré par la loi du 03 mai 1880 au Code d'instruction criminelle. Affirmer le contraire aurait conduit dans nombre de circonstances à priver l'enquête parlementaire de son effectivité. (p. 417 - leçon 13)
(7) CC 134/2013, du 10 octobre 2013 - portée du vote obligatoire
Le vote obligatoire autorise évidemment un électeur à s'abstenir, soit à un émettre un vote blanc. Il ne dispose, par contre, pas du droit d'exprimer un vote nul. La Cour constitutionnelle affirme que "même s'il constitue un droit politique fondamental de la démocratie représentative et est d'une importance cruciale pour l'établissement et le maintien des fondements de la démocratie, le droit de vote n'est pas absolu" et "n'implique pas le droit de voter nul". Pour qu'il soit question d'élections libres et démocratiques, ajoute-t-elle, "il suffit en effet que l'électeur puisse émettre son vote sans contrainte, de sorte qu'il puisse voter comme il l'entend. L'électeur est toutefois tenu de respecter strictement la procédure électorale (CEDH, du 11 janvier 2007 - Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres c. Russie). La nullité d'un bulletin de vote n'est que la sanction applicable à un vote irrégulier". (p.218 - leçon 7)
(26) CC 35/2003, du 25 mars 2003 - VGC, accord du Lombard
Les ACCORDS DU LOMBARD avaient consacré une MODIFICATION DES RÈGLES DE COMPOSITION DE SON ASSEMBLÉE. En effet, en vertu de l'article 60, alinéa 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, celle-ci comprend les 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement régional et 5 membres non élus au sein de cette assemblée, désignés à la proportionnelle en fonction des résultats des élections du Parlement flamand. L'objectif poursuivi était d'éviter qu'un parti non démocratique ne puisse, en devenant majoritaire, au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement régional, paralyser irrémédiablement les institutions bruxelloises. La Cour constitutionnelle admet le bien-fondé de cet objectif. Elle indique, en effet, que s'il "peut être admis (...) que des mesures radicales soient prises pour éviter que les libertés politiques qui rendent la démocratie vulnérable soient utilisées afin de la détruire, encore faut-il que de telles mesures soient limitées à la protection du caractère démocratique du régime et ne méconnaissent pas les articles 10 et 11 de la Constitution". Elle rappelle, cependant, le principe qui veux que "les représentants siégeant dans un organe représentatif sont, en règle, désignés par les citoyens qui peuvent être affectés par les décisions de cet organe" et constate que motifs invoqués pour déroger à cette règle "ne sont pas suffisants pour justifier le mode de désignation de 5 membres supplémentaires, prévu par l'article 38, qui ne présente aucun lien avec la volonté exprimée par les électeurs bruxellois". La Cour constitutionnelle n'a pas annulé l'article 60, alinéa 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 qui prévoit que l'assemblée de la V.G.C. compte 5 membres de plus que le groupe linguistique néerlandais du Parlement régional. Elle a simplement annulé les dispositions qui fixent la manière de procéder à la désignation de ces derniers. Or, le législateur spécial s'est abstenu de tirer la moindre conséquence de l'arrêt de la Cour. Il en résulte que L'ASSEMBLÉE DE LA V.G.C. EST DEPUIS 2003 IRRÉGULIÈREMENT COMPOSÉE. (p.860 - leçon 26)
(15) CE 220.717, du 24 septembre 2012 - Rijmenans, affaires courantes, urgence
Les AFFAIRES URGENTES sont celles, si elles n'étaient pas réglées sur le champ, risqueraient de causer un PRÉJUDICE IRRÉPARABLE À LA COLLECTIVITÉ. Ainsi par exemple, a-t-il jugé que, à "la veille de la présidence de l'Union européenne par la Belgique et vu le rôle à jouer de l'ambassadeur belge ne poste à Vienne notamment sur des dossiers aussi sensible que la problématique de l'armement nucléaire en Iran, l'autorité a pu considérer qu'elle ne pouvait laisser le poste de Vienne dans une situation difficile et sans chef de poste. La désignation d'un chef de poste dans de telles conditions justifie le recours à l'urgence". (p.480 - leçon 15)
(17) Avis SLCE - décret affaire Arena
Les articles 37, 107, alinéa 2 de la Constitution ainsi que l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles créent une compétence réservée aux bénéfices du pouvoir exécutif. Autrement dit, le législateur ne peut s'immiscer dans son exercice. Le cabinet ministériel étant intimement lié au fonctionnement des organes gouvernementaux, il appartient à ceux-ci, à l'exception du législateur, d'en régler le fonctionnement. Cette question se pose, en décembre 2004, lors de la mise en cause de Maria Arena, Ministre-Présidente du gouvernement de la Communauté française à la suite des dépenses d'aménagement effectuées au sein de son cabinet. Des parlementaires de l'opposition proposent l'adoption d'un décret visant à opérer un contrôle plus strict des cabinets ministériels. Une telle initiative est, cependant, vouée à l'échec. Consultée sur cette initiative, la section de législation du Conseil d'État relève que les "cabinets ministériels sont des institutions dont, en vertu de l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le gouvernement dispose en propre et a ainsi le pouvoir exclusif de régler l'organisation, les missions et le fonctionnement. Contrairement à ce que prévoient les dispositions à l'examen, il n'est donc pas au pouvoir du législateur décrétal de prendre des règles en ce domaine". (p.534 - leçon 17)
(21) Cass., du 05 mai 2011 - réparation en nature + Tribunal de première instance de Bruxelles, du 04 octobre 2013 - réparation en cas de carence réglementaire
Les cours et tribunaux se sont longtemps bornés à allouer des dommages-intérêts, s'interdisant, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, à adresser à l'administration des injonctions positivités ou négatives. Ce principe est partiellement remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1980, qui, après avoir rappelé qu'en matière de responsabilité, le principe est celui de la réparation en nature, précise que "les cours et tribunaux ne s'immiscent pas dans l'exercice des pouvoirs légalement conférés à l'autorité administrative lorsqu'aux fins de rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée, ils ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à l'administration des mesures destinées à mettre fin à l'illégalité dommageable". Ce principe n'est plus aujourd'hui remis en cause. Ainsi, par exemple, dans un arrêt du 05 mai 2011, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel de Liège a, à bon droit, condamné la Ville de Namur à réparer en nature le dommage subi par un sculpteur du fait de la détérioration irréversible de son oeuvre. Ce dernier obtient, en effet, la condition de la Ville à lui commander une reproduction en bronze de son oeuvre initiale et à la placer à proximité du casino, soit dans un lieu public équivalent à celui où elle se situait antérieurement. A la suite d'un incendie d'une aile du casino de Namur et des travaux qui s'en étaient suivis, l'oeuvre monumentale de l'auteur, réalisée en pierre de France et intitulée Sambre et Meuse, avait été fracturée, réparée grossièrement et repeinte. Elle avait été retrouvée par l'auteur dans le jardin du père de l'entrepreneur chargé des travaux consécutifs à l'incendie. La cour d'appel avait constaté qu'il était gravement portée atteinte au droit moral du sculpteur, que son oeuvre ne pouvait être restaurée et que sa reproduction en bronze se justifiait parce que le bronze est à la fois moins couteux et pus aisé à entretenir que le matériau d'origine. Cependant, en l'état actuel de la jurisprudence, la réparation en nature n'est pas admise lorsque le pouvoir exécutif engage sa responsabilité pour carence réglementaire. Ainsi, par exemple, le Tribunal de première instance de Bruxelles refuse de condamner l'Etat, sous peine d'astreinte, à prendre après 8 ans d'inertie, des arrêtés d'exécution d'une loi, créant des instances de recours contre des mesures prises à l'encontre de détenus par l'administration pénitentiaire. Il estime que compte tenu de la marge de manoeuvre laissée par le législateur au pouvoir exécutif, la condamnation sous astreinte de l'Etat belge à mettre en vigueur les dispositions litigieuses porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Cette jurisprudence n'est pas pleinement convaincante. En effet, en condamnant l'Etat à exécuter une loi après 8 ans d'inertie, le juge ordonnerait qu'il soit mis fin à l'illégalité dommageable et ne déterminerait en rien la manière dont cette exécution doit être opérée. Il ne fixerait en rien le contenu des arrêtés d'exécution, et ne porterait pas atteinte ainsi à son pouvoir discrétionnaire, mais imposerait simplement leur existence. Ce faisant, il ne violerait pas la séparation des pouvoirs. Mieux, il la garantirait en permettant à l'oeuvre législative d'avoir un effet utile, lequel est compromis par l'inertie du pouvoir exécutif. (p.692 - leçon 21)
(29) CC 33/2001, du 13 mars 2001 - assurance soins, compétence territoriale
Les législateurs communautaires doivent faire preuve d'une grande prudence lorsqu'ils prennent des normes applicables sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Tout d'abord, ils doivent S'ABSTENIR D'IMPOSER DIRECTEMENT DES OBLIGATIONS AUX CITOYENS. Une norme communautaire ne sera admissible que pour autant qu'elle ait POUR DESTINATAIRE UNE INSTITUTION et que les citoyens bruxellois ne soient pas soumis directement à son application. Ce principe a été rappelé avec force par la Cour constitutionnelle concernant le décret flamand relatif à l'assurance soins. La Cour relève qu'il "s'ensuit que les disposition du décret s'appliquent obligatoirement aux caisses établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répondent à la définition donnée à l'article 128, §2, de la Constitution mais que les obligations qui incombent aux personnes domiciliées dans cette région auront pour cause leur décision libre de s'affilier à une telle caisse et qu'elles ne seront tenues de les respecter qu'aussi longtemps qu'elles resteront affiliées". Ensuite, les législateurs communautaires doivent veiller à ne pas confondre les critères de l'organisation et de l'activité, applicables respectivement dans le domaine des matières personnalisables et dans le domaine culturel. (p.939 - leçon 29)
(18) CC 3/2001, du 25 janvier 2001 - Conseil Supérieur de la Justice
Les similitudes qui caractérisent la composition de nos trois juridictions suprêmes témoignent du fait que la parité linguistique n'est PAS UNE PROCÉDURE INHÉRENTE AU PROCESSUS DE FÉDÉRALISATION, mais bien une technique visant à prendre en compte la division du pays en deux grandes communautés linguistiques et culturelles. Par rapport à la logique fédérale, la parité linguistique a un effet simplificateur et réducteur. Elle ne permet pas une reconnaissance, en tant que telle, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale et, surtout, compromet toute représentation des Germanophones au sein des structures qu'elle régit. Force est de constater que ceci ne semble pas soulever, aux yeux mêmes de la Cour, d'objection de constitutionnalité. En effet, elle a été appelée à connaître d'un recours dirigé contre la composition du Conseil Supérieur de la Justice, laquelle obéit également à la parité linguistique. Elle considère que ce type de composition ne méconnait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle indique qu'en fait, les magistrats germanophones connaissent le français parce qu'ils ont du obtenir leur diplôme en français. Elle se réfère également aux législations relatives à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat qui comprennent des dispositions similaires et estime, en conséquence, que le législateur "a pu raisonnablement considérer qu'il convenait de prendre, à l'égard du Conseil supérieur, une disposition comparable à celles qui s'appliquent aux 3 juridictions supérieures dont la compétence territoriale s'étend à toute la Belgique". (p.549 - leçon 18)
(15) CE 141.188, du 24 février 2005 - Meulemeester et Ville de Charleroi, affaires courantes + CE 166.925, du 18 janvier 2007 - Meulemeester et Ville de Charleroi, affaires courantes
Longtemps, le Conseil d'Etat s'est déclaré incompétent pour sanctionner un gouvernement qui a pris un acte administratif qui excède le cadre des affaires courantes. Dans un arrêt du 14 juillet 1975, il modifie sa jurisprudence et annule un arrêté royal du 18 janvier 1983 qui fixait les cadres linguistiques de la C.G.E.R. Il est remarquable que l'obligation de fixer ceux-ci s'imposait au gouvernement depuis 1966. Le Conseil d'Etat a relevé qu'il n'apparaissait pas "que cette nécessité fut devenue, en janvier 1973, impérieuse et urgente au point de mettre en péril la continuité du service public s'il n'y était pas immédiatement pourvu". Progressivement, cette jurisprudence a été affinée au point qu'aujourd'hui, le Conseil d'Etat distingue les AFFAIRES COURANTES et les AFFAIRES DE GOUVERNEMENT. Dans l'arrêt Meulemeester et Ville de Charleroi où il est reproché au gouvernement wallon, alors démissionnaire, d'avoir délivré un permis d'environnement, le Conseil d'Etat relève que "lorsqu'un gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses pouvoirs dans la période où il échappe au contrôle des assemblées élues, il peut uniquement expédier ce qu'on appelle 'les affaires courantes' " et "que CETTE NOTION S'OPPOSE À CELLE 'D'AFFAIRE DE GOUVERNEMENT', QUI CONCERNE DES AFFAIRES IMPLIQUANT DES OPTIONS DONT L'IMPORTANCE SUR LE PLAN DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE ES PAR ESSENCE TELLE QUE CES AFFAIRES NE POURRAIENT ÊTRE DÉCIDÉES QUE PAR UN GOUVERNEMENT QUI A L'APPUI DU PARLEMENT ET QUI RISQUE DE PERDRE CET APPUI EN RAISON DE LA DÉCISION QU'IL A PRISE". Il constate cependant "qu'en l'espèce, le dossier n'a qu'une dimension locale et ne paraît pas présenter un enjeu électoral régional". Le Conseil d'Etat constate "qu'en tout cas, le requérant ne démontre pas en quoi la décision attaquée revêtirait un tel enjeu" et "que le fait que le projet ait suscité de nombreuses oppositions et ait reçu l'avis défavorable de la commune sur le territoire sur laquelle il est destiné à s'implanter ne le fait pas enter dans la catégorie des affaires de gouvernement". La jurisprudence du Conseil d'Etat permet de distinguer 3 catégories d'affaires courantes : les affaires qui relèvent de la gestion quotidienne des affaires publiques, les affaires en cours qui constituent l'aboutissement normal de procédures entamées avant la démission du gouvernement, et les affaires urgentes. (p.478 - leçon 15)
(18) CC 124/2010, du 28 octobre 2010 - loyauté fédérale, inspection + CC 95/2010, du 29 juillet 2010 - loyauté fédérale, inspection + CC 7/2012, du 18 janvier 2012 - loyauté fédérale, écoles flamandes de Bruxelles
Lors de la 6eme réforme de l'État, le législateur spécial a incorporé l'article 143 §1 de la Constitution dans les normes de contrôle afin de permettre à la Cour de veiller au respect de la loyauté fédérale. Il lui appartient donc de "vérifier si un législateur a, par son intervention, rendu par l'exercice des compétences des autres législateurs impossible ou exagérément difficile". Ce faisant, le législateur spécial confère à la juridiction constitutionnelle une faculté dont elle usait déjà. La loyauté fédérale (inspirée de la notion de BUNDESTREUE bien connue de la jurisprudence constitutionnelle allemande) est un concept proche de la notion D'ABUS DE DROIT. Originellement, le constituant avait entendu interdire toute intervention de la Cour constitutionnelle en la matière. Il appartenait exclusivement au Sénat de veiller au respect de ce principe. Cependant, dans un premier temps, notamment par référence au principe de proportionnalité, la Cour constitutionnelle n'a pas hésité à sanctionner les abus de droit se rendrait coupable une assemblée législatives. Ensuite, en 2010, elle se réfère expressément au PRINCIPE DE LA LOYAUTÉ FÉDÉRALE, à propos d'un décret de la Communauté flamande qui visait à confier aux services d'inspection de la Communauté flamande bien, et non plus à ceux de la française, le soin de contrôler les écoles francophones situées dans les communes à statut linguistique spécial de la périphérie bruxelloise. À cette occasion, elle indique que : "aux termes de l'article 143, §1, de la Constitution, dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'État fédéral, les Communautés, les Régions et la commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale". Elle ajoute que "le principe de loyauté fédérale, selon les travaux préparatoires de cet article de la Constitution, implique, pour l'autorité fédérale et pour les entités fédérées, l'obligation de ne pas perturber l'équilibre de la Constitution fédérale dans son ensemble, lorsqu'elles exercent leurs compétences". Elle en conclut que le principe "concerne plus le simple exercice des compétences : il indique dans quel esprit cela doit se faire". Appliquant ces principes, elle constate que le nombre d'élèves fréquentant les écoles francophones de la périphérie poursuivent leurs études dans des écoles de la Communauté française et que leurs pouvoirs organisateur peuvent solliciter de la Communauté flamande de dérogations aux règles relatives au programme d'étude. Dès lors, à son estime, serait "incompatible avec le principe de loyauté fédérale (...), la mesure par laquelle le Gouvernement flamand retirerait l'agrément, ou mettrait fin au financement ou au subventionnement d'une école francophone d'une commune périphérique qui aurait introduit une demande de dérogation et approuvé le programme d'études et tant que le Parlement flamand n'a pas confirmé la décision du Gouvernement flamand relative à la demande de dérogation". La Cour considère donc que le principe de la loyauté fédérale contraint les autorités flamandes à permettre une adaptation des programmes d'études pour les élèves qui fréquentent les écoles primaires francophones de la périphérie bruxelloise de telle manière qu'ils puissent poursuivre, sans désagrément, leurs études dans l'enseignement secondaire de la Communauté française. Par contre, dans une autre affaire, la Cour considère que le législateur flamand ne méconnaît pas la loyauté fédérale en instituant un droit de priorité dans les écoles néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale au bénéfice des enfants dont les parents sont capables d'apporter la preuve de l'usage du néerlandais dans le milieu familial. La Communauté française soutient que ce système aboutit, "mathématiquement, à faire peser une charge supplémentaire sur l'enseignement francophone à Bruxelles, alors que l'offre y est aussi insuffisante et que les élèves allochtones, que la disposition attaquée empêche d'accéder à l'enseignement néerlandophone, peuvent conduire à mettre en péril l'équilibre de certaines classes de l'enseignement francophone". La Cour constate que "elle nombre de places disponibles dans l'enseignement est, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, insuffisant tant en ce qui concerne l'enseignement francophone qu'en ce qui concerne l'enseignement néerlandophone" et que "le législateur décréta ne manque pas à la loyauté fédérale en cherchant à résoudre, à défaut de concertation entre les autorités concernées, les difficultés auxquelles se heurtent les établissements qui relèvent de sa compétence". (p.567 - leçon 18)
(13) Référé Bruxelles, du 30 janvier et du 05 février 1997 - Doutrèwe, mesures de contrainte
Lors des travaux de la commission de la Chambre relative aux disparitions d'enfants, deux témoins sont invités, devant les caméras de la télévision, à remettre leurs notes personnelles au président de la commission. Une telle démarche s'apparente à une saisie et nécessite dès lors l'intervention d'un magistrat. Ceci est confirmé par le président du Tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé, lequel relève à propos de la saisie des notes personnelles de Martine Doutrèwe "que la lecture contenu de ces notes ou tout au moins des notes publiées dans l'article litigieux fait bien apparaître que madame Martine Doutrèwe n'envisageait pas de remettre celles-ci lorsqu'elle fût appelée à témoigner devant la commission d'enquête parlementaire (...) ; que la contrainte à les remettre, telle qu'alléguée par madame Doutrèwe, apparaît dès lors vraisemblable ; que les conditions dans lesquelles a eu lieu cette prise de documents est à mettre en relation avec des paroles rappelées à chaque témoin, avant son audition (n.d.a : le droit du témoin de ne pas témoigner contre lui même), concernant sa défense ; qu'il y a dès lors comme le soutien madame Doutrèwe, apparence d'irrégularités". L'interdiction faite par la même commission aux témoins de quitter l'enceinte du Parlement et même d'y circuler librement revêt également un caractère irrégulier, toute privation de liberté supposant l'intervention d'un magistrat". (p.413 - leçon 13)
(3) Problématique de la révision de la Constitution en 1968 sous le gouvernement Vanden Boeynants
Lorsque chacune des chambres a voté la déclaration de révision, le Roi fait, à son tour, une déclaration semblable, laquelle est évidemment contresignée par un ou plusieurs ministres. Une question particulière se pose cependant. Un gouvernement démissionnaire peut-il contresigner une déclaration de révision de la Constitution ? La question se pose, pour la première fois, en 1968. Les chambres élus en 1965 sont constituantes, mais n'ont pu réviser que 2 articles d'importance secondaire. ne pouvait s'accorder sur le sort de l'Université francophone de Louvain, le gouvernement dirigé par Paul Vanden Boeynants démissionne. Si les chambres ont conservé la plénitude de leurs attributions et peuvent incontestablement entamer le processus de révision, en est-il de même pour le Roi, dont l'intervention est indispensable ? Le Sénat estime que rien n'empêche le Roi de faire une déclaration de révision sous le contreseing d'un ministre démissionnaire. La Chambre, par contre, considère qu'un ministre démissionnaire ne peut donner son contreseing à une déclaration de révision qui porterait sur des nouvelles dispositions constitutionnelles. La compétence du Roi agissant sous le contreseing d'un ministre démissionnaire se limite, à son sens, à procéder à une déclaration reproduisant textuellement celle de 1965. Cette seconde solution est retenue. (p.92 - leçon 3)
(6) Consultation populaire de 1950 sur la question royale
On ne peut évoquer la question du référendum en Belgique sans se référer à la loi du 11 février 1950 qui institue une consultation populaire au sujet de la question royale. Les citoyens sont interrogés sur la question de savoir s'ils sont d'avis "que le Roi Léopold III reprenne l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels". 57,68% des votants répondent par oui à cette question. Cependant, si en Flandre, 72,2% d'entre eux souhaitent le retour du Roi, ils ne sont que 48,16% dans l'arrondissement de Bruxelles et 42% en Wallonie. Les chambres constatent alors la fin de l'impossibilité de régner du Roi, mais quelques jours plus tard, celui-ci, tirant les leçons du scrutin et anticipant en quelque sorte les règles de la démocratie fédérale, s'efface. Le référendum de 1950 est une consultation populaire d'option. Le pouvoir législatif demande au corps électoral de porter un jugement sur le chef de l'Etat et sur l'opportunité de le voir reprendre l'exercice de ses fonctions. La constitutionnalité de cette initiative est plus que douteuse. Tout d'abord, elle a, par nature, un caractère décisoire. En effet, il est illusoire d'affirmer qu'après avoir procédé à la consultation, le pouvoir législatif pouvait ignorer la voie tracée par la majorité des citoyens. Ensuite, et plus fondamentalement, elle crée un débat politique sur la personne royale, impliquant que chaque citoyen belge prenne attitude sur sa conduite et porte un jugement de valeur sur les actes et opinions qui ont été les siens pendant la guerre. Or, constitutionnellement, le Roi étant inviolable et irresponsable, sa personne doit demeurer en dehors du débat politique. Il n'est donc pas concevable d'organiser à son égard une forme de plébiscite, ce qu'était à l'évidence la consultation populaire de 1950. (p.192 - leçon 6)
(5) Cour d'appel de Gand, du 19 novembre 2015 - portée de l'article 159 de la Constitution
On notera cependant un intéressant arrêt de la Cour d'appel de Gand du 19 novembre 2015 qui tempère la position prise par la Cour de cassation. La cour d'appel estime que, "nonobstant la portée de l'article 159 de la Constitution, lorsqu'une demande portée devant une juridiction judiciaire et une demande qui avait été traitée par le Conseil d'Etat ont le même objet, il doit être admis que constitue un principe général de droit le fait qu'un arrêt de rejet du Conseil d'Etat ait autorité de chose jugée, cette règle ne se limitant pas aux effets d'un arrêt d'annulation". L'arrêt ajoute que "la possibilité pour les justifiables, après que le Conseil d'Etat a rejeté leurs moyens visant à l'annulation d'un acte administration individuel, d'encore se diriger vers les cours et tribunaux pour soumettre à nouveau les mêmes moyens à ce juge, afin d'obtenir que ce même acte administratif individuel soit déclaré irrégulier et ne puisse pas être appliqué, est contraire à la sécurité juridique, la cohérence et l'économie procédurale, qui peuvent et doivent être attendues d'un appareil judiciaire étatique fonctionnant correctement". (p.170 - leçon 5)
(17) Cass., du 03 mai 1974 - Le Compte, pouvoirs spéciaux
Par l'arrêt Le Compte, la Cour de cassation met fin à toutes controverses en la matière. Elle se fonde sur la DISTINCTION entre le pouvoir réglementaire D'EXÉCUTION et le pouvoir réglementaire D'ATTRIBUTION qui trouve sa source dans L'ARTICLE 105 DE LA CONSTITUTION, aux termes duquel "le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et LES LOIS PARTICULIÈRES PORTÉES EN VERTU DE LA CONSTITUTION MÊME". La Cour de cassation considère qu'une loi particulière, prise ne vertu de la Constitution, peut étendre le pouvoir réglementaire du Roi au-delà des limites fixées par l'article 108. Une loi d'habilitation n'est, toutefois, conforme à la Constitution que si elle n'attribue au Roi des pouvoirs résiduels, c'est-à-dire des pouvoirs que la loi fondamentale n'a pas réservés au législateur. Sont, en principe, inconstitutionnelles, les lois des pouvoirs spéciaux qui autorisent le Roi à modifier ou compléter la législation relative aux impôts, alors que les articles 170 et 171 réservent expressément cette matière au pouvoir législatif. La Cour constitutionnelle n'a pas manqué de nuancer fortement cette affirmation. Par ailleurs, un décret ou une ordonnance peut, dans le respect des principes applicables au niveau fédéral, habiliter le gouvernement régional ou communautaire à prendre, dans les limites des compétences de l'entité fédérée concernée, des arrêtés de pouvoirs spéciaux, et cela, même si cette terminologie semble usitée exclusivement au niveau fédéral. (p.531 - leçon 17)
(8) CC 30/2003, du 26 février 2003 - BHV, suspension
Par son arrêt n°30/2003, la Cour constitutionnelle suspend nombre de dispositions de la loi du 13 décembre 2002 qui concernent la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Elle retient, à ce stade de son examen, le grief des requérants relatif à la violation des articles 10 et 11 combinés avec l'article 63 de la Constitution, en vertu duquel "chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 150". Elle fait grief au législateur d'opérer une répartition des sièges par l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain non pas en fonction du chiffre de la population, comme le prescrit l'article 63 de la Constitution, mais en fonction du comportement électoral, ce qui aurait pour effet que le nombre de 7 sièges constitutionnellement fixé pour la circonscription électorale de Louvain ne serait pas garanti. Elle n'a donc pas égard à la position du Gouvernement fédéral consistant à faire comme si Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain constituaient une seule circonscription électorale en vue de la répartition des sièges entre les candidats néerlandophones, dans la mesure où ceci n'est, selon elle, pas conciliable avec la décision, prise par le législateur lui-même, d'établir deux circonscriptions électorales distinctes. La création, pour les listes néerlandophones, d'un territoire électoral formé de deux circonscriptions est donc suspendue. Il en est résulté que les élections du 18 mai 2003 ont été organisées sur l'ensemble du territoire nationale sur la base de circonscriptions provinciales, à l'exception de l'ancien territoire de la province de Brabant où elles ont été organisées sur la base des règles anciennes. (p.241 - leçon 8)
(23) CE 225.602, du 26 novembre 2013 - Berquin, pouvoirs du Roi
Un arrêt du Conseil d'Etat mérite une attention particulière. Il est fait reproche au ministre de la Défense nationale d'avoir refusé d'exonérer un ancien militaire du remboursement des frais de formation engagés pour son compte par la Défense nationale. Dès lors que la décision d'accorder cette exonération appartient, en vertu de la loi, au Roi, le requérant considérait que le refus qui lui était opposé devait être décidé par la même autorité. Le Conseil d'Etat fait droit à sa demande et indique que "le pouvoir d'autoriser a pour corollaire celui de refuser, et inversement ; que l'autorité à laquelle le pouvoir été confié doit être en mesure de l'exercer pleinement, ce qui ne lui est pas possible si une partie seulement des cas d'application sont portés à sa connaissance ; que même si le Roi agit sur la proposition d'un ministre, il n'en reste pas moins qu'il dispose constitutionnellement d'un pouvoir propre, raisonner autrement reviendrait à modifier l'ordre constitutionnel des compétences et à ne plus reconnaître au Roi qu'un rôle purement protocolaire". Cette décision laisse perplexe. Il est hors de doute que l'acte attaqué était irrégulier dès lors qu'il devait prendre la forme d'un arrêté royal. Par contre, affirmer que le Roi dispose d'un POUVOIR PROPRE est inexact en droit. En effet, il dispose simplement de PREROGATIVES. Or, précisément, ce sont l'existence de celles-ci qui, outre le rôle du Roi dans la formation des gouvernements, distinguent le système belge des monarchies protocolaires. Le Conseil d'Etat aurait donc mieux fait de motiver sa décision en indiquant qu'en s'abstenant de prendre sa décision sous la forme d'un arrêté royal, l'Etat belge a privé le Roi de la faculté d'exercer, dans le cadre du colloque constitutionnel, les prérogatives qui sont les siennes. (p.778 - leçon 23)
(14) CE 217.984, du 14 février 2012 - Youlal, cabinets ministériels + CE 22.198, du 13 janvier 2013 - Youlal, cabinets ministériels
Une affaire Youlal permet encore de préciser les exigences du Conseil d'État dans ce domaine. Asmaé Youlal travaillait au cabinet d'une ministre de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est mis fin une première fois à ses fonctions par une décision dépourvue de motivation. Cette décision est annulée par le Conseil d'État. Celui-ci admet qu'en "ce qui concerne les membres de cabinets ministériels, la rupture du lien de confiance n'est pas nécessairement fondée sur des faits précis et, par conséquent, peut être impossible a objectiver, ce qui réduira forcément la motivation formelle de l'acte mettant un terme aux fonctions d'un collaborateur personnel du ministre à une formule stéréotypée". Il ajoute cependant que "la décision ne comportant aucune motivation formelle, fut-elle succincte ou stéréotypée (...), la requérante a pu effectivement douter des raisons pour lesquels il était mis fin à ses fonctions". L'autorité reprend sa décision et consigne dans un courrier circonstancié tous les manquements qui lui sont reprochés, soit un manque de maîtrise des dossiers et des contrats difficiles avec certains de ses interlocuteurs. À nouveau saisi par l'intéressée, le Conseil d'État annule cette deuxième décision. Il rappelle que "lorsque une autorité administrative se propose de prendre à l'égard d'un membre de son personnel, en raison de son comportement, une mesure grave, telle un licenciement, elle doit, en vertu du principe audi alteram partem, l'en informer au préalable, lui indiquer les griefs qui lui sont faits, lui donner connaissance des éléments sur lesquels elle se fonde et lui permettre de s'expliquer ; que le respect du principe audi alteram partem implique également que l'agent ait accès au dossier rassemblant toutes les pièces sur lesquelles l'autorité administrative entend se fonder". Or, en l'espèce, même si Asmaé Youlal a été reçue par la ministre et son chef de cabinet et qu'à cette occasion elle a pu débattre des reproches qui lui étaient faits, elle n'était pas pleinement informée de la réalité de ceux-ci puisque le lendemain, par courrier électronique, elle a encore sollicité des explications à leur propos. (p. 436 - leçon 14)
(17) CE 227.775, du 20 juin 2014 - Caprasse, circulaires Peeters + CE 227.776, du 20 juin 2014 - Thiéry, circulaires Peeters
Véronique Caprasse, invoquant l'article 1382 du Code civil, estime avoir subi un dommage consécutif au refus de la Région de la nommer en qualité de bourgmestre de Crainhem, précisément parce que qu'elle ne s'était pas engagée à respecter l'interprétation flamande de la législation linguistique. Le ministre en avait déduit qu'elle n'avait pas les qualités morales nécessaires pour exercer la fonction. Le Tribunal de première instance de Bruxelles, se fondant notamment sur l'arrêt précité de la Cour d'appel de Mons, constate que la Région flamande n'est pas fondée à livrer une interprétation authentique de la législation linguistique fédérale et rappelle que les arrêts de rejet du Conseil d'État n'ont pas autorité absolue de chose jugée. En conséquence, il condamne la Région flamande à payer d'importants dommages et intérêts à l'intéressée. Ce débat trouve sans doute son épilogue dans des arrêts rendus par l'assemblée générale de la section contentieux administratif du Conseil d'Etat dans le cadre de la délicate question de nomination de certains bourgmestres de communes à statut linguistique spécial de la périphérie bruxelloise. Cette juridiction, paritaire sur le plan linguistique, est appelée à déterminer si il peut être reproché à des bourgmestres d'avoir refusé de faire application de la circulaire Peeters. Elle constate, d'une part, que l'interprétation de la loi sur l'emploi des langues, selon laquelle il suffirait que dans les communes périphériques, les particuliers qui expriment le souhait que le français soit utilisé dans leur relation avec l'autorité communale, reçoivent automatiquement à nouveau les documents en français par la suite jusqu'à la fin de leurs jours, n'est pas conciliable avec la primauté du néerlandais dans la Région de langue néerlandaise. D'autre part, elle observe que l'interprétation qui consiste à exiger d'un particulier une démarche spécifique chaque fois qu'il souhaite bénéficier de l'usage du français restreint de manière disproportionnée les droits garantis par la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Afin de respecter à la fois la primauté du néerlandais dans la Région unilingue néerlandaise et les droits garantis aux particuliers par la loi sur l'emploi des langues, l'assemblée générale estime que celui qui souhaite être servi en français doit exprimer son souhait au moyen d'une lettre qu'il envoie ou dépose à l'administration communale. Ce choix vaut pour une période raisonnable, à savoir 4 ans, et renouvelable. En outre, le particulier peut, lors d'un contact verbal ponctuel ou relativement à un document déterminé, toujours solliciter l'usage du français. (p.529 - leçon 17)